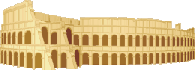LA FIN DU
LIVRE DEUXIÈME — Le christianisme et l’éducation romaine
CHAPITRE II — COMMENT LE CHRISTIANISME S’ACCOMMODA DE L’ÉDUCATION ROMAINE.
— I —Répugnance des chrétiens pour une éducation toute païenne. - Opinion de Tertullien. - Il permet ans jeunes gens de fréquenter les écoles. - Les professeurs chrétiens. - Édit de Julien qui leur interdit l’enseignement. J’ai tenu à montrer longuement et en grand détail l’importance que l’éducation avait prise dans la société romaine de l’empire pour qu’on pût comprendre les embarras qu’elle allait causer au christianisme. Était-il possible à un chrétien pieux de s’en accommoder ? C’est une question qu’on ne devait guère se poser dans les premières années, car ceux auxquels le christianisme s’adressa d’abord se préoccupaient fort peu de la grammaire et de la rhétorique. Mais, avec le temps, il pénétra dans les classes plus élevées de la société, où l’instruction était en grand honneur ; et alors, quand il arrivait que ces gens du monde, qu’il venait de gagner à ses doctrines, avaient des enfants, en âge d’être envoyés dans les écoles, on peut croire qu’ils devaient éprouvai de grandes perplexités. Les écoles étaient toutes païennes. Non seulement on célébrait régulièrement les cérémonies du culte officiel, surtout les fêtes de Minerve, qui était la patronne des maîtres et des écoliers, mais on y apprenait à lire dans des livres tout pleins de la vieille mythologie. L’enfant chrétien y faisait connaissance avec les dieux de l’Olympe. Il était exposé à y prendre des impressions contraires à celles qu’il recevait dans sa famille. Ces fables qu’on lui apprenait à détester chez lui, il les entendait tous les jours expliquer, commenter, admirer par ses maîtres. Était-il convenable de le placer ainsi entre des enseignements opposés ? Que fallait-il faire pour qu’il fût élevé comme tout le monde sans courir le risque de perdre sa foi ? Tertullien se le demande, dans son traité de l’Idolâtrie, et il ne trouve pas grand chose à répondre. Quand il s’agit du maître, il n’hésite pas. Un professeur, nous dit-il, est obligé de fêter Minerve aux Quinquatries, de fleurir son école quand viennent les jours consacrés à Flore, et ce serait un crime pour lui de s’abstenir d’aucune de ces cérémonies diaboliques. Pour faire comprendre aux élèves les récits des poètes, il faut qu’il leur raconte l’histoire scandaleuse de l’Olympe, qu’il leur explique les attributions des dieux et qu’il déroule devant eux toute leur généalogie ; c’est ce qui d’aucune façon ne saurait convenir à un chrétien ; un chrétien ne sera donc pas professeur. Peut-il au moins être élève ? Il semble que Tertullien, pour rester fidèle à lui-même, n’aurait pas dû le permettre. L’enseignement qu’un maître ne peut pas donner sans crime, comment un élève pourrait-il le recevoir sans danger ? Si ces noms de dieu et de déesses souillent la bouche qui les prononce, est-il possible qu’ils ne blessent pas l’oreille qui les entend ? Mais ici, contre son ordinaire, ce logicien impitoyable ne pousse pas son opinion jusqu’au bout. Il s’arrête au milieu du chemin, et souffre chez l’élève ce qu’il a défendu au professeur. C’est qu’il ne lui parait pas possible qu’on empêche un jeune homme d’aller à l’école, et la raison qu’il en donne mérite d’être rapportée. Comment, dit-il[1], se formerait-il sans cela à la sagesse humaine ? Comment apprendrait-il à diriger ses pensées et ses actions, l’éducation étant un instrument indispensable pour l’homme pendant toute sa vie ? Ainsi ce sectaire scrupuleux, à qui toutes les professions étaient suspectes, et qui voudrait enfermer le chrétien chez lui, pour le tenir loin d’un monde empesté d’idolâtrie, n’ose pas l’arrêter au seuil de l’école, quoiqu’il en connaisse les dangers. C’est une nécessité qu’il ne subit qu’à regret, mais à laquelle il lui parait impossible de se soustraire. U n’imaginait pas qu’un jeune homme pût se passer d’apprendre les lettres humaines, ni qu’on pût les enseigner autrement qu’on le faisait de son temps. Du moment qu’un docteur si rigoureux autorisait les jeunes gens à fréquenter les écoles, on pense bien que personne ne s’avisa de le leur défendre. Seulement ses recommandations ne furent suivies qu’en partie. On l’écouta, lorsqu’il disait qu’un chrétien peut étudier les lettres profanes ; on lui désobéit, quand il lui défendait de les enseigner. Non seulement l’Église permit aux professeurs de ne pas quitter leurs chaires, mais elle les encouragea même à les garder. Elle y trouvait son compte, et il lui semblait avec raison qu’un enseignement, qui lui était à bon droit suspect, présentait moins de dangers, s’il était donné par un chrétien. Vers la fin du IIIe siècle, le christianisme avait fait des conquêtes nombreuses parmi les lettrés. On trouve chez nous, dit Arnobe avec orgueil[2], beaucoup de gens de talent, des orateurs, des grammairiens, des professeurs d’éloquence, des jurisconsultes, des médecins et de profonds philosophes. Arnobe lui-même était un rhéteur célèbre de l’Afrique, et son disciple Lactance fut appelé à Nicomédie, où résidait alors l’empereur, pour y enseigner la rhétorique latine. Comme le christianisme a toujours attiré de préférence les plus humbles, il est vraisemblable que les maîtres élémentaires (primi magistri) étaient venus à lui en plus grand nombre encore et plus tôt que les rhéteurs. On a trouvé aux catacombes l’inscription, d’un primus magister Oui s’appelait Gorgonus ; M. de Rossi la rapporte au IIIe siècle[3]. Prudence raconte qu’en passant à Forum Cornelii (Imola), il vit, dans l’église un tableau qui lui sembla fort curieux, et qu’il en demanda l’explication au sacristain. Ce tableau représentait le martyre d’un de ces maîtres modestes, Cassianus, qui, devenu chrétien, fut mis à mort dans l’une des persécutions. Cassianus était notarius, ce qui veut dire qu’il enseignait la sténographie, un art dont on faisait un grand usage dans cette monarchie administrative et paperassière. Ses élèves ne l’aimaient pas, parce qu’il était dur pour eux et qu’il les avait quelquefois privés de congé[4]. Les bourreaux ayant imaginé de le leur abandonner, ils se vengèrent de lui en le perçant de ces poinçons de fer qui leur servaient pour écrire. Le poète, qui a le goût de l’horrible, nous les montre heureux de labourer de leur stylus ce corps misérable, d’exercer sur sa chair le talent qu’il leur avait donné, et il semble prendre plaisir à nous redire les plaisanteries inhumaines dont tout ce petit monde cruel assaisonne sa vengeance. Au moment de la conversion de Constantin, il y eut, suivant l’expression de saint Augustin, toute une cohue de païens qui se précipita dans la religion nouvelle. Il est naturel qu’alors le nombre des chrétiens ait augmenté parmi les professeurs, comme dans tous les métiers. Les partisans de l’ancien culte devaient en être fort alarmés. Ils regardaient l’école comme un des derniers asiles de leur religion, et ils purent craindre qu’elle ne fût bientôt envahie par le christianisme. C’est ce qui fait comprendre le fameux édit de Julien, dont nous avons parlé plus haut, qui défendait aux professeurs chrétiens de lire, dans leurs classes, et de commenter des auteurs dont ils ne partageaient pas les croyances. C’était en réalité leur interdire l’enseignement. Le maître alors ne pouvait rien sans le livre ; on ne disait pas d’un grammairien qu’il enseignait, mais qu’il lisait, prælegebat, et sa leçon consistait uniquement à expliquer un passage d’auteur classique, dont il avait d’abord donné lecture à ses élèves. Or les livres dont on se servait dans les classes étaient remplis de paganisme, et le maître chrétien à qui l’on défendait d’en faire usage était réduit à abjurer sa religion ou à quitter l’école. Sans doute il dut s’en trouver quelques-uns qui cédèrent : il leur était si dur de renoncer à un métier dont ils tiraient tant d’honneur et tant de profit ! Mais il y en eut aussi qui tinrent bon. Des grammairiens, des rhéteurs célèbres, Victorinus, en Italie, Musonius et Proérèse, en Orient, descendirent de leur chaire plutôt que de trahir leur foi[5]. — II —Importance du livre dans l’éducation. - Tentative des
Apollinaires. - On revient à l’étude des ouvrages païens. - Pourquoi les
chrétiens n’ont pas l’idée d’étudier la littérature dans les livres saints et
les auteurs ecclésiastiques. - Le traité de La tentative de Julien dut attirer l’attention de l’Église
sur une des conditions essentielles de l’enseignement, dont elle paraît
s’être peu préoccupée jusque-là : elle lui montra l’importance dû livre. Nous
venons de voir que dans l’école on ne se servait que de livres pleins de
paganisme, et que c’était un grand danger pour les jeunes gens qui
professaient d’autres, croyances. A la vérité le maître, quand il était
chrétien, ne les commentait qu’avec mesure et discrétion ; il pouvait, tout
en admirant la forme, glisser quelques réserves à propos du fond, et mettre
ainsi le remède auprès du mal ; mais le mal subsistait toujours. D’ailleurs
il était au pouvoir d’un prince partisan de l’ancien culte de les confisquer
au profit de sa religion, comme venait de le faire Julien, et, en défendant
aux chrétiens de s’en servir, de leur rendre l’enseignement impossible. Il
fallait donc trouver quelque moyen de procurer aux chrétiens des livres dont
on ne pût pas leur enlever l’usage. C’est ce qui fut essayé par, les
Apollinaires, le père et le fils, deux savants hommes, dont l’un était
grammairien, l’autre rhéteur, à Laodicée, en Syrie. Le père traduisait en
vers Aujourd’hui, nous savons apprécier la poésie des récits de
Il ne semble pas qu’on ait été plus juste pour les écrivains latins qui s’étaient donné la tâche, depuis le ne siècle, de défendre et d’expliquer le christianisme, et j’avoue que cette injustice me paraît tout à fait inexcusable. Je ne vois rien qui pût empêcher un chrétien de comprendre leur mérite et de le proclamer. Tertullien, Minucius Félix, saint Cyprien seraient à toutes les époques des orateurs et des polémistes remarquables ; mais à la fin de ce IIIe siècle, si vide de bons écrits, ils devaient tenir les premières places. Lactance est pourtant bien froid pour eux. Il se contente d’appeler Minucius Félix un assez bon avocat (non ignobilis inter causidicos) ; Tertullien lui paraît fort savant, mais il le trouve obscur, embarrassé, rocailleux. Quant à saint Cyprien, il lui semble s’être trop enfermé dans les questions de doctrine et ne pouvoir pas être compris de ceux qui ne partagent pas ses croyances. Il fait malicieusement remarquer que les doctes du siècle se moquent de lui, et il a soin de rapporter leurs railleries, qui sont fort médiocres, sans prendre la peine de le défendre. Il conclut en disant que l’Église a tout à fait manqué de défenseurs habiles et instruits[10], ce qui est vraiment bien sévère. Mais Lactance est un rhéteur, et il a tous les défauts de sa profession. Quand on a passé toute sa vie à recommander la pureté, la correction, l’élégance, c’est-à-dire les petits mérites du style, on devient souvent incapable de voir les grands. On se fait un type de perfection, qui se compose d’absence de défauts plutôt que de qualités réelles, et l’on ne peut plus être sensible à ce qui est original et nouveau. Il est pourtant visible que, vers la fin du IVe siècle, il se
fait un changement dans l’opinion. Saint Jérôme, qui sait l’hébreu et qui a
vécu familièrement avec les livres saints, en apprécie mieux la beauté. Est-il rien, dit-il[11], de plus harmonieux que les psaumes ? Peut-on rien voir qui
soit plus poétique que les beaux endroits du Deutéronome et des
prophètes ? Il est encore plus explicite ailleurs et ménage moins les
louanges. David, dit-il[12], c’est notre Pindare à nous, notre Simonide, notre Alcée,
notre Horace, notre Catulle, notre Sérénus. Voilà des rapprochements
qui devaient causer, chez les beaux esprits du temps, un grand scandale. Pour
les écrivains ecclésiastiques latins, saint Jérôme est plus réservé ; il leur
reproche beaucoup d’imperfections et n’est entièrement satisfait d’aucun
d’eux[13]. Il faut croire
pourtant qu’ils ne lui semblaient pas trop méprisables, puisqu’il a bru
devoir faire pour eux ce qu’avait fait Suétone pour la littérature profane.
Dans le tableau qu’il nous a présenté, sous le titre pompeux de De Viris
illustribus, de tous les chrétiens qui ont écrit ; il parle honorablement
des auteurs latins, et’ il est si cotent de cette longue énumération
d’écrivains de tout âge et de toute qualité, qu’il s’écrie d’un air de
triomphe[14]
: Que Celse, que Porphyre, que Julien, qui ne
cessent d’aboyer contre nous, que leurs sectateurs, qui soutiennent que
l’Église n’a produit ni philosophe, ni orateur ni savant, apprennent quels
sont les hommes qui l’ont fondée, qui l’ont bâtie, qui l’ont ornée, et qu’ils
cessent de prétendre qu’ils n’y a chez nous que des sots et des
rustres ! Mais ce ne sont encore là que des éloges généraux et
vagues ; saint Augustin fait mieux. Le premier, dans son traité de Ce traité est un livre d’éducation ; mais il ne s’adresse pas à tout le monde ; saint Augustin ne veut élever que des clercs. Voilà, dit-il[16], ce que devront faire ceux qui se proposent d’étudier les Écritures et de les enseigner, de défendre la vraie doctrine et de réfuter l’erreur. Son dessein est double : il veut leur apprendre d’abord comment ils arriveront à comprendre eux-mêmes les livres saints, puis de quelle façon ils les feront comprendre aux autres. Pour les comprendre, leur
dit-il[17], on doit passer par trois degrés successifs : le premier
est la crainte, le second la piété, le troisième la science. Cette
science est difficile ; elle demande un travail patient et de longues
préparations. Parmi les études préliminaires qui aident à l’acquérir, saint
Augustin place sans hésiter celles qui se font dans les écoles. Il montre,
par des raisonnements ingénieux, que tout ce qui s’y enseigne, aussi bien la
grammaire, la rhétorique, la dialectique, que l’histoire et les sciences
naturelles, peut servir à l’intelligence des Écritures. Quoique imprégnée de
paganisme, cette éducation trouve grâce devant lui. C’est une sorte de
préparation générale qui étend, qui fortifie l’esprit, et dont profiteront
plus tard d’autres études plus sérieuses. Ii ne veut pas qu’on y renonce à
cause de ses origines profanes. D’où que vienne une vérité, elle est bonne à
prendre : profani si quid bene dixerunt, non
aspernandum[18]. Les ouvrages
des païens contiennent des maximes utiles pour la conduite de la vie ; leurs
philosophes ont entrevu le Dieu véritable, et donné de sages préceptes sur la
manière dont il convient de l’honorer. Ces biens ne leur appartiennent pas ;
ils sont à ceux qui en feront un bon usage. N’est-il pas écrit que les
Israélites, quand ils retournèrent chez eux, enlevèrent les vases d’or des
Égyptiens pour les consacrer au service de leur Dieu ? C’est ainsi qu’ont
fait les plus grands docteurs de l’Église ; ils sont venus à leur foi
nouvelle avec les dépouilles de l’ancienne. De
combien de richesses n’était pas chargé, en sortant de l’Égypte, ce Cyprien,
qui fut un si éloquent évêque et un bienheureux martyr ! Combien en
emportèrent avec eux Lactance, Victorinus, Optat, Hilaire, pour ne pas parler
des vivants ! Combien en ont ravi ces illustres chrétiens de Dans la seconde partie de son livre, saint Augustin se demande comment un clerc qui possède l’intelligence des Écritures pourra la communiquer aux autres. C’est ici surtout qu’il se trouve en présence de l’éducation qu’on donnait dans les écoles de l’empire et qu’il est amené à en dire son sentiment. Le prédicateur ne doit pas se contenter d’instruire ; il faut qu’il plaise et qu’il touche : c’est précisément ce que la rhétorique se pique d’enseigner. Mais convient-il qu’un orateur chrétien se serve de la rhétorique ? Saint Augustin n’éprouve aucun scrupule à le lui conseiller. Puisque c’est un art qu’on emploie tous les jours pour soutenir le mensonge, qui oserait dire qu’il ne faut pas le mettre au service de la vérité ? Ne serait-ce pas une folie de laisser cet avantage à ceux qui propagent les fausses doctrines de charmer et de toucher les gens qui les écoutent ? Le talent de la parole étant à la disposition de tout le monde, des méchants comme des bons, pourquoi les honnêtes gens ne s’appliqueraient-ils pas à l’acquérir, puisque les malhonnêtes s’en servent pour faire triompher l’erreur et l’injustice ?[20] Mais où doit-on chercher la rhétorique ? D’abord dans les écoles où elle s’enseigne. Saint Augustin n’est pas un ennemi de cet enseignement dont il avait été nourri. Il veut seulement qu’on s’y livre quand on est jeune ; plus tard, on aura mieux à faire. Cependant il ne le croit pas tout à fait indispensable, et il indique les moyens de s’en passer. Celui qui a l’esprit pénétrant et vif, nous dit-il[21], deviendra plus facilement éloquent en lisant ou en écoutant parler ceux qui le sont, qu’en s’attachant aux règles des rhéteurs ! D’autres, l’avaient dit avant lui ; mais voici la nouveauté. Les livres qu’il conseille de lire pour se former à l’art de la parole ne sont pas les chefs-d’œuvre classiques ; quelle que soit, leur perfection, il suppose que celui qui se destine au ministère sacré n’a ni le temps ni le goût de les parcourir ; aussi ne veut-il pas l’arracher à l’étude des livres saints qui doit faire désormais l’occupation de sa vie ; mais il prétend qu’ils ne lui apprendront pas seulement la saine doctrine et qu’ils lui enseigneront encore l’éloquence. Il est donc conduit, pour le prouver, à faire voir que ceux qui les ont composés, apôtres ou prophètes, sont de grands écrivains aussi bien que de grands docteurs de la foi, que sans le vouloir et sans le savoir, ils ont respecté ces règles que les rhéteurs font sonner si haut et payer si cher[22], et qu’on peut en trouver des modèles chez eux, comme chez les auteurs profanes. Ce n’est pas une opinion qu’on puisse énoncer sans preuve. Pour en démontrer la vérité, saint Augustin prend un passage du prophète Amos, un pâtre, un conducteur de troupeaux, comme il s’appelle lui-même ; il l’analyse en grammairien subtil, appelant à son aide les souvenirs de son ancien métier. Il y trouve trois périodes de deux membres qui se répondent entre elles, et des images dont la hardiesse et la beauté lui semblent incomparables. Il applique la même méthode aux Épîtres de saint Paul. Il y montre des exemples de cette figuré qu’on appelle, dans les classes, échelle ou gradation, des phrases symétriquement balancées, des périodes à plusieurs membres, enfin tout l’appareil de la rhétorique. Ce n’est pas que saint Paul l’ait jamais apprise ou s’en souciât ; mais l’éloquence étant chose naturelle, ceux à qui le ciel la donne ne savent pas pourquoi ils la possèdent. Quand la sagesse marche devant, l’éloquence la suit comme une fidèle compagne, sans qu’on ait besoin de l’appeler pour qu’elle vienne[23]. De saint Paul, saint Augustin descend aux auteurs ecclésiastiques des derniers siècles. Là, on sent qu’il est plus à l’aise ; il n’a pas d’effort à faire pour trouver chez eux la rhétorique ; quelques-uns l’avaient enseignée, tous l’avaient apprise, et Dème en changeant de religion ils n’étaient pas parvenus à l’oublier. Quelquefois même ils s’en sont trop souvenus. Saint Augustin cite à ce propos un passage de saint, Cyprien, qui lui paraît trop orné et trop travaillé ; mais, comme il n’a plus commis cette faute, il en prend occasion de dire spirituellement : Ce saint homme a montré qu’il était capable de parler ainsi, en le faisant une fois, et qu’if ne le foulait pas, en n’y revenant plus[24]. Il prend ensuite dans ses ouvrages et dans ceux de saint Ambroise des morceaux qui lui semblent des modèles achevés des trois genres d’éloquence ; il montre qu’ils ont su employer, selon les circonstances, n style simple, le style tempéré à le style sublime, et conclut que par l’assiduité qu’on aura à les lire, à les entendre, et en s’exerçant quelquefois à les imiter, on pourra se donner les qualités qu’ils possèdent. — III —Ce qu’on pouvait tirer du traité de Quoique le traité de Il n’ignorait pas pourtant les dangers qu’un chrétien
pouvait courir à trop fréquenter les écoles. Son expérience les lui avait
révélés. Personne n’a jamais été plus touché que lui par le charme des études
mondaines ; on sait qu’elles l’avaient longtemps écarté de la vérité. Aussi
parle-t-il avec colère, dans ses Confessions, de
ce vin d’erreur, versé à une jeunesse ignorante par des maîtres qui s’en sont
eux-mêmes enivrés, et qui menacent leurs élèves pour les obliger de le boire
avec eux. Il s’élève avec force contre ces
habitudes du passé, qui nous entraînent comme un torrent, et finissent par
nous noyer dans une mer de préjugés et de mensonges, dont se sauvent à
grand’peine ceux mêmes qui montent la barque du Christ[26]. Il semble que
la conclusion naturelle de ces invectives aurait été d’interdire à la
jeunesse chrétienne l’étude des lettres profanes ; mais cette conclusion
n’est nulle part dans les oeuvres de saint Augustin. Même dans le passage des
Confessions que je viens de citer, on ne la trouve pas, et l’on a vu
que le traité de Mais s’il paraissait nécessaire de la conserver, ne pouvait-on pas y introduire quelques modifications qui l’auraient rendue moins dangereuse ? Il y en avait une au moins gui semblait facile. Sans doute il ne pouvait pas être question de bannir tout à fait de l’école les auteurs classiques : aurait-on pu comprendre la rhétorique sans Cicéron, et la grammaire sans Virgile[27] ? Mais il n’était pas défendu, pour tempérer le mal de mettre auprès d’eux quelques écrivains ecclésiastiques ; puisque saint Augustin venait de prouver que l’étude en est profitable, et qu’ils pouvaient, eux aussi, fournir des modèles de l’art d’écrire, qui empêchait de les introduire dans les écoles et de leur donner une place à côté de leurs grands devanciers ? Pourquoi n’a-t-on pas essayé alors de le faire ? Je n’y
vois qu’une seule raison, c’est que l’habitude était prise de faire
autrement. Il semble que rien ne coûte plus à un peuple que de réformer son
système d’enseignement. Pour s’y attacher avec tant d’obstination, on a
d’ordinaire quelques bonnes raisons et des motifs moins sérieux. D’un côté il
répugne aux esprits sages, qui savent l’importance de l’éducation, d’en faire
un champ d’expérience et de livrer au hasard de théories aventureuses
l’avenir des jeunes générations. De l’autre, il arrive toujours qu’à mesure
que nous vieillissons le lointain et le regret donnent un grand charme aux
souvenirs de la jeunesse, que tout nous plaît dans nos jeunes années, que
nous n’en voulons rien reprendre, que le respect que nous éprouvons pour ces
maîtres qui nous ont formés sert de défense à leurs méthodes. Ajoutons qu’un
certain contentement de soi, auquel personne n’échappe, nous amène à penser
que ce système d’éducation, qui nous a fait ce que nous sommes, produisait d’assez
bons résultats. Ce qui est sûr, c’est que rien ne fut changé après
l’apparition du traité de Nous possédons à ce sujet les renseignements les plus curieux. Ils nous sont donnés par l’évêque de Pavie, Ennodius, qui fut l’un des lettrés les plus distingués de l’époque de Théodoric. Cet évêque était avant tout un bel esprit, qui ne renonça jamais à la rhétorique, quoiqu’il ait paru prendre congé d’elle avec éclat en se consacrant au saint ministère[28]. Les écoles l’intéressaient beaucoup, et il nous en parle souvent dans ses ouvrages. Nous voyons, par ce qu’il en dit, qu’elles continuaient d’être alors ce qu’elles avaient toujours été. Pourtant la situation était bien différente ; de grands évènements venaient de s’accomplir, un roi barbare régnait à Ravenne, et l’empire d’Occident n’existait plus. Mais rien n’était changé dans les écoles ; les maîtres expliquaient les mêmes auteurs, corrigeaient les mêmes devoirs, enseignaient à leurs élèves à bien écrire et à bien parler, comme s’il s’agissait de parler ou d’écrire en ce moment. Ennodius est d’avis, comme eux, qu’il n’y a rien de plus important que ces exercices. Au moment où la force brutale domine partout, il persiste à proclamer que l’art de la parole est le premier de tous les arts et qu’il doit mener le monde[29]. Il dit aux jeunes gens de bonne naissance qu’un grand seigneur qui n’a pas étudié est la honte de sa maison, et que les belles connaissances relèvent l’éclat de la noblesse[30]. Il exige que les ecclésiastiques passent d’abord par les écoles, et se fâche contre une mère qui a engagé son enfant dans les ordres avant qu’il n’ait fini ses classes[31]. Cette éducation, qui lui semble nécessaire pour tout le monde, même pour les prêtres, est tout à fait la même qu’autrefois et animée du même esprit. On y enseigne toujours la gram aire et la rhétorique, et par les mêmes procédés[32]. Le rhéteur fait déclamer ses élèves, comme du temps de Sénèque le père et de Quintilien. Les sujets qu’il leur donne à traiter n’ont pas changé : ce sont les mêmes dont Tacite se plaint et dont Pétrone se moque ; il est question de pères que leurs enfants refusent de nourrir, de marâtres qui empoisonnent leur beau-fils, de tyrans qu’on assassine, etc. Mais voici ce qu’il y a de plus extraordinaire : ces maîtres semblent oublier que le christianisme est, depuis près de deux, cents ans, la religion de l’État ; leurs sujets sont le plus souvent empruntés à l’ancien culte. Ils demandent à un jeune chrétien de faire parler Didon, Thétys ou Junon ; il faut qu’il attaque l’audacieux qui demande qu’en récompense de ses hauts faits on lui permette, d’épouser une vestale[33], ou qu’il s’emporte contre l’impie qui a commis le crime de porter une statue de Minerve, la déesse virginale, dans un mauvais lieu[34] ! tant il est vrai que jusqu’au bout l’école est restée païenne. Il y avait pourtant un homme, à ce moment, un homme
d’esprit et de cœur, qui avait lu avec soin le traité de De ce qui vient d’être dit il me semble qu’une conclusion importante se dégage ; je vais la résumer en quelques mots. Le christianisme, dès qu’il a pénétré dans les classes aisées, s’est trouvé en présence d’un système d’éducation qui jouissait de la faveur générale. Il ne s’est pas dissimulé que cette éducation lui était contraire, qu’elle pouvait singulièrement nuire à ses progrès, et que, même dans les âmes qu’il avait conquises, elle entretenait le souvenir et le regret de l’ancien culte. Il est sûr que c’est elle surtout qui a prolongé l’existence du paganisme, et que, dans les derniers combats qu’il a livrés, les grammairiens et les rhéteurs ont été pour lui des auxiliaires plus utiles que les prêtres. L’Église ne l’ignorait pas ; mais elle savait aussi qu’elle ne serait pas assez forte pour écarter les jeunes gens des écoles, et elle supporta de bonne grâce un mal qu’elle ne pouvait pas empêcher. Ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’après sa victoire, quand elle s’est vue toute puissante, elle n’ait pas cherché quelque moyen de se faire une part dans l’enseignement, d’en modifier l’esprit, d’y introduire ses idées et ses écrivains, et de le rendre ainsi moins dangereux pour la jeunesse. Elle ne l’a pas fait. Nous venons de voir que jusqu’au dernier jour le paganisme a régné dans l’école, et que l’Église, pendant une domination de deux siècles, n’a pas eu la pensée ou le pouvoir de créer une éducation chrétienne. Les conséquences en ont été graves. L’enfant à qui, suivant l’expression de saint Augustin, le vin d’erreur est une fois versé, en garde le goût toute la vie. L’imagination et l’esprit conservent le pli des premières années ; ce qu’on a lu dans Platon et dans Homère, dans Cicéron et dans Virgile, il est bien difficile qu’on l’oublie. Le malheureux saint Jérôme, à qui l’on faisait un crime de son instruction classique, répondait avec douleur : Comment voulez-vous que nous perdions la mémoire de notre enfance ? Je puis jurer que je n’ai plus ouvert les auteurs profanes depuis que j’ai quitté l’école ; mais j’avoue que là je les avais lus. Faut-il donc que je boive de l’eau du Léthé, pour ne plus m’en souvenir ?[36] C’est donc en vain que l’Église se flattait de déraciner le paganisme de la terre, puisqu’elle lui laissait une porte ouverte ou entr’ouverte dans l’éducation. Par cette ouverture presque toute l’antiquité païenne a passé. |