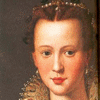LA VIE INTIME
D'UNE REINE DE FRANCE AU XVIIe SIÈCLE
CHAPITRE II. — LA
JOURNÉE DE LA
REINE.
Impression pénible de Marie de Médicis en arrivant au Louvre en 1601 dans son appartement. — Description de cet appartement embelli par elle. — Disposition des pièces, meubles, tentures, objets d'art. — Réveil du couple royal le matin ; le bouillon. — Lever de la reine. — Sa toilette. — Costumes, bijoux, parfums. — Premières audiences. — La messe ; le dîner. — Cérémonial du repas, la table, le couvert, le menu. — Occupations de l'après-midi : les petits chiens. — Livres et littérateurs. — Loteries, musique et concerts. — Les sorties : le jardin du Louvre. — En carrosse dans Paris, buts des sorties. — La foire de Saint-Germain et ses distractions. — Promenades à Saint-Germain, Issy, Poissy. — La villégiature de Fontainebleau. — Vers quatre ou cinq heures, collation, puis réception, le cercle. — Presque jamais de grands dîners. — Le couple royal s'invitant chez des particuliers. — Le souper de la reine. — La soirée : le théâtre ; l'hôtel de Bourgogne ; les Italiens ; Arlequin. — Fêtes : les ballets. — Cercle intime dans le cabinet de la reine le soir ; jeux de cartes. — A onze heures fermeture du Louvre. — Correspondance. — Coucher de la reine.Lorsque le 9 février 1601, tard dans la soirée, Marie de Médicis arrivant à Paris après son mariage, entra pour la première fois au Louvre ; que de l'étroite et vilaine petite rue d'Autriche elle s'engagea sous la porte du palais, porte flanquée de deux grosses tours du moyen âge, et si peu large que le carrosse pouvait à peine passer, si sombre, qu'un ambassadeur étranger s'écriait : Zeste d'une telle entrée ! elle seroit meilleure pour une prison que pour la maison d'un si grand prince ! ; lorsque après avoir traversé la cour déserte,— moins du quart de la cour actuelle, — monté le grand degré, — notre escalier Henri II, — traversé la salle haute du Louvre, — la salle Lacaze, — sans rencontrer personne et à peine éclairée ; gagné par la chambre du roi son propre appartement où elle n'entrevit dans l'obscurité que des meubles défraîchis, des tentures passées et des peintures éteintes ; elle fut étonnée et effrayée croyant ou que ce n'estoit le Louvre ou que l'on faisoit cela pour se moquer d'elle ! Elle devait reconnaître ensuite que le mauvais ordre et la liberté de la cour de France étaient la seule cause de cette insuffisante réception. Héritière du goût des Médicis pour toutes les élégances de la vie et les richesses de l'art, elle ne tarda pas à transformer cet intérieur dans lequel depuis cinquante ans tant de reines avaient déjà vécu. C'est là, dans l'appartement embelli par elle, que nous allons la regarder vivre[1]. L'appartement de la reine occupe le premier étage de ce
qu'on appelait alors le vieil corps d'hostel.
Il comprend cinq pièces en enfilade ne donnant aujourd'hui que sur la cour,
autrefois éclairées des deux côtés ; on en retrouve encore les murs de refend
dans la partie actuelle du Musée du Louvre qui s'étend entre la salle dite
des sept cheminées, et le milieu de l'aile donnant sur En haut de l'escalier spécial, le
degré du quartier de la reine, la première salle est la salle des
gardes. Là, se tiennent les dix gardes du corps et l'exempt, chargés du
service d'honneur. Puis vient l'antichambre, où l'huissier Philippe Clément,
vieux serviteur de la maison royale, passe ses journées devant un grand buffet
et veille. Cette antichambre est la salle à manger de Le cabinet suit après :
c'est le salon. Marie de Médicis y reçoit les nombreuses compagnies. Elle a
fait repeindre les boiseries des murailles d'arabesques délicates à couleurs
tendres. Un beau tapis d'Orient, commandé en Turquie par l'ambassadeur de
France, M. de Brèves, couvre le carrelage ; çà et là, douze fauteuils, ou
chaises à bras et douze chaises recouverts de velours cramoisi piqué de gros
clous dorés. Des bibelots, souvenirs et cadeaux, sont disposés sur des
cabinets d'ébène : un petit coffret de fil d'argent, envoyé par l'Électrice
palatine ; une coupe d'agate, don de la maréchale de Fervaques ; le beau miroir
de la duchesse de Mantoue que j'ai placé dans mon
cabinet, écrit la reine, comme une pièce très
digne d'y être mise en évidence. Quatre chandeliers d'argent vermeil doré éclairent les longues parties
de cartes du soir et Dieu sait s'ils servent ! Dans la grande cheminée à
manteau richement sculptée brillent des chenets d'argent pesant 33 marcs, La chambre à coucher, qui succède, est la plus belle pièce
: deux fenêtres donnent sur la cour et deux sur Enfin un coffret précieux, cadeau d'une princesse allemande, des coupes artistiques, des porcelaines rares, des paniers d'argent, un reliquaire garni de dix-neuf diamants et d'une perle, un bénitier de cristal monté sur argent doré avec son gupillon, une coupe de cristal faite en coquille, mille objets de valeur mis ici et là, achèvent de donner à la chambre un aspect somptueux. Comme le cabinet de la reine est gardé par un huissier spécial, Jean Mauderon, la chambre a aussi son gardien, l'huissier Antoine Drouin, et un garçon de la chambre, Nicolas Guilloret. Ils veillent à ce que personne ne passe devant le lit, même vide, sans s'incliner profondément, comme le veut le cérémonial. La dernière pièce est le petit cabinet ; c'est la plus étroite ; elle a cinq mètres de large sur neuf de long, entresolée, l'entresol du dessus s'appelant l'entre-ciel. C'est dans cette pièce intime, retirée, chaude et gaie, que Marie de Médicis se tient de préférence. Elle y a même un petit lit de repos sur lequel elle passe volontiers la nuit, le cas échéant. Une porte donne directement dans la chambre à coucher du roi ; une autre communique avec le petit degré du roi, la petite montée, escalier situé dans l'angle même du palais, bien connu des intimes ! — il en existe encore un à la même place[5]. — Ici encore des bibelots précieux, des cristaux de Venise, une boîte de chagrin à serrure et à clef d'argent, des miroirs encadrés d'ébène, des bougeoirs d'or ciselé, mais aussi une grande boîte ferrée où Marie de Médicis tient ses titres et papiers concernant nos affaires. Sur la table recouverte d'un riche tapis d'Orient, elle écrit ou signe sa nombreuse correspondance, en se servant de la belle écritoire dont lui a fait cadeau le duc de Mantoue son beau-frère. Le petit nain Merlin fait fonctions d'huissier du cabinet. En plus des quelques œuvres d'art que nous avons notées, or, argent, joyaux antiques, médailles et tapisseries abondent dans l'appartement. Le valet de chambre Pierre Courtois est personnellement responsable de la garde du tout en même temps que Nicolas Roger. Nous ne parlons pas des coffres en bois sculpté dans lesquels s'entassent les robes et autres bardes de la reine. Ils sont dispersés aussi dans les entresols et en haut dans toutes les petites pièces multipliées pour le service, garde-robe, salle des femmes de chambre, salle des filles, salle des valets de chambre. C'est un monde un peu à l'étroit et confus[6]. Quand le couple royal fait bon ménage — ce qui n'arrive pas toujours ; — quand le roi n'est pas en course ou en voyage — et il se déplace souvent, — la reine s'éveille aux côtés du roi. Au moins trois fois la semaine, les mardi, jeudi et vendredi, Henri IV tient Conseil de ses ministres ; de bonne heure, dès sept heures du matin, il saute promptement à bas du grand lit et disparaît. En temps ordinaire, il s'attarde un peu. Les intimes d'ailleurs peuvent entrer dans la chambre. Les matins de premier janvier, M. de Sully vient apporter au roi et à la reine leurs étrennes — des jetons d'or. Un de ces matins-là, où il les trouve encore enfermés derrière leurs rideaux, il exécute de grandes révérences muettes devant le lit, et Henri IV, finissant par percevoir quelque chose d'anormal, tire les courtines, demande ce que c'est et, reconnaissant le surintendant : Ah ! Mamie, dit-il à la reine, voici Rosny qui, je m'assure, nous vient apporter nos étrennes ![7] Il arrive que M. de Sully ne trouve pas le ménage si bien disposé. Un autre premier janvier, venant ainsi apporter les étrennes, après avoir parlé au roi, il s'adresse à la reine : Madame, lui dit-il en lui tendant les jetons, en voici aussi pour Votre Majesté ! Marie, tournée de l'autre côté, ne bouge pas : Donnez-les-moi, s'écrit le roi, elle ne dort pas ; elle est furieuse ; toute la nuit elle n'a fait que me tourmenter ! Les familiers admis le matin dans la chambre royale sont
des jeunes gens, Bassompierre, le brillant cavalier, qu'Henri IV tutoie et
que Marie entraînée traite de même ; d'anciens amis des jours de lutte, de
Roquelaure, Frontenac, Loménie, Henri IV parti, les quatre femmes de chambre sont entrées
pour habiller la reine : mesdames Salvagia, la préférée, Florentine amenée
d'Italie ; Catherine, autre personne de confiance, Ganche et Sauvat, toutes
quatre très en faveur. On passe à la princesse une chemise en toile damassée
d'or et de soie rouge, ouvrée de fil d'or, ou
bien une chemise de soie blanche, de soie noire ; des bas de soie incarnats, jaunes ou bleus ; — elle ne met du noir
que lorsqu'elle est en deuil. — Dans les coffres, on lui cherche quelque
jupon. Il y en a des monceaux : en satin violet
découpé ; satin blanc doublé de taffetas vert ; tabit de Après quoi, elle procède à sa toilette. Un valet de chambre prend un vase posé sur le bahut de la chambre à coucher, et va chercher de l'eau, précédé de deux gardes du corps de l'antichambre. Les femmes de chambre ont mis sur une table la coquille, bassins et serviette. Marie se lave avec une éponge et se coiffe d'un peigne d'ivoire. En arrivant en France, elle a bien, pour garder auprès d'elle son amie d'enfance Léonora Galigaï, prétexté que celle-ci était la seule qui sût la coiffer. En réalité, elle se coiffe elle-même, haut, à l'italienne, ses nœuds justes. Elle reçoit encore et cause pendant qu'elle démêle ses longs cheveux, en les huilant d'huile de fleur d'oranger d'Espagne, pour y arrêter la poudre[9]. Quelle robe mettra-t-elle ? Importante affaire. Robes, bas de robe, manteaux, vestes, cimarres,
pourpoints, mantelets, collets, elle a naturellement tout ce qu'une grande
élégante du temps peut posséder, à profusion, et du plus riche style. On lui
en volera même une bonne partie, un samedi, à deux heures du matin, en
février 1613, ce qui donne une bizarre idée de la façon dont les intérieurs
du Louvre sont gardés. La dame d'atour, Léonora Galigaï, est chargée de
monter la garde-robe de Marie de Médicis ; elle reçoit du trésorier général
de la maison de la reine Ace prix-là, les Les deuils — Marie de Médicis en portera souvent — sont moins dispendieux ; on se contente ici de montcayar, serge ou étoffe de laine croisée et fort déliée dont on fait des habits longs ; d'une petite robe noire d'étamine, ou d'une robe de crespin noir ; d'un grand voile fort commode et aisé ; sur la teste, une coiffe à point avec un bouillon et une écharpe sur la robe, le tout de volant[11]. Quand l'étoffe est choisie, que le mercier et passementier Baron a fourni passement et garnison d'or, d'argent et de soie et or filé, le tailleur de la reine, Jacques Zoccoli exécute, encore un homme de confiance, amené de Florence, notre tailleur et valet de chambre ordinaire, neveu d'un ancien tailleur des Médicis, Dominique d'Elbène. Marie de Médicis porte le costume français con molto gusto universale ! Laissant de côté grandes robes de parade : — robe de toile
d'or à fond colombin, à grande queue, robe de drap d'or et d'argent brodée,
robe de velours bleu semée de fleurs de lys d'or, — Marie a pris quelque
vêtement plus simple, de satin incarnadin[12]. On l'a parée.
Elle met ses bijoux : elle en a des quantités, dispersés dans ses cabinets.
Elle a passé sa bague. Elle prend ses bracelets d'or, garnis de 72 petits
diamants, payés Marie adore les parfums. Les odeurs, du reste, sont pour
elle un agrément nécessaire. Henri IV, qui a d'exquises qualités, a aussi
quelques infirmités. Sa trop bonne amie, Henriette d'Entraigues, marquise de
Verneuil, terrible femme au fond, commune et de langage trivial, lui déclare
crûment qu'il sent comme charogne ! S'il est
vrai, comme l'a dit Agrippa d'Aubigné dans le Baron de Fæneste, qu'en
ce temps on connaisse fort bien un gentilhomme au
sentir, le roi se fait connaître le premier gentilhomme du royaume.
Marie se garnit donc d'essences de son pays.
Elle sème dans tous ses coffres d'habits, dans tous ses meubles, dans toutes
ses affaires, les sachets de parfums, sachets de
taffetas incarnadin remplis de rose parfumée, sachets
de rose de senteur, faits de satin de plusieurs couleurs bandés d'or et de
soie, sachets de satin brodés d'or et
d'argent, remplis de roses musquées : un de ceux-ci, bleu céleste,
coûte Elle a des parfumeurs attitrés, en nombre, dont elle
essaye tous les produits et qui, non pas fournissent, mais, comme on dit en ce
temps-là, sentent Sa Majesté. Simon Devaux,
Emmanuel Mandez, un Portugais de Bragance qui habite rue
de l'Arbre sec, au logis de madame Jacquette, apothicaire ; surtout un
certain Arnauld Maren, également étranger. A celui-ci Léonora Galigaï fournit
un local dans son hôtel de la rue Tournon, pour y pratiquer ses distillations
savantes, et Marie de Médicis vient assister à ses travaux ; elle s'amuse à
mettre la main aux alambics, en présence de madame de Guise et du vieil ami
et banquier, M. Zamet, comme elle se divertit aussi à Fontainebleau à
fabriquer des parfums. Elle ne se contente pas de ce qui est produit à Paris,
elle fait venir de Florence huiles et poudres,
principalement de l'huile de jasmin, d'ambre et musc
: on dit des gants de jasmin ; des gants d'ambre. Les gants sont parfois munis, pour attacher et fermer, de
six boutons d'or esmaillé, garni d'un grand diamant chacun, le tout
valant Autrefois, les reines de France
dévoient baiser les princes, ducs et officiers de la couronne, qui les
saluaient. Marie a refusé d'accepter cet usage, suppliant
le roi de ne baiser que lui seul. Henri IV a acquiescé ; en
compensation, il a accordé aux princes, ducs et officiers, d'entrer au Cabinet de la reine sa femme, ce qui ne se
souloit faire auparavant. Quand on salue Sa Majesté, on fait une
première grande révérence à trois ou quatre pas, puis on s'approche, on met
un genou en terre et on prend le bas de la robe qu'on porte à ses lèvres. La
reine relève en donnant sa main à baiser ; son mot habituel est : Vous soyez le bienvenu. Elle a beaucoup de dignité
dans le geste et elle est sévère sur la tenue. Dieu sait ce qu'il en coûtera
à certain gentilhomme impétueux, qui se disputant avec un autre dans le
Cabinet de la reine, soufflette le compère. Il risqua La réception finie, Marie va à la messe : le cérémonial de
la journée d'un roi et d'une reine de France comporte l'assistance à l'office
quotidien. C'est une occasion de sortie, car les souverains ne se rendent
guère à la chapelle du Louvre, bien que le chapelain et l'aumônier y disent
la messe et que les Augustins, par surcroît, viennent, chaque matin, du
couvent situé en face, de l'autre côté de Parmi les livres qu'elle emporte à la messe, il en est deux que nous avons conservés[17]. Un gentilhomme lui porte son missel, comme des valets ont au préalable transporté à l'endroit où elle entend l'office, le tapis de pied et les coussins épais qui lui servent de siège. Pendant la messe un clerc dit tout haut à l'assistance de se lever ou de s'agenouiller aux moments voulus. Les samedis Marie de Médicis assiste aux vêpres à Saint-Victor et va faire ses prières en la basse chappelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle[18]. Au retour de la messe, la reine déjeune, ou, comme on dit en ce temps, elle dîne. Henri IV et Marie, ordinairement, prennent leurs repas de compagnie, dans l'antichambre de la reine, mais souvent aussi, en temps de querelle, ou pour toute autre raison, ils mangent chacun chez soi, la reine dans son petit cabinet, dans l'entresol, n'importe où, puisqu'on lui apporte la table servie. Quand ils dînent séparément, Henri IV, bon garçon, trouvant sous sa fourchette un morceau succulent, prie quelqu'un d'aller en porter un quartier à la reine. Dans les moments de brouille la reine renverra sèchement le quartier parce qu'elle craint le poison, concluent les mouches de cour[19]. Les heures de ce repas ne sont pas régulières. Les jours
où la reine s'est attardée dans sa chambre, le roi est obligé de la prévenir
et l'haste de s'habiller. Bien souvent il a
été à la chasse le matin et a grand faim ; il prend des acomptes. Traversant
un jour la grande salle haute du Louvre, il aperçoit un de ses gentilshommes,
— Ah ! Sire, embrassez-moi la cuisse, car j'en ai quantité et de fort bonnes ! Ce sont des melons qu'il apporte et dont Henri IV raffole. — Voilà Parfait bien réjoui, riposte Henri IV à ceux qui le suivent, cela lui fera un doigt de lard sur les côtes ! Il m'apporte de bons melons dont je suis bien aise ; j'en veux manger aujourd'hui tout mon saoul ! d'autant qu'ils ne me font jamais mal, quand ils sont bons et que je les mange quand j'ai faim. Or, je meurs de faim, et en attendant mieux, je m'en vais commencer à manger mes melons et boire un trait de muscat[20]. Marie de Médicis est prête. Mais ce sont les cuisines maintenant qui ne le sont pas. Le roi réclame jusqu'à deux et trois fois. Enfin le premier maître d'hôtel est venu prononcer le mot sacramentel : — Sire, la viande de Votre Majesté est portée ! Le couple royal se met à table. Quand le roi mange dans son
Palais, ni prince, ni cardinaux, personne ne mange avec lui que Tout autour de la table royale les Suisses de garde ont
pris place afin d'assurer l'ordre, le public de la cour étant admis à
assister au repas. Ils se tiennent appuyés sur leurs hallebardes, revêtus de
leur costume à bandes bouffantes multicolores, de
velours tanné blanc, bleu et incarnat, qui sont les couleurs de la
maison de Bourbon, coiffés de leur toque de même couleur, tous vieux Helvètes
à grande barbe, parlant l'allemand des Quatre-Cantons et très anciens serviteurs
de la couronne. Ce sont les gentilshommes servants qui font le service —
trois pour le Roi, trois pour Autrefois ces gens n'avaient pas le droit d'entrer ; mais
depuis que M. le Prince de Condé a été empoisonné
d'une tourte portée par un sien page, les officiers de la bouche ont
déclaré qu'ils ne vouloient plus répondre de la
viande du roi portée par d'autres qu'eux. On les a admis[21]. Sur la belle nappe de linge damassé portant les armes du roi et de la reine, ouvrage de Flandre et façon de Damas, le couvert a été mis : deux assiettes d'argent, pour chacun et devant, la nef royale d'argent doré, dans laquelle le roi prend sa serviette finement plissée et son couvert, et où la reine met son éventail ainsi que ses gants ; couteau, fourchette et cuiller qu'Henri IV a fait venir de Pau, par économies ; l'ancienne argenterie du roi de Navarre, d'ailleurs très riche et fort élégante, servant maintenant au roi de France[22]. Le menu est lourd et abondant. Il comprend régulièrement pour le repas du matin : quatre entrées, quatre potages, entre lesquels le roi et la reine choisissent un service de viande bouillie, à savoir une pièce de bœuf de dix livres, un haut côté de mouton, un chapon, une pièce de veau, trois poulets ; un service de viande rôtie, composé de : une épaule de mouton, deux chapons, deux gibiers, une longe de veau, trois poulets, trois pigeons, une pièce de mouton, une pièce de veau. Les dimanche, mardi et jeudi on ajoute un pâté de chapon. Les jours maigres, où le menu est plus mince, on sert un brochet et une carpe. Au souper du soir le service sera identique, avec de petites différences. Comme bouilli : un chapon, une pièce de veau, trois pigeons ; comme rôti : un membre de mouton, une longe de veau, deux chapons, deux gibiers, trois gelinottes, trois poulets, une pièce de mouton, quatre poulets fricassés et un gigot de mouton pour le dégoust. Il n'y a pas de légumes dans ce programme. Les perdreaux et les cailles ne figurent que lorsque Henri IV en rapporte de la chasse. De la duchesse de Mantoue, on reçoit des caisses de saucisson mortadelle et de fromage. Le duc, lui, envoie des fruits et du poisson, des carpions. Il y a un dessert, bien qu'il ne figure pas sur le menu dressé par le premier maître d'hôtel de la reine, M. le vicomte de Charmel, et contresigné de Marie de Médicis. Le dessert, ce sont des confitures — madame l'Abbesse de Saint-Pierre de Reims en envoie de délicieuses, — des pommes, des oranges, raisins muscats, citrons, grenades, poncifs, envoyés de Provence par des négociants décorés du titre de fruitiers de Roi, Claude Roquette, Barthélemy Saiche. Marie d'ailleurs a un jardin fruitier à Saint-Germain, auquel elle tient autant qu'à un trésor. Elle défend expressément que ses enfants, qui habitent le château, pénètrent dans le petit jardin : Vous nous répondez de tous les fruits, écrit-elle à madame de Monglat, la gouvernante, et spécialement des abricots desquels on a fait le compte. S'il s'y cueille seulement un abricot, quand ce seroit pour nos enfants propres, nous nous en prendrons à vous ! Le vin servi à la table royale, dans une bouteille recouverte d'osier, est du claret, vin blanc ou vin rouge. Il en est prévu, par jour, pour le dîner et le souper de la reine, un setier, soit sept litres et demi. Avant de verser le vin dans le verre à pied, en cristal, d'Henri IV ou de Marie, le gentilhomme servant doit l'essayer au préalable devant Leurs Majestés dans un autre verre, à part. Une fois le gentilhomme se trompe et lampe le verre du roi : — Eh, l'ami ! crie Henri IV riant, au moins devriez-vous boire à ma santé ; je vous eusse fait raison ![23] Henri IV boit et mange énormément, d'ailleurs pas très
proprement. Il se donne des indigestions de melons, quoi qu'il en dise. Il
aurait pu faire sien le mot de Malherbe à Marie de Médicis, laquelle en rit
beaucoup : Il n'y a que deux belles choses au monde,
les roses et les femmes ; deux bons morceaux, les femmes et les melons !
La reine, elle, mange plus modérément. Pendant le repas, suivant l'humeur et
les circonstances, le couple royal cause avec les gentilshommes et curieux,
qui, derrière la ligne des Suisses, assistent à la cérémonie. Les règlements
interdisent qu'on parle d'affaires aux princes à ce moment, mais seulement tout haut, d'histoires et autres choses de savoir et de
vertu. Le dimanche les quinze instruments de la musique du roi
viennent donner un concert pendant le repas. — Sous Henri III on chantait des
psaumes. — Puis, les domestiques emportent la table, d'où l'expression : Les tables sont levées. Leurs Majestés se retirent
chacune de leur côté, et les curieux s'en vont, convaincus qu'ils ont vu
quelque chose d'extraordinaire, car le public s'imagine qu'un seul plat de la
table royale coûte au Trésor 18.000 écus par an[24]. Quelquefois quand les rois sont aux cabinets, écrit Malherbe, les peuples croient qu'ils parlent de changer le pôle arctique à l'antarctique et, le plus souvent, ils prennent des mouches ![25] L'après-midi, en effet, Marie de Médicis emploie ses loisirs à des occupations très simples et très diverses, entre lesquelles elle choisit. Elle va d'abord voir ses bêtes. Elle a toute une petite ménagerie de singes, de perroquets et de chiens, au milieu desquels elle adore prendre du plaisir[26]. Les chiens surtout la passionnent. Elle a un certain nombre de petites bêtes gentilles, musquées, qu'elle dorlote, qu'elle emporte avec elle dans son carrosse ou dans sa litière : Bichette d'abord : Je vous préviens, mande-t-elle à une amie, de l'accouchement de ma petite Bichette et comme elle a fait trois beaux petits chiens, dont il y en a un, entre les autres, qui a deux nez, qui est le plus beau et que je vous ai dédié ; Mignonnette, ensuite, pour laquelle elle demande à la duchesse d'Angoulême quelque bête de race faisant un mari sortable ; Turquette, blanche et grise, qu'on a une fois volée et à la recherche de laquelle Marie éplorée envoie valets de pied et gentilshommes, soucieuse surtout de savoir si la pauvre bête n'a pas rencontré, pendant son escapade, quelque galant compère indigne d'elle et trop entreprenant ; Roquette, qui fait, de temps en temps, de petits roquetons, etc. Ce petit monde gambade et aboie autour de la maîtresse indulgente. Marie de Médicis a délégué au soin spécial des chiens un
de ses domestiques, Pierre Guilloret, le
porte-chaise, auquel elle donne, au 14 juillet, Marie, sortant de chez les bêtes, se retire ensuite dans
son petit cabinet. Lit-elle ? Peu. D'abord elle n'a pas de bons yeux ; elle
met des lunettes, étant myope ; ensuite, les choses sérieuses comme la
lecture ne sont pas très de son fait. Elle écrit bien à ceux qui lui
adressent ou dédient des livres — il en vient de partout et tel lui offre son
œuvre d'une façon originale en la mettant sur l'autel des Feuillants, un
jeudi saint, contenue dans une boîte de toile
d'argent et de satin jaune brodé d'argent couvert de dentelle. — Je le verrai bien volontiers ; ou Je le verrai pour la considération du sujet. En
réalité ce sont des paroles en l'air. Livres de dévotion, Histoire des Indes
orientales du P. Dujarric, Panégyriques de Afin d'occuper son temps dans son petit cabinet, Marie
joue aux loteries. Chaque joueur paie sa part du prix de l'objet mis en
enjeu. La reine a, pour ce divertissement et autres menus
plaisirs du même genre, un argent de poche montant au total régulier
de L'autre plaisir de la reine, plus agréable et moins
dangereux pour l'entourage, c'est la musique. Marie l'aime sans passion, mais
intelligemment, avec élégance. Elle a été à bonne école : Henri IV a bien
monté sa Schola et en est fier. Elle-même,
avec beaucoup de difficultés, réorganisera plusieurs fois sa troupe, dirigée
par les maistres de musique Gabriel Bataille,
Antoine Boisset, Michel Fabry, à des dates différentes le principal, surtout,
Pierre Guédron, le compositeur le plus en renom du moment, celui qui compose
les ballets de Cour, et qui est intendant de la
musique de la chambre du roy. La troupe de Marie a des enfants pour
soprani et, à titre de chanteurs, toute espèce de gens, voire même des
chanoines, tel M. Guy le Page, chanoine de Saint-Julien du Mans. Parmi les
instrumentistes, le préféré est le joueur de luth René Fancan ; la reine en
fait le maître de grammaire des enfants de la
chapelle de musique du roi ; elle paie à un autre, Robert Ballard, des
appointements contigus à ses services, Les concerts se donnent aux Tuileries. Princesses et dames
de Elle a d'autres distractions moins relevées : elle prendra
son passe-temps à regarder des heures durant
un joueur de cartes, Jean-Baptiste Capra, dit Montalboto, qui déploie son adresse et subtilité à faire des tours de mains, et
plusieurs gentillesses avec beaucoup de dextérité : elle lui donnera
même, comme marque de sa satisfaction, une chaîne d'or de Enfin, Marie de Médicis, les après-midi, sort. Elle va
souvent d'abord dans le jardin du Louvre, qui est très rigoureusement fermé,
pour que Leurs Majestés puissent en jouir tranquillement[32]. Elle s'est fait
arranger un petit enclos retiré, au bas du corps de bâtiment qu'elle habite,
entre le fossé du Louvre et le chemin qui est le long de Quelquefois, c'est au jardin des Tuileries qu'elle se rend. — On appelle même les Tuileries, la maison de la reine. — Elle s'y divertit à chasser au vol, et ne prend guère que des corbeaux[34]. Quand elle sort en ville, elle ne va jamais à pied, ni en chaise, mais en carrosse. Elle a commandé son carrosse ; le premier écuyer a transmis l'ordre à l'écurie de la reine, l'ancien hôtel Combault, près de Saint-Germain-l'Auxerrois. A l'heure dite, la lourde voiture entre avec précaution sous la porte trop basse et trop étroite du Louvre. Doré, doublé de velours rouge, orné aux portières de rideaux de damas de même couleur, le carrosse de la souveraine est traîné par six beaux chevaux blancs, que conduit un des deux cochers de corps, en livrée superbe, aux couleurs de la reine, le blanc et le bleu : pourpoint, chausses de draps à bandes de velours et bordées de passementeries ; casaque de drap, aussi à bandes de velours ; bas blancs, aiguillettes et ceinture d'or, grand chapeau. Sur les chevaux, sont montés des postillons habillés pareillement : draps et bandes de velours, aiguillettes ; derrière la voiture prennent place les valets de pied, portant une mantille et des chausses de velours, un pourpoint de chamois, un porte-espée. Précédé de deux écuyers, le carrosse a décrit une courbe pour venir au pied du degré du quartier de la reine. La foule de gentilshommes, de pages, de laquais, escorte habituelle des grands seigneurs, qui remplit toujours la cour, s'approche pour assister au départ. La reine monte, masquée, les femmes de qualité n'allant en carrosse que masquées. Autour de la voiture, pas de gardes à cheval : dans les rues de Paris étroites, tortueuses, mouvementées, on risquerait, avec une escorte, trop d'inextricables encombrements[35]. Les buts de promenade sont aussi variés que possible, mais
la reine en a toujours un ; elle ne connaît pas le plaisir de faire errer ses
chevaux sous des ombrages quelconques. Elle va à Chaillot, où elle a une
maison, à Le roi et la reine sortent souvent ensemble. Ils vont à l’Arsenal regarder fondre des coulevrines, petite séance plaisante à laquelle les a conviés M. de Sully. L'Arsenal est un lieu de plaisir où se donnent fréquemment de brillantes fêtes et de jour et de nuit ; l'après-midi, des bagues en masques. La reine Marguerite, elle-même, organise pour la famille royale des joutes de ce genre : on rompt au faquin et en lice, on fait toutes sortes d'armes, de mascarades, de galanteries. Autrefois, c'était au Louvre même que se passaient ces exercices. Dans la cour pavée, autour du Mai planté au centre, les gentilshommes à cheval couraient, pendant que, des fenêtres, ou sur des théâtres, princes, princesses, seigneurs, gens de cour et valets, applaudissaient. Mais, en 1605, six gentilshommes voulant rompre une lance sur cette piste qu'on avait sablée, ont fait si bien que le jeune Bassompierre a eu le ventre traversé et a été transporté pantelant dans l'entresol de la reine. Henri IV a défendu le jeu[38]. Une belle époque pour les fêtes de plein air est le temps de carême-prenant. Marie va voir avec le roi tirer la quintaine sur le pont Notre-Dame, et contempler le spectacle de vingt-deux princes et seigneurs, MM. de Nevers, d'Aiguillon, de Rohan, de Soubise, de Termes, etc., tous masqués, superbement habillés, armés de toutes pièces, montés sur de très beaux chevaux, se donnant de grands coups de lance, ferraillant à l'épée, estocant au milieu d'une affluence énorme de peuple. Belle époque encore, le temps de la foire de Saint-Germain, cette foire si pittoresque qui dure quinze jours, trois semaines, au début du carême. Des baraques établies sur l'emplacement du marché Saint-Germain actuel offrent au public un déballage considérable de toutes les marchandises possibles, étoffes, livres, joaillerie, linge, bijouterie, vaisselle, épicerie, faïence, dentelle. Il y vient des marchands de tous côtés, de France, des Allemagnes, de Flandre, d'Italie. C'est là que les curieux de publications nouvelles, tel Pierre de l'Estoile, se mettent au courant de la littérature. Par surcroît, tous les baladins de la terre se donnent rendez-vous à la foire ; ils ont monté aux abords les piquets de leurs tentes. Ils attirent la canaille. Pages, laquais, écoliers, soldats des gardes se livrent à mille insolences, se battent. La foire est un lieu d'intrigues et de débauches[39]. Le roi et la reine raffolent de cette foire. Le lendemain même de son arrivée à Paris, en 1601, Henri IV y conduisait Marie de Médicis, la tenant par la main, au milieu d'une foule si compacte que les gardes avaient toutes les peines du monde à leur frayer un passage, et qu'ils furent pressés et bousculés. Le roi y va tous les jours ; il ajourne ses départs pour n'en rien perdre. Une année — celle même de sa mort, 1610, — un temps abominable, neige, grésil, verglas, pluie froide entremêlée de grêle, avait provoqué dans Paris nombre de catarrhes et une coqueluche universelle ; le débit des marchandises était piètre, maigre et froid comme le temps. Le roi alla tout de même à la foire qui sans lui eût été déserte. C'est qu'il s'y amuse énormément. Il achète de petites figures de l'Arétin, quelques estampes inconvenantes de Marc-Antoine sans doute, qu'il montre en riant à M. de Montpensier et aux autres seigneurs ; ou bien, apercevant deux cordeliers qui marchandent des perles de huit écus l'once, il va, lui et les siens, les entourer, en se gaussant d'eux, ce qui fait fuir les honnêtes religieux. Mais surtout, il joue au coin des banques et jeux de la foire ; il a une loge, une baraque, dans laquelle est dressée la table et le tapis pour le brelan et là il s'en donne, ainsi qu'au jeu de dés ! Une fois, il perd 700 écus contre M. de Villars. C'est la passion du jeu qui lui fait, chaque année, prolonger la foire de huit jours, bien qu'il dise que c'est pour le plaisir que la reine prend à s'y promener. La reine joue aussi à la foire ; elle y joue à des blanques, sorte de loteries où le billet blanc (d'où blanque)
perd et le billet dit à bénéfices gagne ; à
des loteries analogues à celles de son cabinet. Elle et ses amies se
partagent le prix d'un objet et on tire. Les enjeux sont de grosses sommes.
Une montre d'or, garnie de diamants, de En dehors de ces parties coûteuses, la reine a l'habitude
de faire des cadeaux à propos de la foire ; elle en fait à tous ses enfants,
à tous ses parents, à ses amies ; elle leur écrit : Me
promenant ici à la foire de Saint-Germain-des-Prés, je me suis souvenue de
vous y acheter votre foire, que je vous envoie ; ou bien elle donne
une somme à mademoiselle de Montpensier, par exemple, pour qu'elle s'achète
ce qu'elle voudra. Elle met de 50 à Il arrive que les sorties de la reine sont de petits voyages. Elle va le dimanche en carrosse entre sa dame d'honneur et sa dame d'atour ouïr vespres à Poissy afin de pouvoir, au retour, passer par Saint-Germain et dire bonjour aux enfants, qui y habitent. La reine Marguerite l'invite-t-elle à venir collationner dans sa propriété d'Issy, elle s'y rend volontiers et, en revenant, montée sur un genêt d'Espagne, galope bravement jusques à l'entrée du faubourg Saint-Germain. Car elle monte fort bien à cheval, et goûte particulièrement cet exercice. Naturellement, la promenade la plus ordinaire est celle de
Saint-Germain. La reine y va à cheval, en litière l'hiver. La litière,
tapissée de velours rouge brodé d'or, est fermée de tous côtés, a des
fenêtres vitrées et se chauffe au moyen de boules combustibles parfumées.
Quand la reine est arrivée en France, cette litière était portée par des
estafiers italiens. Henri IV les a congédiés ; de bons mulets du Poitou les
ont remplacés, conduits par des muletiers, escortés de pages de l'écurie. En
cours de route, si la reine veut chasser, elle monte
alors sur une haquenée pour faire courir des lièvres[42]. Il arrive
parfois au ménage royal d'aller passer On a besoin, tous les ans, que le roi et la reine s'absentent de Paris afin de nettoyer le Louvre, d'aérer les chambres, de les désinfecter en les parfumant de bois de genièvre et de curer les fossés. Ils s'en vont trois semaines ici ou là. Ils ont d'ailleurs une villégiature annuelle, régulière : Fontainebleau, où ils résident septembre et octobre, quelquefois novembre, créant une habitude royale qui sera suivie jusqu'à la fin de l’ancien régime. Contrairement à l'opinion des Parisiens du temps qui croient que le jour n'est nulle part si clair qu'au Louvre, et ne prisent rien que l'air de Paris, Marie de Médicis a une préférence marquée pour Fontainebleau. Elle s'y rend fréquemment, à Pâques, en mai, en juin, surtout au printemps. Elle est peu accompagnée, car il n'y a pas beaucoup de place dans le château, quoi qu'il paraisse, ou du moins pas assez de meubles. Si des étrangers veulent y venir, comme l'envoyé florentin Vinta ou les ambassadeurs vénitiens, on les prie d'apporter leurs lits, des tentures, de la vaisselle, et même d'envoyer quelqu'un pour arrêter un logement. La musique du roi cantonne à Avon et Marie de Médicis n'invite ses amies que l'une après l'autre[44]. Marie se plaît infiniment dans le bel appartement qui donne sur le jardin de la reine (aujourd'hui de Diane), dans cette grande chambre à coucher qui servira à toutes les princesses jusqu'à Marie-Antoinette, tout près de ce salon ovale (dit maintenant de Louis XIII), où elle a voulu que ses enfants naquissent. Elle vit simplement dans ce qu'Henri IV appelle nos délicieux déserts de Fontainebleau, n'y emporte de vêtements que juste ce qu'il lui faut, met modestement des chapeaux de paille, que la grande-duchesse de Toscane lui envoie d'Italie, des chapeaux de paille fine de Florence garnis de taffetas ou de satin incarnat. Elle se promène sans apparat dans le jardin avec son parasol fait de deux aunes entières de taffetas violet. Son grand passe-temps est d'aller jeter de la mangeaille aux oiseaux des volières, de regarder pêcher les carpes et de supputer leurs âges légendaires. L'on a pêché deux grandes carpes, écrit-elle à madame de Guise, dont l'une avait huit cents ans et encore quelques-uns disoient qu'elles estoient du temps de Noé et du Déluge ; l'autre n'avoit que trois ou quatre cents ans. J'ai mangé la teste de la première et prenois plaisir à fouiller dedans comme c'eût été dans quelque beau cabinet ! Le grand plaisir de Fontainebleau, pendant le principal séjour, est la chasse en forêt, que viennent suivre des troupes énormes de gentilshommes, quatre ou cinq cents, dit Bassompierre, les dames montées sur des haquenées richement harnachées, cohues multicolores et gaies[45]. Retournons au Louvre pour reprendre le fil de la journée royale. Vers la fin de la journée, Marie de Médicis est rentrée au Palais. Après une petite collation de fruits, de confitures, arrosés d'un peu de vin, servie dans l'antichambre à elle et aux dames de sa suite, elle change de costume, et fait un peu de toilette. Dans son grand cabinet l'attend maintenant une assemblée toujours nombreuse, troupe affairée, à l'affût d'intrigues et de nouvelles, et qui veut être là, pour pouvoir dire par la ville le grand mot des gens de cour : J'ai été au Cabinet — ou au cercle... — on m'a dit au Cabinet... ! La reine y restera jusqu'à sept heures. Le roi et la reine ne donnent presque pas de soupers, c'est-à-dire de grands dîners. Il faut une circonstance exceptionnelle, telle que le mariage du duc de Vendôme, fils naturel d'Henri IV, avec mademoiselle de Mercœur, la plus grosse héritière de France, ou le baptême du dauphin à Fontainebleau, pour que Leurs Majestés organisent un festin de gala. Outre que le cérémonial interdit de prendre place au Louvre à la table du roi, Henri IV n'aime pas gaspiller son argent. Quand il y a festin, peu d'hommes y sont invités ; ceux qui sont présents, grands seigneurs, officiers de la couronne, servent le roi et la reine : ce sont les dames qui dînent. On dresse trois tables dans la grande salle, trois tables en potence, dit-on en ce temps, en fer à cheval, disons-nous : celle du fond est quelquefois surélevée de trois ou quatre marches. Henri IV se met au milieu sous un baldaquin ; il a Marie de Médicis à sa droite, à sa gauche des cardinaux et des ambassadeurs. Près de la reine, s'asseyent de grandes dames : madame et mademoiselle de Guise, la comtesse d'Auvergne, la princesse de Conti. Les convives n'occupent qu'un côté de cette table ; ils n'ont personne devant eux. Sur les deux autres tables au contraire, on se fait vis-à-vis. Le roi est servi par le prince de Conti, le comte de Saint-Pol, M. de Guise ; la reine par MM. de Nevers, d'Elbeuf et de Joinville, qui font office de gentilshommes servants. Les Suisses, avec leurs hallebardes, entourent les tables et, au milieu d'eux, se pressent maîtres d'hôtel, officiers de la bouche, pages et porteurs[46]. Le roi et la reine vont quelquefois dîner en ville chez un
particulier : c'est celui-ci qui paie. Le roi s'invite, car on n'a pas le
droit de l'inviter, et il choisit lui-même les convives. Généralement
l'amphitryon ne s'assoit pas à la table royale, il se tient debout derrière
le fauteuil du prince, qui cause et rit avec lui ; mais il doit, devant le
roi, essayer de tous les mets servis, pour bien montrer qu'il ne les a pas
empoisonnés. L'heureux mortel qui a le plus souvent l'honneur de recevoir le
roi est le banquier Zamet, réputé pour sa mine grave, noire et ses
perpétuelles révérences ; il habite, rue Beautreillis, au Marais, une vaste
et luxueuse maison ornée de superbes tapisseries évaluées à 400.000 florins.
Issu d'une famille d'origine italienne, ayant fait une grosse fortune dans la
banque, ce qui lui permet de rendre de grands services financiers au roi, M.
Zamet est un ami pour la famille royale, un homme de confiance, qu'on nomme
surintendant général de la maison de la reine en M. de Sully, à l'Arsenal, est celui qui, après M. Zamet, voit le plus souvent Leurs Majestés à sa table. Puis ce sont les Concini, dans leur grand hôtel de la rue de Tournon : Henri IV, un peu surpris, admire la magnificence de la réception, les meubles très riches, l'argenterie abondante ; un concert suit le dîner. Puis enfin le maréchal Balagny et le premier président du Parlement ont de temps à autre l'honneur dispendieux de recevoir les princes. La reine, elle, va chez madame de Guise, chez la princesse de Conti, où elle commande une fois un souper de vingt-six personnes, dont un seul homme, le cardinal de Joyeuse. Quand ils n'ont rien de mieux à faire, le roi et la reine soupent tranquillement au Louvre comme ils ont dîné, ensemble, dans l'antichambre, ou séparément, Marie de Médicis prenant parfois son repas dans son petit cabinet, où les femmes de chambre la servent simplement[48]. Leurs soirées sont ensuite occupées de diverses façons. Ils vont quelquefois au théâtre de l'hôtel de Bourgogne. Malheureusement, les comédiens sont assez bons coutumiers de ne jouer chose qui vaille et fréquemment Henri IV s'endort. Une fois on a représenté devant Leurs Majestés la plaisante farce d'un ivrogne lequel déclare à sa femme qu'il aime mieux boire son argent que de le donner en impôt au roi, et que, pour plus de sûreté, il prendra dorénavant du vin à six sols au lieu d'en boire à trois : Pour le moins, monsieur le roy, s'écrie-t-il, n'en croquera pas de cestui-là ! Va m'en quérir tout à ceste heure et marche ! Les agents du fisc arrivent ; le bonhomme fait surgir d'un coffre trois diables qui les emportent, après qu'ils ont subi une tirade sur leur prétendue qualité de gens de justice. Henri IV rit de cette fadaise jusqu'aux larmes ; les ministres se fâchèrent et leurs agents voulurent sévir. Le roi les traita de sots et les pria de rester tranquilles[49]. Marie de Médicis préfère de beaucoup les comédiens
italiens. Elle fait venir tous les ans quelque troupe qui donne la comédie au
moins une fois par semaine à la cour, et le reste du temps à la ville : c'est
la comédiante Isabelle Andreni, qui n'a encore trouvé sa pareille en l'élégance,
promptitude et facilité de toutes sortes de discours convenables à la scène
et son monde, ou encore Julio Romano et sa bande, mais surtout Arlequin ; ah
! Arlequin, le favori, l'acteur à la mode, choyé par elle, gâté, fêté et
comblé de présents ! Elle supplie le duc et la duchesse de Mantoue d'user de
leur autorité toute-puissante pour décider la meilleure
compagnie que faire se pourra à passer les monts, avec Arlequin. Elle
écrit à celui-ci lettres sur lettres ; elle l'assure qu'elle tient prêtes Enfin les voilà arrivés ; il y a dans la bande le vieux
Petrolini et Jean-Baptiste Andrini, dit Lelio, ainsi que sa femme Florinda.
Ils joueront pour Tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de Marie de
Médicis pour Arlequin, de son vrai nom Tristan Martinelli. En 1613, il a
cinquante-six ans, et Petrolini en a quatre-vingt-sept : Ce ne sont plus âges propres au théâtre, écrit quelqu'un ;
il y faut des humeurs gaies et des esprits délibérés, ce qui ne se trouve
guère en de si vieux corps comme les leurs. Ils jouent la comédie qu'ils
appellent Dui Simili qui est le Menechmi de Plante. J'en sortis
sans contentement. Mais Marie est sous le charme de toute l'harlequinerie, comme elle dit. Elle traite
familièrement Arlequin, non seulement lui écrit des lettres très aimables,
mais accepte d'être la marraine de ses enfants, le console des ennuis qu'il a
avec le trésorier, — des tiraillements dans le payement des sommes promises,
— l'aide à retirer ses effets du Mont-de-Piété de Florence et fait intervenir
le duc de Mantoue entre lui et un débiteur. Arlequin est au mieux dans le
ménage royal. On sait l'anecdote : Holà ! dit
Arlequin au roi, il y a assez longtemps que vous
faites votre personnage, laissez-le-moi faire à cette heure ! et,
s'asseyant dans le fauteuil d'Henri IV : Eh bien.
Arlequin, vous êtes venu ici avec votre troupe pour me divertir ! J'en suis
bien aise. Je vous promets de vous protéger et de vous donner une pension !
La troupe d'Arlequin ne joue pas que la comédie ; elle comprend aussi des
baladins, des danseuses de corde, des individus faisant le saut périlleux et autres traits si épouvantables que beaucoup de dames,
même des hommes, tournent le dos de la peur qu'ils ont de leur voir rompre le
col[51]. A défaut de théâtre, le soir, le couple royal fait faire parfois de la musique ; — les règlements royaux prescrivent les jours fixes où la musique du roi doit venir exécuter devant Leurs Majestés ; — la reine encore fait danser. Dans une curieuse lettre écrite à son fils Charles IX, l'ancienne reine Catherine de Médicis expliquait au prince qu'il était nécessaire de donner deux bals par semaine à la cour, car j'ai ouï dire au roi votre grand-père (François Ier), ajoutait-elle, qu'il falloit pour vivre en repos avec les Français et qu'ils aimassent leur roi, deux jours les tenir joyeux, sinon ils s'employoient à autres choses plus dangereuses. Le jeudi et le dimanche en principe, avant que le roi et la reine aient fini de dîner, on allume les flambeaux de la grande salle, les joueurs d'instruments s'installent, on apporte tabourets et scabeaux ; le capitaine des gardes en quartier fait mettre des barrières et les danses commencent ; ce sont des branles, danses en rond auxquelles tout le monde prend part, branles doubles, branles simples, branles de Bourgogne, du Hainaut, d'Avignon, dont le rythme et la cadence se sont conservés dans le populaire : Sur le pont d'Avignon On y danse..., etc. des courantes ensuite, des Canaries, des gaillardes ; les hommes dansant le chapeau sur la tête, l'épée au côté. Lorsqu'un seigneur a l'honneur de faire danser la reine il ne la prend, signe de respect, que par le bout de sa manche pendante. Les danses finies, on va collationner dans une autre salle. Mais Henri IV et Marie de Médicis sont loin de faire danser aussi souvent que le prescrivent les anciens usages[52]. Une autre distraction des soirées de la reine, ce sont les
ballets ; la princesse y prend un plaisir extrême, les organise elle-même, y
joue. Les ballets sont des représentations compliquées, coûteuses et
magnifiques. On les donne un peu partout : dans la salle haute du Louvre ;
dans l'antichambre de Marie de Médicis ; à l'appartement du rez-de-chaussée,
où on installe tout autour de la pièce des gradins sur lesquels s'installent
les dames ; à la grande salle de Bourbon, dans l'hôtel d'en face, belle salle
de cent huit pieds de long sur quarante-huit de large, entourée de colonnes à
chapiteaux doriques et dont la voûte est semée de fleurs de lys d'or : les
jours de fête douze cents flambeaux de cire blanche portés par des consoles
et des bras d'argent éclairent une profusion de tapisseries, de sculptures et
de peintures ; — mais surtout à l'Arsenal, où Henri IV fait construire exprès
une très belle salle de fête à double rang de galeries qu'on inaugure le 6
décembre 1609. La reine monte les représentations ; elle choisit les princes,
princesses, dames et seigneurs qui en feront partie. Duret et Durand,
Palluau, Quand les hommes jouent seuls, on les déguise ridiculement ; ils entrent deux par deux, et ce sont des couples de tours, de femmes colossales, de pots de fleurs, de chats-huants, de basses de viole, de moulins à vent. Ils défilent, dansent, sortent de leurs affublements, dansent encore quatre par quatre, puis ensemble, se remettent dans leurs machines et s'en vont. Les femmes se parent élégamment, Marie souvent en italienne. Le plus magnifique ballet qu'elle donna fut celui de 1609, le ballet des Nymphes de Diane dont les répétitions eurent lieu dans la grande salle du Louvre et la représentation à l'Arsenal et chez la reine Marguerite. Marie de Médicis l'avait longtemps pourpensé et dessiné : il dura jusqu'à six heures du matin. D'ailleurs tout le monde, et partout, danse des ballets. Le carnaval en foisonne, Souvent le ballet, même devant la reine, tombe dans la mascarade : Je crois que jamais je ne vis rire personne comme je vis rire la reine, écrit le témoin d'un de ces ballets, qui se termina par d'agréables bouffonneries. L'extraordinaire désordre qui y règne, un désordre grand, honteux, indigne, gâte ces fêtes de Cour. Les salles sont petites, les invités trop nombreux, on s'étouffe, on crie ; impossible de circuler et aux danseurs d'évoluer. Pour le grand ballet de 1614, qui eut lieu à l'Arsenal et coûta 10.000 écus, le capitaine des gardes, chargé du service d'ordre, avait laissé pénétrer tout le monde. En arrivant, la reine, qui vit cette cohue, se mit dans une violente colère ; elle déclara qu'elle s'en allait, que la soirée n'aurait pas lieu. On se regarda navré ; les gardes du corps poussèrent dehors l'assistance. Alors Marie de Médicis, qui était déjà au Louvre et avait fait coucher Louis XIII, ordonna de le rhabiller, revint et, devant un public moins dense, le ballet fut donné tellement quellement. On finit par exigera la porte des méreaux, des marques[54]. Aux époques de deuil, Marie donne des fêtes plus intimes. Elle a monté dans l'entresol du Louvre un petit théâtre avec des sièges pour quatre-vingts personnes : on y représente des comédies légères. Ou bien elle va dîner chez la princesse de Conti, à Saint-Germain-des-Prés, chez madame de Guise, rue de Grenelle, chez madame de Guercheville, sa dame d'honneur, et après le repas, des jeunes gens, Bassompierre, M. de Chevreuse, M. de Vendôme, lui dansent, dans ce petit cercle, quelque menu ballet. Mais tous les soirs ne sont pas jours de fêtes, et le
couple royal reste souvent au Louvre : il ne sait pas demeurer seul. Lorsque
la reine a donné le bonsoir à tous ceux qui
remplissaient son Cabinet, chacun se retire, excepté les intimes avec qui un
nouveau cercle commence : la princesse de Conti, madame de Guise, sa mère, la
maréchale de Marie de Médicis joue surtout à la prime. Elle a un beau
jeu de cartes peintes et enluminées représentant divers animaux, que Louis de
Onze heures ont sonné à l'horloge du Louvre ; la ronde des gardes du corps, après avoir fait trois cris l'un après l'autre par la cour pour avertir à chacun de se retirer, ferme les portes du logis royal et va remettre les clefs au capitaine des gardes en demandant le mot pour la nuit. La reine s'attarde souvent de longues heures à deviser avec sa dame d'atour ou à écrire[57]. |