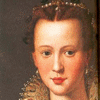LA VIE INTIME
D'UNE REINE DE FRANCE AU XVIIe SIÈCLE
CHAPITRE PREMIER. — MARIE DE MÉDICIS.
Enfance triste de Marie de Médicis. — Mort de sa mère, de ses frère et sœur, second mariage de son père. — Demeurée seule, elle reçoit pour compagne la petite Léonora Galigaï. — Education sévère de Marie. — Son aspect physique à dix-sept ans ; beauté, santé. — Projets de mariage ; nombreux et brillants partis ; échecs successifs des combinaisons. — La princesse, préoccupée par une prédiction, veut être reine de France. — Emprunts perpétuels des rois de France aux grands-ducs de Toscane à cette époque. — Pour obtenir de l'argent Henri IV propose d"épouser Marie de Médicis. — Marchandage de la dot. — Cérémonie du mariage et voyage en France. — La nouvelle reine le lendemain de son mariage ; son caractère, résultant de son tempérament. — Sa gaieté, sa bonne grâce. — Elle est d'intelligence médiocre et d'humeur changeante ; sa nervosité. — Intégrité de ses mœurs. — Passion pour la magnificence ; libéralité. — Sa religion formaliste. — Dons et aumônes ; bonnes œuvres impersonnelles et obligatoires.Petite princesse de Toscane, élevée dans le palais Pitti
que venait d'embellir l’Ammanati, au milieu des richesses d'art accumulées
par sa famille et des élégances réalisées par son père, Marie de Médicis
avait eu une enfance triste. A peine âgée de cinq ans, en 1578[1], elle avait perdu
sa mère, la pâle et délicate archiduchesse Jeanne d'Autriche, petite-fille de
l’empereur Ferdinand, frère de Charles-Quint, peu intelligente, morte sous
les brutalités de l'homme dur qu'elle avait épousé. Quatre enfants restaient
en bas âge, un fils, Philippe, trois filles, Eléonore, Anne et Marie. Le
père, François-Marie de Médicis, — qui, en 1574, avait succédé comme
grand-duc de Toscane à Côme Ier, — prince vigoureux, violent, doué de
qualités d'esprit brillantes, de goûts raffinés, mais égoïste, aristocrate,
emporté dans ses sentiments jusqu'à la cruauté, perfide, vaniteux, cruel, une
laide nature, était tout entier à des passions qu'il ne savait ni discuter ni
modérer. Sa liaison avec la célèbre Bianca Capello avait été la fable de
l'Italie et des cours étrangères ; deux mois après la mort de sa femme, il
l'épousait ; puis, trop absolu pour supporter la présence de ses enfants, qui
lui rappelaient des souvenirs importuns, il les installait au Pitti et se
retirait dans la solitude de Pratolino avec Bianca, s'enfermant, ne recevant
plus personne, occupé à surveiller l'accroissement de sa fortune
qu'assuraient des galions chargés de marchandises, des comptoirs de banque
créés dans les principales villes d'Italie, des magasins trafiquant à son compte
de diamants et de céréales[2]. Leur belle-mère
fut pour les enfants un objet de honte et de douleur. Marie de Médicis avouait
plus tard qu'en voyant la veuve d'un bourgeois de
Florence prendre la place de sa mère, elle ne
pouvoit souffrir cet abaissement fait par le poids d'un amour déréglé
; le duc Gonzague de Mantoue écrivait à l'archiduc Ferdinand : Le grand-duc n'a pas craint sinon d'abandonner entièrement
ses filles à cette femme avilie, du moins de permettre qu'elles aillent
publiquement ensemble avec elle dans Florence. Moins d'un an après la
mort de Jeanne d'Autriche, Bianca Capello donnait des fêtes brillantes, bals,
carrousels, tournois, chasses de taureaux et de bêtes fauves au filet,
comédies, parties de campagne. Elle avait fait croire au grand-duc qu'un
certain Antonio était leur fils, et le prince, pris de passion pour cet
enfant, le comblait de faveurs, lui donnant des apanages de soixante mille écus,
palais à Florence, maison aux champs, à De cette période de sa vie, l'enfant qu'était Marie de Médicis ne garda que des impressions douloureuses. Hasards ou présages, le souvenir d'accidents terribles resta gravé dans sa mémoire et, soixante ans après, elle en parlait encore avec effroi ; la foudre était tombée trois fois dans sa chambre, une fois cassant les vitres, une seconde fois blessant la femme de chambre, une troisième fois brûlant les rideaux du lit ; des tremblements de terre avaient par trois fois aussi secoué Florence et ébranlé le palais grand-ducal ; enfin un jour, près de Pise, se promenant au bord de la mer, la petite princesse avait manqué de se noyer. D'autres peines allaient encore et plus gravement l'attrister[4]. Chétif et d'une santé maladive, son frère Philippe mourait en 1583. Sa sœur Anne, plus âgée qu'elle de cinq ans, jeune fille vive et piquante, qui contribuait à donner quelque gaieté à leur petit groupe, était emportée assez brusquement le 19 février 1584, après une fièvre causée par des saignements de nez prolongés ; elle avait quinze ans. Cette même année 1584 n'était pas achevée qu'Éléonore s'en allait, mariée au duc de Mantoue, et Marie de Médicis demeurait seule, à onze ans, sans mère, presque sans père, dans ce grand palais où l'étiquette la condamnait à demeurer enfermée le plus possible, n'ayant plus personne des siens qui l'aimât, qui pût l'élever et en qui elle eût confiance. La voyant isolée, l'entourage eut alors l'idée, avec l'approbation du grand-duc, de lui donner une petite compagne. On fit choix d'une enfant âgée de huit ans, plus jeune qu'elle de trois ans, qui se nommait Léonora Dori, et ensuite s'appela Galigaï. C'était une fille pas jolie, très intelligente, maigre, brune, petite, nerveuse, douée surtout d'un esprit endiablé, d'une gaieté entraînante, ce que, plus tard, son secrétaire appellera une humeur plaisante et bouffonesque[5]. D'où sortait-elle ? Les contemporains, dans vingt et trente ans, seront malveillants ; les uns la diront fille d'un menuisier, les autres d'un charpentier et d'une mère diffamée ; la tradition s'établira qu'elle était fille de basse naissance, aussi dépourvue d'éducation que dénuée des grâces de son sexe. L'impopularité extrême dont elle a joui doit mettre en garde contre ces informations. Interrogée à son procès en 1617 sur son état civil, Léonora déclarera que sa mère s'appelait Catherine de Dori ; qu'elle n'a pas connu son père, lequel était gentilhomme florentin. La cour d'Henri IV, sollicitée en 1600 d'accepter Léonora comme dame d'atour à Paris et interrogeant pour savoir si elle était en mesure, par ses origines, de pouvoir monter dans les carrosses de la reine, recevra comme réponse que l'amie de Marie de Médicis est de bonne bourgeoisie et qu'à Florence bonne bourgeoisie vaut noblesse[6]. Les deux petites filles s'entendirent très bien. Fine, adroite, prudente, Léonora s'attacha à sa maîtresse, s'appliquant à être très complaisante, très diligente à la suivre et à faire ce qui estoit de sa volonté, à l'amuser. Abandonnée, ainsi qu'elle l'était, ne vivant, retirée dans son palais, qu'entourée de grandes personnes un peu austères pour elle, Marie se prit d'affection pour la compagne dévouée qui ne cherchait qu'à lui faire plaisir, lui faisoit passer le temps, lui servoit de conseil, et ainsi se fonda cette faveur que l'habitude ensuite ne devait que fortifier et qui allait durer jusqu'à la mort[7]. Le grand-duc François, pris d'une fièvre violente, mourut brusquement le 19 octobre 1587, jeune encore, — quarante-sept ans, — et le lendemain, quelques heures après, Bianca Capello le suivait, double mort mystérieuse qui excita les soupçons des Florentins, mortels ennemis de leur grand-duc. La disparition de son père allait modifier le sort de Marie. A défaut d'héritier mâle, le grand-duché de Toscane revenait au frère de François, Ferdinand, cardinal-diacre de la sainte Eglise romaine. Ferdinand abandonna la pourpre, prit le pouvoir. Fort et épais comme son frère, bien qu'il n'eût encore que trente-huit ans, pas distingué de formes, mais bon, libéral, aussi modéré et bienveillant que François avait été dur et sec, d'un naturel jovial et d'un entretien agréable, Ferdinand aima sa nièce comme sa fille. Le 30 avril 1589, il épousait Christine, princesse de Lorraine, nièce de Catherine de Médicis, qui avait elle-même négocié ce mariage. Christine, ou Chrétienne, avait seize ans, le même âge que Marie de Médicis[8]. L'arrivée à Florence de cette jeune grande-duchesse fit reprendre au Pitti l'air de fête et de gaieté qu'il avait perdu depuis longtemps. La parité des âges de la tante et de la nièce était un avantage ; elle était aussi un inconvénient, en raison de la difficulté pour les princesses de conserver les distances entre elles[9]. Des fêtes somptueuses marquèrent les premiers temps du séjour de Christine ; ce furent des galas au Pitti comme jamais Marie n'en avait vus. Ferdinand était plein de bonté pour Marie, Christine se montrait gracieuse. Les enfants, deux fils, une fille, allaient bientôt absorber le temps et les affections de celle-ci. L'éducation de Marie de Médicis avait été confiée par le grand-duc François à madame Orsini, une Romaine. Sévère, étroite d'idées, madame Orsini, — d'elle-même ou par ordre, — s'était appliquée à tenir sa jeune élève dans la retraite la plus absolue ; elle ne lui laissait voir personne, veillait à ce que Marie ne sût rien de la politique et des affaires, la suivoit attentivement. La petite princesse de Toscane y gagna de ne pas connaître les usages du monde, mais, en retour, on lui prêcha la docilité et le respect à l'égard de son père, celui-ci mort, à l'égard de son oncle et de sa tante[10]. Pour les études, comme il fallait quelque émulation, on lui adjoignit, parle commandement du grand-duc François, Antonio, le fils de Bianca, puis un cousin, Virginio Orsino, fils du duc de Bracciano et d'Isabelle de Médicis. Antonio était trop haï, en raison de son origine, pour produire quelque impression sur Marie de Médicis ; il n'en fut pas de même de Virginio ; de cette camaraderie, née de bonne heure, devait éclore un sentiment plus tendre, réciproque, semble-t-il, mais qui n'alla jamais, chez la princesse, jusqu'à la passion. Qu'y eut-il entre eux ? On ne le sait pas bien ; et, sans une indiscrétion de Christine, la tante, des jalousies aiguës d'Henri IV et des propos légers de la cour de France, plus tard, on ignorerait cette idylle incertaine des deux jeunes gens[11]. François de Médicis avait prescrit que sa fille reçût toute l'instruction désirable en ce temps. On ne lui apprit pas cependant le français. En revanche, les notions des arts lui furent enseignées d'une manière pratique. Le grand-duc était un savant et un artiste ; il était botaniste, chimiste, lapidaire ; il faisait de la peinture et de la porcelaine, notamment de l'imitation de la porcelaine chinoise ; il s'entendait merveilleusement aux pierres précieuses. Par goût personnel hérité de son père, Marie se mit avec ardeur à la peinture, à l'architecture, la musique, la sculpture et la gravure. Elle devait plus tard donner à Philippe de Champaigne un dessin gravé par elle, probablement à ce moment ; ce dessin existe encore : il autorise à penser que le maître de la princesse collaborait notablement à certaines œuvres trop achevées de son élève pour être d'un enfant amateur[12]. Comme le grand-duc, elle s'adonna aussi aux pierreries, sut de bonne heure discerner les vraies des fausses et s'éprit pour les parures en joyaux d'une passion dont on devait, jusqu'à sa mort, constater les dispendieux effets. Elle eut également du goût pour les mathématiques. Sous le règne de Ferdinand, le théâtre et la musique, très à la mode à la cour grand-ducale, furent l'objet de ses préférences : c'était le temps où les musiciens Jacobo Péri et Julio Gaccini composaient de véritables opéras et où Octavio Rinuccini mettait en musique la pastorale de Daphné. Vers dix-sept ans, elle était devenue une grande et blonde jeune fille, très bien portante, un peu grasse, sinon forte, agréable de fraîcheur et d'éclat, régulière de traits, — sans être positivement jolie, — saine et vivante. Sa figure trahissait sa double origine : la mère autrichienne, le père Médicis ; de sa mère, elle avait le bas du visage, le menton avançant des Habsbourg, l'ovale assez pur, les lèvres légèrement accusées, pas très distinguées, le nez fin et bien dessiné ; du père, elle tenait le front large et beau, le regard droit et ferme, l'ensemble assuré de la bonne bourgeoise qui a de la fortune. Mais hélas ! de la mère elle gardait l'intelligence insuffisante et du père aussi la volonté tenace, deux traits qui, réunis, ne donnent que de l'entêtement. Gracieuse, aimable, souriante, Marie était une princesse dont le regard et le front annonçaient une personne un peu bornée et têtue ; on s'en rendit compte de bonne heure[13]. Il fut très tôt question de la marier. Riche héritière de ces gros commerçants et banquiers qu'étaient les Médicis, elle constituait un parti royal. Ferdinand, son oncle, attentif à suivre une politique susceptible de lui procurer les profits les meilleurs, entendait bien ne la placer qu'aux conditions les plus avantageuses et ne la céder que contre espérances politiques larges et sûres. Un instant, l'aventure de Virginio avait inquiété. De cinq ans plus âgé que la princesse, Virginio n'avait-il pas osé, comme l'écrira plus tard Sully, concevoir des espérances par-dessus sa condition ? Christine avait dû défendre au jeune homme d'adresser la parole à Marie et le faire surveiller. Mais Marie ne voulait pas de lui. Il y eut pour elle une longue série de négociations diverses projetées, étudiées et rompues. Dès son avènement au trône, en 1587, Ferdinand, mal assuré encore de ses moyens, songeait à une union avec le fils du duc de Ferrare ; Marie avait quatorze ans. L'idée n'eut pas de suite. Informées que le grand-duc pensait à un mariage, les cours étrangères s'agitèrent. Un gouvernement paraissait surtout préoccupé, c'était celui du roi d'Espagne, à qui il importait que les trésors accumulés à Florence n'allassent pas, grâce à une alliance dangereuse, soutenir les entreprises de quelque adversaire politique. Il mit à suivre tous les projets, à les contrecarrer, à en proposer une persévérance inlassable. L'insuccès de la combinaison avec Ferrare établi, il insinua la sienne, un mariage avec le prince de Parme, Farnèse ; mais il s'était mal informé ; Farnèse avait des vues ailleurs et déclina. L'année suivante, en 1589, il revint à la charge et présenta un nouveau candidat, le duc de Bragance. Cette fois, ce fut Ferdinand qui refusa. La grande-duchesse Christine, de son côté, pensait à un prince français de la famille de Lorraine, M. de Vaudémont[14] ; elle fut un peu surprise en se heurtant à un refus énergique de Marie de Médicis. Qu'était-ce à dire ? On accusa la petite confidente de la princesse, Léonora, d'avoir donné de fâcheux conseils ; les explications furent embarrassées ; il y eut une scène, et Léonora manqua d'être chassée. Ferdinand conçut alors un brillant projet : c'était de donner sa nièce à l'archiduc héritier de l'empereur Mathias, frère de Rodolphe II, et qui, veuf de l'archiduchesse Maximilienne-Grégoire, ne se refusait pas à convoler en secondes noces. Le grand-duc tenta l'impossible pour y arriver, insinuations, artifices, flatteries, cadeaux au gouverneur du prince, le marquis de Dénia, bassesses même ; rien n'aboutit. Entre temps, le roi d'Espagne réapparaissait, offrant une seconde fois Bragance ; mais Bragance n'était pas prince régnant, et le grand-duc déclara qu'il ne pouvait accepter pour sa nièce un personnage réduit à l'état de particulier ; il prétendait la placer dans un rang au-dessus même de sa naissance et lui ménager un parti plus avantageux. Sur quoi, l'empereur Rodolphe, réflexion faite, se ravisait, demandait Marie de Médicis soit pour lui-même, soit pour son frère l'archiduc héritier et envoyait un conseiller, Corradino, à Florence afin de négocier. Ferdinand était enchanté. On convint du contrat ; la jeune fille aurait 600.000 écus si elle épousait l'empereur, 400.000 si elle prenait l'archiduc ; puis Corradino ajouta que, quant à la date du mariage, on ne pouvait pas la fixer, qu'il fallait attendre la paix et autre chose. Après des tergiversations bizarres, le grand-duc comprit qu'on se moquait de lui, qu'on allait le tenir en suspens tant qu'il y aurait intérêt pour l'empereur à ce que la princesse de Toscane n'épousât pas quelque adversaire et que, les difficultés passées, on romprait. Outré de colère, il reprit sa parole. Marie de Médicis ne tenait pas à ce mariage[15]. Elle avait, elle, son idée. Certaine religieuse, célèbre à
ce moment en Italie par sa sainteté, Les relations de Les emprunts d'Henri IV à Florence furent très nombreux. Il fallait, pour transporter des bords de l'Arno à Paris cent mille écus, dix-sept charrettes escortées par cinq compagnies de cavalerie et deux cents hommes de pied[18]. Les demandes continuelles créèrent entre les deux princes une situation bizarre. Afin d'excuser ses requêtes et d'en obtenir l'effet voulu, Henri IV se faisait humble : il parlait de protection ; il laissait entendre qu'il désirait avoir des conseils ; il multipliait les formules respectueuses et les témoignages de soumission. Du côté de Florence, on élevait le verbe avec humeur ; on articulait des plaintes et des reproches qui, chaque jour, allaient s'accentuant ; on prenait un ton de liberté et de remontrance singulier : Vous dépensez trop, disait-on, nous ne pouvons pas nous ruiner pour vous. Comment le royaume de France, qui est plus riche que nous, ne vous suffît-il pas ? Henri IV alors allait plus loin ; il proposait de se faire catholique, pensant de la sorte plaire au grand-duc ; pressé par la nécessité, il eût promis tout ce qu'on eût voulu[19]. Or, en 1592, le cardinal de Gondi, chargé par lui d'une
négociation d'emprunt de ce genre, s'étendant avec Ferdinand sur les projets
du roi de France et lui expliquant ses intentions, hasarda l'idée que le
prince pourrait bien obtenir en cour de Rome l'annulation de son mariage avec
Marguerite de Valois, et, devenu libre, épouser Marie de Médicis. Gondi, qui
avait pensé à tout, ajouta que le grand-duc donnerait certainement à sa nièce
un million d'écus d'or en dot. Sur le moment, Ferdinand entra dans la
combinaison avec empressement, ne parut pas faire d'objection au chiffre de
la dot, ce que le cardinal prit pour un acquiescement, et Henri IV, prévenu
du résultat de la démarche, ravi, — car, après tout, il avait le temps de
réfléchir avant l'annulation de son premier mariage, — se dépêcha d'envoyer Puis les choses tombèrent. Henri IV était trop occupé de gagner son royaume ; son cœur était pris ensuite et la cour de Florence, très au courant de ce qui se passait à Paris, n'avait pas de peine à penser que la passion du roi pour Gabrielle d'Estrées rendait impossible une union quelconque. Ferdinand chercha ailleurs un mari pour sa nièce. Cette passion pour Gabrielle d'Estrées, dont on voulait, à n'importe quel prix, écarter les conséquences menaçantes, à savoir un mariage, décida l'entourage d'Henri IV à reprendre quelques années après le projet d'union avec Marie de Médicis. Tout le royaume souhaitait le remariage du prince, tout le monde redoutait le scandale de l'union avec la maîtresse. Dès 1597, le légat parla de la princesse de Toscane au cardinal de Gondi, le pape étant très partisan de l'annulation du mariage de Marguerite, de l'éloignement de Gabrielle et de l'idée florentine. Il ne fallut rien moins que la question d'argent criante et inéluctable pour décider Henri IV à subir ce que la nécessité de ses finances et le souci de sa dignité imposaient aux ministres[21]. Les dettes de On chargea Geronimo Gondi d'aller trouver le grand-duc à Florence et de reprendre les pourparlers. Ferdinand, tenu au courant par ses agents diplomatiques, attendait. Le pape était de son côté. Rome voulait bien annuler le mariage de Marguerite de Valois afin de permettre l'avènement au trône de la princesse de Toscane, mais non celui d'une maîtresse, soucieuse de légitimer ses enfants. Gondi fut très bien reçu. Sur le principe même du mariage, il n'y avait pas de difficulté, on était d'accord ; mais, lorsque le négociateur parla du million de dot, le grand-duc indigné se récria : jamais il ne donnerait une somme aussi exorbitante ! En vain Gondi invoqua-t-il que quelques années auparavant Ferdinand avait accepté ce chiffre, le Florentin nia énergiquement[24]. De Paris, les ministres Villeroy et Rosny, informés de la difficulté, mandèrent à Geronimo de rentrer, et il fut décidé que les discussions se poursuivraient au Louvre entre le gouvernement et l'envoyé florentin Baccio Giovannini. Henri IV commença par insister pour avoir, même, un million et demi de dot, le million représenté par les dettes et le reste livré en deniers comptants. Entendez bien, disait-il : en 1592, vous consentiez à admettre le chiffre de un million, et je n'étais pas roi assuré ! Aujourd'hui où je le suis, je vaux moitié plus ! Giovannini riposta qu'il avait ordre de ne pas suivre la cour de France sur ce terrain et qu'il ne pouvait offrir que 500.000 écus ; l'empereur se contentait bien, lui, de 400.000 pour l'archiduc héritier ! Mais, sous main, l'envoyé florentin suppliait le grand-duc, son maître, de consentir à des sacrifices. Si le roi n'épouse pas Marie, disait-il, il n'épousera personne ou qu'une maîtresse ; ce royaume se ruinera et vous perdrez toutes vos créances. De leur côté, les ministres d'Henri IV conseillaient à celui-ci de baisser ses prétentions et de descendre jusqu'à 800.000 écus. On écrivait au pape de peser sur le grand-duc de Toscane ; on introduisait à Rome le procès en annulation du mariage de Marguerite de Valois et on le poussait avec activité[25]. Ferdinand consentit à monter jusqu'à 600.000 écus. Alors les ministres de France, de plus en plus préoccupés de la passion du roi pour Henriette d'Entraigues, se décidèrent à lui faire accepter ce chiffre. Après tout, déclarait Sully, jamais reine de France n'avait eu si forte dot ; et sans ironie il ajoutait, parlant à Henri IV : Il n'est pas de la dignité de votre personne de prendre une femme pour de l'argent, de même qu'il ne faut pas que le grand-duc achète voire alliance pour une somme. Moitié lassitude, moitié insouciance, — il avait l'esprit ailleurs, — Henri IV céda. Il fut donc arrêté que la dot serait de 600.000 écus, dont 350.000 donnés comptant et le reste à valoir en créances. L'affaire était conclue[26] ! Pauvre princesse Marie ! Il avait été bien peu question de sa personne, de ses goûts, de son bonheur pendant ces discussions intéressées. Le roi de France ne savait à peu près rien de sa future fiancée et il n'avait rien demandé. On lui avait parlé vertus, des grâces, de la piété chrétienne et de la beauté de cette princesse accomplie ; il s'en tenait à ces banalités[27]. Il attendit six mois après la décision du mariage pour s'enquérir auprès de M. d'Alincourt, revenant de Florence, de ce que celui-ci pensait de Marie de Médicis, et M. d'Alincourt, en bon courtisan, ne put faire qu'un honorable récit de la personne et du mérite de la princesse. Henri IV se déclara très content, ajoutant, il est vrai, comme je fais du contenu des articles du contrat de mariage[28]. Tout au plus s'était-il assuré qu'elle avait bonne santé et semblait en mesure d'avoir des enfants, puis qu'elle savait monter à cheval, car il projetait de la faire beaucoup voyager, de lui montrer le royaume pendant un an, et, entre autres, de la mener à Pau voir la maison paternelle de l'ancien roi de Navarre, ainsi que le jardin planté par lui dans sa toute jeunesse[29]. Les deux cours avaient échangé les portraits des futurs. Pour Marie, il était temps que ces discussions prissent fin. Elle venait d'avoir vingt-sept ans. Depuis qu'on parlait de son mariage, que tant de partis avaient été proposés et n'avaient pas abouti, elle désespérait ! A défaut du roi de France, lorsqu'on lui avait présenté l'archiduc Matthias, homme difforme et violent, elle avait dit qu'elle irait plutôt dans un couvent que de l'épouser. Une profonde mélancolie la minait ; sa santé était atteinte ; sa beauté, faite d'éclat et de fraîcheur, se fanait. La décision du mariage avec le roi de France la ranima. Elle aussi ne se préoccupa pas de l'homme ; elle ne fit aucune objection aux histoires de maîtresses et à la faveur éclatante d'Henriette d'Entraigues. Comme elle, tout le peuple de Florence exultait de l'événement qui allait la mettre sur le principal trône royal de l'Europe ; c'était la réalisation des rêves de la petite princesse. Le mariage avait été arrêté à la fin de décembre 1599[30]. On envoya Sillery à Florence avec son fils d'Alincourt dans les premiers mois de 1600 pour dresser le contrat, lequel fut signé le 23 avril[31]. Il ne restait plus qu'à procéder au mariage lui-même. Ce fut très long. Pour beaucoup de raisons, il fut décidé
que Marie ne viendrait en France que dans cinq mois, en septembre, puis que
les cérémonies auraient lieu à Florence, Henri IV devant être représenté par
le duc de Bellegarde, son grand écuyer, auquel il donnerait procuration. En
réalité, le mariage ne fut célébré que le 5 octobre. La guerre avec le duc de
Savoie, l'amour, plus violent que jamais, d'Henri IV pour Henriette
d'Entraigues et mille autres prétextes avaient retardé. Ce furent, dans la
capitale de L'air très heureux, Henri IV, les jours qui suivirent son mariage, répétait à qui voulait l'entendre que la reine était belle, plus belle qu'on ne lui avait dit et qu'il ne l'avait cru d'après ses portraits ; qu'il l'aimait non seulement comme sa femme, mais comme sa maîtresse, et qu'elle était bien celle qui lui convenait le mieux[38]. Tout épanouie par ses grandeurs nouvelles, Marie, en effet, était resplendissante. Dans une seconde circonstance, elle paraîtra aussi à ses contemporains la plus belle des femmes de la cour, ce sera le lendemain de la mort du roi, lorsque le sombre de ses vêtements de deuil, faisant ressortir son beau teint de blonde, dissimulera mal la satisfaction intime qu'elle éprouvera à se sentir reine régente du royaume[39]. La jeune fille bien portante et fraîche s'était développée en une belle jeune femme éclatante de santé. Elle est fort riche de taille, dit un contemporain qui la vit passer dans Paris à ce moment, grasse et en bon point ; a l'œil fort beau et le teint aussi, mais un peu grossier, au reste, sans fard, poudre ni autre vilainie. Le roi disait : Elle a un naturel terriblement robuste et fort. En mon particulier, écrivait-elle elle-même journellement aux gens auxquels elle donnait de ses nouvelles, je ne fus jamais plus saine. Avant de la connaître, Henri IV lui avait mandé gaiement qu'elle se tînt saine et gaillarde. Ce dernier mot lui avait plu, et elle l'avait gardé. Quant à moi, écrit-elle à l'un ou à l'autre, je suis toujours gaillarde[40]. Pour lui faire conserver cette heureuse santé, dont il
avait besoin, avouait-il, afin d'avoir d'aussi beaux
enfants que ceux qu'il avait eus de Gabrielle, Henri IV la soumit à
une hygiène spéciale : d'abord la purgation et la saignée[41]. Sur ses
conseils pressants, tels, comme l'envoyé florentin, se purgeaient trois fois
en trois jours afin d'expulser tous les excréments
et superfluités et ne pas laisser souffrir la nature, puis se
faisaient tirer deux livres de sang. Le chirurgien Hélie Bardin eut mission
de donner à la reine ses coups de lancette à intervalles réguliers, afin de la rafraîchir et aussi pour la rendre plus
disposée. Il en coûtait au trésor Elle ne fut jamais malade. Venant d'Italie, elle souffrait d'un mal d'estomac dont les médecins italiens n'avaient pu venir à bout, parce qu'ils n'avoient jamais reconnu la cause du mal et m'ordonnoient toutes choses chaudes, tandis que les médecins français l'avaient guérie, reconnaissant que son mal provenoit de la chaleur du foie et ne m'ordonnant que des choses froides et rafraîchissantes. Elle gardait, pour le principe, la caisse d'eaux médicinales que lui avait envoyée le grand-duc de Toscane, eaux et remèdes propres à plusieurs sortes de maladies dangereuses ; elle conservait dans la liste des gens de sa maison le distillateur Charles Huart, destiné à lui préparer de bons et salutaires remèdes ; elle n'avait à user ni des uns ni des autres. Tout au plus fut-elle prise de quelque mal de dents ; mais alors, peu confiante cette fois dans les médecins français, cependant nombreux autour d'elle et experts, à son dire, elle fit venir d'Italie un certain Geronimo, opérateur, en toute diligence, avec toutes les recettes, médicamens qu'il a pour ce, ensemble les engins les plus propres pour en faire arracher, s'il en étoit besoin, afin d'être soignée. Les principaux incidents de sa vie physique ont été les grossesses. Elle les a eues pénibles, en raison des tourments, des peines et des scènes violentes que causa dans le ménage l'histoire de la marquise de Verneuil. La première, celle du dauphin, avait été assez bien supportée. Au moment de l'accouchement, Marie fut tenue quelque temps en grand péril, parce qu'elle avait mangé trop de fruits, crut-elle. Les autres furent fâcheuses. En 1605, partant enceinte de Tours pour aller à Amboise, elle dictait, donnant de ses nouvelles à une amie : J'estois tellement incommodée de ma grossesse que je ne peux vous escrire de ma main[44]. Les médecins s'inquiétaient d'interminables et violents dérangements. Une fâcheuse maladie de flux de ventre, mande-t-elle deux ans après à la grande-duchesse de Toscane, dans des circonstances semblables, dont j'ai été travaillée depuis dix ou douze jours, l'oblige à garder le lit et l'accable. Pour le second fils, — un duc d'Orléans qui devait mourir de bonne heure, — les fatigues extrêmes de la grossesse, jointes aux soucis causés par Henriette d'Entraigues, eurent pour effet que l'enfant vint dans le plus pitoyable état, hydrocéphale, sujet aux convulsions, peu viable. Pendant la grossesse qui précéda la naissance d'Henriette, il fallut supprimer tous les plaisirs de la cour, bals et autres ; Marie de Médicis maigrissait, de violentes coliques la torturaient. Les suites de ces couches furent un instant redoutables. Depuis estre accouchée, mandait-elle à la duchesse de Mantoue, j'ai été travaillée de très grandes douleurs de coliques et suffocation intérieure dont j'ai enduré beaucoup de douleurs ; longtemps elle demeura prostrée et affaiblie. Henri IV était préoccupé[45]. Ce n'était pas que les soins lui manquassent. Elle avait désiré accoucher de tous ses enfants à Fontainebleau, où elle se plaisait beaucoup ; tous y sont nés, sauf Henriette. On lui installait dans la chambre ovale, dite aujourd'hui de Louis XIII, un beau lit de velours cramoisi rouge, accommodé d'or, recouvert d'un baldaquin ou pavillon de toile de Hollande, la chaise tout auprès pour le travail, également garnie de même velours rouge. Elle avait près d'elle une sage-femme réputée, Louise Bourgeois, femme du chirurgien-barbier Martin Boursier, laquelle n'était pas seulement une matrone de plus ou moins d'expérience, mais une savante connaissant la médecine, sachant écrire des livres en termes techniques et qui nous a laissé le détail des Six couches de Marie de Médicis[46] ; puis un accoucheur apprécié des femmes du temps, fort demandé et célèbre pour son habileté, M. Honoré, très expert, confie Marie de Médicis à la duchesse de Lorraine, qui attend un enfant et à qui elle le propose ; je suis aise de l'avoir près de moi quand je suis en semblable accident ; enfin, le médecin ordinaire du roi, M. Petit, qui ne manquait jamais. En même temps que les secours matériels, ceux du ciel, plus importants pour les contemporains d'Henri IV, étaient abondamment sollicités. On faisait dire dans toutes les églises de Paris et d'ailleurs les prières des quarante heures[47] ; Marie de Médicis commençait une dévotion appelée des trois jeudis ; le trésorier général de sa maison, M. Florent d'Argouges, délivrait des prisonniers et distribuait d'abondantes aumônes ; enfin et surtout, tout le monde priait sainte Marguerite. La dévotion à sainte Marguerite pour l'heureuse délivrance des femmes en couche était fort à la mode, et Marie de Médicis la goûtait ; elle faisait lire autour d'elle la vie de la sainte ; il y avait à Saint-Germain-des-Prés une relique de la ceinture de la bienheureuse qui avait pour vertu d'empêcher de crier ; cette relique était fort demandée, même par de simples particuliers, auxquels on la confiait, et, en son honneur, on célébrait tous les ans une fête solennelle à l'abbaye, afin de rendre fécondes les femmes stériles et de faciliter le travail de celles qui ne l'étaient pas. Marie de Médicis demandait au prieur de lui envoyer à Fontainebleau le fragment en question de la ceinture ; deux moines venaient l'apporter dans un carrosse de la reine ; on installait la précieuse relique dans la chambre ovale, sur une table recouverte d'un tapis, et, pendant que la reine souffrait, les deux religieux, à genoux dans une pièce voisine, priaient pieusement[48]. On dit que Marie de Médicis mourut plus tard, en 1642, d'une hypertrophie du cœur. Cette affection cardiaque aurait pu lui venir à la suite des émotions nombreuses et des déceptions de la seconde moitié de sa vie. Rien ne la révèle dans le temps de sa gloire et de sa puissance. Peut-être la nature nerveuse et sanguine que l'envoyé florentin Guidi constatait chez elle l'y prédisposait-elle[49]. C'est cette nature nerveuse et sanguine qui explique surtout le caractère moral de Marie de Médicis. Marie de Médicis a laissé dans l'histoire une impression défavorable. Résumant le sentiment de la postérité, Saint-Simon esquissait d'elle un portrait extrêmement sévère. Quand on voit le curieux dessin que l’an Dyck a tracé pour la représenter sur ses vieux jours, on est tenté de donner raison au rude auteur du Parallèle des trois premiers Bourbons. C'est bien la figure d'une femme méchante, jalouse, dont la physionomie antipathique annonce un esprit borné à l'excès, toujours gouverné par la lie de la cour, sans connaissance aucune et sans la moindre lumière, dure, altière, impérieuse[50]... Et, de fait, depuis sa chute du pouvoir en 1617 jusqu'à sa mort à Cologne, elle a passé sa vie dans des intrigues misérables, préoccupée surtout de brouiller les affaires du royaume, de provoquer des troubles et de renverser Richelieu. Mais, pour juger équitablement le caractère de la mère de Louis XIII, il faudrait analyser plusieurs éléments distincts : savoir ce qu'elle était en venant en France, en 1600 ; quelle impression a produite sur elle sa vie d'intérieur avec Henri IV, vie d'humiliations et de larmes ; déterminer les modifications amenées par l'exercice du pouvoir absolu de 1610 à 161", dans tout l'épanouissement d'une vanité satisfaite, d'une volonté obéie et dégoûts contentés ; enfin, mesurer la profondeur de la chute provoquée par le coup d'Etat du 24 avril 1617, qui, de reine toute-puissante, la rabaissa au niveau d'une particulière prisonnière à Blois ou en fuite et révoltée ; et, de la souveraine adulée, ne fit plus qu'une basse intrigante, chagrine, querelleuse, dépensière, — et dépourvue d'argent, — ambitieuse, — et dénuée d'influence. Si elle était morte à la fin de 1616, sa réputation eût été meilleure ; peut-être justifierait-on toute sa politique de la régence en disant que, sans expérience et sans autorité morale, elle ne pouvait rien faire de mieux que de suivre les conseils prudents de vieux ministres circonspects et de temporiser, concilier, céder. L'année de la chute de Concini lui a été fatale. La disgrâce et le malheur ont eu pour résultat de développer ses défauts jusqu'à l'odieux et de faire disparaître ce qu'elle pouvait avoir de qualités. L'histoire Fa jugée sur sa conduite finale ; les contemporains, en 1601, n'étaient peut-être pas aussi rigoureux. L'impression qu'elle fit en arrivant en France fut en effet excellente. On la célébra en éloges dont les termes évidemment étaient vagues et d'une banalité que le genre d'ailleurs comportait en ce temps. Les poètes l'environnèrent d'une auréole charmante[51]. Elle s'était présentée au roi son mari craintive et timide, — elle a toujours eu un fond de timidité, — très résolue à être soumise et obéissante ; Henri IV lui témoigna sa joie par mille prévenances. Je ne saurais vous dire, écrivait-elle au grand-duc, de quelles marques d'honneur et de faveur Sa Majesté m'a entourée et avec quelle bonté elle me traite en toute occasion. Le public la trouva belle et gracieuse ; chacun répétait combien, dans les cérémonies publiques, elle savait montrer une gravité majestueuse et vraiment royale. Sully fut sous le charme : Il n'y avait rien, dictait-il plus tard dans ses Economies royales, qui fut plus digne d'admiration que son beau port et contenance, sa bonne mine, sa belle taille, sa grâce, sa majestueuse présence et sa vénérable gravité, voire sa gentillesse, industrie et dextérité à gagner les cœurs et s'acquérir les volontés et affections des personnes lorsqu'elle y voulait employer ses cajoleries et les charmes de ses belles paroles, courtoisies, promesses, caresses et bonnes chères estant d'autant plus puissantes et pleines d'efficaces qu'elles estoient moins communes et ordinaires. L'ambassadeur vénitien la trouvait angélique, di qualita veramente angeliche, et le bon l'Estoile, se faisant l'interprète du sentiment populaire, écrivait : L'humeur de la roine plaira au roi, car elle est prompte et gaie, porte une grandeur au front assez modérée et toutefois est accorte[52]. Malheureusement, il était des ombres à ce tableau. Personne ne parlait de son intelligence. Sur ce point, aux premières entrevues à Lyon, Henri IV s'était trompé. Le grand-duc de Toscane, mieux informé et connaissant sa nièce depuis longtemps, avouait à M. d'Alincourt, l'ambassadeur du roi de France, qu'elle était loin de valoir sa sœur, la duchesse de Mantoue[53]. Il fallut bien s'en apercevoir lorsque le roi son mari, soucieux de l'avenir, chercha à la faire assister aux conseils du gouvernement pour lui apprendre le maniement des affaires ; elle manifesta une incapacité si surprenante, une indifférence si ennuyée qu'il fallut y renoncer. Peut-être son ignorance de la langue française, au début, était-elle cause de cette répugnance[54]. Le cardinal de Richelieu, cependant, la jugeait plus tard à sa valeur, mais, par discrétion, attribuait son insuffisance au peu de connoissance qu'elle avoit des affaires générales, au peu d'application de son esprit, qui refuit la peine en toutes choses, et ensuite à l'irrésolution perpétuelle en laquelle elle étoit. Cette irrésolution, dont la politique hésitante de la régence a été le témoignage, pouvait bien venir en grande partie des avis temporisateurs de conseillers plus que prudents ; elle venait aussi de l'impossibilité de la souveraine à voir clairement toutes les raisons des partis à prendre et à choisir. Les défaillances de la volonté ne sont que des faiblesses de l'intelligence. Nous venons de voir la réserve qu'indiquait Sully lorsqu'il parlait de l'amabilité de Marie de Médicis, appréciant cette amabilité d'autant plus qu'elle n'était pas commune ; elle était très peu commune. La reine paraissait inabordable ; elle est assez grave de son naturel, écrit Richelieu, et peu caressante. La princesse de Conti, son amie intime, cependant, remarquait de son côté que la souveraine estoit assez froide à tout le monde, et un ambassadeur étranger notait pour son gouvernement combien Marie se montrait peu affable à l'égard des princes et des courtisans, fort différente en cela des précédentes reines de France[55]. Du peu d'amabilité au caractère agressivement désagréable, il n'y a qu'un pas. Pour beaucoup, cette froideur, qui n'était que la marque d'une personnalité peu douée du côté de l'esprit et du cœur, était de la morgue. Elle est d'humeur altière, jugeait Fontenay-Mareuil. On la trouvait hautaine. Elle était surtout entière. Irrésolue dans les grandes affaires, comme elle devait le manifester, elle était intraitable dans les petites. Henri IV en était outré. Il disoit souvent à ses confidents qu'il n'avoit jamais vu femme plus entière et qui plus difficilement se relâchât de ses résolutions. Constatant que le dauphin avait une volonté aussi irréductible, le roi, une fois, s'était échappé à dire à la reine : Étant de l'humeur que je vous connois et prévoyant celle dont votre fils sera, vous entière, pour ne pas dire têtue madame, et lui opiniâtre, vous aurez assurément maille à départir ensemble[56]. Il disait vrai. Or, cette froideur apparente cachait une nervosité extrême. Tout agissait sur elle ; le moindre fait causait un ébranlement maladif avec répercussions interminables. Elle déclarait à Henri IV qu'elle se tourmentoit tellement en tout qu'elle s'esbahissoit si elle n'estoit maigre. Elle avait de perpétuelles colères, et pour des riens[57]. Une nervosité développée se traduisant par une sensibilité excessive à propos de mille détails de la vie quotidienne va souvent avec une humeur changeante, disposée, pendant les temps calmes, à prendre les choses gaiement. Le propre de certains êtres nerveux est d'être tantôt irritables et déprimés, tantôt optimistes. Marie de Médicis appartenait à cette catégorie de tempéraments. Elle aimait à rire et plaisanter, — Léonora avait dû son succès à son humeur joyeuse. — L'amusement lui plaisait : bals, comédies, parties, tout ce qui entraînait, distrayait, provoquait la gaieté de l'âme et du corps était son fait. Nous continuons à vivre gaiement, comme de coutume, écrivait-elle une fois en 1609 à la duchesse de Montpensier ; elle eût pu l'écrire tous les jours. Pareille prédisposition, chez une personne peu intelligente, produit souvent la légèreté inconsistante. A regarder parler et agir Marie de Médicis durant les dix premières années de son séjour en France, on finit par avoir l'impression d'une femme peu assurée d'elle-même, instable, agitée, incapable d'une suite d'idées un peu ferme et raisonnée ; en somme, une nature assez médiocre et vacillante. Par une contradiction fréquente chez les caractères de ce genre, la mort d'Henri IV la changea brusquement. Devant les responsabilités qui s'imposaient à elle, elle se réforma. Autant elle avait été auparavant insouciante, se levant tard, ne s'occupant de rien, que de ses toilettes et de ses plaisirs, autant elle s'appliqua aux affaires avec une constance inattendue : elle fut sur pied de bonne heure, tint conseil toutes les matinées, des heures durant, donna audience sans discontinuer pour traiter des intérêts publics. Les ambassadeurs étrangers, Contarini, Gussoni, Nani, étonnés, l'écrivaient à Venise ; elle-même avoua, dans un document public, que le travail seul avait pu accoiser (diminuer) l'affliction profonde causée par l'assassinat de son mari, et elle en avait tiré cette maxime qu'elle redisait aux autres : Toute douleur s'allège quand on travaille de toute affection à ce qui tourne au bien de la République[58]. Voulait-elle donner tort au mot de l'écrivain du XVIe siècle : Vengeance, colère, amour, légèreté, impatience rendent les femmes incapables au maniement des affaires d'Etat ; leur domination est pleine d'inconstance, leurs entreprises sont défectueuses pour estre craintives, irrésolues, soudaines, indiscrètes, glorieuses, ambitieuses ?[59] En présence de nombreux écrits qu'elle recevait, remplis de conseils et d'avis à la royne mère, des moyens propres à tenir le gouvernement du royaume, et qui attestaient de la part de leurs auteurs de sérieuses appréhensions sur ses aptitudes aux fonctions que les hasards et la fortune lui donnaient l'occasion de remplir, était-elle soucieuse de mériter l'estime des gens de bien et de s'acquitter de ses nouveaux devoirs avec zèle[60] ? Henri IV reconnaissait volontiers que, si elle était discrète et gardait bien ce qu'elle ne voulait pas dire, elle étoit aussi désireuse d'honneur, glorieuse par excès de courage, et que, si on pouvait l'accuser de paresse, ou pour le moins de fuir la peine, elle ne reculait devant rien si elle étoit poussée à l'embrasser par passion. Vraie Médicis, Marie a eu la passion du pouvoir, de la grandeur, de l'autorité suprême, et c'est cette passion qui explique sa transformation en 1610. Cette passion explique — étant assez absorbante par elle-même — que Marie n'en ait pas eu d'autres. Il faut ranger parmi les erreurs historiques tout ce qui a pu être dit des prétendues amours de Marie de Médicis. D'un tempérament très froid, la reine était insensible aux sentiments qu'elle eût pu provoquer et trop peu Imaginative pour suppléer à l'insuffisance de sa nature, rien moins qu'ardente, par les rêves romanesques d'un esprit désœuvré. La malignité publique de son temps lui a prêté pour Concini un penchant coupable, mais, à vrai dire, c'était un bruit plaisant chez les contemporains plutôt que l'expression d'une conviction certaine[61]. Si par ailleurs on avait connu les véritables relations de la reine et du maréchal, relations généralement tendues et non amicales, quelles que fussent les apparences, — le pouvoir extraordinaire de Concini fut dû, en partie, à un jeu double du personnage qui a trompé tout le monde, en se servant du crédit réel de sa femme, faisant croire aux ministres qu'il pouvait tout sur l'esprit de la reine et à celle-ci que lui seul tenait ministres et princes, ce qui a fini par être vrai à force de malentendus, — on se fût convaincu que l'hypothèse de cette faiblesse n'était pas même vraisemblable. Dramaturges et romanciers lui ont prêté ensuite le cardinal de Richelieu ; c'eût été le fait, chez elle, d'une passion d'automne bien tardive, — car elle aurait eu à cette date de quarante-cinq à cinquante ans, — et chez le cardinal, si sec, tout en intelligence, très peu doué sur le chapitre du cœur, et pas du tout du côté des sens, d'un effort hors de proportion avec ses manières ; sans parler de la sévérité de Louis XIII, qui n'eût jamais toléré près de lui le soupçon d'un désordre aussi scandaleux[62]. En réalité les plus qualifiés de ses contemporains ont rendu hommage à l’intégrité de ses mœurs[63]. Légende aussi — il est à peine besoin de le dire — que la thèse renouvelée de nos jours, d'après laquelle, descendant de toute une lignée d'empoisonneurs, Marie de Médicis aurait empoisonné elle-même, se livrant aux sortilèges, aux incantations, à la magie. Il n'est aucun texte sérieux qui donne l'ombre d'apparence à cette accusation mélodramatique[64]. Elle n'eut que la passion du pouvoir. Cette passion explique qu'en vraie héritière d'une famille connue pour sa magnificence, la reine ait tenu à exercer l'autorité suprême avec des formes de libéralités royales, et ceci est l'un des traits caractéristiques de Marie de Médicis. Les contemporains ne tarissent pas sur sa bonté : Libéralité et magnificence, s'écrie Matthieu de
Morgues, sont les vertus morales qui ont le plus
éclaté en nostre princesse. Bassompierre, qui en savait quelque chose,
déclarait qu'en magnificence et générosité la reine
avoit dépassé toutes les autres princesses du monde. Richelieu la
trouvait de son naturel magnifique, et,
lorsqu'elle donnait — Dieu sait si elle donnait autour d'elle, — elle aimait
à dire que ce qu'elle faisait était pour faire
paroître sa grandeur et sa libéralité[65]. Elle a mis un
point d'honneur à se donner cette réputation. Peut-être se mêlait-il à ses
sentiments quelque préoccupation de vanité et une tendance peu douteuse à la
dissipation — les embarras perpétuels de ses finances en ont été la suite. —
Ce sont surtout les dons faits au nom de la religion qui témoignent de cette
profusion inconsidérée et nuancée d'ostentation. Etant donné son esprit, sa religion, évidemment, ne
pouvait être ni forte ni éclairée ; elle n'était que formaliste. Marie de
Médicis, conformément au protocole royal, entendait la messe le matin, au
Louvre ou ailleurs. En bonne paroissienne, elle faisait régulièrement ses pâques
tous les ans à l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois ; elle suivait à pied,
selon la tradition royale, la procession de Vraie dévote, avec les formes voulues, elle faisait des
pèlerinages ; elle faisait des vœux ; elle chargeait tel comme l'évêque
d'Avranches d'aller au Mont-Saint-Michel, au sanctuaire de l'archange, accomplir
un vœu formulé par elle[71]. Elle tenait aux
reliques, en recevait beaucoup, en envoyait de même ; expédiait des reliques
de la vraie croix à la duchesse de Lorraine, sa nièce, enceinte ; adressait deux morceaux des reliques de saint Vincent de
Vannes à la femme d'un ambassadeur d'Espagne, pour qu'elle en mît une au cou,
dans un reliquaire, l'autre dans une boîte d'ivoire, sur un autel ; réclamait
à l'évoque de Meaux les reliques de saint Fiacre, qu'elle faisait porter à sa
tante, la grande-duchesse, laquelle bâtissait une chapelle à ce saint aux
Augustins de Florence[72]. Elle
multipliait aux églises et chapelles de ces dons faciles par lesquels on
croyait racheter de bonnes œuvres payées les fautes commises contre les lois
du décalogue : lampes à Dans ses dons et aumônes il faudrait distinguer : ceux que les habitudes françaises ont imposés à la reine de France ; ceux que la tradition florentine des Médicis la sollicitait de continuer à Paris ; ceux qu'elle décida, inspirée par son goût de magnificence ; ceux dont un sentiment de pitié et de charité intimes était vraiment la source. Ceux-ci furent les moins nombreux : il y en eut quelques-uns. C'était bien peut-être par un bon mouvement de son cœur qu'encore jeune fille, ayant à ses ordres une de ces esclaves turques prises dans des razzias sur les côtes barbaresques, elle la libérait, la faisait baptiser, nommer Jeanne Médicis et la mariait à un Florentin appelé Montanti. Encore à Florence, elle avait converti une de ses femmes de chambre provenant de la même origine, avait été sa marraine et lui avait fait épouser Mattiati Vernacini, emmenant le couple en France en 1601. Du reste, le goût des conversions devait la suivre longtemps, car ne s'avisait-elle pas plus tard de vouloir faire abjurer certain médecin juif portugais, Montalto, en qui elle avait grande confiance, et n'eut-elle pas l'idée de le faire instruire par le cardinal du Perron ! Elle chargeait M. de Brèves, ambassadeur à Constantinople, de lui envoyer du Levant des familles turques à convertir, gens travaillant à des broderies ; elle donnait de l'argent ; on embarquait ces Levantins sur des vaisseaux vénitiens, aux moindres frais possibles ; on les conduisait à Paris après leur avoir fait dire qu'ils étaient en volonté de se faire chrétiens s'ils étaient aidés de quelques moyens de vivre. Elle devait s'inquiéter des missions en pays païens, et le lieutenant pour le roi en aucun pays des sauvages des Indes occidentales ayant demandé quelques capucins pour vacquer autant qu'ils pourront à l'établissement de la foi chrétienne, elle s'entremettait et en obtenait quatre du Père provincial de l'ordre en France. Protéger les missionnaires, en l'espèce des capucins, et rapatrier les huguenots, s'il s'en trouvoit, fut l'instruction qu'elle prodigua aux gouverneurs de colonies, secondant les efforts de tous ceux qui partaient pour les terres lointaines, afin de fonder des établissements, mais surtout afin d'assurer la propagation de la religion. M. Jean de Biencourt, sieur de Poutrincourt, s'en allant au Canada, en Acadie, avait reçu ainsi 500 écus et deux jésuites, les PP. Biard et Massé[74]. Elle était touchée sans doute encore lorsqu'elle accompagnait elle-même aux Carmélites deux de ses femmes de chambre se faisant moniales ; ou bien qu'elle obtenait du roi Henri IV, à force d'instances, la grâce d'une pauvre jeune femme détenue au For-l'Évêque et condamnée à mort, — le cas est peu fréquent dans la vie de Marie de Médicis, — ou qu'elle écrivait et faisait écrire par le roi à tel gouvernement étranger, celui de Venise, afin d'obtenir le rappel d'un malheureux banni du territoire de la République[75]. Mais le reste de ses bonnes œuvres n'a été qu'actes impersonnels, obligatoires pour la 'fonction, portant leur marque d'ostentation et de parade. Ainsi la reine donnait aux pauvres à la semaine sainte et
à Noël : donations réglées ; pendant la semaine sainte : De même, Marie de Médicis, chaque année, fournissait à
treize jeunes filles les moyens matériels de se marier, fondation
traditionnelle et imitation de ce qui se faisait à Florence, où Laurent le
Magnifique dotait ainsi des filles peu fortunées[76]. En août, le premier
aumônier de la reine, le cardinal de Bonsi, présentait à la souveraine une
liste déjeunes filles susceptibles d'obtenir la faveur enviée ; Marie
choisissait, et les sommes étaient remises le 15 août avec des cérémonies
spéciales. Une madame Dujardin remettait les gratifications, lesquelles
variaient entre 150 et La reine, encore, délivrait des prisonniers détenus pour
dettes, chaque année, à la semaine sainte, ou bien au moment d'un de ses
accouchements ; le nombre total de ces heureux, à chaque opération, variant
entre cinquante et soixante-dix qu'on tirait de partout, de Marie de Médicis payait les pensions d'écoliers et
d'étudiants : Elle faisait d'innombrables largesses aux hôpitaux et aux couvents. En 1612, de ses deniers et de ceux de la reine Marguerite, on meubloit et accommodoit trois maisons aux faubourgs Saint-Victor, Saint-Marcel et Saint-Germain, deux pour les hommes, une pour les femmes, où on enfermait en huit jours, ramassés sur le pavé de Paris, les gros gueux et les caymans qui demandoient l'aumône, l'épée au côté, avec le collet empezé sur la peccadille[79]. Elle s'occupait de l'hôpital de Elle consentait à protéger l'Oratoire naissant, qu'elle avait la pensée d'installer à l'hôtel des Monnaies ; elle favorisait les Carmélites venues d'Espagne à l'instigation de la duchesse de Longueville, et les aidait de ses écus afin de leur permettre de bâtir leur prieuré de Notre-Dame-des-Champs ; elle secondait les Capucines à qui elle faisait une rente annuelle. Elle donnait régulièrement à une infinité de couvents, aux religieuses de l'Ave Maria, aux Capucins, aux Ursulines du faubourg Saint-Jacques, aux Carmes déchaussés[81]. Mais, de tous ces bienfaits et largesses, quels étaient ceux qui venaient de son initiative, ceux que son entourage obtenait d'elle sans qu'elle y prêtât à peine attention, ceux que les aumôniers, enfin, sollicités, faisaient en son nom sans presque qu'elle le sût ? Gestes convenus, formalités traditionnelles inhérentes à la charge royale, que l'absence de note personnelle gracieuse ou émue rend caractéristiques de la souveraine froide qu'a été Marie de Médicis ! |