LES SPECTACLES ANTIQUES
ATHÈNES
Lan deuxième de la 91e olympiade.THÉLESTE DE SÉLINONTE À SON FRÈRE Cher frère, cher ami, mon ambassade na servi de rien. Cest la guerre. La paix, cette aimable déesse quAristophane chante si bien, la paix qui donne les beaux paniers de figues, les myrtes, le vin doux, les violettes épanouies auprès de la fontaine, les olives tant pleurées, la paix qui rend le vigneron à sa vigne, le laboureur à son sillon, une fois encore a battu de laile et senvole loin de cette Athènes insensée qui na pas su la retenir. Tu sais que nos cités de Sicile, toujours en proie à de
folles querelles, à de haineuses rivalités sinon à des guerres fratricides,
sollicitent, implorent lintervention de létranger. Aveuglement impie et quil
faudra quelque jour chèrement payer. Hélas ! nous voulons des alliés pour
nous entre-déchirer plus vite et nous détruire plus sûrement. Ségeste, nôtre
voisine et par cela même notre ennemie, appelle les Athéniens ; lor que ses
envoyés ont étalé dans lassemblée du peuple, celui surtout quils ont laissé
se perdre aux mains de quelques démagogues en crédit, a fait merveille et mis
en déroute mes arguments les plus subtils, confondu mon éloquence. Lambassadeur
de Sélinonte a vainement évoqué lintérêt suprême de tous les peuples de lHellade,
vainement rappelé que le jour même, où Alcibiade mène tout, règle tout. Le peuple le hait, mais il ne peut sen passer. Cest un vers dAristophane. Le mois dernier, un fâcheux accident faillit, cependant compromettre cette brillante fortune. Un matin on trouva, renversées et brisées sur les dalles de la rue, trois statues dHermès. Le sacrilège souleva un tel tumulte que la tempête menaçait de tout emporter, jusquau bel Alcibiade. Par bonheur, cest un homme subtil et dune merveilleuse souplesse. Il excelle à jouer les personnages les plus divers ; sil y trouvait profit, il se ferait initier aux mystères dEleusis, mais comme Euripide il dirait : La bouche a juré, lâme ne sest point engagée. Une sentence de ce même Euripide lui convient mieux encore : Il vaut la peine de commettre une injustice pour arriver à lempire, mais dailleurs on doit être juste. Je ne sais si Alcibiade vise à la tyrannie ; il est capable de tout ce qui est bien comme de tout ce qui est mal ; je doute même quil fasse de lun à lautre une distinction bien précise. Toutefois une accusation dimpiété et de sacrilège pouvait arrêter sa fortune en ce premier essor. On disait, et moi ambassadeur condamné par mes fonctions elles-mêmes à tout pénétrer, à tout connaître, je noserais jurer du contraire, quAlcibiade et quelques-uns de ses compagnons de débauche avaient, dans une nuit dorgie, promené si loin leurs rondes titubantes que les dieux mêmes navaient pu arrêter leurs furieux ébats ; et les Hermès sétaient cassé le nez par terre pour navoir pu suivre la danse. Alcibiade cependant a su parer le coup, du moins gagner du temps, car laccusation reste en suspens, le jugement est ajourné. QuAlcibiade soit vainqueur, et linjure des dieux sera bien vite oubliée. En attendant tout se prépare pour la guerre, chacun fourbit ses armes. Le Pirée regorge de galères ; les équipages sont réunis, exercés tous les jours. Esclave, mon havresac !... Apporte les plumes de mon casque !... Esclave, détache ma lance !... Mon bouclier rond à tête de gorgone !... Les vers ont rongé le crin de mes aigrettes !... Esclave, ma cuirasse de guerre ! Ce dialogue quAristophane met aux lèvres de ses Acharniens, se répète dans toute la ville ; cétait lautre jour encore un fracas darmures à ne plus rien entendre. Maintenant le divin Bacchus nous impose une trêve, répit suprême et qui ne men a semblé que plus doux. Nous sommes au mois dÉlaphébolion, et les grandes Dionysiaques viennent dêtre célébrées. Insouciance charmante et que jenvie à ce joyeux peuple athénien, jamais, mont assuré même des vieillards, toujours aisément détracteurs du temps présent, les fèces ne furent plus belles, jamais elles nattirèrent dans Athènes concours de population plus nombreuse et plus empressée. Combien de ces hommes si heureux de vivre, combien de ces éphèbes qui ont juré, selon la formule du serment imposé, de ne point, déshonorer leurs armes, de combattre pour les dieux et pour la patrie et de ne pas laisser leur Athènes moindre quils ne lont trouvée, combien de ces braves, orgueil des jours passés, espérances du lendemain, reverront cette chère Athènes, combien dans les joies du départ peuvent se promettre le bonheur du retour ? Les fêtes ont duré neuf jours ; hier cétait le dernier. Si ma diplomatie est condamnée à la retraite, si le vaisseau qui me ramènera mattend déjà dans le port de Phalère, je dois reconnaître les procédés obligeants, la courtoisie parfaite que partout, des plus grands aux plus petits, on na cessé de me prodiguer. Ce sont bien là ces Athéniens qui se font un honneur de sappeler entre eux non les puissants, non les riches, non pas même seigneurs, mais les gracieux, chariontes ! Ah, mon ami, que leur esprit est fin et délié ! Que leur grâce est séduisante ! Ils se feraient tout pardonner des hommes et des dieux ; mais le destin aveuglé et sourd ne connaît point le pardon. Ils nous déclarent la guerre, et je les aime comme de vieux amis, mieux encore, comme des frères égarés ; mes vux demandent leur défaite, et je serai le premier à la pleurera On avait obligeamment insisté auprès de moi pour que mon départ fut retardé et pour que jhonorasse de ma présence les Dionysiaques. On massurait que lambassadeur même dune cité ennemie était un hôte désiré et que ma place dans toutes les fêtes serait marquée auprès des premiers magistrats. Aisément je me suis laissé faire violence ; jai fêté Bacchus comme jamais je nai fêté nos dieux. Lentreprise serait longue dénumérer tant de plaisirs. Une chose cependant ma frappé, cest lordre exquis, harmonieux, qui toujours tempère les éclats de la gaieté la plus turbulente ; la mesure parfaite, instinctive qui règne en toutes choses. Ce nest pas une foule, cest un peuple. On sent, que tous ces corps ont léducation du gymnase et de la palestre, que tous ces esprits se sont éveillés, aiguisés aux discussions des assemblées populaires, dans le Pnyx, dans les tribunaux. Ceux-là même qui adorent Bacchus sous les formes dune outre rebondie, ne chancellent, ni ne divaguent comme ferait un barbare. Un Athénien aviné est encore un Athénien. Ici les fonctions ne sont pas quun honneur, mais un profit qui saffirme en belles espèces sonnantes. Doit-il siéger et voter dans lassemblée du peuple, le citoyen est payé, payé encore sil doit juger, payé sil est hoplite, payé sil est rameur, payé sil est cavalier, payé enfin, cest le dernier mot de la munificence officielle, sil se fait spectateur et assiste aux représentations scéniques. On samuse et lon reçoit encore trois oboles. Le plaisir est un devoir civique, comme la beauté en toutes choses est ici la suprême loi. Mais, me diras-tu, quel trésor peut suffire à de telles
largesses ? Serait-il dans Athènes quelque Midas qui puisse, au seul contact
de ses mains, tout changer en or ? LIlissus reçoit-il les eaux du Pactole ?
Les alliés payent, Athènes dépense. Rien de plus de simple, comme tu le vois. Athènes est
rigoureuse aux débiteurs attardés. Tu connais notre Sicile, ce pays béni entre tous, aimé du
soleil et caressé de la ruer, ce pays aux contrastes prodigieux qui porte
dans ses campagnes fleuries toutes les délices des champs Élyséens, et dans
les flancs de lEtna monstrueux toutes les horreurs sublimes, toutes les
épouvantes dun tartare mystérieux, ce pays où les cités sappellent
Syracuse, Panorme, Agrigente, Sélinonte, ce pays où les villes sont grandes
et peuplées comme des royaumes, tu sais combien je laime ; Je me suis oublié à te parler dAthènes, son image occupe sans cesse ma pensée et quand je le voudrais, je ne pourrais pas plus my soustraire, quun brin dherbe ne peut échapper à la terre qui le nourrit, au jour qui léclaire ; à la rosée qui le féconde. Maintenant que je vais te parler des Dionysiaques, cest encore Athènes, toujours et partout, que nous retrouvons clans ces fêtes sans rivales ; elle sy célèbre elle-même en sa gloire, en sa grandeur, en son génie autant quelle y célèbre le dieu couronné de lierre, le grand Bacchus.
Tout au contraire les joueurs de lyre, les citharistes sont, bien vus. Le jeu de ces instruments commande une pose aisée, facile, gracieuse ; cen est assez pour que lartiste soit en faveur, comme son art lui-même. Pincer un peu de la lyre ou du moins en connaître les premiers éléments rentre dans le programme dune bonne éducation. Les lyres, les cithares ont maintenant onze ou douze cordes. Jai entendu aussi une nouvelle venue et que la mode déjà recommande, la harpe des Égyptiens, le trigone ; la lyre phénicienne, lépigone même, avec ses quarante cordes, ne saurait rivaliser en puissance, en richesse, en variété, avec ce trigone qui berce, aux rivages du Nil, la voluptueuse indolence des Pharaons. Ces concerts ne mont laissé quun souvenir confus. Le lendemain, cétait hier, je prenais place au théâtre de Bacchus et je voyais dipe roi. Notre terre de Sicile connaît et goûte beaucoup les
représentations scéniques. Thalie et Melpomène sont dignement honorées parmi
nous. Le très glorieux Eschyle nest-il pas venu abriter sa verte vieillesse
aux bosquets embaumés que le Cyané rafraîchit ? Notre Sélinonte même na-t-elle
pas la première écouté, encouragé, dans notre île, les bégaiements de Ces représentations scéniques nont lieu ici quà de longs intervalles : aux petites Dionysiaques, en automne, aux jours où les vendanges remplissent les celliers et réjouissent les vignerons, aux Lénies, en plein hiver, mais on ne joue guère alors que des comédies ou des bouffonneries grotesques ; enfin au printemps, aux grandes Dionysiaques, quand la sève a gonflé et fait éclater les bourgeons, quand lespérance des moissons prochaines déjà égaye la campagne, quand les narcisses sont épanouis aux pâturages du Pentélique, quand les anémones rouges empourprent les blancs rochers de lAcropole, enfin quand les abeilles réveillées enveloppent lHymette de leurs joyeux bourdonnements. Ainsi le goût du théâtre satisfait, mais non pas surmené par des jouissances trop fréquentes, tenu en haleine, surexcité par lattente elle-même, nen est que plus délicat, plus sévère peut-être, mais aussi plus intime, plus profond, plus respectueux enfin ; car pour le goûter dignement et complètement, il faut dabord respecter ce que lon aime. Chaque année les grandes Dionysiaques amènent un concours de tragédie. Tu sens bien quil serait impossible de représenter toutes les pièces, toutes les ébauches plus ou moins informes quil plairait à un amateur quelconque de nous apporter. Les Spartiates jettent dans un gouffre qui jamais ne rend sa proie, les nouveau-nés malvenus et débiles ; ainsi font les Athéniens des pièces qui ne sont pas jugées dignes du grand jour de la scène ; elles disparaissent aux ténèbres de loubli. Trois poètes seulement sont choisis et désignés pour prendre paru à la lutte suprême. Autrefois on était tenu dapporter une tétralogie, quatre pièces dont un drame satirique, tâche énorme, et ces pièces devaient se faire suite, évoquer, raconter les principaux épisodes dune mène histoire. On se montre moins rigoureux aujourdhui. On nexige plus quatre pièces, et les pièces présentées nempruntent pas toujours la même origine ou la même tradition. Autrefois une équité jalouse ordonnait le tirage au sort des interprètes. Si une interprétation plus heureuse, plus savante devait favoriser lun des concurrents, le hasard seul en décidait. Il nen va plus de même ; et les poètes ont soin par avance de recruter les acteurs les plus habiles. Cette innovation na fait que grandir linfluence et le crédit des principaux acteurs. Je ne sais sil en est ainsi dans tous les pays ; on me dit que certains peuples tiennent pour dégradante la profession de comédien. Athènes en juge dautre sorte. Non seulement Violon, Théodore, Andronicus sont grassement payés, mais on les recherche, on tient leur amitié en grand honneur. Télestès dont la mimique toute-puissante faisait, dit-on, trembler, était lélève et le confident le plus intime dEschyle. Les citoyens, et ils sont nombreux, qui rêvent de la tribune et des lonctions publiques, sollicitent souvent les conseils et les enseignements de quelque tragédien fameux. Le Pnyx nest-il pas un théâtre, le peuple un public, et nest-ce pas quelquefois la destinée de la patrie, toujours la fortune et lavenir de lorateur, qui se jouent là, en lespace de quelques instants ? Voici même, et cest souvent, une désolation dans Athènes, que les rois, les tyrans fastueux renchérissent sur les largesses des auteurs et des magistrats. Quelques-uns des acteurs les plus renommés commencent à courir le monde en quête de nouvelles victoires et surtout de salaires dignes, non pas de leur talent qui toujours est limité, mais de leur vanité qui ne lest pas. Autrefois le poète ne laissait à personne le soin, lhonneur, le risque dinterpréter le principal rôle de sa pièce. On a pu voir encore le divin Sophocle, en sa radieuse jeunesse, tenir le rôle de Thamyris et montrer la belle Nausicaa jouant à la balle avec les jeunes filles ses compagnes, auprès de la fontaine où vient sasseoir Ulysse. Toutefois cétaient là des rôles secondaires. Au reste Sophocle na pas une voix bien puissante : cest le seul don que lui ait refusé la prodigalité des dieux. Maintenant les auteurs ne sont acteurs que par exception. Si Aristophane joua lui-même le personnage du démagogue Cléon, ce fut sur la réponse négative de tous les acteurs refusant dassumer une tâche aussi périlleuse. Cétait alors un homme redouté que Cléon, ce fils de corroyeur qui usurpait le crédit, la puissance de Périclès et prétendait lui succéder. Parodie grotesque ! Cléon après Périclès ! Hélas ! Mais notre amour indulgent toujours oublie les fautes, les vices même de ce que nous aimons. Je ne veux plus parler de politique ; cela me rassérène et cela me repose. On ne saurait manier les affaires et les hommes sans se salir un peu et lesprit et les mains. Le théâtre de Bacchus, qui prête sa vaste enceinte à la
pompe des représentations tragiques, senchâsse au flanc de lAcropole et
regarde le La construction du théâtre de Bacchus commença dans la soixante-dixième Olympiade, sous la direction des architectes Démocrate et Anaxagor. Thémistocle y fit travailler activement ; mais, bien que le monument soit vaste, commode et dadmirables proportions, en un mot digne dAthènes, de ses poètes et de ses dieux, on projette de nouveaux agrandissements, des splendeurs plus grandes. Athènes aime tant son théâtre que jamais elle ne renoncera au plaisir de le refaire et de lembellir. Il suivra les destinées de la cité et se transformera dâge en âge. Il peut contenir, massure-t-on, trente mille spectateurs. Partout le rocher lui prête une base solide, un majestueux encadrement. Les gradins étaient primitivement taillés au vif de la pierre ; on les a depuis peu revêtus de marbre, au moins pour la plupart, car les derniers, ceux-là qui tout là-haut, presque au niveau du mur de lAcropole, reçoivent les ménèques et la foule des très petites gens, ne sont aujourdhui encore que de rocher. Les gradins inférieurs sont exclusivement réservés aux
dignitaires. Une soixantaine de fauteuils de marbre, côte à côte alignés, se
développent tout à lentour de lorchestre. Le grand prêtre de Bacchus Éleuthérien
a sa place marquée tout au centre, dans laxe de la scène ; à lui seul
revient lhonneur de présider la solennité. Le siège quil occupe, plus
richement décoré quaucun autre, déroule, finement sculptés dans le marbre,
satyres, petits génies ailés qui enfourchent des griffons. A la droite du
grand pontife de Bacchus prend place lexégète, linterprète officiel des
lois sacrées et des oracles ; puis vient le prêtre de Zeus Olympien, puis le
prêtre de Zeus protecteur de la ville. Sur la gauche on voit lhiérophante
venu dÉleusis ; cest lui qui dans le temple de Cérès initie les pèlerins
pieux aux mystères redoutés de la grande déesse Les prêtres de Phbus Délien,
de Poséidon, dArtémis, lexégète des Eupatrides, lhiéromnémon, on nomme
ainsi le député dAthènes au conseil amphictyonique, les prêtres de Phbus
Pythien, le prêtre dÉrechthée, le prêtre de Lorsque je pénétrai dans le théâtre de Bacchus, les gradins disparaissaient déjà sous lentassement de toute une population. Ma place mattendait cependant. Un rabdophoros, un de ces hommes qui sont préposés à la police et au bon ordre du théâtre, sempressa à my conduire dès que ma présence lui fut signalée ; et chacun, il me plaît de le rappeler, se levait pour me livrer passage ou seulement pour me faire honneur. Il ne fut pas un seul des magistrats publics, de ceux-là même qui le plus violemment avaient combattu mes propositions et traversé mes desseins, qui ne mait obligeamment salué. Peu de femmes dans cette foule. Elles ne sauraient assister sans gêne et sans inconvenance aux bouffonneries puissantes mais licencieuses dun Aristophane ; on a peiné à simaginer une honnête mère de famille écoutant Lysistrata ou lassemblée des femmes. Les tragédies toutefois respectent les scrupules dune austère pudeur, et lâme ne peut que grandir, sexalter en des pensées plus hautes quand parlé la muse dEschyle ou de Sophocle ; mais les Athéniens, sans imposer à leurs femmes la tyrannie de lois jalouses, de par les discrets conseils seulement dune habitude docilement acceptée, retiennent le plus souvent leurs filles, leurs surs, leurs épouses au logis. Le gynécée nest pas une prison, et rien ne ressemble moins à la demeure sombre, mystérieuse, presque inaccessible au profane, dun roi dAsie ou dun satrape, que la maison dun Athénien, toujours hospitalière aux amis, aux étrangers, même aux quémandeurs importuns ; mais, dans la pensée dun Athénien, la femme est la divinité bienfaisante et vigilante du ménage, le doux génie qui préside à ce petit monde domestique lait de nos affections les plus intimes, de nos tendresses les plus profondes et de nos seuls vrais bonheurs. Il faut à la maison le sourire de la femme et les rires de lenfant. Quelques femmes, et des plus honnêtes, assistent cependant aux représentations tragiques ; aucune loi ne linterdit. Elles ont leurs gradins réservés, qui les réunissent et leur épargnent le contact immédiat dune foule quelquefois tempétueuse. Des places particulières les attendent, mais ne leur sont pas imposées. Jai vu quelques femmes, et des plus belles, des mieux parées, sinon des plus respectables, qui effrontément et dun air vainqueur prenaient place au milieu des hommes. La fameuse Aspasie en avait donné lexemple, et Périclès lavait toléré, peut-être en gémissant tout bas. Cest lhistoire éternelle : on impose des lois à un peuple, on nose faire une observation à la femme quon aime. Lexemple étant mauvais, fut aussitôt suivi, non pas de celles qui comprennent leur vraie mission, mais de celles qui veulent le bruit, létalage, lés adorations des regards partout sollicités. Ce ne sont pas ces hétaïres qui se contenteraient de vêtements quelles-mêmes auraient tressés. Leurs doigts ont désappris, si jamais ils lont connu, le jeu de la quenouille et de laiguille ; ils ne savent plus que tenir un miroir. Ces femmes nayant dautre but dans la vie que dêtre jeunes et belles le plus longtemps possible, sont toujours en quête de parures nouvelles, dajustements savants et qui puissent éblouir quand vient le jour fatal où lon ne saurait plus, de par les simples dons de la nature, séduire tous les curs et charmer tous les yeux. Aussi les modes orientales trouvent-elles chez ces femmes une clientèle complaisante. Il me souvient dune Corinthienne qui, tout enveloppée de fins tissus phrygiens rehaussés de broderies à paillettes dor, de palmettes et de méandres, portait sur sa jupe azurée toutes les étoiles du firmament. A ce luxe impertinent on reconnaissait aussitôt une étrangère. Une Athénienne, même de celles qui aiment à se montrer, aurait mis plus de tact dans sa coquetterie et naurait pas dans les lourds colliers qui létouffent, dans les longues épingles qui hérissent sa chevelure, étalé sottement les dépouilles dune province. Shabiller avec goût, que le vêtement soit simple, pauvre même ou de grande richesse, quelle science délicate et profonde ! Il faut, pour réaliser cette aimable merveille dun homme bien mis ou dune femme élégamment parée, un goût extrême, je dirais même de lesprit. Les Athéniens presque tous y excellent ; aussi ont-ils beaucoup desprit. Il faut dabord faire sien, sassimiler intimement, tout ce que lon prend, tout ce que lon porte ; notre moi doit transparaître à travers nos vêtements, les bijoux mêmes nont tout leur éclat que si notre pensée y rayonne. Que de gens, étrangers à ce qui les enveloppe ou les charge, semblent lavoir emprunté ou volé ! On voudrait le leur reprendre, car ils ne savent quen faire. Tout le monde est couvert ou vêtu, bien peu sont habillés. En ces fêtes des Dionysiaques, Athènes presque tout entière est dans son théâtre de Bacchus. Les esclaves ne sont pas admis, encore même sous le prétexte daccompagner leurs maîtres ou de leur apporter des coussins qui atténuent la dureté des sièges de marbre, pénètrent-ils quelquefois dans ces lieux interdits, et je suppose que beaucoup dentre eux, restent confondus, entassés aux ombres discrètes des corridors et des portiques. On nest pas toujours bien sévère ; Athènes en fête ne veut dans ses murs que des heureux. Lesclavage est ici plus doux quen aucun lieu du monde. Ce ne sont pas les lois qui exigent des maîtres une bonté indulgente et facile, mais les murs, ce qui est plus sûr et ce qui vaut beaucoup mieux. Tu vas sourire de ce propos, mais il me semble que les animaux eux-mêmes, acceptés comme dhumbles amis, non durement fouaillés, hennissent, aboient, miaulent ou braient ici plus gaiement que partout ailleurs. Songe bien que dans Athènes le chien dAlcibiade est un personnage dimportance. Si javais pour voisin de droite un perse, le plus souvent muet ou laconique et sentencieux comme un oracle, javais pour voisin de gauche un poète de quelque renom, Ion de Chio, bavard et médisant comme un Crétois. En quelques instants il ma dit tout ce quil a fait et tout ce quil fera. Cette année il na pas voulu concourir ; et cependant plusieurs fois il na pas craint de se mesurer avec Sophocle et Euripide. Lhonneur est déjà grand dêtre admis à une pareille lutte. Le caprice des juges ou le hasard dune inspiration heureuse, a justifié quelquefois cette audace par la victoire. Ion de Chio connaît toute la cité dAthènes ; sa médisance égratigne sans déchirer. Il samuse lui-même à me faire les honneurs de lassemblée. Mon ignorance curieuse ne cesse de linterroger, sa faconde jamais ne se lasse de me répondre. Je dois beaucoup à cet ami dun jour et notre conversation revivra dans cette lettre. Tous les servants de Thalie et de Melpomène, quils soient dAthènes ou seulement ses enfants dadoption, car elle est aisément hospitalière à tous les talents et le génie donne droit de cité, sont là curieux, attentifs, jaloux de sinstruire ou plutôt secrètement désireux de critique ; rien ne réjouit plus un jouteur que la culbute dun rival. Ion de Chio me les nomme et de quelques mots le plus souvent les fustige. Ce nest pas dun confrère ni surtout dun poète quil faut espérer quelque indulgence. Voilà Critias, me dit-il, lauteur dun Sisyphe. Sa pièce lui est retombée sur la tête comme le rocher vengeur sur la tête de son héros. Peiner, gémir dans le Tartare sans fin ni trêve, cest cruel mais être chanté par Critias ; cest un supplice que Minos avait oublié.... Vois-tu là-bas cet homme plus blanc, plus rose, plus frais quune matinée de printemps, ce visage apprêté comme celui dune vieille coquette, cest le bel Agathon, un poète ingénieux à ciseler des riens, à rythmer de petits vers et qui semble quand il déclame, comme dit Aristophane, gazouiller une marelle de fourmis. Plus loin cest Alcimène, auteur tragique, auteur comique. Double gloire ! Par malheur, Thalie lobsède quand il chausse le cothurne, Melpomène le dévore quand il met le brodequin ; rien de plus lamentable que ses comédies ; rien de plus bouffon que ses tragédies. Le voilà qui cause avec Théognis. Cet homme pâle et qui semble figé dans une placidité marmoréenne, cest aussi un poète ? Oui vraiment, Théognis dignement surnommé la neige. Phbus dégèle les chutes du Pinde ou du Parnasse, jamais il na pu dégeler les vers de Théognis. Tu vois à droite, sur le troisième gradin, toute une niellée de poètes : Acestor, Morychus, Nicontaque, Xénoclès qui excelle dans lemploi des machines et qui remplace léloquence des vers, les caractères absents par lessaim des divinités volantes ou lapparition des spectres et dés fantômes. Ce spectacle ne laisse pas damuser le vulgaire et de mériter à Xénoclès quelques applaudissements. Le public est bien sot. Nas-tu pas remarqué que le public est toujours sot quand il applaudit louvrage dun confrère ? Voici là-bas Melitus, maigre, hâve, jante, ridé comme une outre ride. Il ne se nourrit que de fiel, et cela ne lui profite guère. Comme un chien hargneux toujours acharné à la poursuite de quelque gibier, il faut toujours que sa haine et ses injures cherchent quelque victime. Socrate la raillé, il exècre Socrate, et ses livres, à défaut de la ciguë, distillent le poison des calomnies les plus infâmes. Pauvre et bon Socrate ! Il a quelques amis, des disciples enthousiastes, mais il a bien des ennemis. Nest-il pas dans le théâtre ? Si vraiment. Le grand nom de Sophocle ne laurait-il pas attiré, quil naurait pu manquer une occasion de voir son cher Alcibiade. Alcibiade est son élève ? Son élève bien-aimé. Tu ne saurais imaginer de quelles attentions délicates lélève environne le maître, quelles grâces coquettes il déploie pour se lattacher et le captiver ; dans la dernière campagne le maître et lélève partageaient la même tente. Alcibiade est un charmeur qui dériderait lennui dun satrape et ferait sourire Lacédémone. Les dieux lont prédestiné à toutes les conquêtes. Alcibiade est-il ici ? Non, pas encore ; il ménage ses effets, il prépare son entrée. Au reste il est chorège et une partie des frais de ces représentations lui incombe. Peut-être est-il dans le chorignion où les acteurs revêtent leurs costumes et reçoivent les derniers encouragements du poète et les conseils de lhégémon, car si le poète est le chef des churs, le chorodidascale, lhégémon est le maître suprême des musiciens instrumentistes. A défaut de lélève qui ne peut tarder à venir, tu vois au-dessus de nous le maître, le sage Socrate. Cet homme un peu court et trapu, le visage épais, les lèvres lourdes, le nez écrasé ? Cest le divin Socrate. Je ne puis te le proposer comme le type de la beauté athénienne. Lenveloppe est grossière ; mais une flamme subtile y veille qui tout réchauffe et tout illumine. Les yeux sont petits, mal dessinés, mais ne te semblent-ils pas darder des flèches et des éclairs ? Le regard interroge et répond. En effet et lon sent quil pénètre les plus profonds mystères de la pensée. Ce nest pas seulement un homme, un philosophe, cest une lumière. Puisse tout ce qui est la nuit, lombre et le mensonge ne pas sentendre quelque jour pour létouffer ! Quel est donc cet homme qui vient de se lever à demi et dun signe amical vient de saluer Socrate ? Un confrère, le fils dun cabaretier de Salamine et dune revendeuse de légumes, lauteur dHippolyte et de Médée, Euripide. Il fut athlète en son jeune âge et sescrima dans la palestre et le stade avant daborder la scène tragique. Je connaissais son nom, jai retenu quelques-uns de ses vers. Sa réputation a pénétré jusquen Sicile. Ceux-là seraient les très bien venus qui nous apporteraient ses pièces ; et nous serions hommes à gracier un condamné pour prix dune tirade dEuripide. Il vient de terminer,
assure-t-on, trois pièces nouvelles : Palamède,
Alexandre, les Troyennes. Sans doute nous les entendrons aux
prochaines Dionysiaques. De lhabileté, du talent, de lesprit et du plus
subtil, Euripide eu a sans doute : mais il altère nos vieilles traditions
tragiques. Éros, Aphrodite prennent chez lui une place toute nouvelle et cela
ne va pas sans scandale. Tous les vieux adorateurs dEschyle protestent
furieusement. On a déjà dit quEuripide voulait quitter Tant pis pour Exécrable caractère du reste, ombrageux et triste. Euripide hait les femmes, mais dune haine qui ressemble bien à une tendresse aigrie et déçue. Sophocle a dit : Euripide déteste les femmes... au théâtre. Il a beaucoup restreint dans ses pièces le rôle du chur. On dit même que pour la composition musicale, Euripide emprunte la collaboration secrète de Timocrate dArgos ou dIophon, le fils de Sophocle. Pure médisance, je veux le croire, on est si jaloux les uns les autres dans notre métier ! Je vois avec plaisir quil est encore des poètes dhumeur plus charitable. Euripide a déjà écrit un grand nombre de pièces ; il a plus de soixante ans. Quelle que soit son expérience, il ne travaille pas vite cependant. Un jour Alcestis se vantait devait lui davoir composé plus de cent vers en trois jours, tandis que lui, Euripide, en avait à peine écrit trois dans le même espace. Aussi tes cent vers ne vivront-ils que trois jours, répliqua Euripide. Le hasard a des ironies singulières. Sur les gradins à notre gauche voilà Aristophane qui sassoit en face dEuripide. Ce sont des ennemis ? Mortels ! Aristophane tient pour les vieux usages. Cest un homme du passé. Peut-être aussi un homme de lavenir. Qui le sait ? Sa lèvre moqueuse toujours frémit et sagite. Rude jouteur, redoutable adversaire, il manie la férule dune main légère et cependant les coups sont rudes, les blessures profondes. Son rire éclate comme la foudre. Disant cela, Ion adresse au terrible railleur le salut le plus respectueux. Aurait-il peur de la férule ? Je le croirais. Aristophane aussitôt rend le salut, et dun air si empressé, dune politesse si obséquieuse, quil semble encore se moquer. Je ne suis pas très rassuré pour ce pauvre Ion de Chio.
Labeille, cest ainsi quon le surnomme, reste cachée dans sa ruche, distillant, préparant son miel digne de la table des dieux. Sans doute il est auprès de ses acteurs et de ses musiciens. Je ne sais si nous pourrons le voir. Quel âge a-t-il ? Quatre-vingts ans ou à peu près ; mais son génie est jeune encore et aussi puissant quil fut jamais. Lan passé lun de ses fils cependant.... Il a plusieurs fils ? Deux, mais qui ne sont pas nés de la même femme ; de tout cur ils se haïssent et se jalousent. Lun de ses fils, dis-je, Iophon, le musicien dont je parlais tout à lheure, prétendit que lintelligence de son père commençait à baisser et quil convenait de lui retirer ladministration de ses biens. Laffaire fut portée en justice. Sophocle se contenta de répondre : Si je radote, je ne suis pas Sophocle, si je suis Sophocle, je ne radote pas. Puis, déroulant un papyrus, il lut quelque scène de sa dernière tragédie. Quel succès, quelle victoire pour Sophocle ! quelle honte pour Iophon ! Sophocle, comme tant dautres, a plus de gloire que de bonheur ; sa famille ne lui est pas un asile chéri, un doux refuge contre la tempête. Son petit-fils, le fils même
de cet ingrat Iophon, console le vieux poète de ses chagrins domestiques et
lui rend toute la tendresse, toute la vénération quil mérite. Enfin nous
tous faiseurs de vers, nous abdiquons devant cette royauté presque séculaire.
Sophocle est pour nous laïeul, le guide et le maître. Il vit, il monte, il
rayonne dans la sérénité et la splendeur des gloires immortelles. Tous nous
savons son histoire, belle, radieuse comme celle de notre chère Athènes. Tous
nous allons, aux portes de la ville, visiter le petit village de Colonne qui
fut son berceau ; cest un pieux pèlerinage. Tous nous revoyons par la pensée
Sophocle, à peine âgé de seize ans, chanter et danser le Pæan autour du
trophée dressé sur le rivage de Salamine, car on avait choisi Sophocle entre
tous les jeunes Grecs comme le plus agile et le plus beau. Tous nous revivons
cette hutte héroïque du vieil Eschyle et du jeune Sophocle, de ce grand
soleil finissant et de cette aurore qui se lève. Tous nous connaissons cette
noble existence de labeur, de dévouement à Changeant de propos, je désigne à mon obligeant voisin un homme mal mis, dallures communes et grossières, le regard inquiet et dur, les rides grimaçantes, le nez arqué comme le bec dun vautour, la barbe inculte, les cheveux en désordre. Il vient dentrer, il interroge toute la salle dun long regard à la fois triste et insolent, puis, refusant de prendre place sur les gradins, se tient debout, tout près dune sortie, comme sil voulait se ménager une retraite facile. Cest un philosophe bien connu, Timon le misanthrope, mest-il répondu. Il fait profession de mépriser toutes choses, de bafouer, de blâmer tout le monde. Cest une attitude originale, un parti pris ingénieux et que récompense une sorte de popularité. Cela vous donne toujours un air de grand homme et dhomme desprit que de proclamer partout la sottise et la petitesse du genre humain. Lautre jour cependant, cétait à la sortie de lassemblée populaire qui a décidé lexpédition de Sicile, Timon arrête Alcibiade dans la rue et en plein visage lui envoie ce beau compliment : Courage ! mon fils, continue de tagrandir ainsi, car ta grandeur sera la perte de tout ce peuple ! Cette réplique ramenait notre conversation et nos pensées
sur des choses qui ne pouvaient que nous être déplaisantes. Par bonheur voilà
quil se fait dans tout le théâtre un mouvement subit. Est-ce donc que la
représentation commence ? Non, mais un acteur vient de paraître, qui sempare
audacieusement du premier rôle dans la vie publique. Un drame va se dérouler,
réel, redoutable, terrible et mortel à bien des nations et des cités. La
terre, la mer lui serviront de scène. Ce nest pas un jeune homme, cest un homme, beau, fier, hardi, dune démarche aisée, dans tout lépanouissement magnifique de sa force, de son corps, de son esprit. On sent quil est né pour le commandement ; il porte la tête haute, son regard est assuré, son geste décidé ; la lèvre discrète promet le sourire. La pensée habite ce beau front pur et qui ne connaît pas loutrage de la ride la plus légère. Cette pensée est active, mais non pas inquiète et anxieuse. Alcibiade commande à tant de gens, préside à tant de choses, règne sur tant de curs, quil doit commander à la fortune. Le favori dAthènes nest-il pas le favori des dieux ? Voilà un homme qui est habillé et mieux quaucun autre ne saurait être ! Sur le premier vêtement, le chiton, sans manches, qui est relevé et serré à la ceinture, lhimation a été jeté dans un désordre harmonieux et dun art suprême. Une de ses extrémités passe sur lépaule gauche et le bras la retient. Létoffe appliquée sur le dos couvre le côté droit et lépaule, laissant le bras droit à découvert. Cet himation est de pourpre, mais dun rouge adouci, un peu pâlissant. De petites boules de métal, dissimulées dans ses plis, en règlent et pondèrent la savante architecture. Cest de la statuaire qui vit et cest la plus charmante. Polyclète qui, dans sa statue du Doryphore, a donné le type du corps humain en ses plus belles proportions et ses grâces les plus exquises, reconnaîtrait dans Alcibiade son chef-duvre et son enseignement. Athènes tout entière se mire en son bel Alcibiade, et comme elle je ne puis me lasser de le suivre et de ladmirer. Pour elle, pour nous, pour lui, puisse-t-il mourir jeune et sans que cette joyeuse floraison subisse aucune flétrissure ! Ce vu homicide te surprendra peut-être. Il est juste et clément cependant. On ne saurait simaginer sans tristesse, sans douleur, Alcibiade vieux et ridé. Quil disparaisse dans sa fleur, ne laissant que des regrets attendris, ne serait-ce que pour aller là-bas, dans lÉrèbe, charmer tous les morts comme il a charmé tous les vivants ! Je navais encore pu détacher mes yeux dAlcibiade quand le héraut public se leva et ordonna lentrée des churs, le commencement de la représentation. Je ne te dirai rien des deux premiers drames exécutés devant nous, peut-être mont-ils causé quelque plaisir, je ne saurais me les rappeler ; je ne me souviens, je ne veux parler que du troisième, du dernier, dipe roi. Le héraut une fois encore se lève et crie au milieu dun profond silence : Faites entrer le chur de Sophocle ! Soixante choreutes, divisés en quatre groupes de quinze, pénètrent simultanément dans le vaste demi-cercle de lorchestre. Les uns viennent par la gauche ; les autres par la droite. Ils ne montent pas sur la scène élevée de quelques degrés au-dessus de lorchestre. Enveloppés damples draperies flottantes, mais sans masque, ils obéissent à un coryphée qui du reste, vêtus comme ils sont tous, ne se fait connaître que par la place quil occupe, un peu en avant de tout le chur. Au temps dEschyle chaque groupe ne comprenait que douze choreutes ; linitiative de Sophocle en fit porter le nombre à quinze. Les aulètes suivent, de près les churs, mais ils restent un peu à lécart, laissant lorchestre presque tout entier aux libres évolutions des chanteurs. Les flûtes jouent sur le mode mixolydien, car ce mode est plaintif. Il semble que déjà les instruments gémissent et pleurent les infortunes fameuses ddipe et de tous les siens. Le rythme lent, un peu monotone, scande la marche solennelle des choreutes. Ils viennent, ils avancent, glissent ainsi que lon se figure dans lÉlysée les ombres bienheureuses. Toujours ces poses, ces attitudes sculpturales où se plaie le lumineux génie dAthènes. Cest un grand bas-relief qui passe et, lon sétonnerait peu, la représentation finie, de le voir reprendre sa place aux murailles dun temple de marbre. Le chur marque la transition entre la foule des spectateurs qui est là entassée, et la scène, les héros qui tout à lheure vont loccuper. Les Grecs ne veulent nulle part de contrastes violents, doppositions soudaines ; le chur nest pas lacteur du drame ni le spectateur, ou plutôt il est lun et lautre. Sa personnalité anonyme et partagée lui permet les sentiments collectifs, les pensées générales ; il rapproche, il réunit, il confond, dans une sympathie commune, ce qui regarde et ce qui est regardé, ce qui est dit et ce qui est écouté, la salle et la scène, la prose tout humaine et la divine poésie, la réalité et le rêve. Les choreutes nont pas encore chanté. Un chur dentrée, le parodos, ainsi quil est dusage, nouvre pas cette nouvelle tragédie. Les savantes évolutions des choreutes, leur défilé, leur groupement grandiose, tout sest fait sans quune voix ait répondu aux lamentations des instruments. Lautel du grand Dionysos occupe le centre de lorchestre. Cest un bloc de marbre circulaire. Les thyrses chers aux ménades, des pommes de pins, des masques de théâtre enguirlandés de pampres y sont sculptés et festonnent, égaient sa blancheur immaculée. Cest le Thymélé. Les choreutes longuement ont promené tout alentour leur procession sacrée, leurs danses graves, les ébats solennels de figures changeantes. Ils saluent, ils célèbrent le dieu que la pensée de tous évoque et sent là toujours présent, le dieu de la joie, du vin, mais aussi des fêtes glorieuses et des inspirations fécondes. Cinq portes sont ouvertes sur la scène, la porte royale, la plus haute, celle qui en occupe le centre, les deux portes dites des hôtes, deux autres enfin beaucoup plus petites ; lune celle de droite, est supposée donner accès dans la ville, celle de gauche, que lon pourrait dire de létranger, est supposée donner sur la campagne ; de grands satyres de marbre, velus, une jambe en avant, les poings appuyés sur les hanches musculeuses, la tête fléchissant et versant sur la poitrine les flots dune barbe épaisse, tout le corps ramassé dans un effort puissant, flanquent les trois portes principales et soutiennent de leurs épaules la lourde masse du linteau. A droite, à gauche, aux extrémités de la scène, les périactes se dressent. Faits de bois et de toile peinte, montés sur des pivots, ils ont trois faces et précisent le lieu où le drame va se passer. En ce moment ils nous montrent les abords dune ville. Si la fantaisie du poète nous doit conduire en quelque autre site, dans un palais, dans une campagne, les périactes tournant sur leur base mobile, nous montreront une autre face et tout à coup, aidant la pensée des spectateurs, nous ouvriront des perspectives nouvelles. Un groupe de comparses (Rôpha) entrent en scène par la porte de droite et bientôt sarrêtent, prenant des attitudes désolées. Ainsi que des suppliants, ils portent des rameaux dolivier entourés de bandelettes, ils lèvent les bras, et leur pantomime expressive obsède le ciel dune vaine prière. Enfin, par la porte royale, le héros du drame, le personnage principal, le protagoniste parait ; il tient un long sceptre dor, cest dipe, roi de Thèbes. Callipide, un grand ami dAlcibiade, en est le digne interprète. Bien que sa folle vanité ait souvent prêté à rire, que naguère encore il ait amusé tous les matelots du Pirée en simprovisant chef de galère, en usurpant, du droit de son seul caprice, les insignes et la pompe héroïque dun stratège, il compte entre les premiers tragédiens, et ce nest pas vainement que Sophocle confie la destinée du nouveau drame à son expérience et à son habileté. La première fois quun étranger est admis à quelque représentation scénique, son impression immédiate est toute de surprise, presque de stupéfaction. Songe donc que ces personnages le plus souvent enveloppés de lendyma, tunique en brocart dor qui traîne jusquà terre, de lepiblema large manteau de pourpre, chaussés du cothurne aux semelles énormes quinventa Aristarque de Tégée mort dernièrement plus que centenaire, capitonnés du somation qui rembourre le corps et gonfle la poitrine, les bras perdus en des manches pendantes, enfin la tête et la nuque complètement enfermées dans le masque, lonkos, ces personnages, disons-nous, conservent à peine figure humaine. Le masque surtout, quil reflète une placidité sereine ou quil se contracte en des plissements pleins de menaces, quil exprime la douleur ou la colère, la plainte ou langoisse et le désespoir, avec son haut toupet, sa perruque flottante ou furieusement échevelée, ses orbites larges et vides que ne peut traverser la flamme dun regard vivant, sa bouche béante comme la bouche de marbre dun colosse qui rend des oracles, gène, inquiète, et fait peur. Ce sont là des êtres plus quhumains et qui ne sauraient vivre de notre vie commune. Ils nous dépassent et lon en vient dabord à se demander quel abîme a laissé échapper sur notre terre, au milieu de. notre débile. humanité, ces colosses errants, ces monstres grimaçants. Cependant ce nest, là quun mouvement démoi fugitif, une terreur bientôt apaisée. Ce grandissement factice simposait de toute nécessité. Le théâtre de Bacchus (et lon en a construit, encore de plus vastes) mesure cinq cents pieds de diamètre total ; la scène seule dépasse soixante-quinze pieds. Le plus beau, le plus grand vainqueur de Delphes et dOlympie, ne paraîtrait quun enfant dans cette immensité. Au reste toutes ces conventions, tout cet appareil étrange, mais rationnel, simposent bientôt sans peine. Limmobilité des expressions que les masques nous présentent ne saurait nous étonner. La mobilité des traits dun visage humain, leur subtile et rapide éloquence ne serait pas comprise si même elle pouvait être vaguement devinée de nous spectateurs qui sommes relégués si loin. Tout, presque tout du moins, est convention, illusion au théâtre ; il ne convient pas dy chercher la vie réelle et banale, le plus souvent fastidieuse et monotone, mais un rêve grandiose, terrible ou charmant qui sinspire de la vie et, de la réalité. Que les passions en lutte, les sentiments exprimés tient leur inspiration, leur source première au fond de notre cur, cest la loi suprême du théâtre ; mais passions, sentiments, pensées ne doivent pas raser la terre, bien au contraire, senvoler dans un essor ambitieux non pour retomber et se briser sur le sol comme le présomptueux Icare, mais pour dévorer à tire-daile lespace, lazur éternel ; limmensité du monde et des cieux. Lhomme au théâtre doit grandir, de lâme et du corps, saffirmer caractère toujours vivant, type immortel que salueront toutes les nations et tous les âges. Je mabandonne à ces pensées, et cependant dipe a parlé. Les citharistes, discrètement dissimulés derrière les périactes, accompagnent sa voix. Ce nest pas un chant, mais le paracatalogué, une déclamation rythmée et qui ondule, tantôt abaissée, fléchissante, tantôt plus vive, plus éclatante. Cela fait songer aux vagues qui se plissent, se creusent, se soulèvent, bercées dun long et tout-puissant murmure. Ô mes enfants, jeune postérité de Cadmus, pourquoi vous tenez-vous dans une posture suppliante ?... Je suis venu moi-même, cet dipe si fameux... mon désir est de vous être secourable. Ainsi parle dipe. Un vieillard répond au nom de tous, et rien nest plus saisissant que la description quil fait des malheurs de la cité. Sophocle sest-il souvenu de leffroyable peste qui dévasta, il y a quelques années, lAttique, emporta Périclès et fit un moment douter de lavenir et de la destinée dAthènes ? on la dit, on le croirait : Thèbes se débat dans un abîme de maux et peut à peine relever sa tête dans la mer de sang où elle est plongée.... Lhorrible contagion a fondu sur la ville et la désole. Le noir Pluton senrichit de nos gémissements et de nos larmes.... dipe est le roi, dipe est le maître, dipe autrefois a délivré le pays du sphinx qui répliquait par la mort, quand la réponse faite à ses énigmes nétait pas la réponse attendue, dipe est le père qui doit sauver les siens, le pasteur qui doit défendre le troupeau. En effet dipe na pas attendu ces supplications pour agir. Par son ordre le fils de Ménécée, Créon, son beau-frère, est parti pour Delphes. Le fléau déchaîné sur la ville témoigne de la colère des dieux. Que Phbus parle donc ! Un oracle seul peut indiquer le remède jusquà ce jour vainement espéré. En effet Créon revient. Son front est ceint dune couronne, heureux présage. Le dieu consent à sexpliquer ; Créon apporte la réponse. Il faut, dit Créon, bannir de cette contrée un monstre quelle nourrit.... Cest le sang qui déchaîne cette tempête sur notre ville.... Laïus a été tué, il y a longtemps de cela et Thèbes oubliait le meurtre de son roi, mais les dieux noublient jamais. Il nest pas de crime qui puisse échapper à la loi fatale de lexpiation. Laïus a été tué sur une route par des brigands, du moins on lassure. Lenquête qui hélas ! mènera si loin et si haut, déjà commence, le dialogue se poursuit entre dipe et Créon. Le meurtrier est sur la terre thébaine, les dieux laffirment. Mais comment le découvrir ? Quels indices ? Quels soupçons ? Sur quelle piste la justice vengeresse va-t-elle se lancer ? Cest moins que le doute et lincertitude, cest lignorance, cest la nuit. dipe cependant en atteste les dieux, il cherchera le meurtrier. Il le doit. Et le drame ainsi des les premières scènes, se noue, curieux, menaçant, déjà gros de tempêtes. Une nouvelle énigme nous est posée, dipe excelle à comprendre les énigmes, cest son ambition, son orgueil. Eh bien quil cherche donc le mot de celle-ci ! Peut-être en viendra-t-il à regretter les griffes du sphinx ; car le sphinx était clément, il ne faisait que tuer ses victimes. Lorsque le dialogue est coupé en interrogations, en réponses hâtives, la musique se fait plus discrète. Elle na pas dautre rôle que de soutenir, de souligner la parole. Les modes employés ne sont pas caractérisés très nettement ; cependant ils suivent, autant quil est possible, le vol entrecroisé des pensées et des vers. Le mode phrygien, tout spécialement cher à Sophocle et quil a, dit-on, le premier introduit dans la tragédie, convient à merveille aux situations pathétiques et troublantes ; il exprime laction ; le mode dorien plus calme, empreint dune profonde majesté, apaise et cependant ne convient quà de sévères pensées. Le lydien sattendrit en des sensations plus douces, tandis que lionien fougueux, violent, déchaîne les orages de la colère, jette les dures paroles qui blasphèment et maudissent. Lhypodorien commande et simpose par une grandeur souveraine. Aussi ces modes ne sauraient convenir le plus souvent au chur. Le chur agit peu ou nagit pas. Les modes lydien et mixolydien lui sont justement réservés. Dans ces modes plus tranquilles, aisément pénétrés dune onction religieuse, sont écrits les chants que le chur resté seul adresse à Phbus Apollon. Ce nest pas lemmellia, scène animée, dansée autant que chantée, mais le stasimon, le chant grave que lon dit, sans laccompagner dévolutions ni de danses, le chant en place, prière sainte et qui magnifiquement épandue aux vers harmonieux de Sophocle, balancée de la strophe à lantistrophe, est si douce, si coulante, si belle quelle ne saurait manquer dattendrir les dieux. La tragédie grecque présente deus grandes divisions, la partie purement chorale le choricon et le rhésis, le drame proprement dit, laction et le dialogue. Le son éclatant des hymnes saints se mêle aux accents des voix gémissantes. Fille de Zeus, viens à nôtre aide et daigne nous consoler !... Dieu Lycien, tire de ton carquois dor les flèches invincibles, viens nous protéger !... Et toi, qui ceins une mitre dor, compagnon des Ménades, divin Bacchus, prends une torche enflammée et combats le plus cruel de tous les dieux ! dipe revient. Il sadresse au chur, il sadresse à toute la cité de Thèbes ; déjà quelque vertige la saisi. Il faut suivre cette uvre de vengeance que réclament les dieux. Quon se mette en campagne l Que lon recherche le meurtrier ! Quon le dénonce ! Le dénonciateur est assuré dune royale récompense : Quel que soit le criminel, je défends à tous sur cette terre qui mappartient, de laccueillir, de lui parler, de ladmettre aux prières, aux sacrifices sacrés, de lui offrir leau lustrale. Que tous le rejettent loin du seuil de leurs maisons comme le fléau de la patrie ! Et le malheureux, dans sa haine insensée, sexcite, se grise ; il maudit ce meurtrier inconnu, il se maudit, lui-même : Que lassassin traîne dans linfamie une vie misérable ! Sil pénètre jamais chez nous, dans mon palais, et de mon consentement, moi-même je me voue aux malheurs demandés pour lui. Que retombent sur moi les imprécations lancées contre le coupable ! dipe devance lavenir ; il a lui-même prononcé son arrêt. Dans tout le théâtre lémotion est profonde, non pas bruyante cependant. Le drame vainqueur sest emparé de la scène ; le poète sest asservi nos yeux, nos oreilles, notre esprit ; il nous conduit comme un berger son troupeau. Nous avons abdiqué toute volonté, toute pensée qui nest pas la sienne, nous le suivons et toujours nous le suivrons, nous devrait-il conduire à la hache du victimaire, aux autels altérés de sang. Sollicité par le peuple thébain, appelé par dipe, Tirésias va venir. Tirésias, seul de tous les êtres vivants, a été tour à tour homme et femme. Tirésias a surpris au bain la sur de Zeus, la divine Héra, et la déesse irritée ordonne que ces yeux qui lont un instant contemplée, ne voient plus rien désormais. Tirésias est aveugle ; mais implorée par sa mère, la clémence de Zeus a donné au sacrilège le don de divination et de prophétie. Pour lui les yeux du corps sont à jamais fermés, les yeux de lesprit sont ouverts à toutes les lumières. Tirésias connaît tout le passé, prévoit tout lavenir ; il nest pas dombre que le flambeau de sa pensée ne dissipe, pas de mystère quil ne pénètre. Voici Tirésias en présence ddipe. dipe linterroge. Aussitôt le devin recule et veut senfuir. Quel abîme sest ouvert ? Quelle vipère a sifflé dans les ténèbres ? Hélas ! hélas ! Que la science est un présent funeste !... Quon me laisse partir ! dipe insiste, menace. Il veut comprendre, il veut savoir. Son orgueil de roi ne saurait accepter de résistance ni de vaine défaite. Tirésias doit, parler. Ce silence obstiné laccuse, serait-il donc complice du meurtre de Laïus ? dipe ose le supposer et jette au vieillard linsulte de ces soupçons odieux. Tirésias, poussé à bout révèle loutrage puisquil le faut, il révèle cette vérité terrible, il la proclame, il la crie à la face de tous. Conforme-toi, dipe, à la sentence que toi-même as prononcée ! Je te lordonne ! Tu es linfâme qui souille cette terre ! dipe cependant ne saurait se reprocher ces crimes. Lui meurtrier, lui parricide ! Cette effroyable révélation met le comble à sa colère. Il sait bien quil est innocent. Thèbes en a-t-elle jamais douté ? Est-on criminel sans le vouloir, sans connaître son crime ? Hélas ! il se peut faire, si telle est la volonté des dieux. dipe outragé accable dinjures ce devin de malheur. Des ennemis lont suborné, soudoyé. Cest un complot, tramé dans lombre, Créon, Tirésias sont dintelligence contre le roi. Mais dipe saura se défendre. Quil parte donc ce Tirésias, ce prophète menteur, cet aveugle qui prétend voir quelque chose ! Il renie ses devoirs de sujet, il se proclame serviteur et prêtre dApollon ! Protection mensongère que cependant. dipe veut bien encore respecter. Et Tirésias, retournant le poignard dans la blessure quil a faite, précise son accusation, déchire tous les voiles, prédit tous les malheurs, toutes les épouvantes du lendemain. Le dialogue haletant, à chaque réplique, sur chaque mot, bondit, sursaute, jette de sinistres éclairs, tantôt se coupe en phrases nettes et courtes, tantôt sépand plus longuement, déchaîne le torrent des vers menaçants et terribles. Cest un combat, une mêlée, les glaives prompts à lattaque, habiles à la riposte, sentrecroisent, se heurtent, brillent, les coups portent, les blessures saignent et je ne sais quelle horreur sublime enveloppe déjà, ainsi quun voile funèbre, la victime que sest promise le destin. Je pars, dit Tirésias,... ce meurtrier maudit, il est dans cette cité.... Il perdra ses richesses, il perdra la vue. Aveugle, il ira sur la terre dexil, soutenant à grandpeine dun bâton ses pas chancelants. Il se reconnaîtra pour le père et le frère de ses propres enfants, pour le fils et le mari de sa mère, pour le meurtrier de son père.... Maintenant, dipe, rentre dans ta demeure, et si tu peux jamais me convaincre de mensonge, proclame que je nentends rien à la divination ! dipe voudrait vainement sen défendre. Le blessé cest lui, et la plaie senflamme, sagrandit aux morsures dun poison subtil. Un effroyable doute est entré dans son esprit. Il a baissé partir Tirésias et lui-même cherche, loin de la foule, un inutile refuge dans son palais. Le crime et le remords lhabitent, le souillent, et bientôt ils sauront len chasser. Que faire ? Que penser ? Le peuple de Thèbes hésite. Lautorité est grande qui sattache aux paroles de Tirésias. Mais dipe autrefois a sauvé la ville, dipe règne depuis de longues années, aimé, respecté de tous. dipe est étranger, son père Polybe vit toujours, il est roi de Corinthe. Comment le fils dun père vivant aurait-il pu commettre un parricide ? Quelles incertitudes ? Une clarté soudaine a cependant traversé cette nuit, mais la nuit, aussitôt est retombée plus épaisse, plus profonde. Vain mirage ! clarté mensongère ! Ces horizons entrevus, que plutôt ils restent voilés pour jamais ! Lillusion est clémente et douce auprès dune semblable vérité. dipe et Créon, une fois encore mis en présence, accentuent le conflit. Les récriminations, les accusations haineuses du roi ne sauraient déjouer la tranquille défense dune âme forte de son innocence et de la mystérieuse approbation des dieux. Le chur intervient, modérant ces menaces vaines et rappelant le malheureux dipe à plus de calme et de raison. Sur de Créon, épouse ddipe, reine par la naissance et par le libre choix de ses deux maris, Jocaste intervient ; sa voix est plus docilement écoutée. agrus joue le rôle de Jocaste. Ce nest quun personnage de seconde importance, un deutéragoniste. agrus lui prête cependant une majesté singulière. Il na pas chaussé le haut cothurne, mais lembale un peu moins élevé et qui convient mieux aux rôles de femme. En ce moment trois acteurs sont en scène. Sophocle le premier eut cette audace de mettre aux prises plus de deux personnages. Eschyle avant lui limitait le conflit et la lutte au choc de deux personnes et de deux passions. Jocaste est incrédule aux oracles, même aux dieux. Aurait-elle pressenti le scepticisme impertinent dun Euripide ? Elle protège son frère ; Créon, menacé de mort, en sera quitte pour le bannissement. Mais ce nest pas assez, Jocaste désire faire mieux encore, rendre la paix à cette âme ddipe bourrelée de chagrins, de regrets, de vagues inquiétudes et quun souffle de démence a déjà traversée. Sache, dit-elle, que les choses humaines nont rien de commun avec la vaine science des devins. Un oracle inspiré non par le dieu lui-même, mais plutôt dicté par ses prêtres, prédit à Laïus mon époux quil périrait de la main dun fils qui lui naîtrait de moi. Des brigands étrangers lont tué sur un chemin qui se partage en trois sentiers. Lenfant voué au parricide, nétait pas né depuis trois jours que, les pieds percés, il était jeté, et abandonné sur une montagne déserte. Laïus est mort et non sous les coups de son fils, comme loracle lavait dit.... Pourquoi donc sinquiéter ?... Ces mots qui dans la pensée de Jocaste devaient dissiper toutes les craintes, bien au contraire tout à coup réveillent des souvenirs longtemps oubliés. Ce nest plus de lanxiété, cest de langoisse : Laïus, répète machinalement dipe, fut tué, dis-tu, dans un chemin qui se partage en trois sentiers ? On la dit.... Où donc ?... En Phocide, au croisement des routes de Delphes et de Daulie. Combien dannées écoulées depuis lors ? Peu de temps après tu devenais roi de ce pays. Un cri de douleur échappe aux lèvres ddipe : Zeus ! que veux-tu faire de moi ? Et quel était lâge, quels
étaient, les traits de Laïus ? Ses cheveux blanchissaient. Ses traits différaient peu des tiens. Toujours dipe interroge, toujours Jocaste répond, encore inconsciente de son uvre mauvaise. Chaque mot est un flambeau qui sallume. Quel secret va se découvrir ? Est-ce donc aux enfers que nous allons descendre ? dipe, pris de vertige, sacharne à cette recherche et multiplie ses questions. Il se perd, il le sent, il le dit, mais il veut se perdre. Le gouffre entrouvert lui fait peur et lattire. Tout à lheure il se condamnait, se maudissait lui-même, maintenant que la mémoire lui revient à lesprit, que le soupçon des crimes accomplis lui soulève le cur, il sacharne à se confondre lui-même et lui-même à se découvrir. Comme cela est vrai et profondément humain ! Ne sommes-nous pas toujours les premiers artisans de nos malheurs ! Il est si bien dans la destinée des hommes de souffrir quils se plaisent bientôt à flétrir toutes leurs joies ; et leurs lèvres, seraient-elles égayées dun sourire, ne cherchent rien tant que le venin qui les doit empoisonner. Un homme, un témoin survit encore ; il petit tout éclaircir, cest lun des serviteurs qui accompagnaient Laïus. Berger, retiré à la campagne, il garde les troupeaux du roi, comme il a fait toute sa vie. Quon aille le chercher ! quon lamène ! Il a dit que plusieurs brigands avaient assailli Laïus ; et lui dipe était seul, il se le rappelle très bien, lorsquil frappa et renversa de son char un voyageur qui lui disputait le chemin. Jocaste écoute et nous écoutons plus attentifs quelle-même. dipe raconte larrivée dun étranger sur le chemin que lui-même suivait, chemin qui se partage en trois sentiers, la querelle survenue, la rixe, le combat, la funeste victoire, la mort dun vieillard assommé sous le bâton, la fuite de son escorte. Quel effrayant, rapprochement aussitôt simpose à lesprit ! Cependant, dipe est fils de Polybe, non de Laïus, le fils de Laïus est échappé par la mort à lhorreur des crimes prédits. Où donc chercher linceste et le parricide ? dipe est en proie aux plus cruelles incertitudes, tantôt prêt à sarracher lui-même un aveu qui lépouvante, tantôt raisonnant avec plus de sang-froid, se répétant toutes les circonstances qui contredisent laccusation et proclament son innocence. Une fois encore les éclairs ont traversé les nuages dont le ciel est obscurci, mais plus nombreux, moins rapides. Nous cheminions inquiets sur une route pleine de surprises et dembûches, bordée de précipices, maintenant, nous y courons. Un vent dorage sest levé qui nous pousse par les épaules et dun instant à lautre, nous sentons approcher labîme où vont sengloutir la gloire, la puissance ddipe et ce qui lui reste encore de chimère, dinnocence et de bonheur. Un chur dune gravité toute religieuse suspend cette course fatale. Le poète a voulu reposer un moment notre émotion haletante, il nous ménage, nous épargne pour nous frapper plus sûrement tout à lheure. Nos âmes obéissantes au souffle inspiré des beaux vers, sont pour lui comme les cordes dune lyre ; il les fait vibrer, résonner à son caprice, sattendrir, étouffer leurs plaintes ou bien exhaler tous les sanglots, gémir toutes les douleurs. .... Lorgueil enfante le tyran... sil est un homme qui sans crainte de la justice, sans respect pour les images des dieux, ose porter jusquà eux linsolence sacrilège de son bras et de sa langue, quune mort funeste le châtie de ses passions criminelles ! si pour grandir sa fortune, il brave la justice, si dans sa démence il sabandonne à des actes impies et porte sur les choses saintes une main sacrilège, au milieu de ces profanations, quel mortel se fera désormais un honneur de mettre un frein à ses passions ... ? Cet appel véhément, à la justice provoque dans toute lassistance une émotion que Sophocle navait pu prévoir. Rappelle-toi que laffaire des Hermès renversés nest apaisée que dhier. Et voilà quen un langage plus impérieux, au milieu de la solennité dune fête publique, par la voix de ces choreutes quinspire lâme de la patrie elle-même, les dieux semblent rappeler leur injure encore impunie et réclamer la vengeance promise. Nous éprouvons une sensation mal définie de gêne, de tristesse, de colère et de honte. Le vrai coupable, celui quAthènes presque tout entière a aussitôt désigné, le contempteur des dieux est là au milieu de la foule, sur les gradins réservés aux premiers magistrats. dipe un instant est oublié, on ne voit quAlcibiade. Tout autre que lui se serait troublé et dénoncé par son trouble même, car tous les yeux le cherchent, je ne sais quel vague murmure monte et prélude aux tempêtes les plus redoutables. Mais Alcibiade est maître de lui comme il est maître des autres. Il se retourne à demi, lentement regarde autour de lui ; il nest pas un regard qui soutienne limpassible fermeté du sien. Lindignation, la haine déjà menaçante expirent devant cette tranquillité souveraine, comme devant un écueil, la vaine colère de la ruer et de ses vagues affolées. Au reste Sophocle nest pas de ces poètes que puisse déserter longtemps lattention vigilante de ceux qui lécoutent. Il nous ressaisit bientôt. Tout à lheure Jocaste faisait étalage de son incrédulité ; la voici qui revient les mains chargées de guirlandes fleuries. Cest bien là un de ces revirements où se trahit lincurable faiblesse dun cur de femme ; Jocaste veut prier ces dieux dont ses doutes insultants raillaient la sagesse et les oracles. La peur lui rend sa foi et sa piété. Un messager parait, porteur dheureuses nouvelles, du moins il se plait à lassurer. dipe, appelé par Jocaste, prendra sa part de cette joie. Polybe, roi de Corinthe, père ddipe, vient de mourir, non pas victime dun meurtre sanglant, mais épuisé de vieillesse, soumis sans violence aux lois suprêmes de la nature. Quel surcroît de gloire et de puissance ! dipe règne sur Thèbes, la riche Corinthe lattend pour le proclamer roi. Ce nest pas tout, Polybe disparu, loracle est déjoué, la menaçante prédiction du parricide tombe inutile et démentie. dipe peut se réjouir, car auprès des épouvantes dun avenir qui déjà lui semblait présent, la mort de ce père promis au meurtre lui devient une joie, un doux apaisement. dipe, effroyable ironie, ne peut trouver de bonheur que dans la mort de tous les siens. Il est encore inquiet cependant ; il échappe au parricide, mais les oracles lui ont encore prédit linceste le plus hideux. Et sa mère vit, encore, Mérope, restée à Corinthe. dipe, tout à lheure emporté sur une pente fatale, sétonne de ce répit. Est-il donc sauvé de lui-même et des autres ? Il doute. Cest le noyé à peine échappé du torrent et -qui se cramponne dune main crispée aux rochers de la rive. Partout il cherche un appui, un guide, une voix qui le console et qui lencourage. dipe fait part au messager de ses anxiétés et de loracle déjà à demi démenti, mais qui lobsède encore. Quelle heureuse occasion pour cet homme de montrer son zèle, de mériter la faveur de son nouveau maître ! dipe ne doit plus conserver aucun sujet dinquiétude. Mérope nest pas la mère ddipe, Polybe nétait pas son père. dipe trouvé mourant et suspendu par une courroie qui lui traversait les pieds, nétait, quand il fut reçu au foyer de Polybe, quun orphelin abandonné et inconnu de tous. Cependant le roi, lui-même privé denfant, lenvironna dune tendresse toute paternelle et le fit élever comme son fils. Quelle révélation soudaine, inattendue, et qui rejette le malheureux dipe dans les terreurs un moment assoupies ! Cette joie promise nétait rien quun mirage décevant. Il faut que la vérité éclate. Le drame rebondit. Cest le torrent quun écueil avait un instant arrêté, tout à coup il brise ses digues trop fragiles, il roule plus terrible, impatient, jaloux de donner libre cours à ses colères, libre espace à ses ravages, comme sil voulait se grossir encore de larmes et de sang. Jocaste a compris enfin. La première elle voit clair en ces ténèbres bientôt dissipées. Une dernière rois, elle conjure dipe darrêter ses recherches. dipe résiste. Il a senti passer sur son visage le souffle glacé qui annonce un prochain abîme. Quimporte ? Une puissance fatale le pousse. Le trident invisible de Poséidon déchirait les flancs des chevaux attelés au char du malheureux Hippolyte, le char fuyait heurté sur la grève, mis en pièces sur les rochers, et le dieu trop fidèle accomplissait la vengeance dun père abusé. dipe lui aussi ne saunait plus reculer. Il a réclamé la vengeance, il la doit accomplir. Jocaste lui a dit : Malheureux ! puisses-tu ne savoir jamais qui tu es ! Puis elle est partie sur un cri dépouvante qui nous a fait trembler. Parler encore, elle ne le pourrait plus. Regarder cet dipe, cette énigme vivante dont le mot tout à coup sest révélé ? Elle nen aurait plus la force. Souffrir même la lumière du jour, vivre comme tous ceux qui nont pas indigné le soleil, voudra-t-elle y consentir encore ? Labandon commence. Lépouse a fui, nest-elle que lépouse ? dipe veut savoir, veut savoir toujours ! Ce messager, venu de Corinthe, ignore lorigine de lenfant apporté au roi Polybe. Il le reçut dun berger au service de Laïus. Ce berger ne serait-il pas lesclave qui accompagnait Laïus dans son dernier voyage ? Il se peut, il faut sen éclaircir ! Une fois encore le chur remplit la scène de chants attendris, de plaintes et de prières. Mais le drame se hâte. Une telle angoisse étreint nos curs, que nous appelons ce dénouement suspendu, longtemps dérobé, toujours promis et qui doit cependant mettre le comble à toutes ces horreurs. Il semble que nous traînions une chaîne, de forfaits inouïs et dont le premier anneau est scellé aux dernières profondeurs des enfers, si même les enfers ont jamais pu concevoir de semblables forfaits. Il vient enfin, ce vieux berger, serviteur de Laïus ; et dabord il ne reconnaît pas le messager venu de Corinthe. Tant dannées ont passé depuis le jour où tous deux paissaient les troupeaux de leurs maîtres aux pâturages du Cithéron ! Une ombre clémente, pour la dernière fois, sépand et nous dérobe latroce vérité. Mais pressé de questions et par le messager et par dipe lui-même, le berger rappelle ses souvenirs. A son tour il comprend, à son tour il veut se taire ; car tous, prêtres, devins, reine, épouse, pasteur, esclave, les plus grands et les plus petits sont condamnés à regretter les paroles à peine échappées de leurs lèvres, tous reculent, tous veulent se rejeter en arrière comme lon fait, lorsque sous le pied a glissé dans lherbe un serpent gonflé de venin ; tous parlent, cependant, épouvantés bientôt de leurs réponses et des clartés sinistres dont tout à coup sillumine le chemin. En vain il a voulu sen défendre, il le dit, il lavoue. Ce berger avait reçu un enfant nouveau-né quun ordre formel lui commandait de faire périr. Pourquoi donc ? Un oracle avait prédit à cet enfant le parricide. Le tuer, cétait lui faire grâce. Mais le berger, un pauvre homme bien simple ne pouvait comprendre ces subtilités ingénieuses. Tuer un petit être qui navait encore sur la terre fait que gémir et pleurer, il nen eut pas le triste courage. Rien ne défend mieux un enfant que dêtre sans défense. Il lépargna, et qui donc, cest la question dernière, avait recuis ce nouveau-né au pasteur qui devait être son bourreau ? Jocaste elle-même : et cet enfant, on le disait fils de Laïus ! Le mystère est enfin révélé à tous et dans toute son étendue, dans toute son horreur. Au cours de ce drame sublime et qui semble bien simple cependant, car une pensée unique le traverse et le domine, lorage na jamais cessé, plus de quelques instants, de menacer et de gronder. Nous allions dans cette nuit, dirons-nous menés par le génie tout-puissant, du poète ou par les grondements dun tonnerre qui se rapproche toujours ? Voici que la foudre éclate. Jocaste tout à lheure a fui ! dipe vient de fuir à son tour. Quest-ce donc quils ont voulu fuir ? La punition, le châtiment des hommes ? Nul ne songe à les inquiéter : ce sont là de ces maudits élevés si haut dans leur infortune quils nappartiennent quaux dieux. Ils fuient leurs crimes, le fer rouge du remords qui leur a brûlé le front, ils fuient leurs justiciers secrets, leurs vrais bourreaux, ils se fuient eux-mêmes. Hélas ! lhomme est à lui-même le seul ennemi quil ne saurait fuir, le seul vengeur implacable auquel il ne saurait échapper. Tu ne peux croire, ami, quelle impression saisissante et poignante nous laissent ces départs précipités et affolés ! Comme ces disparitions subites en disent plus que ne feraient les plus éloquentes lamentations ! Un instant venu, Sophocle lui-même a senti quil devait se taire. La douleur arrivée à son paroxysme, reste muette, le cur na plus de sanglot, la bouche na plus de cri, les yeux nont plus de larmes. Nous sommes écrasés, terrassés, anéantis, à peine sil nous demeure assez de souffle pour nous reprendre à la vie. Seuls les choreutes qui ne sont que les témoins et les confidents, non pas les artisans de tant de vicissitudes et de tant de malheurs, peuvent encore nous parler un langage vrai et qui se fasse entendre de notre cur et de notre pensée. Race des mortels, que notre vie est peu de chose, dit-il... ! dipe, si longtemps comblé dhonneurs, riche de gloire, toi qui fus reçu dans le même sein, comme père et comme époux, comment ce lit nuptial qui fut celui de ton père, a-t-il pu si longtemps te porter en silence ?... Fils de Laïus, pourquoi te connaître ?... Que ma douleur sépande en clameurs lamentables !... Le drame nest pas terminé cependant. Quest-il advenu de ces douleurs farouches ? Ces désespoirs sans nom ont-ils retrouvé la voit ? Ont-ils jeté des cris que nous puissions entendre ? Un envoyé parait qui va nous le dire. ... Les eaux de lIster, celles du Phase ne suffiraient pas à laver les souillures cachées dans cette demeure, sécrie-t-il. Quel récit dune puissance tragique quon ne saurait dépasser ! On nous aurait mis sous les yeux toutes ces infamies et ces crimes nouveaux, dignes fils des crimes anciens, que la terreur ne serait pas aussi profonde. Quelque répugnance, quelque dégoût gênerait notre émotion. Les yeux, occupés à suivre une mimique compliquée, pourraient distraire la pensée. Nous serions ainsi sollicités par des objets divers. La surprise serait plus grande, limpression plus brutale, mais peut-être moins profonde. Ce sont les yeux de lâme qui savent le mieux pénétrer les mystères de nos douleurs. Jocaste, rentrée dans sa royale demeure, sest enfermée en la chambre des époux ; elle a évoqué lombre sanglante de Laïus, lui rappelant le souvenir de ce fils oublié qui devait tuer son père et rendre sa mère, mère denfants incestueux. Elle inonde de ses pleurs ce lit où elle eut un époux de son époux, des enfants de son enfant. Alors dipe est accouru, abominable tête-à-tête quils nont pu supporter ! dipe, lépée à la main : Où est-elle cette femme, criait-il, qui est ma mère et la mère de mes enfants ? Puis les portes un moment fermées, et qui nous dérobaient laccomplissement de ces fatalités suprêmes, se sont rouvertes tout à coup. On a vu Jocaste étranglée et pendue. dipe sest jeté rugissant sur le cadavre, il a saisi une épingle des vêtements et lui-même sest arraché les yeux, ces yeux coupables, gémissait-il, de navoir pas vu ses crimes et de voir ses malheurs. Ses yeux narrosent plus son visage de larmes, mais dune pluie de sang. Sophocle, avec une habileté suprême, ou pour mieux dire par une sublime inspiration de son génie, nous a quelques instants épargné le spectacle ddipe, de ses supplices et de ses vengeances. Il va rendre son héros, non plus à nos soupçons, non plus à cette haine que le crime traîne toujours après soi, mais à notre pitié ; car cet homme est tout à la fois innocent et coupable, coupable de fait, innocent dintention. Il a été grand par ses exploits, grand de sa royauté conquise, grand de ses richesses et dune toute-puissance longtemps sans bornes, dun bonheur longtemps sans nuage, il est plus grand encore par son infortune. Ses calamités lui sont un nouveau diadème. Victime plus cruellement frappée que celle qui tombe sur lautel, il apparaît sur le monde, seul, sans crainte désormais, sans rival, car rien ne saurait plus légaler ni latteindre. Il a épuisé toutes les amertumes, il ira à travers les contrées et les peuples, personnification sublime de la fragilité des choses humaines, effroyable exemple de linfaillibilité implacable des dieux. Nous lattendons cependant ; nous voulons lentendre, nous voulons le voir ; il nous appartient, car toujours le malheur appartient à lhomme. Le voici ! Il entre. Tout dabord il nous tourne le dos. Il marche lentement, au hasard, il hésite où mettre le pied. Ses bras tendus cherchent un appui, les mains implorent une main qui les guident. dipe na pas encore fait lapprentissage de sa lugubre infirmité : il se retourne ; nous le voyons. Callipide a changé de masque. Les orbites béantes sont rouges dun sang mal épanché. Cest un frémissement dhorreur qui traverse limmensité du théâtre tout entier. Pour moi je ne me connais plus, je ne suis plus Théleste de Sélinonte, je ne suis plus sur les gradins dun théâtre, je suis à Thèbes auprès ddipe, mon cur se serre, je nose plus respirer et mes yeux pleurent toutes leurs larmes pour cet aveugle qui nen a plus. Mon regard est troublé, ma lèvre sèche, mon front inondé dune sueur dépouvante. Cest beau cependant, cest admirable et ces tortures ont une secrète douceur. Ces horreurs jamais ne grimacent ; jamais ce désespoir ne se fait hideux et bas. Nous sommes toujours emportés à de telles hauteurs que tant de misères senveloppent dune splendeur divine. dipe aveugle et saignant fait songer à Prométhée enchaîné sur le Caucase et livrant ses entrailles aux griffes du vautour. Ce drame est implacable, mais il garde la sérénité éternelle du destin. Implacable, ai-je dit, jusquà présent il est vrai. Mais la muse de Sophocle réserve à tant de blessures un baume consolateur ; elle va sattendrir, gémir et pardonner. Hélas ! hélas ! malheureux que je suis !.... Ainsi parle dipe. Sa voix perdue dans le silence et dans cette nuit, sans aurore, lui fait peur et larrête. Le chur lui adresse quelques paroles amies ; et voilà cet homme, tout ensemble tourmenteur et patient, victime et bourreau, qui sémeut et remercie. Il est donc des mortels qui peuvent encore supporter sa présence. Joie inespérée ! Ce monstre ne se croyait plus de la famille des humains. Je ne puis approuver le châtiment que tu viens de tinfliger, dit le chur. Ne condamnez pas ma résolution, répond dipe. Descendu dans les enfers, de quels yeux aurais-je pu regarder un père, une mère infortunés ?... Que ne puis-je à tout jamais me boucher les oreilles ? anéantir tout ce qui me laisse en communication avec les hommes ? être à la fois aveugle et sourd ?... Ô Corinthe ! demeure vénérable que jappelais celle de mon père !... Ô triple chemin, sombre vallée, forêt témoin de mon crime, étroit sentier à lembranchement des trois routes qui as bu le sang de mon père, gardes-tu le souvenir des crimes qualors jai commis et de ceux que jai commis plus tard ?... Hyménée ! funeste hyménée !... Créon reparaît, Créon que le ressentiment dpide condamnait au bannissement. Thèbes lui appartient, à son tour il est roi. dipe est à sa merci, Créon peut décider de lui ; mais quelle disgrâce, quelle douleur est-il encore qudipe puisse redouter ? Créon tout à lheure injustement outragé et puni, se montre pitoyable à celui qui fut son frère. dipe a épuisé les vengeances des dieux, que pourraient lui demander encore les vengeances des hommes ? Quelle place trouverait-on dans ce cur qui nait pas encore saigné ? dipe est cependant touché de cette clémence. Il ne la pas implorée pour lui ; mais il est père, bien que ce doux nom lui fasse horreur ; il songe à ses enfants, à ses filles surtout. ... Ô Créon, je laisse deux filles bien dignes de pitié. Autrefois elles venaient sasseoir à ma table auprès de moi ; je ne touchais aucun mets dont je ne leur fisse la première part. Veille sur elles avec tendresse !... Que je les touche encore une fois, Créon, mon frère !... Créon a prévu et devancé ces désirs. Les enfants sont venus. dipe ne les voit pas ; il ne voulait plus les voir. Créon les fait approcher de lui. dipe les sent, il les embrasse, furieux, avide, honteux et cependant enivré de cet amour paternel le plus doux de tous les amours. Ces baisers redoutés, désirés, il ose les prodiguer dans cette nuit que lui-même sest faite ; car la nuit est clémente et ne sait pas rougir. Quel avenir cependant pour ces filles nées de linceste ! ... Qui oserai vous épouser, mes enfants !... Le célibat, la stérilité, seront votre partage.... Fils de Ménécée, toi le seul père qui leur reste, ne les regarde pas avec mépris, elles sont issues de ton sang. Ne souffre point quelles consument leur vie dans la misère et labandon ! Dégale point leur infortune à mes malheurs !... Promets-le, généreux Créon, et pour gage de ta promesse, ne refuse pas de me donner la main !... Créon consent, Créon touche cette main tout à la fois criminelle et vengeresse, cette main qui a tenu le sceptre des rois et qui peut-être va se tendre aux aumônes de létranger. dipe enfin séloigne. Cest lexil qui commence. Derrière lui dipe a laissé ses enfants, il ne saurait les guider dans la vie, lui qui ne saurait plus se guider dans le chemin. Il part. Tous les oracles sont accomplis. Les dieux ne sont-ils pas contents ? Lexilé emporte avec lui tous les deuils qui peuvent désoler une famille, toutes les souffrances qui peuvent dévaster une âme, toutes les tristesses, tous les regrets, toutes les épouvantes qui peuvent courber vers la terre le front dun homme, dun fils, dun époux, dun père et dun roi. Le chur alors, cest laphodos, le chant de sortie, accompagné des chalumeaux, conclut ce drame ainsi achevé dans les larmes de pitié et dattendrissement : Voyez, Thébains, cet dipe qui explique les énigmes du sphynx, en quel abîme de misère il est descendu !... Aucun mortel sachez-le bien, tant quil na pas vu luire le dernier de ses jours, ne saurait être appelé heureux.... Mes souvenirs si présents quils fussent, ont dû me trahir
quelquefois, mes récits ne sont pas toujours fidèles, jose pourtant te le
dire, tel est, dans son ensemble magistral, ce drame ddipe roi.
Telle est cette uvre souveraine que le vieux Sophocle vient denfanter en la
fleur hivernale de ses quatre-vingts ans. Quel prodige ! Comment ce vieillard
qui peut-être a déjà heurté du pied les dalles de son tombeau, trouve-t-il en
sa pensée, tant de force, tant de jeunesse ? Comment ce cratère qui semblait
enseveli sous la neige, a-t-il projeté tant de flammes, lancé tant de lumière
? On en vient à se demander si le poète na pas fait quobéir, écouter,
transcrire ce que la muse elle-même se plaisait à lui dicter. Melpomène,
jalouse de laisser la tragédie modèle, le type achevé de ses nobles
créations, naurait-elle pas donné à Certes Athènes est digne découter Sophocle comme Sophocle est digne denseigner Athènes ; et, le succès fut grand, lenthousiasme soulevait la foule comme les aquilons soulèvent limmensité frémissante de la mer. Les applaudissements roulaient, le plus souvent venus des rangs du populaire, de tout là-haut, des gradins extrêmes, on aurait pu dire du ciel même, quelquefois indiqués, préparés, encouragés par un murmure que prêtres et magistrats, les plus grands, les plus illustres de la ville, laissaient échapper de leur cur plutôt que de leurs lèvres. Mais les applaudissements, les plus furieuses acclamations ne sauraient payer dun juste prix cette victoire et le présent qui nous est fait. Pour moi je suis entré dans ce drame comme dans un temple sacré. Je me sentais enveloppé de cette horreur sainte que la présence du dieu impose au pèlerin. Sous les colonnades assombries, dans les perspectives fuyantes, sous la clarté des lampes qui scintillent, il me semblait avancer lentement. Les grandes lignes dune architecture sévère et toujours harmonieuse se révélaient, se déployaient en leur sublime unité, sans monotonie toutefois, et dans cette unité même, toujours variée. Plus javançais, plus je me sentais ému, plus je me trouvais humble et, petit. Je napplaudissais pas, jécoutais les voix épandues dans cette enceinte ; cétait une admiration filiale et tremblante, presque de la stupeur. Javais voulu exhaler un hymne de reconnaissance, je restais immobile, je me taisais, mais ce silence était, une prière et maintenant que le dieu, le temple, le sacrifice ne soit plus quun souvenir, bien des fois encore les paroles ont manqué et je ne saurais dignement exprimer tout ce que je pense. Certes, Marathon, Himère, Salamine, Platée sont de belles batailles, déblouissantes victoires. Les fanfares qui les ont célébrées sonnent toujours à nos oreilles. Mais cette tragédie ddipe roi nest-elle, pas une aussi belle bataille, une aussi mémorable victoire ? Qui sait cependant si lavenir connaîtra le jour qui devait léclairer ? Cette victoire est en même temps un bienfait suprême, car elle a maculé les horizons où senfermait le génie humain ; elle est remportée sans quune mère ait eu à pleurer son enfant, sans haine, sans meurtre, sans fol orgueil pour le vainqueur, sans honte pour le vaincu ; elle na fait que des heureux. Peut-être est-ce une raison pour que les hommes se souviennent moins de cette victoire que de celles quils ont payées daffreux massacres et de souffrances longtemps inapaisées. Après dipe roi que reste-t-il encore à faire ? Après ce coup de foudre que reste-t-il encore à dire ? Melpomène pourrait briser les cordes de sa lyre et remonter au ciel. Il semble quun silence éternel pourrait ressaisir ce théâtre de Bacchus sanctifié par ce chef-duvre divin ; il semble que le monde pourrait finir. La tragédie athénienne pourra-t-elle se maintenir sur la cime conquise ? Tant quelle vivra incarnée dans Sophocle, on le doit espérer. Sophocle seul peut égaler Sophocle. Laigle seul peut monter jusquà son aire sublime et donner des frères à ses petits. Mais une uvre comme dipe roi ne limite pas son envolée au ciel dune seule cité, elle appartient à tout ce qui est la terre des humains. Lhumanité nest pas quitte envers elle. Cette histoire ddipe roi sera plus quune légende confuse, oubliée à demi, que le génie du poète nous la rendra toujours vraie, toujours vivante, toujours présente ; cest une immortalité qui peut défier les siècles, et tous les pleurs ne sont pas répandus quarracheront aux yeux de lhomme, les malheurs de Jocaste et du fils de Laïus. Cinq juges solennellement désignés par larchonte investis dune autorité sans appel décident du résultat dans ces concours dramatiques et prononcent la sentence. Tu ne saurais timaginer ma stupéfaction, celle aussi de bien dautres, lorsquau moment de quitter le théâtre, jappris qudipe roi obtenait seulement le second prix ; le premier était attribué à la pièce de Philoclès. Philoclès est neveu du grand Eschyle, cest un mérite ou du moins un honneur, je le veux bien, mais qui me touche peu. Le souvenir dune telle gloire écrase, sil ne soutient pas. Aristophane a plusieurs fois bafoué Philoclès ; Aristophane nest pas indulgent, mais ses critiques ne sont jamais ni sans justesse, ni sans quelque justice. Au reste je ne prendrai pas la peine de discuter un jugement scandaleux et qui fera plus de tort aux juges quà Sophocle. Le second rang attribué à dipe roi, à cette pièce hors de tous les rangs, au-dessus de toutes les places ! Lesprit court les rues dans la ville chérie de Pallas ; mais il nest pas de ville où la sottise et lenvie naient droit de cité. En tous lieus où deux hommes respirent, il est un sot, quelquefois plus. A peine sorti du théâtre, je ne désirais rien tant que me retrouver seul avec mes pensées. Aussi je ne dis pas un mot, je ne fis pas un signe pour retenir Ion de Chio, quand il prit congé de moi. Brusquement cependant il revint sur ses pas et me jeta ces mots murmurés à loreille : Étranger, tu voulais voir Sophocle. Tiens ! regarde, là-bas ! cest lui ! Ces mots me troublèrent si profondément que joubliai, je crois, de remercier Ion. Jai eu loccasion, bien des fois dans ma vie, de voir et daborder des hommes sur qui reposait la destinée de tout un peuple, je me suis vu admis auprès de rois puissants, de tyrans cruels ; et si délicate que fût ma mission, si grands que fussent les intérêts confiés à mon zèle et à mon dévouement, jamais la conscience de ma responsabilité, jamais le danger même ne ma fait perdre mon sang-froid, ni voilé un seul instant la parfaite lucidité de ma pensée. La présence de Sophocle, souhaitée cependant, me semblait plus redoutable. Je navais dessein ni daborder cet homme, ni de lui parler, jespérais seulement le voir, lécouter sil se pouvait, et je tremblais, comme un enfant devant son maître, comme le croyant devant son Dieu. Je ne venais pas solliciter un oracle, ni demander une grâce, et mon cur battait dans ma poitrine comme si jallais entendre larrêt de toute ma destinée. Un instant je restai immobile, anxieux, incertain de ce que je ferais. Sophocle séloigne cependant ; il méchappe, il va disparaître. Il faut le suivre, il faut le rejoindre. Je hâte le pas. Il me prend une envie folle de marcher dans son ombre. Un fiancé passionnément épris ne se griserait pas de rêves plus étranges ; moi aussi je guette un regard, un signe, jespère un mot égaré jusquà mes oreilles ou plutôt jusquà mon âme et qui me donne la musique dune voix aimée ; moi aussi jaspire à ces riens charmants, mais qui nous sont des faveurs sans prix, quand vient le jour où le cur séveille. Une rue, renommée dans Athènes, débouche près du théâtre de Bacchus et doucement sélève aux pentes dernières de lAcropole. Cest la rue des Trépieds. Les nombreux monuments votifs que les vainqueurs des jeux publics y ont fait ériger expliquent cette appellation. On y marche environné dédicules, de petits sanctuaires, de bustes, de statues, et comme des soldats qui font la haie sur le passage dun roi, la vieille Athènes de Solon et dEschyle regarde passer la nouvelle Athènes. Les aïeux, de leurs yeux de marbre ou de bronze, interrogent leurs fils et leurs demandent sils sont dignes du sang qui les a fait naître. Cest par là que sépand la foule et que jai vu Ion sengager et bientôt disparaître. Sophocle prend une autre direction. Sans doute il craint le tumulte et le bruit. Il fuit la cohue de ces gens impatients de regagner le logis. Je le suis, mais à distance le plus souvent ; un esclave naurait pas tant de respect et de déférence. Nous voici bientôt, loin des quartiers populeux de la ville, presque dans la campagne. Quelques bosquets ombreux, les bouquets fleuris des lauriers-roses, une ligne de verdure qui ondule et serpente, enfin une certaine fraîcheur répandue dans lespace me révèlent lIlissus. Je le devine plutôt que je ne laperçois ; car le jour baisse, la nuit savance. Sophocle nest pas seul. Un jeune homme laccompagne, presque un enfant, svelte, élégant, beau, gracieux a faire envie aux plus belles. Sans le connaître, aussitôt je le reconnais, cest Sophocle le jeune, le petit-fils, dirai-je, de Sophocle lancien, non de Sophocle le grand, car le génie est aussi une jeunesse, et celle-là ne saurait se flétrir. Maintenant que rien ni personne ne les importune, le petit-fils et laïeul marchent plus lentement. Laïeul est dune taille qui dépasse un peu la moyenne, il se tient droit. Sa barbe est épaisse et toute blanche, les cheveux sont abondants et bouclés ; un mince bandeau noué par derrière les partage et de sa rougeur éclatante accentue leur blancheur de neige. Le vêtement est dune extrême simplicité, sans aucun de ces petits enjolivements que tolère le goût nouveau. Les traits du visage sont admirables ; à peine lâge a-t-il un peu creusé les joues, sillonné les tempes de rides très légères, lil est vif, le nez hardi, la lèvre immobile et, doucement rêveuse. Le caractère suprême qui se révèle, cest la fierté sans orgueil, la placidité sans froideur. Le petit-fils lui aussi nest vêtu que de laine tout unie. Est-ce bien deux hommes que je vois là ? Nest-ce pas plutôt le même homme à deux âges différents ? Sophocle à son aurore, Sophocle à son crépuscule ? Une origine commune, la parenté la plus intime, le même sang, le même cur peut-être saffirment dans les traits, dans laltitude, dans la démarche. Ils se complètent, ils se reflètent, tous les deux. Celui-là promet lhomme, celui-ci le réalise et lachève. Lenfance et la vieillesse ont de secrètes sympathies ; elles se comprennent si bien. Ce sont deux faiblesses qui veulent se rapprocher et sunir. Ce qui commence aime et recherche ce qui finit. Ce qui finit est clément à tout ce qui commencé. Le soir et le matin ont tous les deux dineffables douceurs. Peut-être, en un langage mystérieux, laïeul et lenfant échangent, de muettes confidences, mais ils ne disent rien, leurs lèvres restent closes. Nous étions arrivés auprès du temple de Zeus Olympien. Pisistrate lavait commencé, les Perses lont saccagé. Périclès a fait reprendre les travaux encore inachevés. Rien ne ressemble plus à un monument qui croule quun monument qui sélève, et dans la nuit grandissante, le chantier, lédifice incomplet ont la majesté et aussi la tristesse des ruines. Le sol est encombré de blocs qui seront des architraves, de dalles qui seront des métopes, de tambours qui seront des colonnes. Sophocle et son compagnon ont obéi à la même pensée ; ils sarrêtent et côte à côte prennent place au large tailloir dun chapiteau à peine dégrossi. Le site est magnifique, je conçois quil retienne au passage et commande la méditation. Javais peur de ma témérité sacrilège, mais je nai pu résister au désir de me rapprocher en cheminant à petits pas comme un voleur, étouffant le murmure de mon haleine, me dissimulant dans lombre que projettent les colonnes déjà dressées, jai pu sans trop de peine arriver à mon but et sans que le poète ait soupçonné ma présence. Là-bas, sur la droite, lAcropole apparaît. Lombre enveloppe les colonnades. Une lueur dernière laisse au fronton du temple de la victoire Aptère, une tache scintillante. Aptère, sans ailes, Athènes a voulu ainsi la victoire dont le culte lui est cher. Elle a voulu condamner la déesse changeante à la fidélité. Illusion peut-être, défense vaine. Si la victoire nest plus loiseau qui passe, elle est encore la femme qui jusque dans livresse de ses amours anciennes, médite la trahison des nouvelles amours. Mais aujourdhui encore la cité nest que joie et plaisir ; déjà elle apaise son lointain murmure, déjà elle repose, bientôt elle sommeille. Les colonnes qui me cachent et me protègent, avaient tout à lheure des transparences rosées ; on aurait dit quun sang divin circulait aux veilles de ce marbre. Échauffées tout le jour dun soleil ardent, caressées, pénétrées de cette flamme qui donne la vie, elles rayonnaient quand lhorizon éteignait déjà lincendie de ses splendeurs suprêmes. Voilà ce que jadmire, voilà ce qui mentoure. Un homme enfin est assis près de moi ; et cette ville que je sens là toute prochaine, cest Athènes, et cet homme assis sur les marbres dun temple, cet homme qui règne dans cette solitude, dans ce silence, dans cette immensité, cest le plus grand des poètes, cest le chantre divinement inspiré, lévocateur des ombres, le confident du ciel, de la terre et des enfers, cest Sophocle. Un sanglot tout à coup sélève et vient troubler le calme de la nuit commençante. Père, père vénéré et chéri, quelle indignité ! quelle infamie ! dit une voit douce et harmonieuse jusque dans sa colère. Quest-ce donc, mon enfant ? répond une voix plus grave et qui me fait tressaillir jusquau plus profond de mon cur. Toi le second prix ! Ton dipe vaincu ! Nest-ce que cela, mon fils ? Mon uvre ta semblé digne du premier rang, ta tendresse tabuse peut-être ? Mais quand il serait vrai, quimporte ? Crois-tu quil soit jamais donné à lhomme de monter si haut quil ne craigne plus de rivalité ? Les géants avaient entrepris de détrôner les dieux, le grand Zeus lui-même ; et moi, mon enfant, je ne suis pas un dieu. Mon dipe est supérieur, penses-tu, au drame de Philoclès, mais combien il est inférieur encore au rêve que javais rêvé, au mirage décevant que jai voulu poursuivre ! Notre uvre la plus belle, toujours quelque peu nous trahit ; et nous voyons toujours bien au-dessus delle, une place que tous nos efforts ne sauraient conquérir. Enfin, crois-moi, je suis assez vieux pour que lon consente à me croire, notre tâche à nous autres poètes est inconsciente plus quil ne semble. Les applaudissements nous sont doux, il est vrai, mais chanter est plus doux encore ; doux et amer quelquefois, toujours commandé par une fatalité qui nous domine. Penses-tu que le rossignol sinquiète beaucoup dêtre écouté ? Lamour seul lapplaudit et lui paye ses gazouillements. Quil soit dans Athènes ou dans le monde quelques hommes qui me comprennent, quelques âmes qui souvrent à ma pensée comme souvre la tienne, mon enfant, il suffit ; je suis dignement payé. Quai-je fait dailleurs ? jai travaillé, écouté les voix secrètes qui me bercent et me tourmentent, puis jai pris les tablettes et le style divoire ; la muse a fait le reste. Nous ne sommes rien que par la volonté immortelle des dieux. Non, je ne puis oublier ce jugement inique. Cest une honte pour Athènes. Partons ! Eschyle nous en a donné lexemple, Euripide annonce le projet de faire comme lui. Quittons cette ville qui te méconnaît et laissons-lui son Philoclès ! Mon enfant, et sur ce mot la voix de Sophocle montait plus ferme et plus sévère, mon enfant, ne parle jamais de honte quand tu parles de la patrie ! Tu nas pas plus le droit de médire dAthènes, même aujourdhui, quun fils na le droit de médire de sa mère. Elle ma comblé de tant de bienfaits, mon Athènes bien-aimée, que jamais ma gratitude ne pourra les lui payer. En des jours radieux et dont le souvenir seul me fait bondir le matin, jai été son soldat avant dêtre son poète. Je lui ai donné mon sang sur les champs de bataille avant de lui donner sur la scène ce que tu veux bien appeler mon génie. Cest elle qui minspire ; elle a nourri mon esprit comme elle a nourri mon corps. De toutes mes pensées, et tous les fibres de mon être je lui appartiens ; je suis son fils, et ma grandeur, ma gloire ne sont quun rayon perdu dans le rayonnement de toutes ses gloires et de toutes ses grandeurs. Si les générations futures nont pas oublié ma voix, puissent-elles comprendre quil faut une Athènes pour faire un Sophocle ! Mon enfant, toi aussi tu es né poète, et, disant cela, le vieillard doucement étendait la main sur le front de son enfant, je le sais, je le dis, je lai lu dans ton âme, avant de le lire dans tes yeux. Melpomène sest penchée sur le berceau que balançait ta mère, et ses veux pleins déclairs ont trouvé des sourires pour toi. Don fatal et qui te réserve des luttes cruelles, car tout se paye, dabord et surtout la gloire. Tu as vu les coureurs dans le stade se hâter vers le but, se passant une torche enflammée. Je touche au terme de la carrière et bientôt la torche qui me fut remise, doit échapper à cette main défaillante. A ton tour, mon enfant, à toi de la saisir ! A toi de la porter plus loin, plus haut que ton aïeul na pu le faire ! Je vois en tes regards, en tes ardeurs printanières, ma jeunesse renaissante, et la vie que tu dois vivre sajoute à celle que jai vécu. Mon passé se prolonge en ton avenir. La muse me donne la renommée, tu me donnes le bonheur. Béni sois-tu, mon enfant ! Mais à cette heure où la bénédiction dun ancêtre descend sur ton front promis aux lauriers, je te le redis encore : serait-elle injuste pour nous, cruelle pour toi, criminelle et folle pour elle-même, ne maudis jamais ta patrie ! Ce serait un parricide plus horrible que celui ddipe et celui-là, ni mon fils ; je ne voudrais pas le chanter.... Mais rentrons ! La nuit est profonde. Puisse Athènes taccueillir
connue elle a fait de moi ! Elle nest pas pour ne vivre quun jour, et son
erreur peut se promettre le repentir du lendemain. Puisse-t-elle nous
associer dans une même tendresse et lavenir confondre les deux Sophocles,
car jai voulu te donner mon corn, cest dire quelle est, ta promesse et
quelle est mon espérance ! Le vieillard est debout maintenant, Il regagne la ville. Quelque lassitude ralentit son pas. Sa main sappuie sur lépaule de lenfant. lis se taisent., ils séloignent. Me voilà seul dans le silence et dans la nuit. Espérer que jamais il sera deux Sophocles, non, je ne saurais marrêter à cette heureuse pensée. Un seul Sophocle, cest déjà beaucoup. La nuit est belle, tranquille et sereine. Pas un nuage, pas une brume. Le ciel est tout émaillé de ses étoiles comme une prairie de ses fleurs. Les unes brillent, éclatantes, les autres luisent à peine et la tache lumineuse quune goutte de lait divin a faite à cette immensité, sétale interrompue aux cimes ombreuses du Pentélique et de lHymette. Et moi, je me dis que limmortalité nest pas le privilège des seuls immortels et que toutes les étoiles ne sont pas dans les cieux. Que resterait-il des héros, des conquérants, de ces passants prodigieux, sil nétait des poètes pour les chanter, des historiens pour nous dire leur triche terrible et sanglante, des statuaires pour dresser les marbres des vainqueurs ? Lart seul prolonge un peu la vie dans ce tourbillon éternel qui emporte toutes choses ; lart seul immobilise ou du moins retient quelques, moments le temps, cet implacable niveleur. Après les dieux lui seul peut se proclamer créateur. Demain je pars pour |
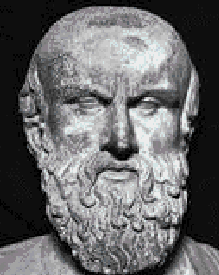 LOdéon est un édifice circulaire construit au flanc de lAcropole.
Une tente dune royale magnificence lui servit de modèle, celle que Xerxès
occupait le jour où Salamine, nourricière des colombes, comme chante Eschyle,
vit sombrer les vaisseaux des barbares aux abîmes de ses flots dazur et naître
sous un rocher un petit enfant qui devait être le grand Euripide. Que de
gloire, que de bonheur dans une seule journée ! LOdéon avant-hier, sous le
marbre de ses colonies, sous son toit de cèdre, recevait tout ce que
LOdéon est un édifice circulaire construit au flanc de lAcropole.
Une tente dune royale magnificence lui servit de modèle, celle que Xerxès
occupait le jour où Salamine, nourricière des colombes, comme chante Eschyle,
vit sombrer les vaisseaux des barbares aux abîmes de ses flots dazur et naître
sous un rocher un petit enfant qui devait être le grand Euripide. Que de
gloire, que de bonheur dans une seule journée ! LOdéon avant-hier, sous le
marbre de ses colonies, sous son toit de cèdre, recevait tout ce que 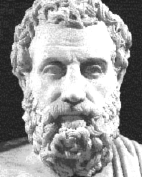 Et
Sophocle ? Où donc est-il ?
Je désirerais tant le saluer au moins du regard
Et
Sophocle ? Où donc est-il ?
Je désirerais tant le saluer au moins du regard