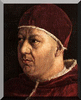HISTOIRE DE LÉON X
PRÉFACE.
|
Au commencement du seizième siècle, à la renaissance des lettres, deux hommes quittaient l’Allemagne, leur patrie, pour visiter l’Italie. L’un, monté sur une mule, traversait à petites journées les Alpes, emportant pour se distraire en chemin quelques satiriques grecs et latins ; l’autre suivait sur un cheval de bataille l’empereur Maximilien Ier, dans l’expédition du Milanais. De nos deux voyageurs, l’un était prêtre et se nommait Érasme ; l’autre était poète et s’appelait Ulrich de Hutten ; tous deux, ennemis du capuchon, s’arrêtaient pour écrire une épigramme contre le moine qui passait à leurs côtés. Ils avaient assisté aux luttes de Pfefferkorn et de Hogstraët contre Reuchlin, et ri de bon cœur de l’encre que les moines et les humanistes de Cologne avaient dépensée dans cette querelle ; seulement le prêtre y avait pris une part active, parce qu’il était né bien avant le poète. Érasme était alors le roi de l’ironie ; son bonheur et sa gloire peut-être étaient de faire la guerre aux péchés d’habitude qu’il prêtait à tout ce qui portait un froc. Ces péchés étaient au nombre de sept, comme dans le catéchisme : l’orgueil, la paresse, la colère, l’avarice, la luxure, l’envie, la gourmandise. Il n’y en avait malheureusement que sept, mais il était homme d’invention. Pour ridiculiser les moines, il avait imaginé une foute de joyeusetés qui couraient les écoles, et devenaient bientôt autant d’apophtegmes qu’on répète encore de nos jours avec une imperturbable assurance. Il leur attribuait cette singulière formule que vous pourrez chercher, mais qu’assurément vous ne trouverez dans aucun de leurs livres : Gréciser, c’est faire de l’hérésie. Alors le monde monacal était une terre que peu de lettrés avaient visitée, en Allemagne surtout, où naquit ce proverbe. Érasme en sortait, y avait été nourri, vêtu, élevé, et en avait rapporté toutes sortes de fables auxquelles on ajoutait foi, parce qu’il avait un rare talent de narrateur ; qu’il savait parer une médisance, enchâsser une calomnie, mettre en œuvre un mensonge, et donner à tout ce qui s’échappait de sa plume ou de ses lèvres un tour fin et spirituel. Du reste, comme il ne faut pas que nous tombions dans le péché que nous reprochons à notre Batave, nous devons, pour être juste, confesser que l’épigramme de Désidérius n’allait pas au delà de l’épiderme ; qu’elle égratignait, mais ne faisait pas couler le sang. Ulrich de Hutten ne ressemble à Érasme ni de figure, ni de vêtement, ni de style. Sa poitrine est emprisonnée dans un corselet de fer travaillé à Nuremberg ; à ses côtés pend une longue épée ; ses talons sont armés d’éperons en forme de croc, et ses deux cuisses cachées sous des écailles d’acier poli. Sans le laurier dont il s’est couronné lui-même en tète de ses œuvres, et qu’il porte souvent en voyage, vous le prendriez pour un de ces gantelets de fer qui, dans la guerre des Paysans, s’en vont à la chasse de nos vieux reliquaires, de nos images peintes sur bois, de nos chasubles brodées d’or, et de nos ostensoirs surchargés de pierres précieuses. On dirait, en le lisant, que le champ de bataille est son trépied sibyllin. Son ironie, car il rit aussi, déchire comme son éperon ; sa moquerie a une odeur de sang ; son épigramme sent le corps de garde, et sa gaîté monte au cerveau comme la fumée de ce bois de gayac dont il a célébré les vertus. Érasme donc et Ulrich de Hutten se trouvaient à peu près en même temps en Italie, au moment où Jules II partait pour la conquête de Bologne. Ni l’un ni l’autre ne comprirent le pontife-roi. Hutten s’attache d’abord à la forme extérieure. La figure de Jules Il, que Michel-Ange prit pour modèle en taillant son Moïse, l’effraye ; il en fait un Sarmate à la barbe épaisse, à la chevelure ondoyante, à l’œil hagard, aux lèvres gonflées de colère. Alors, comme s’il tremblait à cette apparition, il appelle un autre Brutus pour délivrer Rome de ce non veau Jules : Rome, assure-t-il, qui meurt dans l’esclavage si quelque poignard ne la débarrasse du tyran. Hutten, qui a dans les veines du sang germain, se lamente chaque fois qu’une forteresse tombe au pouvoir du Saint-Siège. Il a rêvé que le beau ciel, les plaines fécondes, tes montagnes couvertes de vignes et d’oliviers, les fleuves et les rivières de l’Italie, appartiennent en toute propriété à son empereur Maximilien. Tout cela est à vous, lui dit-il ; étendez la main, et reprenez ce qu’on vous a dérobé : voici Bologne, la ville du droit canon, elle est à vous ; voici Rome, la ville aux sept collines, elle est à vous ; voici Parme et Plaisance, où vos ancêtres ont rendu justice, elles sont à vous ; tout ce qui est puissance civile vous appartient : au pape, les clefs du royaume du ciel ; aux apôtres du Christ, les conquêtes de l’enseignement. Dans ses préoccupations teutonnes, il ne s’aperçoit pas que, si son empereur osait toucher à une seule pierre du patrimoine de l’Église, Venise viendrait avec son d’Alviane, l’Espagne avec son Gonzalve de Cordoue, la France avec son Gaston de Foix, pour lai en disputer la possession. Et alors que deviendrait cette lumière que la papauté a fait lever eu Italie, et dont quelques rayons éclairent déjà l’Allemagne ? où tous ces Grecs chassés de Constantinople iraient-ils chercher un asile ? où se réfugierait l’art qui vient de se réveiller ? que deviendrait cette philosophie platonicienne que les chanoines de Santa-Maria-del-Fiore ont intronisée à Florence ? quel serait le sort de tous ces peintres ombriens que les couvents fêtent et protégent ? pour qui travailleraient le Pérugin, Raphaël et Bramante ? Jusqu’où va la passion d’Ulrich ! Sur la place de Saint-Pierre, de nombreux ouvriers sont occupés à élever une basilique dont Jules il conçut l’idée, et Bramante le plan ; il a traversé cette place, et il n’y a trouvé que deus maçons, dont l’un était boiteux : les pierres crient, lapides clamant, et il n’entend pas ! Nous nous trompons, le poète a repris un moment l’usage de ses sens, le soleil de Rome lui a rendu la vue ; mais voici tout ce qu’il aperçoit : Une tourbe d’avocats, de juristes, de procureurs, de bullistes, attachés comme autant de mouches à sa pauvre Allemagne, dont ils aspirent le sang : mais, de toutes les intelligences chrétiennes qui vivent à Rome, il n’en a pas vu une seule. Alors, dans sa colère, il s’écrie : Brisons nos fers et jetons bas leur joug. Ces cris, exhalés en beaux vers, traversent le Rhin, vont remuer les esprits en Franconie, et préparer le grand schisme qui coûtera bientôt tant de larmes à l’humanité. Les peuples allemands croient aux récits d’un voyageur qui a décrit, en courant à cheval, les mœurs d’une nation, et ils pleurent, aux dithyrambes du poète, sur la dégradation de toutes ces intelligences méridionales, à qui Dieu pourtant, dans sa bonté, avait donné, disait-on, pour habitation cet autre paradis terrestre où l’oranger croit en plein champ, terre dont Hutten conteste aussi les splendeurs. Ne nous étonnons pas des colères et des préventions de Hutten, que partagera Luther. C’est des Alpes qu’est descendu Cécina, qui marqua son passage à travers’ l’Allemagne par des traces de sang, qui donna des fers à l’Helvétie, qui mit si cruellement à mort le vieillard d’Aventicum. Hutten et Luther haïssent tout ce qui sort da monde latin, et, dans leurs préjugés, ils ne font pas plus grâce au sol qu’à l’homme : pour Luther, la rampe verdoyante du Poltesberg nourrit plus de fleurs que toutes les montagnes de l’Italie ; pour Hutten, le tilleul de la Franconie est mille fois plus beau que le hêtre de la campagne de Rome. A l’exception de Jules II, et nous dirons pourquoi, Érasme a respecté tout ce qui de son temps porta la tiare. Mais il s’est dédommagé de ce silence obligé, en dénigrant tout ce qui avait un froc, en Allemagne comme en Italie. En Allemagne, c’est à l’intelligence qu’il s’est attaqué surtout ; en Italie, ce sont les mœurs qu’il a poursuivies : ces mœurs, il ne les a guère connues, car rarement il est descendu dans un monastère. Il lui suffit de deux ou trois épigrammes comme chaque nation en possède sur le clergé conventuel, épigrammes qui en Italie avaient deux à trois siècles d’existence, et, depuis Dante, s’étaient transmises par voie de poète jusqu’à Pontano, pour immoler Ies moines à sa risée. Hutten et Érasme se seraient bien gardés d’aller visiter un de ces monastères où ils prenaient plaisir à loger tant de fabuleuses folies : ils auraient trouvé agenouillé dans une petite chapelle un pauvre frère qui, les mains jointes, priait Dieu de le délivrer de ces dignités mondaines que le pape lui imposait, et qu’il était obligé d’accepter par obéissance : car l’obéissance aussi a ses martyrs 1 liais que leur faisait la vérité ? ils emportaient avec eux un roman ingénieusement disposé en drame, et qui ne devait voir le jour qu’en Allemagne : car c’est une chose bien remarquable qu’ils n’ont osé imprimer en Italie aucune de leurs bouffonneries antimonacales ; et cependant, à cette époque, de tous les pays du monde, l’Italie seule jouissait du privilège de penser et d’écrire librement. Un historien contemporain a déjà remarqué la couardise d’Érasme. Tant que le philosophe est en Italie, dit Adolphe Muller, il fait l’éloge de cette nation, même dans ses épîtres familières. Mais, quand les Italiens se vantent hautement d’avoir été ses maîtres, le Batave orgueilleux s’irrite et se met à les dénigrer. lorsque nous conçûmes le projet de décrire cette grande révolte contre la foi de nos pères qu’on appelle Réforme, nous pensâmes que notre devoir était de visiter le pays qui en avait été le berceau. Il nous tardait d’apprendre si ces théologiens, moines pour la plupart, qui combattirent Luther, avaient été, comme il osa le dire, déshérités du ciel ; si Dieu avait abandonné des créatures qu’il avait suscitées pour défendre son Église ; si la vérité n’avait eu pour athlètes que des intelligences privées de raison ; et nous fûmes heureux, en exhumant de la poussière cette légion de nobles défenseurs du catholicisme, de voir que nous avions été trompé, et le monde avec nous ; que la parole d’Eckius, de Faber, de Priérias, était aussi splendide que Luther la faisait terne, et que l’illumination d’en haut n’avait pas plus manqué que le courage à tous ces nobles preux en Jésus-Christ. A vrai dire, il nous répugnait de croire que leur piété envers notre vieille mère n’eût pas été récompensée dès cette vie. La même pensée qui nous poussait vers l’Allemagne nous a conduit en Italie. Luther l’avait visitée en 1510. Dans quelques fragments de ses Tisch-Reden, il nous a raconté sous quelles impressions il avait repassé les Alpes ; mœurs et intelligence, il n’a rien épargné. L’intelligence de ses hôtes a été magnifiquement vengée ; c’est le temps, cet historien sans peur, qui s’est chargé de leur réhabilitation. Lorsque, assis dans son auberge de l’Aigle-Noir, entre Amsdorf et Justus Jonas, Luther parlait des ténèbres épaisses qui s’étendaient sur les cloîtres, le temps prenait soin d’enregistrer chacun des titres de gloire de ceux qui les habitaient en passant : il dressait le catalogue des œuvres entreprises dans les couvents ; œuvres dans tons les genres, depuis le Thesaurus cornucopiœ de Bolzani le franciscain, jusqu’au Saint-Marc du peintre Fra-Bartolommeo, de l’ordre des dominicains. Quand l’Allemagne comptait à peine un rudiment en langue grecque, l’Italie possédait sept poèmes épiques. Jamais époque ne fut attaquée avec plus de méchanceté que la renaissance en Italie : la Réforme a su rendre séduisant le mensonge à force de parure. Des catholiques, en se faisant l’écho des plaintes exhalées au delà du Rhin, souvent par des âmes passionnées qui n’avaient jamais traversé les Alpes, n’ont pas compris que, pour colorer sa rébellion, l’erreur avait eu besoin de nous tromper. Elle avait besoin de nous faire croire qu’avant la venue de Luther, le grand arbre catholique, sorti d’un petit grain de sénevé, n’abritait plus de ses ombres que des âmes qui avaient éteint volontairement en elles la lumière du père céleste ; car, sans cela, comment lui pardonner sa révolte ? Elle avait besoin de démontrer que le chef de la catholicité avait altéré le dépôt des vérités qu’il avait reçu de saint Pierre, étouffé cette voix du Christ qui devait régénérer le monde, corrompu et souillé la parole de Dieu ; car, sans cela, comment justifier ses insultes à la papauté ? Elle avait besoin de prouver que les grandes dignités ecclésiastiques, qui ne devaient être que le prix de la foi et des lumières, étaient le lot de l’orgueil et de l’ignorance ; car, sans cela, pourquoi ses tentatives contre l’épiscopat ? Il fallait encore qu’elle nous révélât que dans ces monastères ultramontains, jadis séjour de la prière et des vertus, toute étincelle de foi s’était éteinte, qu’à la vie de l’âme avait succédé la vie du corps, et que l’homme avait remplacé l’ange ; car, sans cela, pourquoi cette sécularisation des couvents qu’elle provoquait partout sur son passage ? Voilà les plaintes que fit entendre la Réforme par la bouche de ses apôtres, mais dépouillées de ces injures qu’elle leur donnait pour ornement on pour appui. Notre devoir était d’en vérifier la sincérité dans cette Rome chrétienne d’abord, dont elle avait prédit la chute en témoignage même de la vérité des accusations qu’elle avait formulées. Il y a longtemps que Rome serait tombée, si elle eût ressemblé à l’image que Wittemberg en avait tracée. Nous avons cherché sérieusement à étudier la papauté sous deux sortes d’aspects, telle qu’elle s’est produite à la Renaissance : comme fille du Christ dans ses attributions toutes spirituelles, comme puissance mondaine dans ses actes tout humains. Nous la verrons, sous ces deux représentations, ressusciter les lettres, fonder des gymnases, élever des chaires aux diverses sciences, fouiller la terre pour y chercher des statues à la contemplation desquelles l’art revêtira une nouvelle forme ; appeler les Grecs chassés de Constantinople, et les loger splendidement à l’Esquilin ; favoriser le mouvement des imaginations vers Platon, donner pour toile les murs de la Sixtine aux grands peintres de l’époque, loger dans un couvent de pauvres ouvriers allemands, apportant en Italie le bel art de l’imprimerie, que Léon X appelait une lumière nouvelle descendue du ciel ; bâtir un palais pour les livres, un autre pour les statues, un troisième pour les tableaux ; chercher an delà des mers les manuscrits d’écrivains antiques ; réveiller la langue de David, d’Homère et de Virgile ; affranchir la pensée ; donner à la parole une liberté dont elle ne jouissait nulle part, et, quand elle y est forcée, se servir de son épée pour fonder les libertés nationales, et arracher les peuples du continent italien an joug de l’étranger. Luther avait dit à Léon X : Vous voilà comme un agneau au milieu des loups, comme Daniel au milieu des lions, comme Ézéchiel parmi les scorpions. Et cependant le Saxon connaissait la cour du pontife. Nous prendrons place an consistoire parmi les robes rouges qui formaient le cortège du pape ; nous dirons les titres de ces princes de l’Église à l’admiration des lettres et à l’amour des chrétiens, et l’on verra combien nous aurions été malheureux en nous laissant tromper par la feinte pitié du moine. Il ajoute quelques lignes plus loin : A tous ces mécréants qui vous entourent qu’opposerez-vous ? deux ou trois cardinaux, hommes de foi et de science. Deux ou trois ! Quand nous aurons suivi Cajetan dans ses pérégrinations chrétiennes à travers l’Italie ; que nous nous serons assis dans la petite chambre de Louvain où Adrien d’Utrecht partage avec les pauvres le pain qu’enfant il reçoit de son père pour sa nourriture quotidienne ; quand nous aurons visité cette forêt ombreuse de Viterbe, où Léon X ira chercher Égidius pour le décorer de la pourpre romaine ; que nous aurons assisté aux réceptions, à Rome, du cardinal Grimani, qu’Érasme appelle une des splendeurs de l’Église du Christ, nous verrons s’il ne nous restera pas encore d’autres noms à citer ? Pourquoi donc Luther oublie-t-il Paul-Émile Césio, qui disait souvent : Mieux vaut manquer du nécessaire que de laisser souffrir les autres ; Boniface Ferreri de Verceil, qui fit élever à ses frais un collège à Bologne ; Campeggi, dont Érasme a célébré les vertus ; l’évêque d’Albe, Vida, qui ne vivait que de racines ; Giberti, le père des pauvres et des lettrés, comme on le nommait à Rome ? Il nous sera bien permis de réveiller de leur tombeau ces saintes ombres pour rappeler un moment leurs travaux apostoliques. Léon X a été malheureux : il n’a pas plus échappé aux calomnies qu’aux louanges de la Réforme : l’éloge, dans les termes qu’il est formulé, ferait plus de tort à la mémoire du pape que l’insulte même. Le protestantisme en fait un humaniste érudit, un poète brillant, un lettré de la renaissance enfin, tout occupé, sur la chaire de Saint-Pierre, de vanités mondaines : ce qu’il y a de plus douloureux, c’est qu’il a donné le change à l’opinion catholique, qui répète des jugements inspirés par la passion. fout en acceptant les louanges que lui ont décernées à dessein les écrivains de la Méforme, nous réclamons pour Léon X une gloire plus durable que celle qui trouve ici-bas son prix dans l’admiration et les applaudissements des hommes ; et cette gloire, que Dieu seul peut donner, il faudra bien la lui restituer quand nous le verrons dans le cours de sa vie, si courte et si pleine, pratiquer tous les préceptes de l’Évangile, qu’enfant il avait étudiés à Florence ; conserver dans l’exil cette chasteté de mœurs qui défia, suivant l’expression d’un écrivain contemporain, jusqu’au soupçon lui-même ; vivre, au milieu des humanistes romains, à la manière des chrétiens de la primitive Église ; jeûner, prier, et, rude à lui-même, faire maigre trois fois la semaine, répandre autour de lui d’abondantes aumônes, et, quand Dieu l’eut constitué chef de l’Église, donner au monde le spectacle des vertus chrétiennes les plus éminentes. Nous le verrons au concile de Latran, poursuivant l’œuvre glorieuse commencée par Jules Il, et qui devait s’accomplir à Trente : la réforme de l’Église. Il y a bien longtemps que la papauté travaillait à l’amélioration intellectuelle et morale du clergé : elle voulait une réforme ; Nicolas V, Sixte IV, Innocent VIII, en avaient proclamé la nécessité. Que si vous cherchez dans le cahier des doléances écrit par l’Allemagne à Nuremberg, vous n’y trouverez pas un des griefs que les ordres ont formulés, et auxquels la papauté n’eût déjà tenté de faire droit. Certes, s’il est une page où Léon X se montre dans tonte sa grandeur chrétienne, c’est à Latran quand il écoute les gémissements des cœurs catholiques, et que sous son inspiration le concile promulgue ces règlements dont la sagesse n’a point été assez appréciée, qui vivent encore, et qui seront comme l’éternelle gloire de l’Église et du vicaire de Jésus-Christ. Nous donnerons l’analyse des actes du concile, et l’on nous dira si Léon X faillit à sa mission apostolique. Ouvrez les livres de tous ceux qui ont écrit la vie de ce pape ; ils passent les veux fermés devant ces travaux véritablement évangéliques. Nous l’étudierons surtout dans les lettres écrites sous les noms de Bembo et de Sadolet ; couvre incontestable du pape, parce qu’on y reconnaît à chaque ligne les qualités de son esprit, de son cœur et de son style. II en est de toutes sortes, adressées à des rois, tels que François Ier et Henri VIII ; à des humanistes, tels qu’Érasme et Lascaris ; à des poètes, tels que l’Arioste et Vida ; à des artistes, tels que Raphaël. Ce n’est plus là le Léon X que nous accompagnerons au Vatican, dans la basilique de Saint-Pierre, au palais de Saint-Jean de Latran, au Gymnase romain, à Florence, à Bologne. Il est seul dans son cabinet d’étude, seul avec son correspondant, auquel il dit tout ce qui lui vient sur les lèvres ; et en vérité, si dans ces confidences intimes, il est des pages pour le politique, l’humaniste, l’artiste et le lettré, il en est un bien plus grand nombre pour le chrétien qui veut, avant tout, entendre le vicaire de Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs l’histoire du pontife, c’est-à-dire son âme : elle est là tout entière. Pour nous, c’est plus d’une fois que nous avons ouvert ce recueil précieux ; nous le laissions pour y revenir ; il nous semblait, en lisant ces lignes écrites par Léon X, qu’il vivait encore, qu’il était à nos côtés, qu’il nous parlait ; et, comme ce camérier qui, à la vue du tableau oit Raphaël a fait revivre si admirablement les traits du pontife, s’agenouille pour demander au pape sa bénédiction, nous étions tenté de prendre la main qui avait tracé de si belles paroles, et de l’embrasser en signe d’admiration et d’amour. Expliquons clairement notre pensée : notre livre nouveau est le complément de notre œuvre sur la Réforme. Si dans l’Histoire de Luther nous avons démontré que, hors de l’unité catholique, il n’y a plus que désordre dans les intelligences, anarchie dans les doctrines, doute et négation dans la pensée ; Si dans l’Histoire de Calvin nous avons prouvé que, hors de l’unité catholique, la Réforme avait été obligée, pour vivre et pour se perpétuer, de tomber dans le despotisme ; Dans l’Histoire de Léon X, nous voulons faire voir que, sous cette papauté répudiée si violemment par la Réforme, il y avait unité, foi, lumière, liberté. Ici, pas de dispute théologique ; le fait est un argument assez lumineux. Nous savions bien qu’avant nous d’autres écrivains avaient raconté la vie de notre héros, mais leur pensée n’était pas la nôtre ; aussi avons-nous tâché de ne pas les imiter. Un de ces historiens, qui travaillait à la manière des bénédictins, Roscoë, a tracé le tableau du règne de Léon X ; mais tableau tout mondain, où le pape n’est présenté que sous l’une de ses faces. Quand on a lu Roscoë, on tonnait l’artiste, on ignore le chrétien. C’est une réhabilitation du caractère de Léon X que nous tentons aujourd’hui ; c’est Léon X aussi dans son couvre religieuse, inconnue à la plupart des lecteurs, que nous avons essayé d’apprécier. Un ancien a dit que le devoir d’un historien est de ne pas taire les vertus des personnages dont il retrace le souvenir : Præcipuum munus... ne virtutes sileantur. Nous avons voulu mettre ces vertus en lumière. Ne nous plaignons pas du silence et de l’oubli de Roscoë : pourrions-nous demander à un disciple de Knox l’amour filial d’un catholique pour son père ? Sachons gré à l’historien anglican de tout ce qu’il a mis souvent d’impartialité dans son récit en écrivant la vie de Léon X ; sans lui, peut-être n’aurions-nous pas entrepris notre ouvrage. A une époque de difficiles investigations, il pénétrait dans les archives et dans les bibliothèques publiques et particulières, conférait des manuscrits qu’on prêtait avec peine, visitait soigneusement chaque endroit où devait se passer une des scènes de son livre, interrogeait les monuments, relisait les poètes de l’époque, et, pèlerin de l’histoire, puisait aux sources officielles les documents nombreux et variés qui devaient entrer dans sa composition littéraire. Roscoë, en nous traçant notre marche, nous avait indiqué notre devoir. Comme Roscoë, c’est en Italie même que nous avons rassemblé les matériaux de notre ouvrage. Notre première visite devait être naturellement à cette Rome, encore brillante des splendeurs dont l’a dotée Léon X. Là nous avons retrouvé cette papauté dont la Méforme compta les jours, vivant de la vie que lui assigna le Christ et qui ne doit pas avoir de fin : les noms seuls étaient changés. Il y a plus de trois siècles, un homme dont nous raconterons le voyage en Italie, Erasme, disait à Léon X : Soyez béni, car vous faites fleurir la piété chrétienne, les saintes lettres et la paix parmi les nations. S’il revenait à la lumière, et qu’il lui fût donné de s’agenouiller devant Grégoire XVI, de quelles autres expressions se servirait-il pour louer le pontife assis aujourd’hui dans la chaire de Saint-Pierre ? Nous l’avons vu ce pontife : à nous, voyageur inconnu, n’apportant pour tout trésor qu’une foi vive, il a ouvert ses bras comme il eût fait à un roi des lettres : la Vaticane était là, il nous en a livré tous les trésors. Il y a trois siècles, à la tête de cette bibliothèque, œuvre et pensée d’un pape, était Inghirami, dont la parole était aussi belle que puissante. Là, nous avons retrouvé l’humaniste d’Érasme dans le cardinal Lambruschini. Érasme ajoute qu’il compte comme une de ses bonnes fortunes d’avoir joui pendant quelques moments trop rapides de la conversation de cet écrivain au style cicéronien. Grâce au cardinal, ministre d’État ; grâce à cette haute intelligence que nous avons eu le bonheur d’écouter, nous avons pu consulter tout ce que nous demandions de documents à ces immenses archives, où nous avons été introduit par Mgr Laureani, dont le zèle égale les lumières. A tous ceux qui voudraient écrire l’histoire abrités par de doux silences, nous dirons : Allez à Rome ; vous y trouverez de riches bibliothèques, comme celles de la Minerve et des Augustins, ouvertes à diverses heures de la journée. Ne craignez pas de tourmenter la patience des conservateurs : la patience entre dans leurs attributions ; c’est une vertu que le supérieur leur recommande et que Dieu leur accorde pour salaire. Manuscrits, livres, brochures, tout est à vous, jusqu’à l’intelligence des gardiens, trésor qu’ils sont obligés de donner à qui en a besoin. Vous seriez bien malheureux en quittant ces vastes nécropoles, si vous n’emportiez avec vous l’amitié des pères à qui la garde en fut confiée. Vous faut-il de nouvelles lumières ? vous avez les membres du sacré collège que vous pourrez visiter sans vous être fait annoncer, et qui sont toujours prêts à rendre des arrêts comme clés services. Nous ne pouvions oublier Florence, qui tint une si belle place dans les destinées et les affections de Léon X. La Magliabecchiana, les archives du palais Pitti, nous ont fourni de curieux renseignements sur des hommes et des faits littéraires du seizième siècle. Nous avons visité tous les lieux où des personnages de notre récit se sont trouvés en scène : Fiesole, dont le prieur chérit si tendrement Léon X : Careggi, où Laurent le Magnifique dissertait avec Ficin sur le néoplatonisme ; le palais de la Via Larga, d’où le peuple chassa, dans un transport de colère, ces rois marchands qu’on nommait les Médicis ; le couvent des dominicains, qu’habita longtemps un moine du nom de Savonarole, dont nous avons essayé d’apprécier le génie religieux et politique. Là vivent, comme à la Minerve de Rome, dans la pratique des lettres et des vertus, des religieux qu’il est impossible de ne pas aimer. Pour le mystérieux génie qui traversa si glorieusement leur cloître, tous conservent un culte d’amour et d’admiration. Nous avons raconté les fautes de Savonarole, sans crainte d’offenser ces saintes âmes, parce qu’à la robe blanche du dominicain nous préférons la vérité, ce que du moins nous croyons la vérité. A l’époque que nous nous proposons de décrire, la papauté fut plus d’une fois obligée de défendre, les armes à la main, la nationalité italienne. Nous la suivrons sur le champ de bataille, moins pour raconter les péripéties du combat, que pour faire connaître quelques-uns des principaux personnages qui s’y trouvèrent mêlés. Il est une grande figure historique qu’on a pris à tâche de dénigrer et que nous essayerons de réhabiliter, celle de Mathieu Schinner, évêque de Sion et légat de Jules II : c’est dans l’abbaye de Saint-Maurice en Valais que nous l’avons étudiée. L’art de la Renaissance, et sous ce terme nous comprenons la peinture, la sculpture, la poésie, les lettres, devait avoir une large place dans notre histoire : nous la lui avons donnée. Il est un peintre, le commentaire en quelque sorte de Léon X, que nous nous sommes attaché surtout à faire apprécier : c’est tout à la fois dans l’Ombrie où se passa son enfance, au Vatican où l’appela la papauté, que nous suivrons Raphaël. M. Passavant, dont l’ouvrage récent a fait une si vive sensation en Allemagne, nous fournira de curieux documents sur celui qu’il a poétiquement nommé : le plus bel astre du firmament de l’art. Et maintenant, puissent les hommes d’études sérieuses lire ces pages, que nous leur abandonnons, avec la même attention que nous les avons écrites. Goëthe a dit : L’historien a un double devoir à remplir, d’abord envers lui-même, puis envers ses lecteurs : pour se satisfaire lui-même, il est obligé de s’assurer que les faits qu’il rapporte sont réellement arrivés ; pour satisfaire ses lecteurs, il est obligé de les prouver. Nous pensons avoir rempli ce double devoir. |