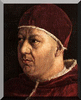HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XLII. — L’HOMME INTIME.
|
Portrait de Léon X. -
Chagrin du pape, quand il est obligé de punir. - Combien il était libéral. -
Etablissements de charité qu’il fonde à Rome. - Les lettrés persécutés en
appellent au pape. - Reuchlin et Érasme. - Piété de Léon X. - Henri VIII lui
dédie l’Assertio septem sacramentorum. - Les épîtres familières du pape. -
Combien elles témoignent du zèle du pontife pour la religion. - Calomnies des
protestants répétées par les catholiques. - On doit à Léon X l’institution de
diverses cérémonies religieuses. - Vie intérieure du pape. - Son goût pour la
musique. - Léon X à table, à la chasse, à Viterbe et à la Magliana. - Conclusion. Quittons le Vatican : ne parlons plus du pape, du souverain temporel, de l’artiste ; essayons de faire connaître l’homme privé. On dit que peu de temps après la mort de Léon X, un vieux serviteur du pape s’arrêta devant le portrait qu’en avait fait Raphaël, et qu’on trouve à Florence au palais Pitti, et S’agenouilla pour baiser la main de son maître, comme si le sana y circulait encore. C’est que jamais, en effet, peintre flamand ne mit plus de vie réelle dans une tête. C’est bien là cette figure de Médicis, au coloris tout vénitien ; ces chairs blanches et mates de tous les hommes de sa race ; cet œil myope qui semble s’échapper de son orbite ; ce front d’une pureté limpide ; cette large tête reposant sur deux épaules évasées ; ces mains un peu trop féminines, aux doigts ornés de camées antiques ; et dans tous les traits cet air d’angélique bonté qui charmait ceux qui avaient le bonheur de l’approcher, avant même qu’il eût pu les séduire par le doux son de voix que les poètes de l’époque comparaient à de la musique. On n’a pas besoin de connaître le personnage qu’a voulu représenter Sanzio, pour deviner que ces lèvres n’ont dû s’ouvrir que pour bénir ou pardonner. Luther est un aussi grand artiste que Raphaël : en quelques mots il a peint Léon X : Mitis ut agnus, a-t-il dit, doux comme un agneau. Deux ou trois fois pendant le cours de son pontificat, Léon X dut user de rigueur envers de grands coupables, comme dans la conspiration des cardinaux. Ce jour, il souffrait dans l’âme et dans le corps ; il ne mangeait plus, des larmes involontaires tombaient de ses yeux, et la nuit il priait pour raffermir son courage ébranlé. Il y avait lutte entre le prince et le père : il fallait bien que la justice fût satisfaite, mais le combat était long et douloureux. L’expiation consommée, alors Léon X, de son plein mouvement, se laissait aller à ses instincts innés de bonté : il saisissait une solennelle occasion pour témoigner à celui qui l’avait offensé que le cœur du juge ne conservait plus aucun ressentiment. C’était le prêtre qui, la grille du confessionnal fermée, ne se rappelle plus les péchés du pénitent. Au milieu du saint sacrifice, quand, à la voix du célébrant, Dieu descend sur l’autel, il se levait, marchait droit à celui dont la faute était désormais couverte, l’attirait dans ses bras, l’embrassait avec effusion, et, au nom du sang divin, lui promettait de ne pas garder souvenir du passé, et il tenait religieusement sa parole. Dans plus d’une page de notre histoire nous avons raconté les libéralités du pontife envers les gens de lettres. Ces libéralités, souvent trop fastueuses, avaient leur récompense dans ce monde, où elles étaient chantées en vers et en prose, sur la toile et sur la pierre, car la reconnaissance n’est pas toujours muette. Mais il est des bienfaits qui tombaient dans l’ombre, sur des êtres obscurs, et entre trois témoins, sans compter Dieu : le pape, son maître des cérémonies et le solliciteur, et dont Rome ne parla qu’après la mort du pontife. Chaque matin, qu’il sortît du Vatican pour se promener dans Rome, ou qu’il restât dans son cabinet d’étude, Pâris de Grassi avait ordre d’emplir de pièces d’or et d’argent une grande bourse que Léon tenait suspendue à ses côtés, et où il puisait à pleines mains pour secourir le mendiant qui se présentait en baillons, ; l’exilé qui, chassé de sa patrie dans ces temps de déchirements politiques, venait à Rome chercher un refuge, car Rome alors, comme aujourd’hui, était l’asile des grandes infortunes ; l’écolier qui manquait de livres nécessaires pour achever ses études ; le vieux professeur qui n’y voyait plus et dont l’âge avait affaibli les forces. En vain des voix prudentes essayaient-elles de faire comprendre au saint-père que ses libéralités devaient avoir un terme, il n’écoutait personne et retombait sans cesse dans ses habitudes d’enfance, la prodigalité. A ceux qui le tourmentaient trop vivement il répondait par toutes sortes de belles sentences tirées des livres saints ou des écrivains profanes : refuser le faisait souffrir. Un jour, un de ses secrétaires qu’il aimait comme tous ceux qu’il avait attachés à son service, Bianchi, lui demandait, dans une supplique écrite en termes pressants, une faveur que les canons faisaient un devoir au pontife de refuser. — Et si j’accordais le transfert du bénéfice, dit-il au solliciteur, qu’est-ce que cela vous rendrait ? — Deux cents écus d’or, répondit le serviteur. — Eh bien, reprit le pape, les voilà ; et il déchira la supplique. Une autre fois on lui parlait d’un poète qui faisait admirablement les vers latins, et qui mourait de faim. — Comment donc, dit en riant le pape, moi qui, dans ma vie, ai secouru tant de piètres rimeurs, j’aurais pu oublier ce chantre divin ? Tenez, tenez, voilà pour le poète, et il donnait sans compter. A Rome, dans les Etats de l’Église et dans d’autres provinces italiennes, Léon X nourrissait un grand nombre de prêtres, de religieuses, de vieux militaires et d’exilés. En montant sur le trône, il trouva sa capitale remplie de mendiants que les guerres avec l’étranger avaient réduits au plus affreux dénuement, et qui souvent tombaient morts de faim au coin d’une borne ; son cœur se sentit ému de pitié, et il fonda l’hospice des incurables de Sainte-Marie, destiné à recevoir les infirmes et les malades atteints d’affections que l’art regardait comme inguérissables. Par ses ordres, des hommes de confiance étaient chargés de parcourir la ville, d’aller à la découverte des pauvres et des malades, qui trouvaient dans cette léproserie tous les secours de l’art et de la charité. On lui doit l’établissement d’un monastère, sous le vocable de Sainte-Marie-Madeleine, asile ouvert aux filles repenties qui, voulant pleurer les désordres d’une vie passée dans le libertinage, s’amendaient, et, réconciliées avec Dieu et la société, trouvaient dans cet hospice les soins de l’âme et du corps, le pardon de leurs fautes et l’oubli du passé. Le monastère était administré par les frères de l’Archi-charité, entretenu par les dons ?du souverain, les aumônes des fidèles, les quêtes faites dans les églises, et les biens des matrones mortes sans tester. Cette confrérie de l’Archi-charité avait été instituée par le cardinal Jules de Médicis, pour venir au secours des pauvres honteux et des débiteurs insolvables, dont le nombre était si grand à Rome. Des visiteurs choisis par le conseil d’administration avaient pour charge de fouiller les greniers, afin d’y découvrir quelque pauvre âme toute honteuse de sa misère, et qui, n’osant pas tendre la -nain aux passants et révéler sa gêne au curé de la paroisse, était exposée à mourir de désespoir ; ou bien encore l’ouvrier jeté en prison par un créancier qu’il ne pouvait payer, même au prix d’un travail de nuit et de jour. La confrérie veillait aussi sur les morts. Il arrivait souvent qu’on promenait de porte en porte le cadavre d’un indigent, afin de recueillir quelques pièces de monnaie destinées à l’ensevelir. Dans les temps de maladie épidémique, la charité et la pitié, trop souvent sollicitées, avaient fini par ne plus s’émouvoir ; alors le corps était conduit au cimetière sans croix ni flambeau. Léon X vint au secours de l’institution par des dons et d’utiles règlements, et, grâce au pontife charitable, la société put donner chaque dimanche un pain de plusieurs livres aux pauvres de la ville de Rome. Il est un moment dans l’histoire de l’esprit humain, au seizième siècle, où la pensée qui craint d’être persécutée se réfugie sous la blanche soutane du pape : c’est ce que fit Reuchlin, dans sa querelle avec Pfefferkon. Il avait publié sur la conservation des livres judaïques des opinions qui déplurent aux moines de Cologne. A Dieu ne plaise que nous condamnions le zèle du dominicain Hogstraet, homme de conviction et de foi ! Reuchlin, le grand humaniste teuton, à la vue des flammes où l’on a jeté comme hétérodoxe son Speculum oculare, se rappelle qu’au delà des Alpes, à Rome, vit un pontife de la race des Médicis, qui aime les saintes lettres avec passion, et il lui demande des juges, tout comme Pic de la Mirandole, notre philologue nomade, en avait demandé à Innocent VIII et à Alexandre VI. Léon lit la supplique, et désigne Grimani, le protecteur d’Érasme, et d’autres belles intelligences, pour terminer le procès. Le représentant de l’école de Cologne est cité à comparaître, mais il ne vient pas ; et le pape alors, tout en réservant les droits de la vérité qu’a peut-être offensée Reuchlin, ordonne que l’affaire reste en suspens. Si Léon X eût vécu plus longtemps, il est permis de croire qu’il eût exigé quelques cartons dans l’œuvre de l’humaniste allemand ; Reuchlin se serait soumis aux ordres de Sa Sainteté, et tout aurait été fini. Comment suspecter la foi d’un savant qui, dans la dédicace de son Traité de la Cabale au souverain pontife, écrit ces belles lignes : Va, mon livre, reconnais l’autorité suprême de celui qui juge le monde ? Érasme, lui aussi, avait pris pour juge Léon X. Il avait quitté Rome, traversé la nier, et fait son entrée à Londres, où venait de le devancer une lettre du pontife. Le pape écrivait à son fils Henri VIII : — Je vous recommande mon cher Érasme : j’ai toujours aimé les bonnes lettres. Cet amour inné en moi, l’âge n’a fait que l’accroître, parce que j’ai remarqué que ceux qui les cultivent sont attachés de cœur aux dogmes de notre foi, et qu’elles sont l’ornement et la gloire de l’Église chrétienne. Dans divers chapitres de notre ouvrage, nous avons montré de quel zèle Léon X était animé pour les intérêts de la religion. A tout prendre, il eût pardonné peut-être à quelques épigrammes d’Érasme contre le froc, car il savait que, pour le philosophe, rire était vivre, et le pape ne voulait la mort de personne ; mais il se fût montré inflexible pour la moindre offense envers la religion. Les poètes eux-mêmes ont célébré la vive piété du pontife. En Angleterre comme en France, on rendait justice aux sentiments religieux du souverain. Aussi, quand après l’apparition de la Captivité de Babylone par Luther, Henri VIII voulut prendre la défense du dogme catholique outragé par le moine augustin, il dédia son livre, Assertio septem sacramentorum, à Sa Sainteté. C’est un beau volume in-4° sur vélin, écrit par un calligraphe d’une rare habileté, par quelque moine peut-être, qui devait porter sa tête sur l’échafaud pour la gloire de cette sainte Église dont Henri se disait alors le fils soumis. Le roi s’est fait peindre sur la première page du manuscrit : c’est bien là le bel Henri, un des princes les mieux faits de son époque, aux vêtements tels qu’il les aime, rehaussés de vives couleurs. Il est dans l’attitude de la dévotion, à genoux : Léon X sur son trône semble écouter l’enfant qui vient offrir à son père le livre qu’il a composé pour la gloire du Christ. L’acte d’hommage est signé de la main du prince, d’une main ferme comme celle d’un martyr qui confesserait sa foi. A la fin du volume sont ces deux vers que le monarque a tracés avec amour : Anglorum
rei, Henricus, Leo decime, mittit Hoc opus, et fidei testem, et amicitiæ. Puis un nouvel acte de foi, c’est-à-dire une nouvelle signature. La récompense ne se fit pas attendre : un autographe du pontife que l’on conserve dans les archives de la couronne d’Angleterre, et où Léon X donne au prince le titre de Défenseur de la foi, que les monarques anglais continuent de porter, de cette vieille foi pour laquelle tant de martyrs allaient bientôt monter sur l’échafaud, Thomas Morus entre autres, dont une femme a retracé si poétiquement les infortunes. Il n’est pas de pontife qui dans sa vie ait reçu autant de dédicaces que Léon X, en prose et en vers. Le livre qui paraissait sous le patronage du pape était sûr d’un brillant accueil dans le monde lettré. Léon X lisait avec un soin extrême les ouvrages qu’on voulait lui dédier ; il les lisait en théologien, en écrivain, en artiste. Plus d’un poète lui dut le redressement d’un vers boiteux ; plus d’un latiniste, l’indication d’un solécisme : son oreille était d’une grande sévérité. On montre en Italie, dans diverses bibliothèques, des notes ajoutées à la marge d’un livre, des ratures officieuses, d’heureuses substitutions de mots qui témoignent du goût et de la science linguistique du royal censeur. A cette Allemagne qui se vantait déjà d’être plus latine que le Latium même, quand elle poussait, par la voix de Luther, ce cri de révolte qui émut si douloureusement les âmes, Léon X opposa un des humanistes qui avaient fait à Rome l’étude la plus approfondie de la langue de Cicéron, et la chrétienté eut une bulle qui, sous le rapport de l’art, restera comme un modèle de style. Comparez l’œuvre de Luther répondant au pape, à la composition d’Accolti ; comme le Saxon est mesquin 1 L’exorde de la bulle du pape est un tableau à la manière de Michel-Ange ! Un moment encore revenons à ces lettres écrites par Léon X, et publiées par Bembo ; c’est là que brillent toutes les qualités du pontife. Il faut étudier le pape quand il dispense ses royales faveurs. Avant de se décider, il attend, il écoute, il prend conseil ; souvent, c’est loin de Rome, dans un couvent obscur que ses regards s’arrêtent pour chercher quelque pauvre frère qu’il destine, non pas à briller dans le inonde, mais à édifier l’Eglise par ses vertus. Il s’agit de donner un remplaçant temporaire au vicaire général de l’ordre des Augustins, Egidius de Viterbe, jusqu’à ce que l’ordre en chapitre solennel ait conféré lui-même cette dignité à l’un de ses membres. C’est sur un moine habitant Venise qu’est tombé le choix de Léon X. Gabriel n’a jamais rien demandé ; toute son ambition est de mourir dans ce silence des saintes lettres qu’il a choisi volontairement. C’est tout à la fois un ordre et une prière que le pape adresse au bon religieux. — Allons, lui dit-il, courage, acceptez la dignité dont je vous revêts de mon propre mouvement, et que je ne vous permets de refuser sous aucun prétexte. Mais Gabriel refuse en s’excusant sur l’amour qu’il a voué à l’obscurité, sur sa pauvre petite intelligence qui redoute les grandeurs, sur sa santé souffrante qui succomberait sous le fardeau. Et le pape réfute une à une, avec une grâce charmante, les objections du religieux. Que parle-t-il de sa pauvre petite intelligence ? mais la lettre qu’il vient d’écrire est un beau témoignage d’élévation et de force d’esprit ; de sa santé souffrante ? mais Dieu n’est-il pas là pour donner à son serviteur la force du corps et de l’âme ? de son amour pour la solitude ? mais qui se cache ainsi est bien digne d’être donné en exemple au monde ; de son amour pour l’obscurité ? mais qui sait se commander à soi-même est fait pour commander aux autres. Alors Gabriel courbe la tète et obéit. Et voyez comme le pape avait bien jugé l’homme : le jour de l’élection venu, le frère eut l’unanimité des suffrages. A cette heureuse nouvelle, le pape écrit au moine : Je me réjouis, non pas que vous ayez obtenu une dignité que vous avez toute votre vie dédaignée, mais des suffrages qui vous ont décerné le généralat. OII 1 heureux événement ! Mais c’est un véritable miracle que cette unanimité de votes ! Vous voilà revêtu d’une grande magistrature ; je suis heureux que vos frères aient eu de vous la mémo opinion que je m’en étais formée. Adieu, bonne santé ; crainte de Dieu et amour de la justice. Le voilà, ce Léon X qu’a tant calomnié le protestantisme ! Est-ce là le pape des Propos de table de Luther, ne pensant qu’à remuer des pierres, à construire des palais, à peindre les murailles de ses chapelles ? Reconnaissez-vous là le pontife mis en scène par les graveurs de Nuremberg, entouré d’hommes de plaisirs, marchant escorté d’artistes, sans cesse penché sur le marbre, fouillant la terre, exhumant les statues antiques, en adoration perpétuelle devant la matière ? A la vue des splendeurs matérielles dont Léon X avait doté Rome, le protestantisme a feint de sourire, et, pour décrier le pape, en a fait un artiste. Il s’y était pris d’abord autrement : un jour qu’il passait sur la place de Saint-Pierre, il vit la papauté travaillant à élever un temple au prince des apôtres, et il écrivit : Les pierres émigrent la nuit, je vous le dis sérieusement ; les princes chrétiens sont tourmentés pour contribuer à l’édification d’une basilique à laquelle deux ouvriers seulement travaillent, et l’un des deux est boiteux. Quelques années après que Ulrich de Hutten avait trouvé cette facétie, que l’Allemagne prit au sérieux, l’église s’élevait à cinquante pieds au-dessus du sol. Alors le protestantisme imagina quelque chose de plus étrange peut-être : ce fut d’accuser la papauté d’avoir pris la place de l’ouvrier boiteux, et de ne s’occuper, en véritable manœuvre, qu’à poser des pierres les unes sur les autres, quand l’âme des enfants du Christ périssait faute de nourriture spirituelle. Grâces à Dieu, nous avons prouvé que le noble culte qu’elle avait voué à l’art ne la détourna pas un seul instant de son devoir envers l’humanité. La correspondance de Bembo existe, qui témoigne, à chaque ligne, du zèle de Léon X pour la religion, de son amour pour l’Église, de sa préoccupation à défendre le dogme catholique, de sa tendresse pour les pauvres, de sa sollicitude pour le salut des âmes, de sa foi vive et éclairée. Tel nous l’avons vu au concile de Latran, tel nous le trouverons dans ses épîtres familières ; c’est le même travail qu’il poursuit : la réformation des mœurs publiques, la paix parmi les princes chrétiens, le bon exemple dans le sanctuaire. Encore si les protestants seuls s’étaient trompés sur le caractère de Léon X ; mais les catholiques eux-mêmes se sont faits plus d’une fois étourdiment l’écho des tristes clameurs de nos frères. Ils pensent avoir formulé un arrêt historique, quand ils ont répété, comme des plagiaires, que le pape montra trop souvent une insouciance coupable pour les intérêts de la religion. A ces âmes abusées disons simplement : Ouvrez et lisez la correspondance du pape, et vos yeux seront dessillés. Même dans une lettre insignifiante à quelques égards, on trouve le pape fidèle aux leçons du divin Maître, et tâchant de ramener au bercail du pasteur la brebis égarée. En achevant la lettre que nous citions tout à l’heure, et qu’il adressait à Gabriel, l’image de l’un de ses enfants rebelles se présente au souvenir du pontife, qui laisse tomber sur Luther ces lignes si pleines d’affectueuse tendresse : Et maintenant il faut que je mette à profit votre zèle. Un prêtre en Allemagne, Martin Luther, comme vous le savez, tente d’entraîner les âmes dans la révolte, en prêchant de nouveaux dogmes. Employez, pour le ramener à la vérité, votre autorité de général de l’ordre, vos conseils et vos frères ; tâchez d’apaiser cet homme. Si vous vous bâtez, il sera facile d’éteindre une flamme naissante ; si vous différez, je crains bien que, lorsque nous tenterons d’éteindre l’incendie, nos secours n’arrivent trop tard. Mais pourquoi tous ces conseils i’ Est-ce que votre sagesse, votre piété, vos lumières .ne vous disent pas assez la conduite que vous avez à tenir ? Tout ce que je puis vous recommander, c’est d’employer à cette œuvre de réconciliation, objet de tous mes désirs, et vos pensées, et vos soins, et votre zèle, et votre temps. Il est dans la vie de Léon X des pages où l’on se dirait transporté au moyen-âge, cette époque d’enthousiasme religieux. Sélim, à la tête de ses hordes tartares, faisait chaque jour un nouveau pas en Europe. Pour arrêter cet autre Attila, le pape, à l’aide de ses légats, remuait les cours chrétiennes ; et partout on promettait à l’homme qui représentait à la fois le christianisme et la civilisation, des soldats et de l’argent ; mais les secours promis n’arrivaient pas. En Allemagne, un poète s’était mis en tête de lutter avec le pape, et conseillait à l’empereur, aux princes, aux diètes, de refuser leur concours au père des fidèles ; et la voix du poète était plus puissante que celle du vicaire de Jésus-Christ. Alors, dit un historien philosophe, on vit à Rome le souverain pontife marcher nu-pieds et appeler sur son peuple, par des gémissements et par des larmes, la protection céleste. Ses prières furent plus efficaces que ses négociations : Sélim mourut avant d’avoir pu exécuter ses projets. C’est à Léon X que nous devons en partie l’institution de ces belles cérémonies religieuses qui, chaque année, pendant la semaine sainte, attirent un si prodigieux concours d’étrangers à Rome. On ne saurait dire la majesté avec laquelle officiait le pontife, le recueillement qu’il gardait pendant la célébration du saint sacrifice. On le voyait, les mains jointes, l’œil fixé à terre ou sur l’autel, prier constamment. Il n’accompagnait et ne portait jamais le saint sacrement que la tête découverte. Il assistait tous les dimanches au sermon, mais il voulait que le prêtre ne parlât pas plus d’une demi-heure, conformément à la décision du concile de Latran. Musicien habile, il faisait chercher dans toute l’Europe les maîtres de chant les plus célèbres, les instrumentistes les plus renommés, pour célébrer le service divin. Il appela de Florence Alexandre Mellini, poète et musicien, pour accoutumer ses chapelains à garder la tonique dans la psalmodie des psaumes, et la mesure syllabique dans le chant des hymnes ou des proses : car son oreille souffrait quand on brisait le rythme ou qu’on offensait la prosodie. Zacharie Ferreri nous a dit ailleurs que sous Jules Il les hymnes qu’on chantait à Rome outrageaient souvent à la fois la grammaire et la quantité. Léon commanda au poète des chants sacrés où la mesure et la syntaxe sont rigoureusement observées, mais que gâte trop malheureusement l’image païenne. Ce ne fut pas la faute du pape que cet étrange amalgame d’idées chrétiennes et d’expressions mythologiques, mais bien de l’époque elle-même, ainsi que nous l’a= wons ailleurs remarqué. Il paraît que de Grassi ou un autre avait composé tout exprès pour le service des chapelles pontificales un rituel où le cérémonial romain était minutieusement décrit. Le manuscrit tomba dans les mains de Christophore Marcello, archevêque de Corcyre, qui le fit imprimer à Venise en 1515, et le dédia à Sa Sainteté. Pâris de Grassi voulait absolument qu’on punît ce qu’il appelait un crime de lèse-majesté pontificale ; mais le pape, qui connaissait mieux l’antiquité ecclésiastique que son maître des cérémonies, bien loin de condamner, approuva l’archevêque, qui livrait ainsi à la piété des fidèles une liturgie dont jamais Rome n’avait fait un secret. Léon X se levait de bonne heure et faisait sa prière à genoux ; quand la maladie dont il était atteint l’avait fait souffrir la nuit, il prenait un luth suspendu à la muraille de sa chambre à coucher, et se mettait à jouer. Il estimait que la musique est un présent du ciel, qu’elle adoucit le caractère, et qu’elle élève l’âme à Dieu. Il la regardait, après les lettres, comme la plus efficace consolation de l’homme dans l’exil. Il aimait à converser sur les principes de l’art musical, et démontrait ses théories en s’accompagnant sur le luth. Les musiciens comme les humanistes venaient chercher fortune à Rome, où le pape les accueillait avec empressement. C’est à Déon X que le Florentin Pierre Aaron dédia le livre qui a pour titre Toscanella della musica. Aaron nous apprend dans son épître dédicatoire que, voulant se faire un sort, car il était pauvre, il vint à Rome et se livra avec ardeur à l’étude des sciences musicales, jusqu’à ce que la mort lui eût ravi son généreux protecteur. Le professeur Thibaut, dans son beau livre sur la musique, a dit : L’Église catholique avait, selon son système, plus que toutes les autres, les plus pressantes raisons de conserver intacts les chants primitifs nommés ambrosiens et grégoriens, chants vraiment célestes, mélodies sublimes, ravissantes intonations qui ont été créées par le génie dans les temps primitifs du christianisme, qui saisissent l’âme plus profondément que beaucoup de nos nouvelles compositions combinées pour l’effet. Nous n’avons pas besoin de dire que les chants empreints d’une simplicité sévère n’étaient pas plus du goût de Léon X que de son siècle. A cette époque, tous les esprits étaient emportés comme à leur insu vers l’effet. c’était l’effet qu’on cherchait en poésie, en peinture, en sculpture, en musique ; et Léon X, sorti du monde brillant de Florence, ne put échapper à cette loi commune que subissait l’intelligence. Un frère s’était rencontré dans un couvent, Savonarole, qui avait tenté de rendre au choral religieux sa forme primitive ; mais il ne vécut pas assez de temps pour opérer cette révolution que le Nord devait poursuivre plus heureusement. Le clergé, si rigoureux à Rome, plus qu’ailleurs peut-être, pour tout ce qui tient au rit, laissa introduire la musique mondaine dans l’église : la psalmodie, avec son ordonnance uniforme, ne pouvait plaire à ce peuple qui allait admirer sur les murs du Vatican les arabesques de Jean d’Udine ; à la Farnésine, l’Alexandre de Soddome, et plus tard, dans diverses chapelles, les peintures de Jules Romain. Ce n’est pas dans une église de Rome à la renaissance qu’on aurait chanté une litanie de la Vierge sur le mode du sixième ton des psaumes ; or Léon X, pas plus que tout ce qui l’entourait, n’était porté de sa nature au beau simple. Cette passion pour la musique suivait le pape jusqu’à table : à la fin de ses repas, on appelait des musiciens qui exécutaient diverses mélodies en s’accompagnant sur la guitare ou sur un autre instrument. Ce repas ressemblait assez à ceux que Vida donnait aux étrangers dans son évêché d’Albe. Les légumes y figuraient en abondance ; le mercredi, pas un plat de viande ne paraissait sur la table ; le vendredi, en n’y servait que des racines ; le samedi, il était de règle qu’on ne mît pas le couvert, le pape jeûnant ce jour-là. Léon X mangeait peu et ne buvait que de l’eau. Paul Jove, qui plus d’une fois eut l’honneur de s’asseoir à la table du pontife, nous dit que l’amour des lettres et des arts était si vif-en lui, qu’il ne voulait pas que le temps du repas fût perdu pour l’instruction des convives : il indiquait un sujet souvent religieux, auquel tout le monde prenait part. Quelquefois l’entretien roulait sur un livre récemment paru, et dont Sa Sainteté indiquait les défauts ou les mérites. Le soir, la conversation se renouait, vive, animée, pleine de saillies, de mots heureux, de traits d’esprit que le pape échangeait avec ses hôtes. Il savait, avec une adresse infinie, amener la discussion sur les poètes profanes, qu’il avait tant aimés dans sa jeunesse, et dont il citait par cœur de longs fragments. C’était tour à tour un professeur, mais sans pédanterie, analysant les beautés d’un passage de Virgile avec un goût qu’eût envié Politien ; un archéologue déchiffrant une inscription avec l’érudite intelligence de Pomponio ; un philosophe discutant comme Benivieni l’influence de Platon sur la restauration des lettres ; un autre Castiglione exposant ses théories sur les lois du beau, et, quand ses convives portaient une robe rouge, un nouveau Sadolet, tout plein des Pères de l’Église. De ses vastes lectures chrétiennes et profanes, il avait retenu une foule de sentences qu’il amenait avec un à-propos exquis. Tous ceux qui avaient le bonheur de l’approcher s’en allaient émerveillés de ses connaissances variées, de son érudition, de son beau langage. Le peuple l’aimait avec passion, et s’inclinait quand il passait comme devant un saint, parce qu’il admirait en lui des mœurs d’une pureté si éclatante, que la calomnie n’essaya pas même de les ternir : enfant, adolescent, homme fait, il vécut chaste et défia jusqu’au soupçon. Nous savons les reproches que de sévères moralistes ont adressés à Léon X : ils blâment surtout son amour pour la chasse. Il est certain que le pape aima cet exercice avec une sorte de passion : ses médecins lui en avaient fait un précepte hygiénique ; le repos eût abrégé ses jours. Vers la fin de l’été, il commençait ses promenades aux environs de Rome. Quand les pluies avaient rafraîchi l’atmosphère si chaude dans la Romagne jusqu’à la fin de septembre, il se rendait à Viterbe et s’amusait à chasser aux perdrix, aux faisans, et aux oiseaux de toutes sortes dont le pays abonde ; puis il continuait ses excursions, s’embarquait sur le lac Bolsène, mettait pied à terre dans l’île qui s’élève au milieu des eaux, et pêchait pendant des heures entières. Alexandre Farnèse l’attendait sur le rivage, pour le recevoir dans l’une de ses belles villas, demeures toutes royales, où Léon X, entouré de ses serviteurs, se livrait à un autre plaisir qu’il chérissait par-dessus tout : la conversation, à la nuit tombante, au pied de l’un de ces beaux pins chantés par Virgile. Là il faisait comme Machiavel à Casciano, il évoquait les ombres des grands hommes de l’antiquité païenne : seulement le pape appelait les poètes, tandis que le publiciste n’interrogeait que les historiens. Dans ces doctes entretiens, Léon X n’était plus qu’un humaniste dont Bembo pouvait discuter les jugements littéraires. Plus de vingt ans après la mort du pontife, Sadolet, dans son évêché de Carpentras, se rappelait avec attendrissement ces heureux instants passés avec son souverain, et des larmes s’échappaient de ses yeux ! Bientôt le pape quittait la maison de plaisance de Farnèse, et s’avançait jusqu’à Civita-Vecchia. Là, dit Roscoë, qui a copié les récits de Paul Jove, on rassemblait, dans une plaine couverte de broussailles et entourée de collines disposées en amphithéâtre, un grand nombre de bêtes fauves qu’il prenait plaisir à chasser. On conserve aux archives de Civita-Vecchia une lettre charmante de Léon X au gouverneur du château ; elle est datée de Rome, le 18 octobre 1518 : Mon cher châtelain, dit le pape, je serai le 24 courant à Civita-Vecchia avec une suite nombreuse. Vous me servirez du poisson et un bon dîner : il faut que je fasse figure au milieu de tous ces littérateurs, de tous ces artistes que j’amène avec moi. Je vous rembourserai de mes deniers tout ce que vous aurez dépensé. Je vous recommande bien de faire attention à ce qu’il ne manque rien au repas, car il s’agit de festoyer des hommes de grande importance et que j’aime avec délices. Nous serons cent quarante : que cela vous serve de règle ; vous ne pourrez pas prétexter d’ignorance. Je vous donne ma bénédiction. Votre souverain, qui vous aime tendrement. Les convives qu’il amenait avec lui étaient, entre autres, Bembo, Sadolet, Favorino, Berni et Raphaël. Mais de toutes les villas hors de Rome, c’était la Magliana dont Léon X préférait le séjour. A quelques milles du Vatican, sur les bords du Tibre, au pied du monastère de Sainte-Cécile, est une assez vaste plaine, jadis habitée par une peuplade du nom de Manlia ; tout autour s’étendent des collines autrefois plantées d’arbustes. C’est là que Sixte IV fit élever un magnifique palais, qu’Innocent VIII accrut et embellit ; c’est là que Léon X venait souvent se réfugier pour échapper au tumulte de Rome, amenant avec lui des ambassadeurs étrangers, des princes, des grands seigneurs et des artistes, et le plus souvent deux ou trois de ses serviteurs intimes. On savait le jour où le pape viendrait habiter la Magliana ; alors le chemin que devait traverser Sa Sainteté était rempli de paysans qui, à la vue de leur souverain bien-aimé, s’agenouillaient pour recevoir sa bénédiction. Sur son passage on élevait des bancs de verdure, des ares de triomphe tressés de fleurs. Le pape descendait de’ cheval ou de voiture, s’asseyait sur un de ces bancs rustiques improvisés par la piété, interrogeait les vieillards, embrassait les enfants, dotait les jeunes filles, payait les dettes des pauvres laboureurs, et s’en allait comblé de bénédictions et de témoignages d’amour. La Magliana n’existe plus ; mais le souvenir de celui qui l’habita longtemps vit toujours. Les paysans montrent encore le tertre où Léon X venait tenir ses assises villageoises. Ils ne savent pas que celui qui traversa tant de fois ces campagnes aujourd’hui si tristes fut le protecteur des lettres, le Mécène des artistes ; que, grâce à sa faveur, plus d’un o cygne au blanc plumage se changea en phénix à la couronne de pourpre, et plus d’un laurier en diadème, n comme dit le poète ; qu’il illustra son règne par de splendides monuments ; qu’il donna son nom au siècle qui le vit naître : on leur a dit seulement que Léon X répandait la joie partout où il portait ses pas, qu’il aimait les pauvres, qu’il pratiquait la justice, qu’il était le père de ses sujets, et ils ne peuvent prononcer son nom sans attendrissement. FIN. |