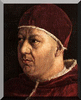HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XL. — LA RÉFORME.
|
Rôle que le Rire joua
dans le drame de la réforme. - Usage que Luther en fit dans sa polémique avec
Tetzel, Eckius, Alved et le pape. - Le démon de Luther. - Le dialogue. -
Ulrich de Hutten. - Mélanchthon s’associe à Luther. - Dialogue contre la
Sorbonne. - Le Pape-âne. - Caricatures de Nuremberg. - Images qu’inspire la
papauté. § III. DU RIRE, EMPLOYÉ PAR LA RÉFORME COMME INSTRUMENT DE PROPAGANDE. Il nous semble qu’on n’a pas suffisamment étudié le rôle que le Rire joua dans le drame de la réforme. Un moment il fut, en chaire, dans le dialogue, dans la polémique dogmatique, un grand instrument de prosélytisme. Le bois et la pierre s’en servirent pour parler au regard et achever l’œuvre insurrectionnelle. Luther comprit la puissance de ce symbolisme, et, dès le début de son duel avec le représentant de l’autorité, il l’employa pour tuer son adversaire. A ses yeux, le syllogisme aristotélicien n’est qu’un âne qu’il faut avoir soin d’attacher au bas de la montagne, quand on veut, comme Abraham, sacrifier sur les hauts lieux. Cet adversaire, ce fut d’abord Tetzel, dominicain fort peu rieur de sa nature, versé, quoi qu’on en ait dit, dans la science des divines Écritures, mais qui, ne marchant jamais sans un attirail d’arguments dérobés aux maîtres de l’école, ne pouvait atteindre le fils du mineur de Mœhra, qui, selon un écrivain protestant, va, vient, brise la haie qu’il ne peut franchir, et escalade monts et vaux à la façon du diable. Refuserez-vous un peu de pitié à ce pauvre moine qui vient d’entrer à Jutterboch au son des cloches, portant sur un coussin de velours la bulle de pardon de Léon X, et qui se voit arrêté dans son chemin, non comme Héliodore par quelque resplendissante épée, à tout prendre il n’y a pas de honte à fuir devant un ange, mais par un moine qui va chercher son bouclier, comme il le dit lui-même, au fond d’une marmite ? Encore si Martin lui avait jeté un argument scolaire ; mais point : au lieu d’encre, c’est avec du vin qu’il veut lui barbouiller la figure. L’entendez-vous ? le maître de la sainte théologie, l’inquisiteur de la foi, l’envoyé d’Albert de Mayence, prince du Saint-Empire, transformé en pourfendeur de rochers ! Pauvre Tetzel, cherche dans Durand, dans Scot, dans Pierre Lombard, dans le divin Thomas, tune trouveras rien pour répondre au moine augustin. Garde-toi bien de te mettre en colère, la colère t’est défendue par ton catéchisme ! N’ouvre pas la bouche pour rire, ton rire aurait une odeur d’école ! Ne te frotte pas le front pour faire tomber de ton cerveau, à l’imitation du Saxon, quelque grotesque image, tes supérieurs t’interdiraient ! Que voulez-vous donc qu’il fasse ? Qu’il descende dans la tombe pour secouer de leur linceul tous ces dieux de la scolastique qui dorment là depuis des siècles ? Mais il n’a pas le don de la création ; ce n’est pas lui qui pourra donner la vie, le mouvement, la parole à tous ces cadavres : vous voyez déjà quel auxiliaire Luther a trouvé dans le Rire ! Le Rire, en Saxe, aura toutes les sympathies de ces écoliers turbulents, bien aises de ne voir dans Aristote qu’un pédant de collège quia fait son temps ; — de ces humanistes séculiers si jaloux de la robe sacerdotale ; — de ces gantelets de fer, sûrs désormais qu’ils ont un dieu nouveau pour applaudir aux coups de dague dont ils frappent l’épaule monacale ; — et surtout de ce peuple bourgeois, qui a vécu jusqu’à présent en dehors d’une lutte dogmatique où dès ce jour les tenants parleront une langue intelligible : car le Rire s’exprime en allemand. Voilà les quatre figures qui vont prendre part à l’insurrection prêchée par Luther : l’indiscipline représentée par des écoliers, — la force brutale par les seigneurs, — la science poétique par les humanistes, — l’avenir par ce peuple dont Luther se vante d’émanciper la raison. A partir de ce jour, le Rire fut le compagnon habituel du docteur. La logique était-elle impuissante, Martin appelait son second, qui arrivait sur-le-champ, et la lutte n’était pas longue. Scultet, son évêque, humaniste fleuri, mélange de finesse italienne et de gravité teutonne, essaye d’adresser au moine quelques timides conseils ; — le Saxon l’éconduit en le comparant à une femme en travail qui accouchera bientôt d’un monstre. Eckius, le docteur d’Ingolstadt, qui, à Leipzig, a porté pendant quatorze jours le poids d’une discussion théologique où, suivant Mélanchthon, il a fait preuve d’une rare habileté, veut défendre la primauté du pape ; — l’augustin lui crie : Raca, vessie emplie de vent, gloriaceus, glorianus, gloriensis et gloriosus. Alved se présente avec ses arguments tirés en partie du consentement des peuples catholiques qui toujours ont reconnu dans le pontife romain l’élu du Christ : — Retire-toi, lui dit-il, bœuf par la tête, bœuf par le nez, bœuf par la bouche, bœuf par le poil. Les théologiens de Leipzig s’avancent en masse pour barrer le chemin au Saxon. — Arrière, leur crie-t-il, ânes, ânissimes, perânissimes, superânissimes. On vient de lui apprendre qu’à Rome on a préparé contre lui une bulle foudroyante, bulle magnifique, l’œuvre littéraire du grand théologien Accolti. A cette nouvelle il bondit, et dans sa colère il trouve des images qu’aucune langue ne saurait reproduire, des paroles de courtisane. Puis sa voix se tait, il n’est pas content parce que son lecteur n’a pas souri. Et il écrit : On dit que l’âne ne chante si mal que parce que, dans sa gamine musicale, il commence toujours par une note trop haute. Notre bulle eût bien mieux chanté, si d’abord elle n’avait pas posé sur le ciel sa bouche blasphématrice. Puis l’Elbe coulant à ses pieds, il y jette la parole du pape eu ces termes : Bulle, tu n’es qu’une bulle de savon ; nage donc dans ces flots ! Bulla est, in aquâ natet. Et tous les écoliers répandus le soir autour de sa chaire s’en vont, au sortir de sa leçon, crier dans les rues de Wittenberg : In aquâ natet ! C’est ici le moment de parler d’un filon nouveau de rire que Luther vient de trouver en enfer. Le Satan qu’il va évoquer n’est pas cet ange déchu qui transporte le Fils de Dieu sur la montagne. Il ne ressemble point à ce roi de l’abîme, dont la figure, dans Milton, est aussi splendide que la parole. Vous ne sauriez le comparer non plus à ce Méphistophélès de Goëthe, qui tente Marguerite dans des songes poétiques, et que Scheffer, avec son imagination allemande, a reproduit si heureusement sur la toile. C’est un type dont il a tout l’honneur ; un démon créé à son image, bavard comme une pie, mauvaise langue comme un portier, sale comme un marmiton, grossier comme un portefaix italien. C’est tantôt le polichinelle napolitain, avec sa double gibbosité ; tantôt notre paillasse de la place publique, avec sa face enfarinée ; tantôt arlequin, la ligure enduite de suie. Si Luther répudie l’anthropomorphisme, c’est pour changer son démon en crapaud, en lézard, en singe, en chauve-souris. Et le rôle répond à la forme. La vie de Luther est un combat perpétuel avec le diable qu’il a rêvé. Quelquefois, après avoir échappé, par taie sorte de miracle, aux agaceries de sa femme, il allait se cacher dans sa chambre de travail, respirant avec délices le parfum des fleurs qu’il entretenait sur sa fenêtre ; écoutant dans une douce extase le bruit d’une gouttelette d’eau qui tombait de la fontaine de son jardin ; enivrant sa poitrine altérée de cet air embaumé qui traversait le Poltersberg, ou caressant affectueusement le chien qu’il avait amené de sa prison de la Wartbourg. Alors il se prenait à s’entretenir avec ce monde visible ; il disait à la fleur : Pauvre violette ! combien tes couleurs seraient plus vives si Adam n’eût pas péché ! — à la goutte d’eau : Où vas-tu, au sortir de ce bassin ? Te mêler aux flots de l’Océan, comme l’homme à l’infini, en quittant cette terre ; — à l’air de la montagne : Ah ! vent du nord et du midi, porte à mon Créateur mes aspirations intimes ; — au chien de sa Pathmos : Toi aussi, tu as vu bien des livres ; en es-tu plus savant ? Et bientôt son démon l’arrachait à ces douces rêveries, mais un démon qui n’a touché ni ces fleurs, ni cette eau limpide, ni cet air des hauts lieux. Pécheur entêté, lui disait le diable, Dieu ne te pardonnera pas. — Son Fils a pris mes péchés, répondait le moine au tentateur, ils ne m’appartiennent plus. N’as-tu plus rien à me dire ? va-t’en. N’es-tu pas content ? tiens, mon drôle, voici de quoi te savonner la figure. Et il se penchait vers sa table de nuit. Vous pensez bien que le Satan de Martin n’avait garde d’attendre cette pluie immonde ; il s’enfuyait. Puis il revenait à tire-d’aile, et il bourdonnait : Tu seras condamné dans l’autre vie. — Pas vrai, te dis-je, répétait le Saxon. Tiens.... in manum sume crepitum ventris, cum istoque baculo vade Romam. S’il reparaissait, Luther prenait un grand verre qu’il emplissait de vin jusqu’au bord, et il buvait, buvait encore : car boire, disait-il, c’est le meilleur moyen d’échapper à Satan. Presque toutes les puissantes imaginations de la Renaissance sont légendaires : Luther beaucoup plus qu’un autre. Il y a dans ses Propos de table une foule d’historiettes, racontées du reste avec une naïveté charmante, où son diable se cache sous les eaux pour saisir la jeune fille qui vient laver son linge ; — près du berceau du nouveau-né, pour changer l’enfant qui dort ; — à table, pour taxer la messe d’idolâtrie ; — derrière un docteur catholique, pour lui souffler un argument hérétique ; — au chevet du pauvre Érasme, pour saisir l’âme du Batave. Ces démons sont bavards à se bouclier les oreilles, et ont toujours sur les lèvres quelque propos drolatique que Luther a soigneusement recueilli. Au sortir de son cabinet de travail, Luther montait souvent en chaire, où l’ironie venait s’asseoir à ses côtés. Son auditoire était admirablement constitué pour le Rire. Il y avait là, autour de la chaire de l’église de Tous-les-Saints, des moines qui avaient jeté bas le froc pour obéir, dit le prédicateur lui-même, à des exigences gastriques ; des religieuses échappées du couvent, et qui attendaient, comme une sorte de Messie, l’époux qu’on leur avait promis ; des électeurs à moitié ivres du vin dérobé dans quelque caveau monacal ; des chevaliers qui, à l’instar de Sickingen, allaient sur la grande route à la chasse d’un a gibier encapuchonné ; » des écoliers qui avaient brûlé en place publique Aristote, et surtout de ces bons buveurs qui vidaient d’un trait une pinte de bière en se lamentant sur l’intempérance des chartreux. Ce n’est pas nous qui avons tracé cette facétieuse nomenclature, mais Luther lui-même. Or, que le Rire descende, comme une langue de feu, sur tous ces auditeurs, vous êtes bien sûr d’une expansive gaîté qui circulera à travers les nefs du temple, pendant les bouffonnes improvisations du prédicateur contre les papistes. Le dialogue est, de toutes les formes littéraires, celle que le Rire adopta de préférence en Allemagne, dans le duel entre la réforme et le catholicisme. Le fond en était léger ; les détails seuls brillaient par la broderie. C’était un conciliabule de moines, une thèse de théologiens, une aventure nocturne de dortoir, un festin de prêtres, une visite de médecins entre deux grilles. L’action était prise dans les mœurs conventuelles, dans la vie sacerdotale ou dans le régime scolaire. La scène se passait ordinairement dans quelque vieille sacristie. L’acteur portait presque toujours un capuchon, un rabat, une soutane noire, violette ou rouge. Il parlait latin, mais un latin de frère portier ; ou bien allemand, mais un allemand de tabagie. L’écrivain, plus hardi qu’Aristophane lui-même, nommait en toutes lettres le malheureux qu’il voulait jouer, ou se contentait d’ôter ou d’ajouter une lettre au nom du personnage. En sorte que le peuple n’avait pas besoin de commentaire pour deviner le poète : au marché, il voyait passer à ses côtés le comédien malencontreux ; à l’église, il l’entendait chanter au lutrin ; en chaire, il l’écoutait parier ; à l’école, il le trouvait expliquant Aristote ou saint Thomas : le programme du dialogue était comme une affiche de spectacle. Ici le Rire va revêtir une autre figure : Hutten remplace Luther. Ulrich de Hutten, né en 1488, au château de Steckelberg, en Franconie, est une de ces organisations excentriques que le moyen-âge a produites en abondance. Il ressemble à Salvator Rosa. Il était poète, orateur, théologien et guerrier. On le voit, dans quelques-uns de ses livres, la tête ceinte de laurier, les cheveux flottants, la poitrine couverte d’acier, la main armée d’une de ces grandes épées telles qu’en portaient les soldats de Charles le Téméraire à la bataille de Morat. Sur le trépied d’Apollon, il improvisait des vers où parfois manquait la mesure, mais brûlants comme du feu ; sur le champ de bataille, il frappait d’estoc et de taille ; à table, il buvait sans s’enivrer. Il aimait les femmes plus encore que le vin : heureux si, dans l’intérêt de sa santé et peut-être de sa gloire, il n’eût courtisé que les Muses. Ulrich, qui avait parcouru l’Allemagne, la France, l’Italie, buvant, guerroyant, chantant, aimant, avait recueilli, dans sa vie nomade de poète, d’homme d’armes et de galant aventurier, une foule de joyeusetés, de lazzi et de concetti, dont il adornait son style, à la manière de notre Rabelais. Pantagruel n’use pas du mot propre avec plus de délices. Un jour qu’il retournait dans sa verte Franconie pour se guérir d’une maladie qui n’a rien de poétique, bien que Fracastor l’ait chantée en vers harmonieux, il trouva sur son chemin un morceau de bois de gayac qu’il essaya de dissoudre dans de l’eau, et qu’il avala en guise de remède ; et le mal gaulois ou napolitain qu’il traînait avec lui, en expiation de son péché, cessa momentanément de le tourmenter. Alors, dans la joie de cette cure miraculeuse, il se mit à célébrer la vertu de cette substance ligneuse, en un traité que Mayence imprima vers 1519. Or, à qui croyez-vous qu’il va dédier ce livre ? Peut-être à quelque joyeux compagnon de corps de garde ou d’infortune ? Point ! A son révérend père en Christ, Albrectht, prêtre de la sainte Église romaine, du titre de Saint-Chrysogone, cardinal, archevêque de Mayence et de Magdebourg. L’épigramme serait meilleure si les mœurs du prélat n’avaient été louées par un moine qui n’aimait guère les robes rouges, par Luther lui-même. On ne sait, en lisant le De Guaiaci medicinâ, s’il faut rire ou rougir de cette confession de lépreux. Le malade fait de son corps comme de ses livres : il montre toutes ses plaies, et dit jusqu’aux remèdes qu’il faut employer pour les guérir. Dans son enthousiasme pour sa découverte, il remercie le ciel et s’écrie : Si les Égyptiens mettaient jadis l’ail au rang des dieux, comment n’adorerais-je pas le bois de gayac ? C’est qu’il a tant souffert et qu’il souffre tant encore ! Ah ! monseigneur, raconte-t-il piteusement, si vous saviez tout l’argent que j’ai dépensé, les tortures que les chirurgiens m’ont fait subir, le sang que ces imbéciles de médecins m’ont tiré ! Seulement il ne dit qu’à demi la cause de son mal ; il en attribue l’origine à des phénomènes physiques, à l’insalubrité de l’air, aux miasmes des eaux, et surtout à la conjonction de Saturne et de Mars. L’historien serait bien malheureux s’il ne provoquait ici qu’un sourire d’étonnement. Il y a bien autre chose qu’une facétieuse épigramme de caché dans cette dédicace : le signe visible d’une révolution religieuse qui va venir. Le jour où le pouvoir laissa le nom d’un évêque en tête d’un livre destiné à célébrer les vertus anti-syphilitiques du bois de gayac, il était aisé de pressentir les destinées du sacerdoce : le prêtre était abandonné. Le peuple n’avait pas besoin d’une autre manifestation ; il avait compris la pensée de ses maîtres temporels. Seulement, à ce peuple toujours à l’avant-garde d’une révolution, il fallait un langage plus intelligible : Ulrich le parla dans ses Dialogues. C’est là qu’il règne véritablement sans rival. Pour trouver un satirique auquel on puisse le comparer, il faut remonter jusqu’à l’antiquité grecque. De Thou a fait de Hutten un autre Lucien. C’est souvent, en effet, en tenant compte de la différence plastique de l’idiome, lu même verve, la même causticité, et peut-être le même miel de paroles harmonieuses. Seulement la forme doit être différente. Comme Lucien s’adresse à l’esprit cultivé du philosophe, quand chez lui l’idée est indécente, le mot est ordinairement gazé ; tandis que de Hutten, parlant à la multitude, s’étudie, au contraire, à dépouiller le signe de toute espèce de vêtement. Il y a dans ses Dialogues des scènes qui ressemblent assez à ces peintures qu’on trouve sur les mitrailles de certaines maisons de Pompéi. Quelques-uns de ses personnages, comme Eckius, s’amusent, pour faire rire, à jeter bas jusqu’à la feuille de figuier de nos premiers pères. Nous nous garderons bien d’introduire notre lecteur dans ce Musée défendu ; qu’il lise le Conciliabulum Theologistarum adversus Germaniæ et bonarum litterarum studiosos, Coloniæ celebratum, et il aura une idée de l’effronterie du Rire, en Allemagne, à l’époque de la Réforme. Quelquefois le Rire, pour remuer plus ardemment la fibre populaire, se met à évoquer l’image mélancolique de la patrie. A la haine de Hutten contre la pourpre romaine, et qui déborde en sarcasmes si poignants, il est aisé de deviner le poète de race teutonne. On serait presque tenté de lui pardonner sa fanatique colère, tant il y a dans son âme de flamme patriotique ! C’est qu’il aime jusqu’à l’idolâtrie, l’herbe, la fleur, la glace, la neige, la blonde fille de sa chère Allemagne 1 c’est qu’il nourrit en son cœur un mépris profond pour tes descendants de ces Romains qui vinrent brûler jusqu’à son toit de chaume ; c’est qu’il croit au cygne que Jean Huss, le prêtre bohême, apercevait à travers les flammes de son bûcher ; c’est qu’il rêve un Hermann spirituel qui viendra briser le joug que Rome fait peser, à ses yeux, sur la Germanie : alors chez lui le rire est fou, insolent, épileptique, comme dans le Dialogue qui a pour titre : a Comment Jules, qui après sa mort voulait forcer l’entrée du Paradis, a été repoussé par le portier Pierre, bien que de son vivant il se fît appeler du nom de saint, et que, vainqueur dans tant de guerres sur cette terre, il crût être un jour le maître du ciel. u On a dû remarquer, dans l’histoire religieuse ou politique des nations, que la Providence a rarement manqué de placer à côté de ces organisations tempétueuses qui ont pour mission ou châtiment de troubler l’harmonie du monde moral, quelqu’une de ces natures aimantes vers qui l’âme se sent attirée par d’irrésistibles sympathies. Ainsi fait-elle dans notre univers physique, en jetant au pied du Grindelwald le myosotis au diadème bleu de ciel, sur le versant du Grimsel abrupt le rhododendron à l’ombelle purpurine. Entre Hutten et Luther, comme pour nous consoler, elle mit Mélanchthon, ce cygne aux blanches ailes qui va poser son nid au milieu des lotos grecs, à l’ombre du palmier iduméen ou du hêtre italique. Dans ce drame que nous nommons la Réforme, où gronde sans cesse le tonnerre, où l’humanité ne marche qu’a travers la sombre lueur des éclairs, où l’azur du ciel est obscurci par d’éternels nuages, où l’oiseau cesse de chanter, l’étoile de briller, la rose de fleurir, elle suscite ce beau jeune homme, qui, un moment, moment bien court ! aima tout ce qui fait battre le cœur, tout ce qui charme l’oreille, tout ce qui enchante le regard : poésie, musique et peinture. Mélanchthon s’essaya, lui aussi, dans le dialogué ; il voulut faire rire, mais son rire fut tourmenté. Voici le sujet de sa colère : La Sorbonne avait condamné divers articles de la symbolique Wittenbergeoise. Mélanchthon prit la défense de son maître bien-aimé ; son pamphlet eut peu de succès dans le monde théologique. Luther imagina de venir au secours de Philippe : le maître et le disciple se réunirent, et de concert composèrent ce Ludus où l’on reconnaît la simplicité littéraire de Melanchthon, bien qu’il ne porte que le nom du Saxon. C’est une scène où l’on joue perpétuellement sur le mot, et par conséquent dont tout le sel est dans le vocable latin : O vos rudes et vos Sorbonici, dit Mélanchthon ; la Sorbonne répond : rudes, proposition offensante, si par rudes vous entendez ces pieux serrés dont on fabrique l’auge des porcs : Spectabilis domine decane ! La Sorbonne se récrie : de cane ! nous ne sommes pas progéniture canine, entendez-vous ! Ces tristes concetti firent sourire quelques blanches barbes sorbonistes ; mais le peuple resta froid, cela devait être. Alors le cygne dont Menzel nous a parié eut le courage de souiller son beau plumage pour amuser les passants. A Nuremberg, la ville des flèches ailées, des clochetons transparents, à côté de cette maison travaillée comme une dentelle, où naquit Albert Durer, était un atelier de graveurs qui avant la Réforme gagnaient leur vie à peindre, sur une planche de buis, ces fleurs aux corolles épanouies, ces séraphins aux ailes déployées, ces vierges aux blanches tuniques, ces pères éternels à la barbe soyeuse, et ces mille figures dont l’art aujourd’hui peut à peine reproduire les charmants caprices. La guerre déclarée aux images par Carlstadt avait nui à leur commerce. L’atelier fermé, les ouvriers, ou les poètes plutôt, se mirent à parcourir l’Allemagne. Quelques-uns arrivèrent à Wittenberg, où Luther ne tarda pas à utiliser leur talent. Leur couteau, car ils ne se servaient pas d’un autre instrument pour évider le bois, catholique d’abord, se fit luthérien pour ne pas manquer d’occupation : le grand artiste était là, qui avec sa verve intarissable leur fournissait chaque jour de nouveaux sujets. Mélanchthon, pour se venger peut-être du peu de succès de son Ludus adersus sacrilegam Sorbonam, aida son maître dans la composition d’une caricature dont la vue seule devait faire rire, aux dépens de la papauté, tous les buveurs de bière de l’auberge de l’Aigle-Noir, à Wittenberg. On se mit à l’œuvre ; Luther, qui savait un peu de dessin, traça le croquis de l’image. Callot n’eût pas mieux fait. Donc représentez- vous une sorte de monstre tel que le fiévreux en imagine dans ses rêvasseries nocturnes, ayant une tête d’âne, la main droite semblable au pied d’un éléphant, la main gauche à celle d’un homme, le pied droit fait en forme de sabot de bœuf, le pied gauche d’un griffon, le ventre d’une femme enceinte, les bras, le cou, les jambes squammeuses, le bas des reins terminé par un dragon qui jette des flammes. C’est le fameux Pape-âne, Papst-Esel, qui défraya, pendant de si longues années, la conversation de tous ceux qui prédisaient la chute du catholicisme. On avait fait courir le bruit que l’original avait été trouvé au fond du Tibre, par un véritable miracle de Dieu, qu’on mettait en tiers dans cette farce de Tabarin. Un de ces ouvriers nomades de Nuremberg prit le dessin, qu’il reproduisit fidèlement sur le bois. Puis Mélanchthon se chargea de la légende, qui montait, descendait et s’enroulait, avec toutes sortes de caprices bouffons, autour de l’image. Cette légende est elle-même un véritable tour de force d’imagination, vous allez en juger : Le dragon qui sort du podex papal, jetant par la bouche des flammes, signifie les menaces, les bulles virulentes, les blasphèmes que le pape et sa séquelle vomissent sur cette terre au moment où ils s’aperçoivent que leur destin est accompli. Puis vient, comme dans nos complaintes rurales, la moralité ; elle est bouffonne par son sérieux : Chrétiens qui me lirez, ne méprisez pas un si grand prodige. Le doigt de Dieu est ici dans cette peinture si fidèle de l’Antéchrist : Dieu a eu pitié de vous, il a voulu vous tirer de la sentine du péché à l’aide de cette image miraculeuse. La gravure parcourut bientôt l’Allemagne réformée. Attachée à l’aide d’une épingle à la fenêtre des cabarets, étalée sur l’échoppe du libraire aux foires de Francfort, collée en guise d’illustration dans quelque pamphlet contre Rome, partout elle excitait le Rire : c’était une prophétie contre la papauté, traduite en signes visibles. Le mouvement iconologique une fois donné, la caricature remplaça le dialogue, le sermon bachique, la discussion aristotélicienne. On n’attaqua plus le moine par des arguments bibliques qu’il pouvait repousser : un morceau de bois amassé dans un buisson, et sur la fibre ligneuse, polie comme la pierre à aiguiser, quelques linéaments taillés à l’aide d’un couteau de cuisine, et le capuchon fut livré aux moqueries populaires. Le Rire en voulait surtout à la papauté ; il inspira Luther, qui cette fois cessa d’avoir recours à Mélanchthon. Deux images sorties tout entières de son cerveau obtinrent un succès prodigieux. Dans la première, le pape est assis sur son trône pontificat dans toute la splendeur de ses vêtements : de chaque côté de sa face se dressent deux oreilles d’âne. Autour de la tête du vieillard nagent, glissent, volent dans le vide, une myriade de démons. L’un d’eux est allé ramasser dans la table de nuit d’un père du couvent un emblème immonde qu’il pose sur la cime de la triple couronne. L’autre, connue sous le nom de la Truie papale, représente le pontife assis sur une truie aux larges flancs, aux mamelles gonflées, que le cavalier pique à coups d’éperon. D’une main il bénit ses adorateurs : une vieille édentée, un paysan qui ressemble à l’un de nos mais de mélodrame ; de l’autre il présente l’emblème que nous n’osons nommer : la truie lève le grouin, flaire avec délice ; le pape impatienté crie à l’animal. — Vilaine bête, veux-tu bien marcher ! au concile, au concile ! Il fallait bien raconter les prodigieuses imaginations du génie réformateur, si nous voulions donner une idée du Rire, dans l’une des représentations matérielles de l’art. L’historien ne saurait être blâmé parce qu’il a soulevé, comme !a fille du patriarche, un pan de la tunique luthérienne. Serait-ce simplement pour dérider quelques fronts moroses, qu’il aurait étalé aux regards ces bouffonnes nudités ? A Dieu ne plaise ! L’histoire, cette fille de la vérité, porte aussi un miroir où Hutten apparaît avec son dialogue obscène, Luther avec ses causeries trempées (le vin et de bière, Mélanchthon avec sa légende comico-sérieuse, pour nous montrer jusqu’où peut s’abaisser l’intelligence qui n’écoute que le mensonge ! Voyez combien la parole, ce beau don du Seigneur, a été par eux souillée ! En vérité, s’il est une âme qui dût rester pure, c’était celle de cet adolescent, qui porte dans l’œil, sur les lèvres, sur la figure, quelque chose de raphaélique ; de ce professeur parfumé de langue grecque, qui verse chaque jour à ses auditeurs le nectar homérique ; de cet héte d’un monde idéal qu’habitent les ombres de Platon et d’Aristote ; du commensal d’Erasme et du correspondant de Sadolet ! Pour plaire à je ne sais quelles exigences terrestres, pour amuser un peuple d’écoliers et de marchands, le malheureux 0lélanchthon consent à jeter de la boue à la face de cette royauté spirituelle qui civilisa le monde ! Pendant que Luther, Mélanchthon et Hutten s’étudient ainsi à dégrader la papauté, que fait cette fille du ciel ? elle inspire Bramante qui pose les fondements de l’église de Saint-Pierre, Raphaël qui peint la Transfiguration, Michel-Ange qui trace sur les murs de la Sixtine la Création de l’homme : ces images valent bien celles que la Réforme a produites ! Retournons à Léon X. |