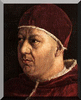HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXXIII. — PEINTURE. - RAPHAËL.
|
Raphaël part pour
Pérouse. - Pierre Vanucci, surnommé le Pérugin, donne des leçons à Raphaël.
- Progrès de l’écolier. - Raphaël retourne à Urbin, puis part pour Città di
Castello. - Raphaël à Florence, où il étudie les œuvres de Masaccio. -
Influence de Léonard de Vinci sur la manière de l’Urbinate. - Le symbolisme
de Dante. - Œuvres que Raphaël peint à Florence. - Castiglione. - Sentiment
chrétien répandu dans toutes les créations de Sanzio. § II. RAPHAËL SOUS LE PÉRUGIN. Vers la fin de 1500, un enfant descendait la grande rue d’Urbin, et prenait le chemin de Pérouse. Si quelques peintres de l’époque, Luca Signorelli ou Timothée Vitti, avaient rencontré le voyageur de quinze ans, aux cheveux bouclés, à l’œil noir, au front éblouissant de blancheur, à la tête coiffée d’une petite casquette coquettement rabattue sur l’oreille, aux épaules négligemment couvertes d’un manteau de drap de Venise, présent de son bon oncle Ciarla, peut-être auraient-ils demandé la permission au serviteur qui l’accompagnait de prendre un croquis de cette figure d’ange ; mais assurément ni l’un ni l’autre ne se seraient doutés que l’enfant portait dans sa valise le pinceau qui devait bientôt doter le monde du Mariage de Marie, de la Vierge à la Chaise, de l’Héliodore du Vatican, et de la Transfiguration.
Il y avait dans le talent de Vanucci quelque chose de tendre qui devait séduire l’imagination de Raphaël. Le Pérugin avait fait une étude approfondie des anciens peintres, et s’était approprié cette expression de mélancolie céleste qu’ils avaient su donner à leurs physionomies bibliques. Sa Vierge est souvent divine, et ses têtes d’apôtres, soit qu’elles regardent le ciel, soit qu’elles nagent dans un limbe lumineux autour de Marie et de son Fils, soit qu’elles contemplent le mystère de la Croix, sont des créations éthérées. Il paraît que ces figures de bienheureux, d’anges et d’enfants surtout, que Vanucci excellait à peindre, charmèrent Raphaël. Dans la sacristie de Saint-Pierre, à Pérouse, on conserve, comme une relique, un petit cadre où, sur fond d’or, il a reproduit l’enfant Jésus et le petit saint Jean qu’on trouve dans le tableau que Vanucci avait peint pour Santa-Maria des Fossi de la même ville. Il est impossible de copier avec un goût plus pur la manière d’un professeur. Vanucci dut sourire en se voyant ainsi revivre dans l’œuvre de son élève. Raphaël, comme les séraphins de son maître, avait des ailes, et ne pouvait rester longtemps emprisonné dans les langes d’une imitation plastique. Il faut rendre cette justice à Vanucci, qu’il donna bien vite la clef des champs à ce captif volontaire : il le choisit pour second. C’est Raphaël qui a dessiné la tête de saint Joseph, dans la Nativité que le Pérugin exécuta pour l’église des Minori Riformati della Spineta, près de Lodi, et qui se trouve aujourd’hui dans la galerie du Vatican. Cet essai était quelque chose de merveilleux ; Pierre en fut si content, qu’il lui laissa la direction d’une Résurrection destinée à l’église des Franciscains de Pérouse. Les deux gardes endormis, les deux autres qui s’enfuient quand le Christ secoue la pierre du tombeau, sont de Raphaël. Le dessin de ce double groupe, de la main de l’adolescent, appartenait à la collection de sir Thomas Lawrence. Ce sont des études où l’influence de l’école ombrienne se fait visiblement sentir, mais où l’écolier a laissé des traces de son individualité : une transparence de tons peu familière à son maître ; un soin, peut-être une divination de la forme ou des phénomènes extérieurs, trop négligée jusqu’alors ; une attention plus sérieuse donnée aux lignes et aux contours. Ce qui prouve la déférence du professeur pour l’élève, c’est que dans son tableau le Pérugin a laissé le modèle avec les vêtements inventés par Raphaël, tandis que, dans son carton il donnait aux figures un costume tout historique. Raphaël paya sa rançon intellectuelle en mettant le maître et l’écolier dans le même tableau. Le garde endormi, dans la force de l’âge, c’est le Pérugin ; l’autre garde qui sommeille, mais dans toute la fleur de la jeunesse, c’est lui, Sanzio. Au moment où tout souriait à l’enfant, où professeur et disciples le choyaient à l’envi, où il inscrivait son nom dans des œuvres que Vanucci plaçait dans l’endroit le plus apparent du temple catholique, au-dessus du maître-autel, une fâcheuse nouvelle vint l’arracher à ce qu’il y a de plus doux pour un artiste en cette vie, la gloire. Le trouble s’était glissé dans sa famille, sa belle-mère allait manquer de pain ; on disputait à la veuve de Santi une portion de l’héritage qu’il lui avait laissé en mourant. Raphaël embrasse son maître, dit adieu à ses camarades, quitte Pérouse, et prend le chemin de sa ville natale, où bientôt Bernardina put vivre à l’abri du besoin, grâce aux 26 florins qu’on dut lui payer en outre de sa pension ordinaire. Ces affaires domestiques réglées, il se remit enroule, non plus pour Pérouse, que le Pérugin avait quittée momentanément, mais pour Città-di-Castello, où le lendemain de son arrivée il se mettait à peindre ; car peindre, c’était vivre pour Raphaël. L’église de la Sainte-Trinité avait besoin d’une bannière ; il s’en chargea. D’un côté de la toile, il peignit la sainte Trinité, de l’autre la création de l’homme. L’artiste, dans cette double composition, s’est inspiré de son maître et de son père ; presque toutes les figures principales sont dans la manière de Vanucci, tandis que deux petits anges, l’un qui regarde le ciel, l’autre qui regarde la terre, sont une réminiscence de Santi. Ce qui appartient à Raphaël, dans ce cadre, c’est une pensée toute philosophique, qui dénote déjà le peintre des chambres du Vatican. Adam est plongé dans le sommeil ; derrière notre premier père se dressent des rochers qui jettent des ombres épaisses autour des personnages, symbole de la chute qui bientôt obscurcira l’œuvre du Créateur. Ce tableau, que Raphaël signa de ses initiales, fit du bruit dans la ville. Les augustins vinrent demander au peintre un cadre dont ils avaient fixé le sujet. Ils croulaient un saint Nicolas de Tolentino debout, au milieu des nuages, et couronné des mains de Dieu et de la Vierge ; Satan sous les pieds du thaumaturge, entre deux anges, faisant flotter un rouleau de papyrus où seraient écrites en lettres d’or les vertus du bienheureux. L’idée est poétique assurément et fait honneur aux moines ; l’exécution fut digne du sujet. Le tableau n’existe plus malheureusement. Rien n’égale la fécondité de notre peintre : partout où il passe, il laisse quelque glorieux souvenir. Presque toutes les œuvres de ce maître de dix-huit ans sont de véritables merveilles : c’est, par exemple, le Mariage de la Vierge, ce Sposalizio auquel le musée de Brera, à Milan, n’a rien à comparer ; chef-d’œuvre de grâce, de chasteté et d’expression, dont le graveur Longhi a su reproduire en partie l’ineffable beauté ; c’est une petite Vierge, bijou inestimable, que possède le musée de Paris ; c’est le Couronnement de Marie, si souvent repris par les peintres d’Urbin, et toujours avec un nouvel amour, et qu’on admire au Vatican ; c’est la Vierge de Staffa, devant laquelle tout amateur qui traverse Pérouse doit aller s’agenouiller, dans la maison du comte dont elle porte le nom ; ce sont des esquisses, des caprices, des arabesques, mille fantaisies d’artiste, qu’il laissait tomber avec autant de grâce que d’insouciance partout où il séjournait quelques heures, et que Lawrence, qui en possédait plusieurs, n’aurait pas échangées, comme il le disait souvent, contre la couronne d’Angleterre. Avouons aussi, avec Schelling, que Raphaël vient à une époque heureuse où l’amour de l’art exalte toutes les imaginations. Grâce aux Médicis, l’apparition d’une œuvre de Masaccio est un événement dans Florence, où Léonard de Vinci est traité royalement comme Charles VIII, et où les lettrés n’éprouvent pas plus de joie à la découverte d’une sylve inédite de Politien, que Pomponio Leto en trouvant, dans les ruines de Rome, une belle inscription lapidaire. Ce mouvement intellectuel a gagné l’Italie tout entière. A chaque Vierge nouvelle que produit Raphaël, c’est un murmure nouveau d’admiration, aussi nécessaire, ajoute le philosophe allemand, à la vie de l’artiste que le souffle du printemps à la plante. N’oublions pas que dans cette Ombrie, où Raphaël peint en ce moment, Platon accoutuma les esprits à chercher le principe divin dans l’harmonie matérielle de la création, comme Dante leur enseigna l’emploi du symbolisme dans la manifestation intellectuelle de l’art : philosophe et poète sont donc les auxiliaires, les instruments et les commentateurs des succès du peintre. Car, s’il a dérobé à Platon sa grâce, son rêve et sa poésie, à Dante il a pris sa figure de femme emblématique. Nous verrons bientôt, dans les loges du Vatican, comment Raphaël a su faire usage du mythe païen. Si en quelques-unes de ses peintures sacrées il introduit la mythologie des Grecs ou des Romains, ce n’est pas par un penchant classique pour les divinités de la fable, mais parce qu’à l’exemple de Dante, la figure païenne est un symbole sensuel à l’aide duquel il a mis en relief quelque chaste enseignement du christianisme. Toutefois jusqu’alors les œuvres de Raphaël sont encore humaines, parce qu’en général la spontanéité leur manque, c’est de la lumière, mais dont la source est dans le cerveau du Pérugin. Blême dans les traits à la plume et au crayon que l’artiste éparpille sur le papier, et que Venise a recueillis si dévotement, vous reconnaissez la main de Vanucci. On dirait que l’écolier veut suivre le précepte de Virgile, en s’attachant aux traces de son maître ou de son dieu. Et ce n’est pas seulement le sujet qu’il emprunte à Vanucci, mais la disposition des groupes, le jeu des ombres, l’horizon, le feuillage, le ciel. Cette imitation est telle, que, placé devant un cadre de l’enfance de Sanzio, on se met à murmurer le nom du Pérugin. Ce n’est qu’après un examen plus réfléchi, à quelque rayon transparent qui illumine l’œil, les lèvres ou le front de la Vierge, qu’on reconnaît son erreur. Du reste, ce rayon divin s’arrête tout juste au cou de la madone ; la vie s’est réfugiée tout entière dans la figure de Marie, et le corps, sous ses draperies diverses, n’accuse presque pas de forme. On voit que l’écolier n’a pas encore contemplé le nu ; que la statue antique, à défaut du modèle vivant, n’a pas posé devant lui. Plus tard, il comprendra, à Florence et à Rome, la nécessité d’étudier les types matériels. Raphaël, comme tout esprit d’élite, sent bien qu’il doit échapper au Pérugin, et qu’il a une autre mission à remplir que celle de reproduire la manière de son maître. L’artiste est comme l’âme dont parle l’Écriture, qui ne doit pas vivre seulement de pain, mais de ce qui procède de la bouche de Dieu. Or ce qui sort des lèvres divines, c’est l’esprit, c’est l’inspiration, c’est la pensée, c’est le moi ; et c’est à la poursuite de cette personnalité qu’il s’était mis en ce moment. Il partit pour Florence, emportant avec lui une lettre de recommandation de la duchesse de Sora, la nièce du cardinal qui venait de monter sur le trône pontifical sous le nom de Jules II. Jeune, beau, bien fait, courtisé des princes, chanté déjà par les poètes, et protégé par de nobles dames, Raphaël aurait pu faire plus tard comme Benvenuto Cellini, le ciseleur, dépenser sur les grandes routes son temps et son or, sûr de trouver quelque flatteur qui aurait complaisamment décrit les aventures de cette vie nomade. Heureusement pour sa gloire, il avait alors la modestie et presque la vertu d’une jeune fille. C’est la première fois, nous pensons, qu’on trouve à cette époque une belle dame vantant dans sa lettre de recommandation la sagesse de son protégé, surtout si l’on considère que l’épître est datée d’Urbin. Donc, la duchesse écrivait au gonfalonier Soderini : Magnifique seigneur, vous que j’honore comme un père, celui qui vous remettra cette lettre est Raphaël, peintre d’Urbin, qui veut séjourner à Florence : gentil et sage jeune homme que j’aime beaucoup et que je recommande vivement à votre seigneurie. Qu’elle fasse pour mon protégé ce qu’elle ferait pour moi. (1er oct. 1504.) La lettre était pressante, et Soderini, en homme de cour, dut avoir égard aux sollicitations de la duchesse. Du reste, l’enfant aurait pu se passer de la protection de Soderini : c’était à cette heure un artiste que toute Florentine se fût chargée d’introduire dans le beau monde de la Via largha, pour peu qu’elle eût eu l’espoir d’être peinte de la main du Zeuxis moderne, comme François Raibolini (Francia) appelait son ami. Deux maîtres faisaient en ce moment grand bruit à Florence : Masaccio et Léonard de Vinci. Mort en 1443, Masaccio avait eu le courage d’abandonner l’école de Giotto. C’était un artiste de réaction qui s’était posé en novateur, et s’était fait pardonner son audace à force de talent. Le premier il avait compris et pratiqué le clair-obscur, fait jouer dans sa composition l’ombre et la lumière, donné du relief à ses figures, et formulé plus nettement cette vie extérieure trop dédaignée par ses devanciers. En un mot, il paraissait avoir senti que l’homme est double, et que la fin de l’art doit être de peindre, à l’aide de la couleur, cette dualité visible et invisible, l’esprit et la chair, la matière et le souffle divin. Vasari a nommé cette poétique la manière moderne. C’était tout simplement la résurrection de la forme idéalisée ; ce que Schiller appelle la vie vraie, pour la distinguer de la vie réelle. Il est incontestable que la contemplation des ouvrages de Masaccio opéra dans la manière de Raphaël une véritable révolution. Pendant plusieurs semaines on le vit étudier, avec ses camarades Ridolfo Ghirlandajo et Aristotile di Sangallo, les peintures de la chapelle des Brancacci. Léonard venait de produire une œuvre que possède le musée de Paris, le portrait de la belle Mona Lisa, et achevait son carton célèbre de la bataille d’Anghiari, qui malheureusement a été perdu avec beaucoup d’autres trésors dans les troubles qui désolèrent Florence. A ceux qui nieraient que Raphaël se soit épris de Léonard, il suffirait, ce semble, dit M. Passavant, d’indiquer un profil de la main de l’Urbinate qui se trouve dans la collection de Lawrence. Mais que Raphaël, ajoute le biographe, se soit tout à coup arraché de, Sienne, où le Pinturicchio peignait les fresques de la Libreria, pour venir à Florence étudier les cartons de Michel-Ange, ainsi que le prétend Vasari, c’est une erreur manifeste ; car c’est en 1506 que Buonarotti exposait pour la première fois ses cartons, et Raphaël vint à Florence en 1504, comme le prouve la lettre de sa protectrice la duchesse de Sora. Toutefois Raphaël restait encore amoureusement attaché au type du Pérugin, de peur peut-être qu’en se jetant dans le sensualisme de Léonard, il ne fût obligé de sacrifier quelque fleur de cette chaste poésie biblique dont Vanucci, fidèle aux traditions de ses maîtres, imprégnait chacune de ses compositions. La Madone qu’il fit à Florence est à la fois un souvenir de piété filiale envers son professeur et une protestation contre les tendances trop profanes de Léonard. Regardez-la, et dites si jamais, à vingt ans, un poète rêva une création plus angélique ! C’est bien là assurément la Vierge de nos litanies, rose mystique, Vierge des vierges, mère de grâce divine ! Raphaël a mis en action cette belle pensée de Herder : La prière, c’est l’amour, c’est l’art ! A l’esprit qui ne connaît pas le recueillement, nulle vérité, nulle beauté n’apparaîtra jamais. Cette Madone a fait deux grandes passions depuis Raphaël : le duc de Toscane, Ferdinand III, l’emportait avec lui dans ses courses lointaines, donnant ainsi à l’image voyageuse le nom de son heureux possesseur ; et la grande-duchesse actuelle a longtemps, chaque soir, prié devant cette figure, pour obtenir de celle qu’elle représente un héritier au trône de Toscane. Après un court séjour à Florence, Raphaël voulut retourner à Pérouse. Il laissait dans la ville qu’il quittait une autre Vierge qui, d’abord propriété de la famille du duc de Terra-Nuova, appartient maintenant à Naples, et un beau portrait de jeune homme à l’âge de dix-huit ans, que possède le roi de Bavière. Pérouse l’attendait avec de belles commandes. Pour les nonnes de Saint-Antoine, il fit un maître-autel qui rappelle, dans les airs de tête des apôtres Pierre et Paul, son Couronnement de Marie ; dans le coloris foncé des draperies, son Sposalizio, et dans quelques femmes, le jet de Masaccio. C’est en 1505 qu’il exécuta, dans une chapelle de l’église des Camaldules, sa première fresque. Pour s’essayer à ce genre de peinture, dont il ne connaissait pas encore les ressources, il fit un galbe de jeune homme, que possède le roi de Bavière. il y a, dans sa fresque des Camaldules, des réminiscences de Fra Angelico et de Fra Bartolomeo, dont, il avait étudié les toiles à Florence. L’image de cette cité, l’Athènes de l’Italie, obsédait la pensée de Raphaël. Il subissait alors cette force mystérieuse qui pousse le génie hors de ces sphères étroites, où il mourrait faute d’aliment inspirateur, pour lui livrer le monde, sa véritable patrie, comme a dit Goëthe. Or, à cette époque, Florence était une cité où toute intelligence, qu’elle s’occupât de philosophie, de poésie, de peinture, de sculpture, de lettres ou d’art, était sûre de trouver une source abondante d’inspirations ; au besoin, de la louange et des critiques, double foyer où, suivant notre poète, vient s’alimenter la flamme du génie. Raphaël n’y devait rencontrer que des admirateurs. Deux maisons lui furent d’abord ouvertes ; celle de Taddeo Taddi, l’humaniste, et celle de Baccio d’Agnolo, architecte sculpteur. Dans l’une, il devait trouver la vie matérielle ; dans l’autre, la vie psychologique. Baccio d’Agnolo était l’architecte le plus occupé, ce qui ne veut pas dire le plus habile de Florence. Les banquiers et les usuriers, deux expressions que Savonarole regardait comme synonymes, ne pouvaient loger que dans une habitation dont il avait dressé le plan. Il faut dire à sa louange qu’il recevait admirablement, les artistes surtout. Parmi ceux qui fréquentaient les salons du sculpteur, Vasari cite André Sansovino, Filippino Cronaca, Benedetto da Majano, Antoine et Julien de Sangallo et François Granacci. Michel-Ange y venait aussi, mais plus rarement. Raphaël, dans ce monde d’intelligences, étonnait par sa parole poétique, par ses belles manières, et surtout par sa modestie. Nasi, riche bourgeois florentin, rechercha et obtint l’amitié du peintre d’Urbin. Ce fut pour lui que Raphaël composa la Vierge au Chardonneret. Taddeo Taddi s’occupait de lettres, mais par délassement ; c’était le correspondant de Bembo, le premier latiniste du siècle. II s’éprit tellement de Raphaël, qu’il lui offrit la table et le logement, que l’artiste accepta, mais qu’il paya généreusement : le logement, au prix d’une Madone que lord Francis Egerton acheta de nos jours 30.000 francs ; la table, par le don d’une autre Vierge qui fait aujourd’hui un des ornements du Belvédère de Vienne ; la première était un reflet du Pérugin ; la seconde, une inspiration de Léonard. Aux soirées de Baccio d’Agnolo venait un marchand retiré qui, n’ayant plus rien à faire, s’était fait amateur, et dont le cabinet possédait une magnifique sainte Famille de Fra Bartolomeo, qu’on admire aujourd’hui au palais Corsini, à Rome, et un tableau de Michel-Ange, qu’on voit à la tribune de Florence. Raphaël fit le portrait de cet opulent bourgeois, nommé Angelo Doni, et celui de sa femme, la belle Madalena, tous deux à la manière du peintre de Mona Lisa. Vers la fin de 1505, il eut envie de revoir Urbin, sa patrie, alors le séjour d’une brillante réunion de lettrés. A Florence, il avait étudié le procédé matériel des vieux maîtres ; à Urbin, il allait s’initier à la philosophie de l’art. On faisait chez le duc Guidubald un véritable cours d’esthétique comme dans une université d’Allemagne. Castiglione, l’auteur du Livre du Courtisan, nous a conservé quelques-unes de ces causeries, où des hommes comme Bembo et Bibbiena disputaient sur l’essence du beau, à la manière de Platon. Nous avons essayé de donner une idée des théories esthétiques de Bembo. Ailleurs, toujours dans ce Livre du Courtisan, il s’agit de décrire quelques-uns des caractères de la beauté matérielle, et l’un des interlocuteurs défend aux dames de montrer leurs dents. Le Pérugin, Francia, Luca Signorelli, ont pratiqué le précepte de Castiglione : aucune de leurs vierges n’ouvre la bouche. Raphaël imita ses devanciers jusqu’à ce qu’il eût vu les madones de Léonard. Plus loin, l’écrivain nous montre les Italiennes occupées à éclaircir leurs sourcils, à brûler les cheveux qui leur tombent sur le front. Raphaël, avant de venir à Urbin, connaissait cet artifice féminin : à peine si l’on aperçoit une ligne noire au-dessus de l’œil de ses vierges, dont le front dégagé s’épanouit dans toute sa blancheur. C’est ainsi qu’un livre oublié peut nous donner le secret de procédés qu’on serait tenté d’abord de regarder comme un caprice indifférent d’artiste. Il ne faut pas qu’on s’y trompe, Raphaël était un homme d’étude, un observateur curieux de la nature visible, un ardent travailleur. II ne portait pas plus des madones que La Fontaine ne portait des fables : il eut du génie, surtout parce qu’il eut de la patience. Ce que nous ne saurions assez remarquer à l’honneur de notre artiste, c’est le sentiment chrétien, auquel il est reste fidèle jusque-là. Il a peint par le cœur ; sa beauté, telle qu’i- l’a conçue et produite chez son père, chez le Pérugin, à Urbin, à Florence, est aussi céleste que celle d’Angelico de Fiesole. Savonarole, du haut de sa chaire évangélique, ne cessait de reprocher aux artistes, avec une amertume éloquente, de prendre pour type de leurs vierges quelqu’une de ces beautés de comptoir dont Florence offrait alors un si grand nombre. Jérôme eût mis sur l’autel, au lieu de les brûler sur la place publique, les vierges de Raphaël : nul artiste n’a créé autant de madones, et il n’en est pas une, sous quelque forme qu’il l’ait peinte, avec la paupière baissée, ou l’œil fixé sur son divin enfant ; au pied de la croix, ou couronnée dans le ciel par la sainte Trinité ; portée sur les nuages par des anges, ou assistant à l’ensevelissement de Jésus, devant laquelle il ne faille s’agenouiller. Mais tandis que les maîtres de la vieille école épuisaient tout ce qu’ils avaient de poésie ou de parfum à idéaliser la tête de Marie, lui cherchait et réussissait à imprégner non seulement la tête, mais le corps entier, d’une beauté toute céleste. Chez les peintres de l’Ombrie, cette beauté ne joue comme un rayon qu’autour de la figure ; le galbe est souvent commun ou défectueux. Chez Raphaël la beauté, comme le sang, circule dans toutes les veines. Ne parlons pas des diverses manières de Raphaël, qui n’en eut jamais qu’une seule, qu’il embellit et agrandit, suivant la remarque de Puccini, jusqu’au moment de sa mort. Ce qui semble un changement n’est qu’un progrès ; Raphaël nous le dira bientôt : il a un type de beauté tout formé, un idéal reconnaissable dans tout ce que son angélique pinceau a produit depuis dix ans. On a fait à des conquérants, dit M. Delécluse, l’honneur de les considérer comme des instruments de la vengeance céleste : pourquoi ne dirait-on pas que Raphaël a été la main choisie de Dieu pour exciter l’attention de l’homme à se porter sur toutes les modifications des beautés visibles ? Gloire donc à ces moines qui ont accueilli, fêté et protégé Raphaël, et inscrit son nom parmi les confrères du Saint-Sacrement ! Ils remplissaient, sans le savoir, les vues de la Providence. Aussi, quand en Italie nous rencontrions sur notre chemin un de ces bons pères, augustin, dominicain, camaldule, franciscain, nous étions toujours tenté de l’arrêter et de secouer un des pans de sa robe, pour voir s’il n’en tomberait pas encore quelqu’uh de ces beaux tableaux qu’ils inspiraient et payaient si bien à Raphaël. |
 Raphaël,
donc, avait quitté sa ville natale, et, comme nous le disions, s’acheminait
à pied vers Pérouse, où vivait Pierre Vanucci della Pieve, pour prendre des
leçons de ce maître illustre. Ce fut une heureuse inspiration que le choix
du Pérugin, fait par Simon Ciarla, l’oncle maternel du fils de Jean Santi. A
cette nature d’enfant, douce et rêveuse, il fallait un maître comme Vanucci.
La gloire de ce peintre était grande dans l’Ombrie. A cette époque on citait
de lui trois cadres presque aussi beaux d’expression que de coloris, qu’il
avait tout récemment achevés : son Christ sur la croix, que possède l’église
Saint-Jean la Calza de Florence ; Jésus au tombeau, qui appartient au palais
Pitti, et l’Ascension, que Vasari regarde comme le chef-d’œuvre du maître,
et qui de Saint-Pierre de Pérouse vint, en 1815, décorer le musée de Lyon :
magnifique témoignage de reconnaissance de Pie VII envers la cité qui
l’avait si pieusement accueilli.
Raphaël,
donc, avait quitté sa ville natale, et, comme nous le disions, s’acheminait
à pied vers Pérouse, où vivait Pierre Vanucci della Pieve, pour prendre des
leçons de ce maître illustre. Ce fut une heureuse inspiration que le choix
du Pérugin, fait par Simon Ciarla, l’oncle maternel du fils de Jean Santi. A
cette nature d’enfant, douce et rêveuse, il fallait un maître comme Vanucci.
La gloire de ce peintre était grande dans l’Ombrie. A cette époque on citait
de lui trois cadres presque aussi beaux d’expression que de coloris, qu’il
avait tout récemment achevés : son Christ sur la croix, que possède l’église
Saint-Jean la Calza de Florence ; Jésus au tombeau, qui appartient au palais
Pitti, et l’Ascension, que Vasari regarde comme le chef-d’œuvre du maître,
et qui de Saint-Pierre de Pérouse vint, en 1815, décorer le musée de Lyon :
magnifique témoignage de reconnaissance de Pie VII envers la cité qui
l’avait si pieusement accueilli.