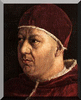HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXXII. — PEINTURE. - RAPHAËL.
|
Colbordolo habité par
les ancêtres de Raphaël. - Jean Santi, son père, exerce avec succès la
peinture à Urbin. - Son amour pour Raphaël. - Il consacre son habitation à la
sainte Vierge, qu’il peint à fresque, aidé, dit-on, par son enfant. - Mort de
Jean Santi. - Jugement sur ce peintre. § I. JEAN SANTI, LE PÈRE DE RAPHAËL. Colbordolo, petite ville du comté d’Urbin, possédait, au moyen-âge, une forteresse dont il ne reste que quelques débris épars sur le dos de la montagne où jadis elle s’élevait. De ces ruines la vue s’étend sur des collines plantées d’oliviers et coupées par deux rivières, l’Isauro et l’Apsa, dont les eaux, après avoir arrosé les plaines de Pesaro, vont se jeter dans l’Adriatique. C’est dans ce bourg démantelé que vivait au quatorzième siècle Sante, dont les descendants portèrent un moment le nom de Sante ou Santi. Plus tard, à l’époque de Vasari, on traduisit d’après la mode italienne le nom latin de Sanctius en celui de Sanzio, que porta si glorieusement Raphaël. En 1446, Sigismond Malatesta vint avec les troupes du pape ravager le territoire du comte d’Urbin et incendier Colbordolo. Peruzzolo, petit-fils du vieux Santi, fut obligé d’abandonner sa patrie et d’aller s’établir dans la capitale de la province, où il mourut en 1457. Santi, son fils, qui s’était mis à faire le métier de courtier pour nourrir sa famille, fut heureux dans son commerce. En 1450, le 21 octobre, nous le voyons acquérir, au prix de 220 ducats, une pièce de terre appartenant à Pierre-Antoine Paltroni, secrétaire du comte ; quelques mois plus tard, le 30 avril 1451, une belle prairie arrosée par des eaux vives ; et, deux ans après, une maison à double corps de logis, dans la Contrada del Monte, nom de la rue qui partait du marché et venait aboutir au sommet du monticule. C’est dans cette maison que naquit Raphaël. De ce belvédère, qu’on prendrait pour un anneau de la chaîne des Apennins, le regard a toutes sortes de magiques spectacles : le matin, le soleil qui sort de l’Adriatique ; au milieu du jour, des forêts étincelantes de feux ; le soir, des jeux variés d’ombre et de lumière. De l’ouest à l’est on aperçoit les montagnes onduler comme autant de vagues au-dessus d’une mer orageuse : on reconnaît le Furlo à ses larges échancrures, qui rappellent la brèche de Roland de nos Pyrénées ; à l’ouest, sur le premier plan, se dressent les pics du mont Nerone, découpés capricieusement, comme dans la haute Saxe ceux du Kœnigs et du Lilienstein ; plus loin, les blanchâtres aiguilles du mont San-Simone, d’où le Tibre descend pour aller se perdre dans la Méditerranée ; au nord repose, dans un nid de pierre, la petite république de San-Marino ; aux pieds de l’observateur, enfin, la ville d’Urbin, avec ses quatre quartiers, aux maisons étincelantes de blancheur, aux églises surmontées de girouettes, aux communautés qui ressemblent à de véritables forteresses : admirable tableau où la nature a répandu avec profusion des eaux, des arbres et des fleurs. C’est sur cette montage, si belle de lumière, de végétation et de coloris, que se passèrent les premières années de Raphaël. Son père, Jean Santi, l’a chantée dans ses vers, car il était poète. Il a laissé une chronique manuscrite, en terza rima, véritable épopée, moins le merveilleux, où il a célébré les faits et gestes du père de Guido, alors duc d’Urbin. Dante avait pris Virgile pour sa muse, Santi invoque Plutarque. Je voudrais bien savoir, lui dit le biographe, comment tu t’es mis dans la tête de te faire l’historien de cette grande famille ? Le poète lui répond : Par la grâce de Dieu, te dire comment, je ne sais ; mais à peine eus-tu subjugué mes sens, qu’aussitôt mon ardeur s’enflamma, et je rimai. Dans ce poème, Santi parle de tout : de combats, d’assauts et de prises de villes, de philosophie, de mythologie, et de peinture surtout. Bien qu’il peignit lui-même, nous le verrons bientôt, il n’hésite pas à louer tous ses rivaux morts ou vivants : il a su dans trois vers enfermer un éloge charmant de Pierre Vanucci et de Léonard de Vinci. Jean était un peintre comme on en trouve à cette époque, amoureux de son art jusqu’à l’exaltation, et qui, assailli par le malheur, garda ses pinceaux pour toute consolation, ainsi qu’il le raconte si poétiquement à son Mécène, le prince auquel il a dédié sa chronique : Depuis, lui dit-il, que la fortune a détruit mon nid domestique, a dévoré jusqu’à mon dernier morceau de pain, il serait trop long de vous dire toutes les tempêtes que j’ai essuyées. Pour gagner ma pauvre vie, je me suis mis à pratiquer l’art admirable de la peinture, et mes chagrins, loin de diminuer, se sont accrus. Me voilà sur les épaules un fardeau qu’Atlas pourrait à peine porter : je peins toujours, et, quoique indigne, je ne rougis pas d’avouer mon culte pour le bel art de Zeuxis. » Nous retrouverons dans une lettre de Raphaël à Léon X quelques-unes de ces images poétiques qu’affectionna Santi. Tous deux les ont puisées vraisemblablement à la même source : dans le spectacle qui se déroulait à leurs regards, de leur observatoire inspirateur de la Contrada del Monte. Santi ne fut point élevé en artiste : il ne fréquenta aucune de ces écoles où, sous la direction de Squarcione et de Verrochio, l’écolier doué de quelque imagination faisait de si rapides progrès. Heureusement il vivait dans une ville où chaque église, chaque couvent offrait quelque œuvre d’ancien maître, depuis Jules de Rimini, qui peignait au commencement du quatorzième siècle, jusqu’à Pierre della Francesca, qui demeura près de Santi pendant une partie de l’année 1469, aux frais de la confrérie du Corpus Domini, qui s’était chargée de payer la pension du peintre du Borgo di San-Sepolcro. Parmi les artistes qui laissèrent une trace ineffaçable de leur passage à Urbin, il faut citer Octavien di Martino Nelli, qui exécuta en 1407, dans l’église de Santa-Alaria-Nuova, à Gubbio, une fresque qu’on a mise sous verre pour la préserver des ravages du temps. Octavien, si l’on en croit la chronique, était disciple d’Oderigi, ce miniaturiste que Dante, qui écrivit à Gubbio deux chants de sa Divine comédie, a placé dans son Purgatoire. A l’époque dont nous parlons, les peintres flamands faisaient fréquemment le pèlerinage de l’Italie pour venir y étudier les principes de l’art. Les confréries des grandes cités accueillaient avec distinction ces hôtes étrangers, et leur commandaient des tableaux d’autel qu’elles payaient généreusement : c’est ainsi que les frères du Saint-Sacrement d’Urbin donnèrent à maître J. de Gand 250 florins d’or pour le travail dont il s’était chargé en peignant un maître-autel que le couvent lui avait demandé. Santi connut van Eyck, qu’il cite avec admiration, et qu’il désigne le plus souvent, dans sa chronique, sous le nom du grand Johannes. Il fut émerveillé de l’habileté que ce maître mettait à reproduire les objets naturels, de façon à tromper le regard. Santi ressemble au spectateur placé pour la première fois devant une couvre de Gérard Dow ; ce qui le frappe, c’est l’art de rendre la nature morte, où van Eyck paraissait n’avoir pas de rivaux : il faut l’écouter alors, il est poète à la manière justement de celui qu’il veut louer : Qui pourra jamais imiter le coloris clair, limpide, transparent d’un rubis, et sa vague splendeur ? Qui pourra peindre un soleil du matin ou le miroir d’une eau encadrée dans des fleurs et des fruits ? Quel peintre sut jamais reproduire la blancheur du lis, la fraîcheur d’une rose ? Cette merveille est trouvée. Santi, rendons-lui cette justice, ne connaissait pas la jalousie de métier ; il louait en beaux termes ses rivaux. Un artiste de cette nature devait être heureux, et il le fut de toutes sortes de bonheurs. D’abord son atelier de la Contrada del Monte ne désemplissait pas de visiteurs. C’est à peine s’il pouvait suffire aux nombreuses demandes des confréries d’Urbin et des villes voisines, où sa réputation de peintre doreur était si bien appréciée. Nul ne savait rehausser d’or comme lui les ailes d’un séraphin : aussi le voit-on occupé sans cesse à dorer des anges pour les frères du Saint-Sacrement. C’était enfin une notabilité de la ville avec qui le prince Frédéric ne craignait pas de causer. Quand il eut, après de longs travaux, amassé quelques centaines de florins, il songea sérieusement à se marier. Il fit choix d’une jeune fille du pays, la belle Magia, l’unique enfant d’un marchand nommé Baptiste Ciarla. On croit qu’il l’a peinte sous les traits de l’une de ces madones que son pinceau aimait à reproduire. En effet, les vierges de Santi ont toutes un véritable air de famille : front large, chairs vigoureuses, œil noir, quelque chose d’un peu masculin comme la beauté romaine. Raphaël s’est souvent inspiré du type inventé par son père ; seulement dans ce bel œil noir il a mis une prunelle mobile ; sous ces chairs rosées, du sang ; dans cette incarnation luxuriante, de la vie ; et dans tout le profil, un idéal que Santi n’aurait jamais trouvé : c’est un homme de métier que Santi, et presque jamais d’inspiration. Le vendredi saint 1483, Magia mit au monde un enfant qui, selon la pittoresque expression de M. Passavant, devait être un jour la plus brillante étoile du firmament de l’art. Santi voulut qu’il portât le beau nom de Raphaël, ainsi que s’appelait ce séraphin qu’il avait peint si souvent pour les frères du Saint-Sacrement. Si l’on en croit Vasari, Santi ne voulut pas que son enfant reposât sur les genoux d’une autre nourrice que Magia, qui devait faire passer dans le sang de Raphaël quelque chose de sa douceur maternelle. François Venturini venait de faire imprimer à Urbin, par maître fleuri de Cologne, une grammaire latine ; ce fut lui, dit 1latïèi, que Santi choisit pour donner des leçons à Raphaël : Michel-4nge de Florence était un élève de Venturini. Santi aimait son fils comme il aimait sa femme, avec passion. Il l’a placé dans quelques-uns de ses cadres, entre autres sous les traits d’un enfant à genoux en contemplation devant la sainte Vierge et son divin fils, dans un tableau qui d’Urbin a passé au muséum de Berlin. On ne saurait en douter, c’est bien là Raphaël avec ses cheveux noirs, son bel œil, son cou de cygne et sa peau rosée, avec cette fleur de carnation et de coloris que l’âge ne fit qu’épanouir. Santi ne quittait pas un seul moment son bien-aimé : lui commandait-on au dehors quelque tableau d’église, alors la petite famille se mettait en chemin dans une voiture couverte, s’arrêtant à chaque église qu’elle trouvait sur sa route pour aller passer quelques instants en contemplation devant un tableau de vieux maître. Santi expliquait à son enfant le sujet du cadre, le procédé mécanique du peintre, sa pensée intime, ses défauts ou ses qualités. Si vous traversez l’Ombrie, interrogez la première jeune fille que vous trouverez, et demandez-lui si elle connaît Dante Alighieri, Torquato Tasso, Lodovico Ariosto, Niccolo Machiavelli, Michel-Angelo, elle hochera la tête en signe d’ignorance ; prononcez ensuite le nom de Raphaël, vous la verrez sourire : un seul souvenir des gloires de l’Italie est resté dans toutes les intelligences, celui du peintre d’Urbin. Dans l’Ombrie, c’est quelque chose de plus qu’un artiste : c’est un être inspiré, une sorte de génie céleste, comme un ange qui communiquait avec ses semblables à l’aide de la couleur. Là, il n’est pas d’église de village, pas de maison noble qui ne se vante, bien souvent à tort, de posséder au moins un dessin de cet adolescent merveilleux. Un jour son père, qui avait une vive foi à Marie, voulut consacrer à la mère des anges la maison qu’il habitait. Jamais il ne fut mieux inspiré ; sa Madone, peinte à fresque, était si belle, si pure de dessin et si suave d’expression, que, Jean étant mort, on dit hautement que Raphaël avait aidé son père dans cette œuvre magistrale. Pourquoi pas ? l’enfance du grand homme est presque toujours prodigieuse. Mozart, ce Raphaël de la musique, à dix ans quittait ses compagnons de jeu pour courir au piano et improviser des mélodies qui arrachaient des larmes de joie à son vieux père. Raphaël eut le malheur, bien jeune encore, de perdre son père. Jean mourut dans les plus tendres sentiments de piété, le 1er août 1494, et fut enseveli dans l’église de Saint-François, qu’il avait dotée de si beaux ouvrages ; regretté de tous ceux qui l’avaient connu, et pleuré surtout de son fils bien-aimé et de son élève fidèle, Evangelista da Piano di Melito. Magia Ciarla, sa première femme, était décédée trois ans auparavant. Il institua, dans un testament fait deux jours avant son décès, en présence de maître Ambroise Barocci, sculpteur et lapidaire de Milan, de son élève Evangelista, et de Tomasso di Maestro Trojano Alberti, pour héritiers universels, Barthélemy son frère et Raphaël son fils. A Bernardina, qu’il avait épousée en secondes noces, il laissa, jure restitutionis, les 60 florins qu’elle avait apportés pour douaire dans la communauté, quelques bijoux de prix et une partie de sa garde-robe. Que si maintenant nous voulons apprécier comme artiste Jean Santi, nous trouverons en lui un digne représentant des peintres qui fleurirent vers la fin du quinzième siècle ; systématique dans l’ordonnance de ses tableaux, ainsi que ses devanciers ; attaché aux formes traditionnelles léguées par l’école de Giotto, niais cherchant dans les détails à se rapprocher davantage de la nature, à reproduire plus fidèlement la vie réelle qu’on ne l’avait fait jusqu’alors. Il est aisé de s’apercevoir des efforts du maître, dans quelques-unes de ses compositions, pour se créer une personnalité, et quitter la voie d’imitation où tous ses rivaux s’étaient engagés ; et marchaient avec plus ou moins de gloire. Santi lutte, et souvent avec bonheur, pour s’affranchir du joug de ces types que les peintres se lèguent comme un héritage. C’est un homme de réaction, qui n’avait pas assez de génie pour être complètement réformateur. Il est grave, sévère, touchant. Ce qu’il exprime avec le plus de bonheur, c’est la figure de l’enfant : comme dessinateur, il est loin d’égaler Mantegna, plus loin encore, comme peintre d’expression, de François Francia. Vous ne trouvez point en lui le jet si hardi de Luca Signorelli, ni le ton solennel de son ami Melozzo de Forli. Toutefois son nom ne saurait périr : d’abord parce qu’il fut le père de Raphaël ; ensuite parce que, comme artiste, il a laissé des œuvres remarquables de sentiment religieux et de style. |