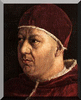HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXXI. — POÉSIE. — POÈTES.
|
L’art à la
renaissance, ne pouvait pas éviter de tomber dans le paganisme. - L’Arioste à
Rome est reçu par le pape. - Ce qu’il aurait voulu obtenir de Sa Sainteté. -
Bulle du pape contre ceux qui réimprimeraient le Furioso. - L’Arioste à
Ferrare. - Vida, que Giberti conduit à l’audience de Sa Sainteté, est
encouragé et récompensé. - Le pape applaudit à l’idée de la Christiade. -
Jugement sur ce poème. - Vida dans son évêché. - Sannazar partage l’exil de son
souverain, vient en France, et retourne en Italie après la mort de Frédéric.
- Son poème sur l’Enfantement de la Vierge. - Ses églogues. - Sannazar à Naples. L’ARIOSTE.
Suivez-la bien, cette intelligence ; la voici en contemplation devant un de ces fragments de marbre achetés si cher par Laurent le Magnifique, qui l’a placé dans son musée de Saint-Marc : mais ce marbre est grec ; l’artiste qui le fouilla, Grec, et l’individualité qu’il représente, grecque encore. Si l’intelligence voyageuse, comme elles le sont toutes à cette époque, veut aller à Rome pour assister aux fouilles du Campo Vaccino, que verra-t-elle sortir de terre sous la pioche du fossoyeur ? une colonne du temple de la Paix, une statue de Vesta, une frise de l’arc de Sévère, des dieux de l’enfer, du ciel, des eaux, de l’air, tout le monde idolâtre. Esprit et matière, œuvres émanées du cerveau, ou faites de main d’homme, édifices et livres, tout ce qu’elle voit, tout ce qu’elle touche, tout ce qu’elle respire, tout ce qui tombe sous la vue ou sous le sens dans l’empire de l’art, est issu du paganisme. Comment, dans cette atmosphère païenne, garderait-elle la robe chrétienne qu’elle reçut au baptême ? cela est impossible. Sous cette couche de poussière mythologique, elle va trouver l’art, et l’art sous des formes dont le christianisme ne peut encore lui offrir que d’imparfaits rudiments : est-il donc surprenant que, pour dérober à l’antiquité ses secrets, l’intelligence se soit faite païenne ? Ecoutons le cardinal Bessarion écrivant à Démétrius et Andronic, fils du sage Gémiste : J’ai appris que notre père et précepteur, s’étant dépouillé de tout ce qu’il avait de terrestre, s’est envolé vers les cieux dans un lieu de pureté pour y danser avec les dieux célestes la danse mystique de Bacchus. Je me félicite d’avoir eu commerce avec un si grand homme. La Grèce n’en a point produit de plus sage depuis Platon, si vous en exceptez Aristote ; de sorte que si l’on veut admettre le sentiment de Pythagore sur la descente et le retour éternel des âmes, je ne ferai point de difficulté d’avancer que l’âme de Platon, engagée par les liens indissolubles du destin, pour achever la période de ses révolutions, avait choisi Gémiste pour sa demeure. Nous voudrions savoir ce que Savonarole aurait pensé de Bessarion, s’il eût connu cette épître ; assurément il en aurait fait un païen et aurait brûlé la lettre dans le même bûcher qui consuma par son ordre les ouvres de Boccace et d’Ovide. Il aurait eu tort ; Bessarion, trop plein de son vieil Homère, dont il veut ressusciter la langue en Italie, parle comme un prêtre de l’antique Samos, parce qu’il a besoin de raviver dans l’âme des fils de Gémiste cette flamme poétique qui s’alluma au foyer de la Grèce antique. Dira-t-on qu’il croyait à Bacchus, à Pythagore ; qu’il écrivait une profession de foi ? Non sans doute ! Bessarion faisait de la mythologie dans son épître, tout comme Jean d’Udine en faisait sur les murs du Vatican : c’est la forme dont l’un et l’autre poursuivaient la réhabilitation. Si un saint évêque a dû succomber au paganisme, attendons-nous à trouver dans les poètes de la renaissance, italiens et latins, toutes les folies de langage dont n’a pu se préserver une âme chrétienne comme celle de Bessarion. Quand donc Léon X encourage une littérature où domine l’élément païen, après les protestations qu’il a faites au concile de Latran contre le naturalisme, ne nous hâtons pas de le condamner ; étudions son époque, et, si à l’aide de cet élément profane il a su donner aux lettres et aux arts une impulsion profonde, croyons que mieux qu’un autre il connaissait l’instrument dont il se servait. Quand, sur cette muraille de soixante pieds, toile que le pape avait donnée à Michel-Ange pour peindre le Jugement dernier, nous vîmes pour la première fois Caron conduisant les âmes dans sa barque, notre foi murmura contre le grand artiste ; mais nous nous rappelâmes bientôt les vers de Dante, qui place le nautonier dans son enfer. Ainsi, l’un des premiers, Dante a consacré la formule païenne. Parmi les poètes qui brillèrent à la cour de Léon X, et qui sacrifièrent trop souvent au naturalisme, tous ne méritent pas également d’attirer notre attention. S’il en est dont la gloire n’aura pas de fin, on en compte beaucoup d’autres qui firent un moment quelque bruit en Italie, mais dont la renommée n’a pas mérité de traverser les Alpes. A ceux-là quelques mots de souvenir suffiront. Tiraboschi, en exhumant leurs noms, n’a pu leur donner l’immortalité. C’est en vain que l’Arioste s’écrie : Dis-moi que tous les jours je pourrai m’entretenir avec Bembo, Sadolet, Paul Jove, Cavallo, Blosio, Molza, Vida et Tebaldeo. Bembo, Sadolet, Vida, Paul Jove, Molza peut-être, n’avaient pas besoin du poète pour vivre dans l’éternité ; mais Blosio et Tebaldeo, qui oserait leur dire : Lève-toi et marche ? En 1513, l’Arioste avait fait le voyage de Rome, pour joindre sa voix à celles des lettrés qui célébraient comme un bonheur public l’exaltation de Léon X. Le pape connaissait l’Arioste, qu’il avait vu plusieurs fois à Ferrare ; et, s’il faut en croire le poète, le cardinal de Médicis lui aurait fait de brillantes promesses qu’il ne tint pas lorsqu’il fut devenu pape. Quelles étaient ces promesses ? Il est facile de comprendre l’Arioste ; il attendait, dit-on, un chapeau de cardinal. Rolli attribue le refus de Léon X ait ressentiment dont le pape avait hérité de Jules II contre le duc Alphonse, protecteur de l’Arioste. Du reste, le poète ne nous a pas mis dans la confidence de toutes ses espérances. il venait à Rome aussi pour obtenir de Sa Sainteté une bulle contre ces forbans qui, sous le nom de libraires, traitaient les auteurs comme les lansquenets leurs prisonniers. Il achevait en ce moment son Furioso, cette épopée romanesque qui devait donner au monde poétique un second Homère. Le pape embrassa tendrement sur les deux joues l’Arioste, et lui promit une bulle dont il paya la moitié des frais. On conçoit la mauvaise humeur et le serment du poète de ne pas revenir dans une ville où, pour toute récompense, il reçoit sur les joues un baiser pontifical. A-t-il dit toute la vérité ? nous en doutons. Ce n’est point un froid baiser qui nous aurait valu de sitôt ces beaux vers que nous écoutons dans un ravissant silence, mais bien, comme le remarque ici Gabriel Simeoni, les ducats dont le pape fit don à l’auteur pour imprimer le Furioso. Simeoni a raison, et l’Arioste lui-même a reconnu plus tard les bienfaits de Sa Sainteté. Il lui écrivait de Ferrare en 1520 : a Je serais bien ingrat si je n’avouais les services signalés que m’a rendus Votre Béatitude. n En fait de services-, ce sont les dons pécuniaires que prisait l’Arioste, parce que, comme il le dit ailleurs, avant qu’Alphonse l’eût fixé définitivement à Ferrare, il menait une vie fort dissipée. Le Furioso, achevé vers la fin de 1515, parut à Ferrare en 1516, in-4°, chez Mazzocho, qui le premier lit usage en cette ville de caractères grecs. Le poète eut soin de placer en tête de son œuvre la bulle de Léon X, qui punit d’une amende de 300 florins tout imprimeur assez hardi pour reproduire le Furioso sans la permission de l’auteur. On a pu s’étonner avec quelque raison que le chef de l’Eglise prît tant de souci d’un poème où La Fontaine a trouvé le sujet de quelques-uns de ses contes. Il est certain que le Roland de 1515 ne ressemble pas à celui que nous avons si souvent traduit ; il n’avait d’abord que quarante chants ; l’Arioste le lit reparaître en 1532 en quarante-six chants, avec de notables changements. On connaît le mot intraduisible que l’on prête au cardinal d’Este qui venait d’achever la lecture du Furioso : Où diable, seigneur Arioste, avez-vous pris toutes ces extravagances ? Le mot a fait fortune aux dépens du prélat : il est probable qu’il ne s’en est jamais rendu coupable. D’abord, mieux qu’un autre, Hippolyte d’Este, poète et musicien, devait être sensible aux magnificences de toutes sortes, que la muse de l’Arioste a répandues dans son ouvrage. Trente tans s’étaient écoulés depuis l’apparition de l’Orlando innamorato de Bojardo, et trente-quatre depuis celle du Morgante de Pulci. Il connaissait ces deux ouvrages, et on le fait parler comme si les géants, les fées, les paladins, les enchanteurs, venaient d’être trouvés par l’Arioste. C’est une impertinence qu’il n’a pas dite, et d’autant plus invraisemblable que, vaniteux comme il l’était, il devait être flatté des fines louanges que le poète donne à la maison d’Este. Si les archives de cette famille pouvaient un jour se perdre, on les retrouverait dans le Furioso de l’Arioste. A Ferrare, où il venait de se fixer, notre poète avait trouvé la médiocrité, c’est-à-dire le bonheur. Nous le voyons remuer des vers, des pierres et des fleurs. Les vers étaient ceux de son Orlando ; les pierres, celles de la petite maison qu’il se bâtissait, et les fleurs, celles du jardin, un des ornements de l’habitation. On dirait, en lisant son poème, que les vers ne devaient pas plus coûter à l’Arioste qu’à quelques-uns de ses héros les grands coups d’épée qu’ils s’amusent à distribuer. Il n’en est rien pourtant. A cette imagination de fée, l’expression n’arrivait qu’après de longues fatigues de cerveau, que prouvent assez les nombreuses ratures dont son manuscrit est couvert. Il n’est pas de stance qu’il n’ait soumise à la critique éclairée de ses nobles amis de Rome, Bibbiena, Navagero, Sadolet, Bembo. Sa maison était petite, mais propre et reluisante au soleil. On connaît l’inscription latine qu’il avait fait placer sur la façade de l’édifice : Parva,
sed apta mihi, sed nuili obnoxia, sed non Sordida, parva meo sed tamen ære domus. Il en avait été l’architecte, car il ne se mêlait pas seulement de poésie ; il faisait le Vitruve, et présidait à l’œuvre, dont il avait donné le dessin. Comme on s’étonnait que l’artiste qui, dans son poème, avait bâti tant de palais enchantés, se fit une demeure si modeste, il répondit en riant que les vers coûtaient moins cher que la pierre. Cette pierre était à lui au moins ; elle ne devait rien à personne, car il l’avait payée de ses deniers. A côté était un petit jardin qu’il aimait à bouleverser, et auquel il faisait violence comme à sa muse quand elle était rebelle. Son fils nous le représente traitant son parterre comme son poème, défaisant le lendemain ce qu’il avait construit la veille, se regardant comme le père de chaque fleur qu’il avait semée, et dont il ne connaissait souvent pas la racine. Un jour qu’il se penchait pour assister à l’éclosion de câpriers, il fut fort étonné de voir sortir de terre une tige de sureau. VIDA. Un jour Giberti (Jean-Mathieu), l’évêque de Vérone, lisait à Léon X quelques pages du poème des Échecs : De Ludo Scacchiæ. Le pape écoutait attentivement, émerveillé du bonheur d’expression avec lequel l’auteur avait rendu des détails techniques qui semblaient rebelles à l’art du versificateur. Tout à coup, à la vue de ces pions qui se meuvent, parlent, agissent comme les héros de l’Énéide, le pape s’écria qu’il fallait avoir un dieu dans le corps pour animer ainsi une figure taillée dans le bois. Il voulut connaître le nom du thaumaturge, et il apprit qu’il s’appelait Jérôme Vida, chanoine du monastère de San-Pietro del Po, à Crémone, sa ville natale ; que, depuis la mort de Jules II, il habitait Rome, où il cultivait les sciences théologiques ; qu’il était d’une conduite exemplaire, simple dans ses goûts, passionné pour l’étude, et cherchant ses inspirations sous les beaux pins dont les jardins de Martial étaient remplis. Le lendemain Giberti présentait son favori à Léon X. Vida n’ignorait pas qu’il allait trouver dans Sa Sainteté un poète et un amateur d’échecs. Il n’est pas étonnant qu’il tremblât. Riais il se rassura bien vite quand il entendit le pape réciter quelques vers de l’élégie sur la mort de Séraphin Aquilano, début poétique de la muse de Crémone. On causa de poésie pendant quelque temps. Léon X, malgré toutes ses sympathies pour l’antiquité, croyait le moment venu où le poète devait quitter cet Hélicon, vieux de plusieurs mille ans, pour gravir le Golgotha. Il y avait, disait-il, une épopée magnifique enfermée dans la crèche de Bethléem, la Christiade, c’est-à-dire le monde échappant au démon ; l’humanité coupable rentrant en grâce auprès de Dieu et réhabilitée par le sang de Jésus ; la Croix, symbole et instrument de civilisation. Arrière les livres païens ! Il n’y a qu’un livre que le chrétien doive ouvrir pour y chercher des sujets dignes d’un enfant de Dieu. Cette idée grande et majestueuse sourit au poète, qui promit à Léon X une épopée chrétienne, et sur-le-champ se mit à l’œuvre ; œuvre périlleuse, comme il le dit, et qu’il n’aurait jamais entreprise si deux grands papes de la famille des Médicis, Léon X et Clément VII, ne lui eussent, l’un indiqué le sujet, l’autre assigné le terme de son poème. Le pape avait compris qu’au poète biblique il fallait un monde qui ne ressemblât pas à celui de la nome antique, une sorte de Thébaïde où la divinité mythologique ne posât jamais le pied, à l’abri de la poussière et des distractions des grandes cités ; une retraite pleine de beaux arbres, d’eaux écumeuses, de doux silence. II l’eut bien vite trouvée. Le prieuré de Saint-Sylvestre, à Frascati, était vacant : il y nomma Vida, et Vida se mit en route après avoir pris congé, d’abord de Sa Sainteté, puis de Giberti, son protecteur ; puis de Bembo et de Sadolet, qui probablement enviaient son bonheur. Ils avaient raison, car il venait de trouver des arbres touffus, des sources d’eau vive, des cascades, de la mousse, un notus frémissant à travers le feuillage de ces pins qui viennent si bien sous le soleil de Rome. Que pouvait-il désirer de plus ? C’est là, dans ce fortuné séjour, que le poète commença sa Christiade. Quand il était content de sa muse, il prenait le chemin de Rome, allait droit au Vatican, et demandait à parler à Sa Sainteté. En qualité d’humaniste, il avait ses libres entrées au palais pontifical. On assure que lorsque Léon entendit l’invocation du premier chant, il dit tout haut : Cedite
romani scriptores, cedite grati ! Nescio quid majus nascitur Iliade. Distique, du reste, dont on a salué chaque poème épique né depuis Homère, qui restera toujours sans rival. Il ne faut pas prendre à la lettre le compliment de Léon X : comme humaniste, le pape n’était pas infaillible. Sans doute il y a dans l’œuvre de Vida de grandes beautés, et des beautés diverses de style, de pensées, d’idées ; mais, à tout prendre, l’eût-il écrit dans la langue italienne ; avec cette pureté de diction que possédaient Berni, l’Arioste, Bembo, nous doutons qu’il eût détaché un seul diamant de la couronne d’Homère. Toutefois il ne faut pas oublier que le Tasse a copié presque textuellement de Vida la peinture de l’assemblée des démons, qui ouvre le quatrième chant de la Jérusalem délivrée, et la harangue de Pluton. C’est la plus belle, louange qu’on puisse faire du talent de Vida. Ailleurs, il emprunte à l’un des hymnes du prieur une délicieuse comparaison, ou plutôt un véritable tableau : le vase enduit de miel que le médecin présente aux lèvres du malade. La grande image du Pandémonion, que Milton avait tirée du Tasse, appartient à Vida ; on connaît cette strophe de la Jérusalem : Chiama
gli abitator den’ ombre eterne. Vous allez en retrouver l’expression dans le poème de la Christiade : ..... Ecce igitur dedit ingens buccina signum Quo
subito intomit cæcis domus alta cavernis Undique opaca, ingens ; antra intonuere profunda, Atque procut gravido tremefacta est corpore tellus. Ce que personne n’aurait pu dérober à Vida, c’est son inaltérable douceur de caractère, sa piété sans faste, son amour pour son vieux père, sa reconnaissance pour Giberti son protecteur, son culte pour Léon X. Au milieu de toutes les séductions de la nature qui l’enchaînèrent plus tard à Frascati, il aimait en imagination à revoir les lieux de sa naissance, à baiser au front sa mère, à presser sur son cœur les blancs cheveux de son père. Il a peint en vers touchants les angoisses d’un fils à leurs derniers instants. Le poète paraît dans cette scène suprême au moment où, comme l’oiseau voyageur, il rentre dans le nid paternel pour jouir de la surprise de ses parents, leur montrer les marques de dignités que lui conféra son souverain, leur crier : Me voici ! et tomber dans leurs bras. Les souvenirs de piété filiale reviennent souvent dans les récits de Vida, et portent véritablement bonheur au poète, qui possédait une qualité assez rare chez les écrivains de sa nation, la mélancolie. Quand il aimait, c’était de toute la force de son âme. Un jour Giberti venait de quitter Rome pour aller au loin remplir des missions dont le pape Clément VII l’avait honoré. Ce fut un coup terrible pour le cœur de notre poète, qui ne put dire adieu à son noble ami ; les sanglots l’étouffaient. Après les larmes viennent les vers, et ils sont attendrissants. Reviens, dit Vida, reviens bien vite ; peut-être que lorsque tu seras de retour j’aurai dépouillé ilion enveloppe mortelle ; mais je ne te quitterai pas : mon âme t’accompagnera sur les montagnes de neige et sur les pics de glace. Si, dans ta patrie, ma tombe s’offre à tes regards, donne à mon ombre un souvenir ; car je ne te demande pas des larmes, ce serait trop de vanité ! Tu diras : J’aimais jadis cette poussière ; et la terre me sera légère, et je dormirai en paix dans la mort. Vida eut un jour une tentation belliqueuse. Léon X encourageait les princes chrétiens à se liguer contre les Turcs. Le poète rêvait déjà la chute du Croissant, et, dans sa joie, il voulait s’associer à ce triomphe des armes chrétiennes. Oui, disait-il à Léon X, j’irai où m’appelleront Bellone et Mars ; de mon glaive flamboyant j’enfoncerai les escadrons ennemis. — J’ai du cœur, du sang, de l’audace, du sang-froid : le barbare tombera sous mes coups. Vida se rappelait qu’il avait étudié à l’école de Jules II, nommé par Clément VII évêque d’Albe, dans le Montferrat, un jour, du haut des tours de son église, il voit venir les Français, qui se jettent en furieux sur la ville, emportent le rempart, surprennent les Impériaux qui fuient de toutes parts. L’évêque n’a pas peur ; il avait fait ses campagnes dans son poème des Échecs. Il réunit les habitants, les harangue, fait sonner la charge, repousse les Français et délivre la cité. Mais bientôt la famine se fait sentir dans Albe, qui manque de pain ; l’évêque vend jusqu’à son dernier vêtement pour en procurer aux malheureux ; et, de peur que le fléau ne vienne de nouveau affliger la ville, il sème des fèves dans les champs voisins et jusque dans le jardin de l’évêché, et s’adressant à la terre : O terre bienfaisante ! dit-il, garde-toi de tromper la semence que ma main te confie. Du haut de mon palais, je promènerai bientôt les yeux sur la plaine, et mon cœur battra de joie à la vue des malheureux, dont l’un cueillera, l’autre mangera, un autre encore emportera sur ses épaules ces vertes dépouilles. Les fèves prospérèrent : au printemps suivant, le champ désolé était couvert de milliers de petites fleurs blanches, gage assuré d’une abondante moisson, et le bon évêque bénissait la Providence : il était sûr que ses pauvres ne mourraient pas de faim. A midi la cloche du palais sonnait, et l’on voyait arriver les commensaux ordinaires de l’évêque, des indigents auxquels il distribuait la nourriture quotidienne, puis il se mettait à table. Il ne mangeait qu’une fois par jour, et jamais de viande ni de poisson. Il avait écrit au-dessus de sa salle à manger : Etranger, si tu n’as pas peur d’un plat de légumes, viens, assieds-toi près de moi. L’étranger n’acceptait pas l’invitation. SANNAZAR.
Naples venait de tomber dans les mains des Français, et le monarque, abandonné de ses sujets, était réduit à conclure avec d’Aubigny un traité en vertu duquel il put se retirer dans l’île d’Ischia. Le cœur se serre en voyant si lâchement trahi un prince comme Frédéric, qui s’appliqua pendant son règne à faire fleurir les arts, à protéger les lettres, à soulager l’indigence, à rendre bonne justice à ses sujets. Qu’avait-il fait pour mériter une si noire ingratitude ? L’histoire en a vainement cherché les motifs. La devise de Frédéric était : Oubli du passé : Recedant vetera ; et il avait bien souvent pardonné. Dégoûté de la royauté, il voulut la quitter comme il l’avait prise, sans peur et sans reproche. Il aurait pu continuer une lutte où le courage ne lui aurait pas fait défaut ; il préféra le repos au trône. Aluni d’un sauf-conduit de Louis XII, il quitta les rochers d’Ischia, et fit voile pour la France, où, sous le nom de duc d’Anjou, il devait recevoir un tribut annuel de 30,000 ducats. Que les flots et les vents soient propices au vaisseau qui porte le dernier rejeton de cette maison d’Aragon, à laquelle Naples dut pendant tant d’années ses splendeurs ! Si vous jetez les yeux sur le pont du bâtiment, vous apercevrez d’abord le prince que Giannone regarde comme le restaurateur des lettres antiques, gloire qu’il partage avec Ferdinand son père ; puis quelques rares domestiques fidèles au malheur, car Frédéric a laissé sa famille à Ischia ; et, près de l’exilé, un poète qui a vendu deux belles terres patrimoniales pour subvenir aux besoins de son maître : c’est Sannazar (Jacopo Sannazzaro) qui s’exile avec celui qu’on nommait hier Frédéric d’Aragon, et qui salue Naples en beaux vers : Parthénope mes amours, douce sirène, adieu ; jardins enchantés, demeure des Hespérides, adieu ; adieu Mergellina, n’oublie pas Sannazar, et reçois cette guirlande, tribut des regrets d’un maître qui n’a rien autre à te donner. Salut, ombre de ma mère ! salut, ombre de mon père ! acceptez l’hommage de mon encens. Vierge de Fornello, ne taris pas pour moi ton fleuve favori, et que le sommeil me rende l’image et la fraîcheur de tes eaux absentes ; qu’il accorde à mon corps fatigué de chaudes ombres et un doux zéphyr ; que les autres fleuves répètent ton agréable murmure, car je pars pour l’exil, exilé volontaire. Qu’étaient devenus ces jours heureux où le poète, pour amuser Ferdinand et son fils Frédéric, improvisait dans la langue des lazzaroni de petits drames à l’imitation de ceux que joue Polichinelle dans les baraques de la place du Largo di Castello ! Des palais des princes ils passaient bien vite dans la rue, où le peuple s’amassait pour les entendre. Les historiens de cette époque ne parlent qu’avec transport d’une farsa qu’il composa à l’occasion de la conquête de Grenade, et qui fut jouée en 1492, en présence d’Alphonse, duc de Calabre, au château Capuano. C’est une étude curieuse que celle de cette farsa, où l’on trouve en germe la comédie italienne, dont Bibbiena, dans sa Calandra, peut passer pour le créateur. En plus d’un passage, on reconnaît le malheureux penchant de Sannazar pour la satire. Il traite Mahomet, un des héros de la pièce, comme il traita plus tard Politien. Frédéric avait choisi pour exil la ville de Tours : il y resta jusqu’en 1503, époque de sa mort. De ce petit nombre de serviteurs montés avec leur prince sur le vaisseau napolitain, un seul fut jusqu’à la fin fidèle au malheur. Ce fut encore notre poète, qui, après avoir fermé les yeux de son maître, quitta Tours et prit le chemin de l’Italie, emportant avec lui divers manuscrits d’Ovide, de Gratius, d’Olympius Némésien, de Rutilius Numantianus, de Martial, d’Ausone, de Solinus. Il retrouva sa belle Parthénope, et sa Mergellina (Mergoglino) assise sur la colline du Pausilippe, et cette petite source dont il aimait à entendre le murmure, et où le pêcheur venait si souvent autrefois se désaltérer. Le vainqueur avait respecté la maison du proscrit. Ce fut un jour de fête pour Naples et les membres de l’Académie de Pontano, que celui où Sannazar leur fut rendu. On vit arriver pour embrasser l’exilé : Jérôme Carbone, Thomas Fusco, Rutilio Zenone, le duc Antoine Carbone, Cariteo, André Matheo, Pierre Summonte. L’Arcadie, qu’il commença fort jeune et termina en France, parut à Naples en 1504, un an après le retour de l’auteur dans sa patrie. C’est un roman mêlé de prose et de vers, ainsi que l’Ameto de Boccace et les Asolani de Bembo, et où Sannazar emploie fort heureusement le vers que les Italiens appellent sdrucciolo ; il fit une vive sensation en Italie. Florence, qui n’aimait rien de ce qui venait de Naples, applaudit néanmoins à l’heureuse pureté de style dont Sannazar avait fait preuve dans son poème. D’habiles connaisseurs, entre autres Tiraboschi, disent qu’après trois siècles l’Arcadie est restée comme une des belles inspirations de la muse italienne. Le vers de Sannazar est harmonieux, souple, gracieux, trop élégant peut-être. Le naturel n’est pas la qualité du poète. Sannazar aime à briller, et ses bergers ressemblent un peu à ceux de Fontenelle. Aux époques de renaissance littéraire, l’écrivain fuit la simplicité avec le même soin qu’il aurait mis en d’autres temps à la chercher. Sannazar imite beaucoup plus qu’il ne crée, et plus l’imitation est apparente, plus il croit au succès. Il est heureux quand on le compare à quelqu’une des gloires des âges primitifs de la littérature il faut qu’il descende de Virgile au moins. Le plus grand reproche qu’on parut adresser à l’Arioste, c’est que sa poétique ne se trouvait pas dans Aristote ; que ses héros ne ressemblaient pas à ceux d’Homère, et que ses mondes étaient inconnus des anciens. A ce Christophe Colomb de l’épopée romanesque on faisait un crime des terres nouvelles qu’il avait découvertes. Il faut reconnaître que Sannazar a cherché sincèrement, sinon dans l’expression, du moins dans la fable, à donner une physionomie nouvelle à l’églogue. Dans Virgile, c’est un drame pastoral qui, d’ordinaire, a pour horizon l’ombre de ces beaux pins qui, depuis dix-huit siècles, élèvent leur parasol de verdure dans les campagnes de Rome. Avant Sannazar, d’autres s’étaient essayés dans la poésie bucolique, particulièrement Benivieni, chanoine de Florence, qui fit de ses bergers de véritables platoniciens. Sannazar, comme le remarque l’Arioste, imagina d’enlever les Muses à leur montagne et de leur donner pour habitation le sable de la mer. L’idée est peut-être neuve, mais n’est pas heureuse. D’abord, le poète a rétréci le cadre de ses drames ; la mer même, avec son espace immense, ne saurait fournir cette variété inépuisable d’images que donne le spectacle de la vie du pasteur, au milieu des vallons, des montagnes et des forêts. Ensuite, le pêcheur, qu’il emploie comme acteur, est un être que beaucoup de ses lecteurs n’ont pu voir et qui ne doit intéresser que médiocrement. Chacun de nous peut vérifier l’exactitude des peintures de Virgile et de Théocrite : vienne le printemps, les champs sont à nos portes. Mais le héros de Sannazar, qui donc ira le chercher sur la mer ? Toutefois il y a des effets ravissants dans ces coups de filet lancés au soleil couchant, sur des flots rougeâtres ; dans cette petite barque qui s’avance orgueilleusement vers le rivage avec sa pêche miraculeuse ; dans cette vie du batelier au bruit des orages. Sannazar les a rendus souvent en peintre et en poète. Scaliger ne l’a peut-être pas flatté en le plaçant immédiatement après Virgile. C’est, dit-on, après l’un de ces repas littéraires qu’il avait institués pour célébrer la fête de Virgile, et si bien décrits par Alessandro d’Alessandri, que Sannazar vint écouter Égidius de Viterbe, que Léon X devait décorer de la pourpre romaine. L’orateur prêchait, ce jour-là, sur la Vierge ; Sannazar, en l’entendant, conçut l’idée, dit-on, de son poème en l’honneur de Marie. Quelques fragments de cette épopée, lus à Rome, avaient donné une grande idée des talents de l’écrivain. On savait que Sannazar n’avait pas toujours pris ses sujets dans le monde qu’habite la mère de Dieu ; que plus d’une fois il s’était mis en scène, même dans son Arcadie, avec de terrestres beautés dont il avait trop vivement célébré les charmes. A Rome donc, on fut heureux d’apprendre que Sannazar cherchait à faire oublier des folies de jeune homme, par trop poétiques, en chantant, à la manière de Vida, les mystères de la foi chrétienne. L’intention était louable, et les encouragements du saint-siège ne pouvaient manquer au poète. Léon X, au moment où la voix d’un moine venait de troubler l’Église, était heureux que le dogme catholique trouvât un défenseur parmi les humanistes séculiers, et, comme il le dit, un David, pour frapper au front un nouveau Goliath, et pour apaiser de sa sainte lyre les fureurs d’un autre Saül. il est manifeste que le pape cherchait à encourager toute pensée religieuse, qu’elle se traduisit en vers, comme chez Vida ou Sannazar ; en prose, comme chez Sadolet ; en cou-leur, comme chez Raphaël d’Urbin ; en marbre, comme chez Sangallo ; en airain, comme chez Sansovino. C’est le poète théologien qu’il protége dans Sannazar, qui doit venir au secours de l’Église menacée par un moine allemand. A cet athlète de la foi il promet son amour et l’affection du saint-siège. Nous pensons avec Érasme que le poète eût mérité plus de louanges encore, s’il avait sacrifié moins souvent au paganisme dans un sujet tout chrétien. Qui pourrait pardonner, quand il s’agit de mystères tels que ceux qu’il célèbre, aux vers sibyllins que Marie porte dans ses mains ; à ces Néréides qui forment le cortége du Christ ; à Protée racontant les merveilles de la Rédemption ? Niais peut-être Sannazar avait-il le droit de se servir des divinités du paganisme pour chanter le triomphe du christianisme, au moment où les dieux du vieux monde étaient mis en fuite par un morceau de bois, taché, il est vrai, du sang de Jésus. C’est l’ingénieuse réflexion de l’un des biographes du Napolitain. Nous reconnaissons avec Flor. Sabinus que Sannazar est toujours resté chaste, quoiqu’il ait abordé avec hardiesse tous les détails du mystère de l’enfantement de Marie ; nous. comprenons que cette langue latine qu’il parle si purement ait pu séduire l’oreille d’un pape, et qu’Égidius de Viterbe, cet esprit si religieux, ait écrit à l’auteur : Lorsque je reçus votre divin poème, je voulus connaître tout de suite cette merveilleuse création. Dieu seul, dont le souffle l’inspira, peut vous récompenser dignement, non pas en vous donnant les Champs Élysées, fabuleuses retraites des Linus et des Orphée, mais la bienheureuse éternité. Avant que le souhait du bon Égidius s’accomplît, Dieu réservait au chantre de Marie de cruelles épreuves. Cette demeure aérienne pendante comme un nid d’oiseau sur les flancs du Pausilippe, et qu’avaient respectée les Français lors de l’invasion de Naples, fut saccagée plus tard par les Impériaux. Sannazar supporta ce malheur en véritable chrétien ; il refit sa demeure. La belle urne où, à l’imitation des anciens, il s’amusait à déposer un caillots blanc ou noir, suivant que le ciel avait fait pour lui le jour heureux ou néfaste, fut remplacée par une petite chapelle dédiée à la Vierge, et où, plus tard, Ange Poggibonsi érigea au poète un magnifique mausolée sur lequel Bembo écrivit ces deux vers : Da
sacro cineri flores ; hic ille Maroni Sincerus musâ proximus ut tumulo. Ne troublons pas les cendres du chantre de l’Arcadie en lui reprochant une épigramme contre Léon X, qu’on aura glissée furtivement, dit Fontanini, avec quelques autres peut-être, dans les œuvres du poète. Le courtisan, jusqu’à la mort, d’un roi déchu, n’a pu calomnier Léon X, son protecteur. MARC-ANTOINE FLAMINIO. A Seravalle vivait un professeur de belles-lettres distingué, Jean-Antoine Zarrabini, qui se faisait nommer Flaminio depuis qu’il avait été reçu membre de l’Académie de Venise. Pendant la guerre qui désola l’Italie, après le traité de Cambrai, Jean-Antoine fut dépouillé de ses propriétés et chassé de sa patrie. Le cardinal Riario vint au secours de l’humaniste, en ouvrant sa bourse au proscrit. Jules II fit mieux : il lui rendit Seravalle. Or Flaminio avait un fils, Marc-Antoine, auquel il dit un jour : Pars, mon enfant, non pas pour une ville obscure, mais pour Rome ; va trouver, non pas un pontife ordinaire, mais Léon X, le prince le plus éclairé du monde, et porte-lui ce poème, que je viens d’écrire pour exhorter Sa Sainteté à faire la guerre aux Turcs ; porte-lui nos sylves, que j’ai dédiées au cardinal de Sainte-Marie in Viâ Latâ. Et le jeune homme partit. Supposez que l’enfant, il n’avait que seize ans, se fût présenté au palais de l’empereur d’Allemagne, du roi de France, du roi de la Grande-Bretagne, de Sa Grâce l’électeur de Saxe ; il est probable que la garde lui en eût défendu l’entrée. Mais le pape, c’est-à-dire le plus grand monarque de l’époque, ne ressemble pas aux autres souverains. Le Vatican s’ouvrit donc à Marc-Antoine Flaminio, qui se mit à lire, en présence d’un grand nombre de cardinaux, le dithyrambe contre les Turcs. Le pape voulait garder l’enfant, dont il se proposait de confier l’éducation à des maîtres habiles ; mais on ne put vaincre l’obstination du père. Marc-Antoine, rappelé, fut obligé de quitter Rome ; mais il y revint bientôt, et cette fois avec un bagage poétique tout personnel. Le pape était alors à sa villa Magliana, où Flaminio lui fut présenté de nouveau : Nous nous reverrons à Rome, mon ami, dit Sa Sainteté à l’écolier. Léon X voulait jouer le rôle de précepteur, et s’assurer si Flaminio comprenait les vers aussi bien qu’il les lisait. L’épreuve eut lieu, et Flaminio s’en tira glorieusement. II répondit aux questions de Sa Sainteté avec une présence d’esprit, une sûreté de goût, un choix d’expressions qui ravirent l’assemblée. Le pape, puisant à pleines mains des ducats d’or dans cette bourse qu’il portait toujours à ses côtés, s’écria : Macte novâ virtute puer, sic itur ad astra. Tu seras un jour, ajouta-t-il, non seulement la gloire de ton père, mais l’ornement de l’Italie ! Cette fois le père n’y put plus tenir : il céda son fils à Léon X, qui lui donna pour maître Raphaël Brandolini. A partir de ce moment, chaque jour se vérifie de plus en plus la prophétie du pape : l’enfant croît en sagesse et en talent ; il a pour amis, encore plus que pour protecteurs, le comte Balthasar Castiglione, le seigneur le plus accompli de son siècle ; Jean-Mathieu Giberti, évêque de Vérone, qu’on est sûr de trouver toutes les fois qu’une jeune muse a besoin de guide ; Sannazar, le chantre de la Vierge ; Fracastor, peut-être le premier latiniste du siècle. A dix-huit ans il publiait des poésies, qu’il mettait sous la protection et sous le patronage d’un nom cher aux Muses, Michel Marulli. Le pape voulait fixer à Rome ce jeune homme dont il avait prédit les succès, et qui relevait un véritable talent par des mœurs virginales. Marc-Antoine aurait aidé Sadolet dans ses fonctions de secrétaire de Sa Sainteté, poste brillant qu’aurait envié Sannazar lui-même, et que notre poète refusa pour ne pas désobéir à son père. Après la mort de .Jean-Antoine, il ne put plus résister aux instances des cardinaux, qui voulaient s’attacher le poète qu’aimait Léon X. Contarini le choisit pour l’accompagner à Worms, au fameux congrès religieux qui se tint dans cette ville en 1540, et où Flaminio se serait trouvé à côté de Mélanchthon et de Calvin ; mais il souffrait de cette maladie de poitrine que l’air tiède de Naples avait une fois guérie. Plus tard, nous le trouvons à Trente en compagnie du cardinal Réginald, et toujours le même, cachant sa vie, aimant l’ombre et la solitude, et refusant la place de secrétaire du concile qu’on lui offre à plusieurs reprises. Ange aux mœurs d’or, a dit Tiraboschi, que le protestantisme jaloux voudrait, mais en vain, nous disputer, car il nous appartient à tous les titres, par sa soumission filiale surtout à l’Église sa sainte mère. N’en croyons pas M. Sismondi : la mélancolie, chez les Italiens, n’est pas toute dans l’imagination ; Flaminio était bien poète par le cœur. Nul, parmi les écrivains de la renaissance, n’a su comme lui peindre les peines de l’âme. Il a des traits de mélancolie que Goëthe ne désavouerait pas, comme dans ce petit tableau où il montre son cœur consumé par la douleur, ainsi que l’olivier par le feu. Et peut-être ne trouverait-on pas dans l’œuvre du maître hollandais le plus fini deux têtes d’une grâce aussi ravissante que celles de ces deux jeunes filles, l’une qui sourit et l’autre qui pleure, peintes par Flaminio. |
 Nous revenons toujours à Savonarole ; Savonarole est plus
qu’un moine, c’est une idée. Comme il se plaignait éloquemment en chaire de
ce matérialisme païen qui s’était introduit à Florence jusque dans la poésie,
cette langue angélique qui, pour parler au chrétien, n’aurait dû, disait-il,
employer jamais que des images chrétiennes ! Le zèle emportait le
prédicateur, qui malheureusement ne comprit pas que le sensualisme qu’il
déplorait était une fatalité à laquelle l’art ne pouvait échapper. Si l’art
n’existait réellement que dans le inonde païen, c’était là seulement qu’on
pouvait aller le surprendre. Voyez ce qui se passe ! L’intelligence qui veut
connaître les phénomènes de la pensée, l’analyse des opérations de
l’entendement, vient attendre sur les bords du Lido l’une de ces barques qui
conduisent chaque jours Venise quelque Hellène fugitif : à l’un de ces Grecs
chassés violemment de Constantinople, elle emprunte Platon, à l’autre
Aristote, les deux grandes divinités de l’imagination et de la raison. Pour
étudier l’histoire, elle n’a que Tacite, Tite-Live, Xénophon, Thucydide ;
pour comprendre les miracles antiques de la parole sur la multitude, il faut
qu’elle s’attache à Démosthène, à Cicéron ; veut-elle chanter en vers,
Virgile, Homère, Horace, Ovide, doivent l’inspirer ; a-t-elle envie de jouer
sur la scène quelques-uns des ridicules de la société, il faut qu’elle lise
Aristophane, Plaute ou Térence ; comme le frère de Saint-Marc, est-elle
chargée de donner une constitution au peuple florentin, tout d’abord on lui
demandera si elle connaît la législation romaine ; à l’imitation de Pontano,
essaye-t-elle de mettre en dialogue les sottises des lettrés, de toute
nécessité il faut qu’elle aille à l’école de Lucien.
Nous revenons toujours à Savonarole ; Savonarole est plus
qu’un moine, c’est une idée. Comme il se plaignait éloquemment en chaire de
ce matérialisme païen qui s’était introduit à Florence jusque dans la poésie,
cette langue angélique qui, pour parler au chrétien, n’aurait dû, disait-il,
employer jamais que des images chrétiennes ! Le zèle emportait le
prédicateur, qui malheureusement ne comprit pas que le sensualisme qu’il
déplorait était une fatalité à laquelle l’art ne pouvait échapper. Si l’art
n’existait réellement que dans le inonde païen, c’était là seulement qu’on
pouvait aller le surprendre. Voyez ce qui se passe ! L’intelligence qui veut
connaître les phénomènes de la pensée, l’analyse des opérations de
l’entendement, vient attendre sur les bords du Lido l’une de ces barques qui
conduisent chaque jours Venise quelque Hellène fugitif : à l’un de ces Grecs
chassés violemment de Constantinople, elle emprunte Platon, à l’autre
Aristote, les deux grandes divinités de l’imagination et de la raison. Pour
étudier l’histoire, elle n’a que Tacite, Tite-Live, Xénophon, Thucydide ;
pour comprendre les miracles antiques de la parole sur la multitude, il faut
qu’elle s’attache à Démosthène, à Cicéron ; veut-elle chanter en vers,
Virgile, Homère, Horace, Ovide, doivent l’inspirer ; a-t-elle envie de jouer
sur la scène quelques-uns des ridicules de la société, il faut qu’elle lise
Aristophane, Plaute ou Térence ; comme le frère de Saint-Marc, est-elle
chargée de donner une constitution au peuple florentin, tout d’abord on lui
demandera si elle connaît la législation romaine ; à l’imitation de Pontano,
essaye-t-elle de mettre en dialogue les sottises des lettrés, de toute
nécessité il faut qu’elle aille à l’école de Lucien. En 1501, toute une famille de princes se trouvait réunie
sur le rocher d’Ischia : c’était Frédéric d’Aragon, roi de Naples,
qu’Alexandre VI venait de priver de ses États, qu’il partageait entre les
rois de France et d’Espagne ; la reine Isabelle sa femme, et ses nombreux
enfants ; la sœur de ce prince, veuve de Mathias Corvin, roi de Hongrie, et
sa nièce isabelle, veuve de Jean Galéas, duc de Milan.
En 1501, toute une famille de princes se trouvait réunie
sur le rocher d’Ischia : c’était Frédéric d’Aragon, roi de Naples,
qu’Alexandre VI venait de priver de ses États, qu’il partageait entre les
rois de France et d’Espagne ; la reine Isabelle sa femme, et ses nombreux
enfants ; la sœur de ce prince, veuve de Mathias Corvin, roi de Hongrie, et
sa nièce isabelle, veuve de Jean Galéas, duc de Milan.