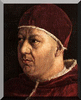HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXX. — L’HISTOIRE.
|
État de Florence à la
mort de Julien de Médicis. - Léon X consulte Machiavel sur la forme de
gouvernement à introduire à Florence. - Plan donné par le publiciste. - Léon
X refuse de l’accepter, parce qu’il anéantirait les libertés de la cité. -
Vie intérieure de Machiavel. - A quelles conditions il offre de rentrer au
service des Médicis. - Son livre du Prince. - Machiavel historien. - Paul
Jove entreprend d’écrire l’histoire générale de son époque. - Il fait le
voyage de Rome pour lire quelques fragments de son ouvrage à Léon X. -
Encouragements qu’il reçoit de Sa Sainteté. - Ce qu’il faut penser de la
vénalité de Paul Jove. - L’historien dans sa villa du lac de Côme. -
Guichardin a un véritable avantage sur ses rivaux pour écrire l’histoire. -
Il est nommé avocat consistorial par Léon X. - Il veut brûler son histoire au
moment de mourir. - Ses préjugés contre la cour de Rome. - Belles qualités de
son livre. MACHIAVEL.
A la mort de ce prince, Florence se trouva dans une périlleuse situation. Un moment on craignit que le parti des Frateschi ne se réveillât, et que l’autorité de la maison de Médicis ne fût ébranlée et peut-être anéantie. On conseillait à Léon X de s’emparer du pouvoir, d’imiter Jules Il, et de réunir la Toscane aux Etats de l’Eglise. Un délégué du pape aurait, en qualité de légat, gouverné Florence. Des esprits plus généreux voulaient qu’il rendît à la république ses vieilles institutions populaires. L’un et l’autre de ces avis étaient dangereux. En confisquant la Toscane au profit du saint-siège, Léon X se brouillait avec la France, avec Venise, avec Naples et l’Empire, qui n’auraient pas souffert une semblable usurpation. A Florence, du reste, le poignard de Boscoli n’était pas perdu, mais seulement égaré. Comment restituer à la république ces antiques privilèges dont elle avait fait toujours un si funeste usage ? Une ville comme Florence, où chaque riche citoyen, sous les yeux mêmes du peuple, élève impunément des palais qui ressemblent à des forteresses, n’est pas faite pour être libre. Jetez les yeux sur ces masses de pierres, qu’on dirait élevées les unes sur les autres par quelque Titan ; vous reconnaîtrez la ville des nobles, la ville de la force individuelle, la ville de l’homme bardé de fer, mais jamais la ville de la liberté, qui ne se cache pas derrière des pierres. Entre ces murailles épaisses vous trouverez des bourgeois des sept arts majeurs, des juges et des notaires, des marchands de drapà*rangers, des changeurs ou banquiers, des fabricants d’étoffe de laine, des médecins et des épiciers droguistes, des fabricants de soieries et des merciers, des fourreurs et des pelletiers, qui sont arrivés à la fortune, de la fortune au pouvoir, mais pas un véritable républicain. A Florence, remarque ici un publiciste distingué, le caractère fondamental de la liberté est l’élection ; et pourvu que les habitants de la cité aient le droit d’élire les magistrats, et la faculté de par-venir, à leur tour, aux magistratures, ils ne s’embarrassent guère de tracer des limites à un pouvoir qu’eux-mêmes, d’un jour à l’autre, peuvent être appelés à exercer. Après la conspiration de Boscoli, Machiavel, rentré dans la vie civile, et négligé par les Médicis de Florence, s’occupait, dans son habitation de la Strada, près de Casciano, de son traité du Prince, et des Discours sur Tite-Live qui ne devaient voir le jour qu’après sa mort. Léon X savait que Machiavel, au camp, en ambassade, dans ses voyages, à Florence, partout où le sort l’avait conduit, s’appliquait à étudier les formes diverses des gouvernements, les mœurs des peuples, le génie des époques, comparant les institutions anciennes aux institutions modernes, cherchant les causes diverses de l’agrandissement et de la chute des vieilles et des nouvelles dynasties, et la raison apparente ou mystérieuse de la conduite de tout ce qui, sous le nom de pape, d’empereur, de roi, de duc, de capitaine, occupait la scène, en Italie, depuis l’expédition de Charles VIII. Il savait que Machiavel avait eu pour ami, pour confident, pour protecteur, Savonarole, César Borgia, Jules II. Plus d’une fois, comme nous l’avons vu, il avait eu recours à Vettori, l’ambassadeur de Florence, pour obtenir du secrétaire de Soderini des renseignements sur la conduite que le saint-siège devait tenir en quelques circonstances difficiles. L’ambassadeur, ami de Machiavel, ne dissimulait pas : il disait, avec toute la franchise permise à un diplomate, celui qui demandait les renseignements ; Machiavel savait fort bien le nom du personnage caché derrière Vettori. Or Léon X, en cette occasion, s’était servi du diplomate pour consulter le publiciste sur la forme de gouvernement à introduire à Florence. Machiavel dut, selon nous, être plus étonné de la confidence du pape que du pardon même qu’il en avait obtenu. C’est la première fois qu’un prince demande des conseils politiques à celui qui voulait le chasser, et le tuer peut-être. Avant de connaître la réponse de Machiavel, nous en faisons une mentalement. Il nous semblait que le complice de Boscoli devait dire à Sa Sainteté : Très saint-père, Florence veut être libre, rendez-lui le gouvernement dont elle jouissait quand les marchandises du monde commerçant s’entassaient dans les boutiques de la rue Callimala ; qu’elle n’ait d’autres maîtres que les maîtres de l’art de la laine ; affranchissez-la, et votre nom sera béni. C’est été le langage d’un républicain : Machiavel ne le tint pas. Il est probable que Léon X connaissait l’ancien secrétaire de Florence, homme de plaisir, amoureux de la table, où il restait beaucoup plus de temps qu’il ne convient à un Spartiate ; impatient de cet état d’obscurité et de gêne où il était obligé de vivre, et disposé à faire le sacrifice de principes politiques qui l’empêchaient de rentrer dans l’administration du pays. Il est certain que Sa Sainteté connaissait la correspondance de Vettori avec Machiavel. Une lettre de l’ancien secrétaire de la république avait dû la frapper vivement : c’est celle où l’écrivain, en retraçant quelques scènes de cette vie toute champêtre qu’il mène forcément à sa villa de la Strada, fait une profession de foi politique qui devait tôt ou tard amener une réconciliation entre les Médicis et le confident ou, si l’on veut, le complice de Boscoli. Qu’on nous permette d’en citer quelques fragments. C’est dans ces pages qu’un hasard providentiel livre au grand jour, pour le malheur du cœur humain, qu’il faut étudier Machiavel ; là se trouve le meilleur commentaire qu’on ait fait de son traité du Prince. J’habite ma villa, et depuis mes derniers malheurs je ne suis pas allé vingt fois à Florence.... Jusqu’à ce moment, je m’étais amusé à dresser des piéges aux grives ; je me levais avant le jour, je tendais des gluaux, et j’allais avec un paquet de cages sur le dos, ressemblant à Gito lorsqu’il revient du port chargé des vivres d’Amphitryon. Le moins que je prenais de grives était deux, le plus sept. C’est ainsi que j’ai passé tout le mois de septembre.... Maintenant, voici la vie que je mène : je me lève avec le soleil ; je vais dans un de mes bois que je fais couper, j’y demeure deux heures à examiner l’ouvrage qu’on a fait la veille, et à m’entretenir avec les bûcherons, qui ont toujours à se plaindre de quelque malheur arrivé à eux ou à leurs voisins.... Lorsque je quitte le bois, je me rends auprès d’une fontaine, et de là à mes gluaux, avec un livre sur moi, soit Dante, soit Pétrarque, soit un des petits poètes tels que Tibulle, Ovide, Catulle. Je lis leurs plaintes passionnées et leurs transports amoureux, et je me rappelle les miens, et je jouis un moment de ce doux souvenir. Je m’en vais ensuite à l’hôtellerie qui se trouve sur le grand chemin ; je cause avec les passants, je leur demande des nouvelles de leur pays, j’apprends un grand nombre de choses, et je remarque la diversité qui existe entre les goûts et les esprits de la plupart des hommes. Sur ces entrefaites arrive l’heure du dîner ; je mange avec ma famille le peu de mets que nie fournissent ma pauvre petite villa et mon chétif patrimoine. Le repas fini, je retourne à l’hôtellerie ; j’y trouve ordinairement l’hôte, ainsi qu’un bouclier, un meunier et deux charbonniers. Je m’encanaille avec eux le reste de la journée, jouant au cricca, au cric-crac. Il s’élève mille disputes ; à mille emportements se joignent des injures, et, le plus souvent, c’est pour un liard que nous nous échauffons et que le bruit de nos querelles se fait entendre jusqu’à Casciano. Le soir venu, je m’en retourne au
logis et j’entre dans mon cabinet. Je me dépouille, dès la porte, de ces
habits de paysan souillés de poussière et de boue ; je me revêts d’habits de
cour ou de mon costume, et, habillé d’une manière convenable, je pénètre dans
l’antique sanctuaire des grands hommes des temps passés.... Je m’entretiens avec eux ; je leur demande compte de leurs
actions ; ils me répondent, et pendant quatre heures j’échappe ainsi à
l’ennui, aux chagrins, à la pauvreté. Et comme Dante a dit : Il n’y a point
de science si l’on ne retient ce que l’on a entendu, j’ai noté tout ce qui
dans leurs conversations m’a paru de quelque importance, et j’en ai composé
un opuscule de Principalibus, où je plonge autant que je puis dans les
profondeurs de mon sujet, recherchant quelle est l’essence des pouvoirs, de
combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les
maintient et comment on les perd. Mes services doivent convenir à un prince,
et surtout à un prince nouveau ; voilà pourquoi je veux dédier mon livre à la
magnificence de Julien. Je me consume et ne puis rester plus longtemps dans la même position sans que la pauvreté nie rende l’objet de tous les mépris. Je voudrais que les seigneurs de Médicis commençassent à m’employer, dussent-ils d’abord ne me faire retourner que des pierres... Chacun devrait tenir à se servir d’un homme qui a déjà acquis aux dépens des autres l’expérience qu’il possède. On ne devrait pas non plus douter de ma fidélité.... (M. Périès.) Voilà l’homme qui, hier, armé du poignard de Brutus, en menaçait les oppresseurs de sa belle Florence. Il ne peut plus vivre dans l’obscurité ; la pauvreté lui pèse comme un insupportable fardeau. A tout prix, il faut qu’il rentre en grâce à la cour de ses tyrans. Ce qu’il leur demande, c’est un emploi dans la république, une place à leurs festins, un rang dans leur cortége, et, s’ils jugent tout cela trop beau, une pierre de leur palais à rouler en leur honneur. Comment tant d’obséquiosité, car envers un si beau génie nous n’oserions nous servir du mot propre, n’a-t-elle pu trouver grâce auprès de Léon X ? Comment expliquer les refus humiliants que Machiavel essuie, le silence obstiné du pape ? C’est que, dans sa villa de la Strada, dans les bois où il rêve de poésie, à la table de son aubergiste, et jusque dans ce cabinet où il évoque les ombres des sages anciens, Machiavel sert deux maîtres : le maître présent, c’est-à-dire le pape, tout-puissant à Florence ; le maître futur, c’est-à-dire le Boscoli qui, tôt ou tard, renversera la puissance des Médicis. Son cœur est républicain, sa plume est monarchique. Ainsi donc le génie, pas plus que le laurier, ne préserve de la foudre. Machiavel tombe, tout comme son compatriote est tombé trois siècles auparavant. Dante, exilé, voudrait revoir sa patrie, mais les Guelfes veillent sous !es armes pour défendre Florence. Alors le poète, dont Dieu n’a pas daigné écouter les ardentes prières, lève les yeux sur l’empereur Henri VII, baise, commeil le dit, la terre, où se sont posés les pieds de son glorieux seigneur, de son très puissant triomphateur, et il lui crie : Pourquoi donc tardes-tu ?... Tu ignores donc que ce n’est pas dans les eaux du Pô ni dans les eaux du Tibre que se désaltère cette bête cruelle qu’on appelle Florence, mais dans les eaux de l’Arno qu’elle empoisonne ! C’est la vipère dans le ventre de sa mère !... Éventre la mère pour arracher et tuer la vipère.... Voyons donc le plan de constitution que le publiciste a tracé. Deux formes de gouvernement peuvent être introduites à Florence : la monarchie et la république. La monarchie est impossible dans tout État où règne l’égalité civile. Florence offre tous les éléments propres au développement du principe républicain. Pour fonder une république, il faut satisfaire trois classes d’individus : la noblesse, la bourgeoisie, le peuple. La chute du dernier gouvernement ne peut être attribuée qu’à la faute que le pouvoir commit en écartant des emplois des hommes qui, par leur naissance, leur fortune ou leurs talents, doivent briller au premier rang. n Dans la combinaison de Machiavel, les places importantes sont dévolues aux hommes de vieille race, et c’est Sa Sainteté qui dirige les choix. La bourgeoisie fait partie intégrante de l’État ; seulement Sa Sainteté a soin de se réserver la nomination des bourgeois comme membres du conseil des Deux-Cents. Puis vient le peuple. Il faut lui rendre, ou du moins promettre de lui rendre une partie de ses attributions : par exemple, rouvrir pour lui la salle des Mille ou des Six-Cents au moins, et lui laisser le droit de nommer à toutes les magistratures, excepté à celle des Soixante-Cinq, des Deux-Cents et du tribunal de la Balia, droit qui ; appartiendra exclusivement au pape. Et afin que Sa Sainteté soit sure que ses partisans feront partie des conseils populaires, elle désignera huit accoppiatori ou scrutateurs qui dépouilleront les votes en secret, et pourront faire tomber le sort sur ceux qu’elle aura désignés. Au fait, s’écrie Machiavel, content de son travail, dans le plan que j’ai l’honneur de soumettre à Sa Sainteté, tous les pouvoirs lui sont livrés. Elle fait la paix, elle fait la guerre ; elle rend la justice, elle rédige les lois, elle nomme les chefs de l’État, elle dirige les élections. On pourrait penser que cette constitution imaginée par Machiavel est un piége tendu à la papauté, si l’écrivain ne s’était réservé une place de secrétaire dans ce prodigieux gouvernement, où la vie et les libertés de tout un peuple sont abandonnées au bon plaisir d’un seul homme. Léon X fut plus libéral que Machiavel. Il comprit parfaitement que le secrétaire livrait Florence à l’anarchie ; que, le pontife étant mort, pas un Médicis ne pourrait garder le pouvoir. Il laissa donc aux Florentins la constitution qu’il avait trouvée en vigueur lors de son retour de l’exil, mais tempérée par quelques règlements qui limitaient l’action populaire dans l’administration des affaires. Le livre du Prince, qui devait populariser le nom du publiciste, était achevé depuis plusieurs années, mais ne parut,que longtemps après la mort de Léon X. Dans cet ouvrage, où la politique est érigée pour la première fois en véritable science, il ne faut pas chercher autre chose qu’une suite de formules à l’usage des gouvernements, auxquelles Machiavel a voulu donner une valeur dogmatique. On explique de deux manières les prétendus mystères dont on dit que l’historien enveloppe sa pensée : — L’écrivain, dit-on, ressemble au Spartiate qui, pour dégoûter de l’ivrognerie, exposait aux regards un esclave ivre, et pousse à la liberté en montrant la tyrannie dans toute sa nudité ; — le républicain avancé donne aux maîtres momentanés de Florence des leçons qui, réduites en pratique, auront bientôt mis fin à la tyrannie qu’ils font peser sur sa patrie. L’apologiste du secrétaire florentin ne voit donc pas qu’il fait de Machiavel, tout à la fois, un rhéteur et un lâche. II n’est ni l’un ni l’autre. Machiavel est l’homme de la force brutale, de la ruse, de la fraude, du mensonge, quand le pouvoir a besoin de mauvaises passions pour réussir de la clémence, de la générosité, de la liberté, de toutes les nobles inspirations, quand le pouvoir, pour vivre, a besoin de faire de la vertu : la nécessité c’est son dieu, l’homme à la tête du gouvernement ne doit pas en avoir d’autre. Règne-t-il de la veille seulement, il faut qu’il use de clémence, parce que la clémence rallie les partis. Quand il aura gouverné quelque temps, il pourra, s’il en est besoin, répandre le sang ; mais d’abord goutte à goutte. Vivre, voilà toute sa loi ; qu’il vive, n’importe à quel prix. Et la preuve que ce ne sont pas de vains jeux d’esprit ou un piége tendu aux Médicis, que les maximes du Prince, c’est que vous les retrouvez ailleurs aussi effrontément exprimées. Qu’on lise attentivement les chapitres 9, 14, 40 du Ier livre des Discours sur Tite-Live, on y verra toute la doctrine du Prince. Le moraliste a flétri le chapitre 18, où Machiavel fait un précepte, en matière de gouvernement, de l’hypocrisie, du parjure et de la fraude. Cette triple condition de vie qu’il impose à tout pouvoir, de quelque source qu’il émane, est indiquée dans le chapitre 13 du livre II des Discours sur Tite-Live. Et qu’on ne nous dise pas que son catéchisme politique ne s’adresse qu’au monarque : le peuple doit en observer les enseignements, s’il veut se perpétuer au pouvoir ; car, comme dit l’écrivain, l’art de tromper n’est pas moins nécessaire au despote qu’au républicain, et Rome le mettait habilement en pratique, quand elle se vantait de se faire des alliés des peuples qu’elle réduisait en esclavage. Il ne faudrait pas, pour justifier le traité du Prince, qu’on s’autorisât du privilège que Clément VII accorda à Blado pour l’impression des œuvres du publiciste. Clément VII, Florentin dans l’âme, voulait honorer, dans Machiavel, l’homme de génie. Du reste, il pensait que des livres qui pour être entendus ont besoin du silence et de la réflexion ne peuvent guère troubler la société. L’œuvre du Spinoza politique n’était pas alors comprise : peut-être que la papauté prenait pour un caprice d’artiste une pensée toute sérieuse. C’est à ce ‘pape lettré que Machiavel dédia son Histoire de Florence, un des beaux monuments de la langue italienne. Le secrétaire ne nous a pas trompés en nous disant, dans sa lettre à Vettori, qu’il évoque les grandes ombres de l’antiquité qui accourent à sa voix ; il a dû plus d’une fois, quand il composait son livre, réveiller Tacite. L’exposition de son histoire est digne du biographe d’Agricola. Comme Tacite, Machiavel est grave, solennel, sobre d’ornements ; et, s’il y eût songé, il aurait pu sans doute nous rendre les livres des Annales que le temps ou l’incurie des hommes a détruits. Personne mieux que lui n’aurait pu comprendre ou deviner les mystères de la vie impériale : et comme il les aurait décrits ! Voyez-le dans son traité qui a pour titre : De d’art de la guerre ; ne diriez-vous pas qu’il a passé toute sa vie dans les camps P Lorsqu’il fait de la stratégie, il semble écrire sous la dictée de d’Alviane ou de Pierre de Navarre. C’est lui qui fit comprendre aux italiens toute l’importance de l’infanterie. Il est probable que Bossuet, quand il conçut le plan de son Discours, avait sous les yeux le premier livre de l’Histoire de Florence, qui n’a pas de modèle dans toute l’antiquité. L’Italie a raison de s’enorgueillir d’un écrivain qui reste maître de chaque sujet qu’il traite ; émule de Lucien dans l’Asino d’Oro et les Capitoli, supérieur, au témoignage de Voltaire, à Aristophane dans la Mandragore, rival de Plaute dans la Clitia, plus ingénieux que Berni dans les Decennali. Son style sait prendre tous les tons : concis, serré, grave dans ses œuvres de politique ; abondant, pittoresque dans son histoire ; vif, rapide dans sa vie de Castruccio Castracani ; brillant, élégant dans ses comédies ; facile, rempli de naturel dans sa correspondance amicale avec Vettori. C’est l’homme le plus complet qu’ait possédé l’Italie, et qui seul a mérité cet éloge gravé sur son tombeau de Santa-Croce : Tanto nomini nullum par elogium. PAUL JOVE.
On ne saurait disconvenir que l’expédition de Charles VIII en Italie n’ait été favorable au mouvement des études historiques. Avant cette époque, quelques essais ont été tentés, pour ressusciter cette science, par Paulin de Piero, Dino Compagni et Jean Villani, à Florence ; par Dandolo, à Venise ; par Æneas Sylvius, que ses talents firent élever à la papauté ; par Poggio et Léonard d’Arezzo. Mais ces tentatives, louables sans doute, ne furent point heureuses. Sous la plume de ces écrivains, l’histoire est tantôt une légende, tantôt un journal, tantôt un simple résumé d’événements qu’ils enregistrent sans méthode, sans critique, sans inspiration. A l’apparition de Charles VIII, l’Italie est le champ de bataille où luttent les nations les plus puissantes du monde ; le canon et l’épée ont cessé de décider seuls de la victoire : la parole, aidée quelquefois de l’éloquence des Grecs anciens, et, il faut le dire, de la duplicité des Hellènes modernes, est une autre puissance qui combat au moyen des protocoles, des manifestes, des instructions, et qui a ses chefs comme l’arme matérielle a les siens. Grâce aux lettres ressuscitées par les Médicis, l’humaniste n’est plus relégué dans un monde invisible ; il peut, se mêler à toutes les scènes qui se jouent autour de lui ; il peut y prendre même une part active, à l’instar de Machiavel, sous Jules II ; en étudier les causes, en faire connaître les acteurs comme Paul Jove et Guichardin. Avouons que ces lettres ont de glorieux privilèges, puisqu’un pape comme Léon X vient demander une constitution politique au commensal d’un aubergiste de village, au compagnon d’un charbonnier. Il est vrai que cet homme s’appelait Machiavel. Paul Jove donc avait entrepris d’écrire le récit de cette grande expédition de Charles VIII. Le premier livre de son histoire était à peine achevé, qu’il eut envie de faire le voyage de Rome, et d’en lire quelques fragments à Sa Sainteté. C’était un des élèves de P. Pomponace, un écolier d’imagination, de beaucoup de mémoire, et qui s’était occupé de grec et de latin, et même de médecine. Paul Jove venait à Rome sans aucune lettre de recommandation : il n’eut besoin que de décliner son nom, celui de son précepteur et le sujet de sa demande, pour obtenir une audience du pape. S’il eût été ambassadeur, le maître des cérémonies t’aurait fait attendre ; mais toutes les portes du Vatican s’ouvraient à qui se recommandait des Muses. Il eut donc son audience dans l’appartement de Sa Sainteté, ce jour-là rempli de lettrés. Paul Jove lut plusieurs pages de ses annales, et, la lecture finie, Léon X affirma qu’après Tite-Live aucun historien ne lui semblait plus éloquent que Paul Jove. L’écrivain ne tarda pas à recevoir, comme encouragement, le titre de chevalier, une pension, la chaire de philosophie au gymnase romain, en attendant d’autres récompenses qu’il eût obtenues si la mort n’était inopinément venue surprendre Léon X. Clément VII acquitta la dette de son cousin. Paul Jove obtint successivement un logement au Vatican, la dignité de chantre de l’église de Côme et l’évêché de Nocera. Depuis sa réception au palais de Léon X, il s’était mis avec ardeur au travail, encouragé d’ailleurs par Sadolet et Bembo. L ‘œuvre s’avançait : elle était presque achevée quand Rome fut assiégée par le connétable de Bourbon. Les soldats pillèrent la maison de l’évêque. Il lui restait un trésor qu’il avait caché, avec son service de table, dans l’église de la Minerve. En fouillant ce sanctuaire, deux officiers espagnols, Herrera et Gamboa, découvrirent la cassette. Gamboa prit l’argenterie ; Herrera s’empara du manuscrit, qu’il se hâta de porter à l’auteur, et dont il demandait un prix élevé. Paul Jove ruiné, n’ayant pas de quoi payer la rançon de son livre, s’adressa à Clément VII, qui, tout aussi pauvre, proposa à l’officier espagnol Herrera un bénéfice à Cordoue en échange du manuscrit : le marché fut accepté. L’histoire de Paul Jove n’était pas rachetée trop chèrement. Paul Jove est un historien philosophe qui ne se contente pas, comme on a fait jusqu’alors, d’exposer des faits, mais qui cherche à les expliquer : il apprécie les mœurs, les coutumes, les institutions des peuples divers dont il parle ; et ces peuples, c’est le monde entier. Il a décrit avec un soin extrême le passage des Français à travers les Alpes sous la conduite de François Ier. Et, dans le récit de cette glorieuse expédition, son style s’anime, se colore, et semble se précipiter comme nos soldats en attaquant et en franchissant les pics de glace que la nature leur opposait pour barrière. Il est malheureux que nous ayons perdu cinq livres de ces annales, les plus fertiles en grands événements : nous aurions voulu voir comment il aurait peint Jules Ii. Jamais historien n’eut moins soin de sa réputation que Paul Jove. Il se représente languissant dans le repos, parce que personne ne s’offre pour l’acheter ; il a besoin de manger deux fois par jour, la soupe à chaque repas, et de se chauffer de la Saint-François à la Saint-Grégoire ; et en vérité, dit-il, bien fou qui s’alambiquerait la cervelle à ses dépens. Ailleurs il se vente de donner aux uns de riches brocarts, aux autres un mauvais sarrau, et il s’écrie, dans un accès d’humeur presque gasconne : Malheureux qui me provoquent ; je vais faire venir ma grosse artillerie, et nous verrons à qui restera la victoire ! Il parle dans une de ses lettres de la plume d’or et de la belle encre dont il va se servir pour raconter la vie de Henri II, roi de France. Il serait difficile de défendre l’honneur d’un écrivain qui se vante ainsi de sa vénalité : qui sait ? peut-être y a-t-il de la forfanterie jusque dans cette prétention à la malignité. Il nous semble à nous, qui avons lu ses ouvrages, qu’il vaut mieux que sa réputation. Un historien qui prend plaisir à mentir n’en appelle pas, comme Paul Jove, en tête de son livre, au témoignage de ceux dont il écrit la vie, et, avant de publier son ouvrage, il n’a pas soin de l’adresser à l’un des capitaines les plus illustres de l’époque, qu’il veut consulter sur la guerre où fut engagée Venise. Il loue franchement la bravoure de nos soldats quand ils viennent pour la seconde fois, sous François Ier, envahir le Milanais ; il prend parti pour le duc d’Urbin qui se révolta contre le saint-siège ; il dit à haute voix les défauts de Léon X, ménage les Frateschi, ennemis des Médicis ; proclame la générosité, la vertu, le courage partout où il les trouve, et appelle du nom de monstre Christiern, roi de Danemark. Il est vrai, comme le remarque Thomas, que Christiern, ce Néron du Nord, était alors détrôné et enfermé dans une cage ; mais la cage pouvait être brisée d’un jour à l’autre. Des libéralités de Clément VII, des présents des princes étrangers, et du revenu de son évêché, où il n’avait jamais résidé, Paul Jove avait acheté la villa Pliniana sur les bords du lac de Côme, dont il avait fait un palais ou plutôt un musée. Il a décrit sa maison de campagne en poète, en peintre, en archéologue : c’est un morceau achevé de style que cette description. On voit, à travers les blanches eaux du lac, d’énormes tronçons de colonnes, des pyramides à demi brisées, des fragments nombreux de statues antiques ; au milieu, une île remplie de pommiers, séjour de cette vierge toujours,jeune que les Grecs nommaient Écho, qui répond par deux fois quand on l’interroge ; près des bords, et pendante sur la colline, une villa rafraîchie par de doux zéphyrs ; dans cette habitation rurale, une salle à manger où président Apollon et les Muses ; à côté, une salle dédiée à Minerve, et ornée des statues de Pline l’Ancien, de Cécilius, de Rufus Cellinius, d’Attilius le Grammairien ; puis la bibliothèque, formée de livres choisis, l’appartement des Sirènes, la salle des trois Grâces. Dans le lointain, ce sont des montagnes qui s’inclinent en rampes verdoyantes, étincellent au soleil, et dont les fleurs portent jusqu’au lac de Côme leurs doux parfums ; dans les vallées, des vignes, des pins, des oliviers, des myrtes, des orangers, des arbres de toutes sortes ; sur le dernier plan, des rocs de granit à la tête chenue, des neiges éternelles, des glaciers aussi vieux que le monde ; et au-dessus de ce paysage, le pavillon lumineux du ciel de l’Italie. C’est dans cette retraite que Paul Jove composa son livre des Éloges, véritable musée où il a fait entrer le grand capitaine et le philosophe, le théologien et le poète, l’orateur et le médecin, des empereurs et des doges, des moines et des reines. Quand on apprit que l’évêque avait conçu l’idée d’un semblable livre, chacun voulut avoir l’honneur de figurer dans sa galerie. Hercule Gonzague lui envoya les portraits du Mantouan et de Pomponace ; un Musulman, celui de Mahomet, par Gentile Bellini, Vasari, les bustes des principaux personnages de l’antiquité ; Fernand Cortez, une émeraude en forme de cœur, sans doute pour que Paul Jove fît usage de sa belle plume en le peignant ; et l’Arétin s’envoya lui-même, après avoir posé devant le Titien, afin que l’historien épargnât au moins la figure de celui qui se nommait le fouet des princes. GUICHARDIN.
Il était fils de Pierre Guichardin, citoyen de Florence, que l’empereur Sigismond avait décoré du titre de comte palatin. Bien jeune, nous le trouvons à Pise, à Ferrare, à Padoue, étudiant le droit civil, et à Florence, après qu’il a reçu le grade de docteur, expliquant les Institutes de Justinien. C’est un jeune homme grave, studieux, austère dans ses mœurs, sévère dans ses vêtements, sobre à table, et ardent au travail. Il avait à peine trente ans quand la république lui confia l’ambassade d’Espagne ; il s’acquitta de cette mission avec tant de bonheur, que le monarque lui fit présent d’un service d’argenterie d’un grand prix. A l’élévation de Léon X ; il fut chargé de complimenter le nouveau pape ; le discours qu’il tinta Sa Sainteté était plein de noblesse ; la cour de Rome en fut enchantée, et Léon X, en présence des cardinaux, témoigna tout son contentement à l’orateur. Plus tard, en 1515, lorsque le pape passa par Florence pour se rendre à Bologne, où François Ier et sa suite étaient attendus, Guichardin eut l’honneur de le complimenter, à Cortone, au nom de la république. Le lendemain, il était nommé avocat consistorial de Sa Sainteté. Pour comprendre le prix de cette faveur, il faut savoir que Guichardin était un des habitués des jardins Rucellaï ; républicain de cœur, partisan des Fratesclii, et favorable à Savonarole ; âme honnête, du reste, qui n’aurait jamais pris le poignard de Boscoli pour affranchir son pays, et incapable de trahir la confiance même d’un pape, quoiqu’il ressemblât à ces vieux sénateurs de Venise, toujours en arrêt contre la politique de Rmne. Léon X connaissait parfaitement les opinions de Guichardin, et il n’hésita pas à lui confier le gouvernement de Modène et de Reggio. Guichardin exerça cet emploi en homme habile ; revêtu d’une double autorité, il sut se faire respecter et aimer, comme gouverneur militaire et comme administrateur civil. Adrien VI n’eut pas peur des talents littéraires de l’historien, et Clément VII les récompensa plus généreusement encore que ses deux prédécesseurs, en le nommant président de la Romagne. Quelque temps avant de mourir, Guichardin fit appeler un notaire auquel il dicta ses dernières volontés. Comme le moribond gardait le silence sur l’histoire qu’il laissait en manuscrit, le notaire lui demanda ce qu’il fallait en faire. -La brûler ! répondit Guichardin. Les intentions de l’auteur ne furent pas exécutées, heureusement pour la gloire de son nom et de l’Italie. L’ouvrage, qui ne contenait d’abord que seize livres, fut imprimé par A. Guichardin, neveu de l’historien, en 1551. Il y manque un grand nombre de passages et des chapitres entiers, entre autres celui qui a pour titre : Des droits du saint-siège sur Parme et Plaisance, que l’auteur vraisemblablement n’aurait jamais publié, et que des éditeurs ennemis du saint-siège ont rétabli dans les éditions postérieures. Il y avait dans cette âme si belle, si noble, un vieux levain de haine, non pas contre la papauté, mais contre la cour de Rome. En lisant quelques-unes de ses lettres, on surprend dans Guichardin de petits mouvements de vanité indignes d’un homme pareil. Il est possible qu’il ait pensé que la papauté n’avait pas assez généreusement payé les services qu’il lui avait rendus ; de là des boutades d’humeur contre Léon X, et même contre Clément VII : c’est une faiblesse qu’il a rachetée bien souvent par l’expression d’une franche admiration pour les vertus de ces deux grands pontifes. Il est presque aussi difficile de se défendre de la flatterie que de la malignité : quelquefois la malignité n’est qu’une flatterie déguisée envers un parti. En niant les droits du saint-siège sur Parme et Plaisance, Guichardin croyait faire sa cour aux Florentins, aux Vénitiens, à tous ceux qui feignaient d’avoir peur de l’ambition de la cour de Rome. On lui reproche d’avoir parlé en termes trop amers des Français : nous concevons la haine du républicain contre l’étranger ; mais nous ne voudrions pas qu’elle l’aveuglât au point de ne lui faire voir dans Charles VIII qu’un prince difforme. Bezzuoli, le grand peintre de Florence, est tombé dans un excès contraire ; il a donné à ce monarque une véritable tête grecque. Juste Lipse a accusé Guichardin de prolixité. Le récit de la guerre de Pise est d’une longueur démesurée ; Boccalini en a fait une critique ingénieuse, en feignant que le sénat de Laconie imposa comme châtiment à un Spartiate qui avait employé trois mots quand deux auraient suffi, de lire en entier cette description, supplice auquel il préféra les galères. Mais que sont ces taches, comparées aux beautés dont étincelle son histoire ? Nul parmi les anciens n’a semé sa narration de réflexions plus profondes ; Guichardin est un historien philosophe qui exerce la raison encore plus que l’imagination. L’étude des lois lui a donné du calme et de l’austérité ; on s’aperçoit aisément, en le lisant, qu’il a suivi Savonarole au couvent de Saint-Marc, car il fait à chaque instant intervenir la Providence dans la conduite des choses humaines. Comme il a vécu sur le champ de bataille, au sénat, au milieu du peuple, parmi les grands, il a sur ses rivaux une incontestable supériorité, c’est qu’il parle avec connaissance de cause de toutes les matières qu’il traite. Nourri des écrivains antiques, de Tite-Live surtout, il aime avec trop de passion la harangue. Quelques-unes de celles qu’il met dans la bouche de ses personnages sont de véritables chefs-d’œuvre. On cite surtout celle de Gaston de Foix avant la bataille de Ravenne ; elle n’a qu’un défaut, c’est d’être trop longue. A vingt-quatre ans, quand on est Français et qu’on a devant soi l’ennemi, on ne perd pas son temps à faire des phrases. L’antiquité a porté plus d’une fois malheur aux historiens de la renaissance. Ce malheur était inévitable. |
 Continent Valeriano n’a-t-il pas placé Léon X dans sa
galerie des lettrés que le sort poursuivit de ses rigueurs ? Il n’en est pas
qui aient été plus cruellement éprouvés dans leurs affections. Après son
père, c’est son frère qu’il perd ; il pleurait hier son frère Julien,
aujourd’hui c’est Laurent son neveu que le ciel lui ravit.
Continent Valeriano n’a-t-il pas placé Léon X dans sa
galerie des lettrés que le sort poursuivit de ses rigueurs ? Il n’en est pas
qui aient été plus cruellement éprouvés dans leurs affections. Après son
père, c’est son frère qu’il perd ; il pleurait hier son frère Julien,
aujourd’hui c’est Laurent son neveu que le ciel lui ravit. Clément VII, cet autre grand protecteur des lettres,
traita Paul Jove plus favorablement encore qu’il n’avait traité Machiavel, et
lui conféra le riche évêché de Nocera.
Clément VII, cet autre grand protecteur des lettres,
traita Paul Jove plus favorablement encore qu’il n’avait traité Machiavel, et
lui conféra le riche évêché de Nocera. Comme Paul Jove, Guichardin a raconté les événements dont
l’Italie avait été le théâtre depuis l’expédition de Charles VIII ; mais il a
plus d’un avantage sur son rival. D’abord, la plupart des faits dont il donne
le récit, il les a vus ; puis la langue dont il se sert est l’idiome vulgaire
; enfin les charges politiques dont l’ont investi ses maîtres ont dû lui
livrer des secrets qu’un autre ne pouvait connaître.
Comme Paul Jove, Guichardin a raconté les événements dont
l’Italie avait été le théâtre depuis l’expédition de Charles VIII ; mais il a
plus d’un avantage sur son rival. D’abord, la plupart des faits dont il donne
le récit, il les a vus ; puis la langue dont il se sert est l’idiome vulgaire
; enfin les charges politiques dont l’ont investi ses maîtres ont dû lui
livrer des secrets qu’un autre ne pouvait connaître.