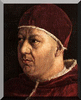HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXIX. — THÉOLOGIE. - LINGUISTIQUE.
|
C’est à tort qu’on
reproche à Léon X d’avoir négligé les théologiens. - Professeurs qui
enseignent la sainte science au Gymnase. - Mouvement imprimé par le pape à
l’étude des langues. - Ambrogio travaille à sa grammaire polyglotte. - Il est
chargé d’enseigner le chaldéen à Bologne. - Pagnini traduit le psautier de
l’hébreu en latin. - Léon X protège les travaux de l’orientaliste. -
Valeriano reçoit des encouragements du pape, et s’occupe d’un grand ouvrage
sur les hiéroglyphes. - Travaux divers de ce savant. - Réformation du
calendrier de Jules César entreprise par Léon X. Nous ne concevons pas le reproche que Pallavicini fait à Léon X d’avoir négligé les théologiens : il nous semble que les faits parlent assez haut ! Thomas de Vio, auquel il donna la pourpre romaine, était un des plus habiles thomistes de son époque ; Prierio, qu’il avait nommé maître du sacré palais, était, au témoignage d’un protestant, versé dans les matières ecclésiastiques ; Sadolet, son secrétaire et peut-être son ami, est un des plus illustres exégètes que compte l’école catholique, et Jacobatio, qu’il fit cardinal, n’avait pas son égal dans le droit canon. Il est probable que Pallavicini ne connaissait pas le Ruolo de l’archigymnase romain que l’abbé Gaetano Marini a publié d’après l’original qui existe à Rome. La théologie y tient sa place, la plus belle, la première, comme la nourrice et la maîtresse de toutes les sciences. Trois professeurs montent en chaire pour l’enseigner : le matin un religieux de l’ordre de Saint-Augustin, le soir maître Nicolas de Luna, et les jours de fête Cyprien Beneti ou Benedetti. Beneti, Espagnol de naissance, et de l’ordre des Prédicateurs, est auteur de divers traités d’une haute importance. Il avait été lecteur en logique au gymnase, sous Jules II et sous Alexandre VI ; l’université de Paris le comptait au nombre de ses docteurs. On ne prend pas garde, en répétant l’assertion de Pallavicini, que la théologie devait nécessairement s’associer au mouvement imprimé par ce pape à l’étude des langues. Si le poète épique cherche à s’inspirer dans Homère, dont l’idiome avait une chaire au gymnase romain, le prêtre qui sort de l’école où professent Lascaris et Favorino, si jamais le dogme catholique est attaqué, ira, pour le défendre, puiser des arguments dans les Pères grecs, dont il entend la langue. Et d’où venaient donc la plupart de ces docteurs qui brillèrent au concile de Trente ? N’est-ce pas des écoles instituées par Léon X ? C’est à Lascaris que Léon X avait confié la direction de cette imprimerie établie sous les auspices du pontife, et d’où sortirent des commentaires sur les tragédies de Sophocle, des scolies sur Homère, les opuscules de Porphyre, et quelques écrits destinés à éclairer le teste du prince des poètes grecs. Chigi, le fermier des mines d’alun du saint-siège, avait prévenu Léon X en montant à ses frais une imprimerie qu’il mit sous les ordres d’hellénistes célèbres. Corneille Benigno de Viterbe, l’éditeur du beau Ptolémée qui avait été publié à Rome en 1507, était un de ses protes. Son premier ouvrier se nommait Zacharie Calliergi, Crétois de naissance, qui à Venise, en 1499, avait surveillé l’impression du grand dictionnaire étymologique de la langue grecque. Au mois d’août 1515, Chigi, le fermier du pape, le protecteur de Raphaël, le banquier des cardinaux, dont il payait généreusement les dettes, et le protecteur de tout ce qui s’occupait de lettres ou d’art, annonçait au monde savant qu’il venait de publier les œuvres complètes de Pindare, in-4°, enrichies de notes et de notules. L’année suivante, il faisait paraître une magnifique édition des Idylles et des Épigrammes de Théocrite. Reiske, quand il voulut, deux siècles plus tard, publier un Théocrite, fut obligé de rendre hommage à la pureté du texte, au choix intelligent des leçons du Théocrite imprimé par le grand Lombard de Rome. Les éditions laissées par Chigi sont devenues très rares ; il donnait ses livres. Mais ce n’était pas seulement les lettres grecques que Léon favorisait dans l’intérêt des divines Écritures ; il voulut ouvrir aux théologiens les sources jusqu’alors cachées des idiomes de l’Orient. Un des chanoines de l’église de Saint-Jean de Latran, Thésée Ambrogio, descendant de la famille des comtes d’Albonèse, parlait un grand nombre de langues mortes et vivantes ; à quinze ans il entendait, dit-on, le grec ‘.comme 11lusurus de Crète, et le latin comme Érasme. A l’exception du latin et du grec, il apprit seul toutes les autres langues, ainsi qu’il le dit lui-même. Il avait étudié les lettres à Milan, et le droit à Pavie, sous Étienne Ottone et And. Bassignana. Il se trouvait à Rome, en 1512, à l’ouverture du concile de Latran. Le monde chrétien avait répondu à l’appel de Jules Il. La ville sainte était pleine de savants, venus pour prendre part aux travaux de l’assemblée. L’Inde y comptait divers missionnaires ‘envoyés par le prêtre Jonas ou Jean ; la Syrie et la Chaldée étaient représentées par Joseph, prêtre, Moyse, moine diacre, et Élias, sous-diacre. Le cardinal de Sainte-Croix chargea le chanoine de traduire du chaldéen en latin la liturgie de l’Eglise orientale ; malheureusement il ne manquait à Ambrogio, pour remplir les ordres du cardinal, que la connaissance même de l’idiome, qu’il étudia et apprit en quelques mois. Puis il se mit à l’œuvre liturgique, qu’il acheva fort heureusement. Pendant qu’il s’occupait de ce travail, Ambrogio donnait au sous-diacre Élias des leçons de latin, et en retour en recevait de syriaque. Léon X, qui cherchait à répandre en Italie le goût des langues orientales, envoya le philologue enseigner le chaldéen à Bologne, Ambrogio n’avait pas voulu de la pourpre que Léon X lui avait offerte. Il quitta Rome, emportant de beaux manuscrits chaldéens qu’il devait à la munificence du pape et de divers cardinaux. Après deux ans de professorat à Bologne, Ambrogio, que Schelborn appelle le restaurateur du syriaque, revint à Rome, rappelé par Sa Sainteté, qui fournit au savant les types nécessaires pour l’impression du Psautier en chaldéen. Ambrogio allait le mettre sous presse quand survint la mort de son protecteur, puis le sac de Rome par le connétable de Bourbon. Il partit pour Pavie, abandonnant aux soldats du vainqueur ses trésors d’archéologie sacrée et le manuscrit de son Psautier, fruit de si longues veilles, et qui, perdu, fut retrouvé dix ans après, en 9534, dans la boutique d’un charcutier. Cette perte, qui aurait jeté dans le désespoir tout autre qu’Ambrogio, n’interrompit qu’un moment ses doctes labeurs. Son dessein était de publier une grammaire polyglotte : chaldéenne, syriaque, arménienne ; magnifique ouvrage que Mazzuchelli regarde comme le premier essai en ce genre qu’ait produit l’Italie. On n’a rapporté qu’imparfaitement le titre du livre d’Ambrogio. Comme un assez grand nombre d’érudits tels que Reuchlin et Pic de la Mirandole, il croyait à une science cabalistique dont l’homme pouvait se procurer la notion à l’aide de quelques formules magiques. Sur les rives rhénanes, l’abbé de Spanheim, Trithemius, évoquait les esprits de l’air, qui soudain accouraient, disait-il, et lui livraient des arcanes qu’il n’a pas publiés. On trouve dans la grammaire d’Ambrogio une conjuration ou præceptum, et la réponse du démon. Le bon chanoine les a données en toutes lettres, avec les caractères démoniaques qu’il a figurés exactement, et qu’il transmit à Postel. Plaignons ces intelligences, et ne les blâmons pas trop sévèrement, ce serait de. la cruauté. La science aussi porte au cerveau ; mais quand le monomane, délaissant l’espace et de retour sur cette terre, recouvre sa raison pour protester de sa soumission aux décisions de l’Eglise, pourquoi nous montrerions-nous plus sévères que Jules II ou Léon X ? Laissons dire à Trithemius : Tu me demandes comment j’ai connu les secrets enfermés dans ma stéganographie ; écoute : ce n’est pas l’homme qui me les a livrés, c’est Dieu lui-même ; pourvu que ce savant soit tout prêt, comme un pauvre petit enfant, à écouter la voix du père, et Trithemius et Ambrogio déclarent que le père n’a qu’à parler. Sante Pagnini (Santès Pagninus) ne donna pas, comme Ambrogio, dans les rêveries de la cabale. Un voyageur, le père Esprit Rotier, inquisiteur de la foi à Toulouse, qui passait à Lyon en 1541, au mois d’août, au moment où la ville éplorée célébrait les funérailles de l’illustre étranger, voulut savoir pourquoi les cloches de toutes les paroisses sonnaient à la fois ; pourquoi ces trois cents hommes vêtus de noir tenaient un flambeau à la main ; pourquoi tout ce peuple répandu dans les rues semblait si triste. On lui répondit que Lyon enterrait le bon religieux dont la voix, non moins que la piété, avait préservé la province du venin des nouveautés luthériennes. C’est à ses exhortations que la ville devait cette léproserie qui s’élevait sur les bords de la Saône, et qui avait été fondée en partie par les dons de riches marchands florentins. Pagnini pensait au corps et à l’âme. Ce moine, de l’ordre de Saint-Dominique, était né à Lucques en 1470. Au couvent de Fiesole, près de Florence, il avait reçu des leçons de Savonarole. L’écolier avait pris à son maître tout ce qu’en bon chrétien il pouvait lui dérober. Symphorien Champier dit que le frère était doux quand il exhortait, véhément quand il reprenait, grave quand il prouvait, abondant quand il louait, et qu’il usait, pour réprimer les mauvais instincts populaires, tantôt du frein, tantôt de l’éperon. Pagnini, savant orientaliste, l’homme trilingue, comme le nomme le poète Voulté, avait conçu le projet de donner une version latine de la Bible d’après le texte hébreu. Il employa, comme il ledit, vingt-cinq ans à ce grand travail, conférant tous les manuscrits qu’il avait en son pouvoir. Quand sa version fut achevée, il vint à Rome. Il n’y avait qu’un souverain qui pût faire les frais d’une semblable publication, encore fallait-il que le prince comprît l’utilité de cette traduction. Pagnini trouva dans Léon X un protecteur et un juge. Il a raconté son entrevue avec le saint-père. Le pape, dit-il, qui savait que j’avais traduit en latin les deux Testaments, témoigna le désir de voir mon ouvrage. Quand il en eut parcouru quelques pages : — Je veux, dit-il, que le manuscrit soit recopié à mes frais, et à mes frais imprimé. Vous concevez la joie du savant. Quelques mois après, caractères, papier, ouvriers, tout était prêt ; et l’année suivante paraissait le Psautier, accompagné de commentaires rabbiniques. La mort de Léon X suspendit l’impression de la version latine de Pagnini. Heureusement un cardinal se chargea de la dette du pontife, et l’œuvre du dominicain put enfin paraître, non point à Rome, qui méritait à tant de titres d’avoir les prémices de l’œuvre, mais à Lyon, cette cité gallo-italienne, qui avait conféré à Pagnini le titre de citoyen. La version de Pagnini, quelle qu’en soit la valeur réelle, -qu’elle mérite les éloges exagérés de Huet et de Touron, ou la critique amère de Richard Simon, n’en est pas moins un glorieux témoignage en faveur de l’écrivain qui s’applique à d’aussi graves études, puis de la papauté qui les encourage et les protége si noblement. Luther a dit que la papauté tenait la Bible sous clef. La réponse de la papauté est péremptoire : elle paye pour la répandre. Il est une version des livres saints que l’Église aime et vénère, c’est celle de saint Jérôme. Quand on nous dirait qu’un pape a refusé d’approuver une version dans une langue dont s’est servi l’immortel docteur, aurions-nous le droit d’en être surpris ? Et pourtant voici un pauvre frère de l’ordre de Saint-Dominique qui veut entrer en lice avec le glorieux écrivain, et donner au monde une traduction nouvelle de la Bible, quand l’esprit, pendant tant de siècles, s’est nourri de la parole du vieux Père. Et il se trouve que trois papes, l’un après l’autre, et grands par des mérites divers, Léon X, Adrien VI et Clément VII, prennent sous leur patronage l’auteur et soit livre ! Remarquons bien, dans l’intérêt du saint-siège, que la version de Pagnini est en latin ; écrite, c’est-à-dire, dans un idiome qui peut être compris en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre, dans tout le monde catholique. Quand le latin aura fait son temps ; quand le florentin, pour nous servir de l’expression de Bembo, sera devenu la langue de toutes les intelligences, alors la Bible paraîtra dans l’idiome vulgaire ; seulement l’autorité voudra lire la version nouvelle avant d’en permettre l’impression, et elle aura bien raison. Attendez quelque temps ; un Espagnol du nom de Servet voudra reproduire le travail du dominicain ; mais en marge de son édition il ajoutera des notules où il répandra le venin de ses doctrines : et l’autorité ne s’alarmerait pas ! Mais c’est un sacrilège que va commettre Servet. Qui donc lui a permis de compléter, d’éclaircir le vocable latin dont se sert Pagnini ? Le père de cette parole latine est mort, et il ne reviendra pas pour la défendre : et voilà ce qui enhardira Servet ! Le mouvement imprimé par Léon X à l’étude des langues se répandait dans toute l’Italie. C’est le moment où le cardinal Ximenès met sous presse les premières livraisons de sa Bible polyglotte ; Guidacerio le Calabrois, sa grammaire hébraïque, beau travail qu’il devait refaire en 1539 à Paris, où il était professeur ; et François Rosi de Ravenne, la philosophie mystique d’Aristote, traduite de l’arabe. Ces trois, ouvrages portent en tête de la première page le nom de Léon X, à qui ils sont dédiés. Cette étude passionnée des langues mortes servait admirablement le progrès des sciences exactes. A Rome on s’occupait de traduire les déments d’Euclide, et des traités d’arithmétique qu’on devait à des Arabes ; les mathématiques étaient en honneur dans les universités du continent italien. Il est certain qu’avant Léon X le gymnase romain possédait déjà une chaire spéciale de mathématiques. Copernic les enseignait à Rome vers 1500 ; mais Léon X est le premier qui ait attaché d’honorables émoluments au titre de professeur de cette science, et qui ait porté le nombre des maîtres à deux, un pour le matin et l’autre pour le soir : le premier maître, Lucas de Burgo, de l’ordre des Frères mineurs, recevait annuellement 170 florins d’or ; le second maître, Antoine de Fermo, 70. Le professeur d’astrologie n’avait que 100 florins. C’était, à ce qu’il paraît, ce Pierre d’Arezzo, chanoine de sa ville natale, et que Léon X, le 3 septembre 1513, avait nommé notaire du palais de Latran et comte palatin. André Sansovino avait fait le dessin de la maison qu’habitait ce savant, que Vasari appelle un astrologue illustre. A cette époque, l’astrologie avait des chaires dans presque toutes les universités d’Italie, et à Rome comme ailleurs. A Padoue l’astrologie fut longtemps regardée comme la pierre angulaire de l’édifice universitaire. Léon X, dans son enfance, avait du goût pour les spéculations astrologiques ; c’est une faiblesse d’esprit qu’il conserva longtemps, et que son historien Paul Jove blâme, mais sans amertume, parce qu’elle était dans ce siècle partagée par les hommes de la plus haute intelligence. Décriée par l’université de Paris, condamnée par le concile de Trente et proscrite par Sixte-Quint, l’astrologie fut bannie de l’Italie, toutefois après avoir rendu de véritables services à l’astronomie, et peut-être plus encore à la poésie. Tous ceux qui s’adonnent à l’étude des astres trouvent ordinairement, dans la magnifique contemplation des sphères célestes, quelque chose de divin qui ennoblit, inspire et remue leur âme. Marsile Ficin, Politien, Benivieni, ces grands astrologues, quittaient le ciel pour célébrer la Divinité. Du reste, cette alliance de la science et de la poésie n’est point un phénomène en ce siècle, mais bien comme une loi et une condition ordinaire du génie. Rucellaï se sert, dans son poème sur les Abeilles, de miroirs grossissants qui l’aident à faire des observations de physique ; Varchi l’historien étudie la propriété des nombres en traduisant Euclide ; Fracastor laisse un moment son beau poème pour combattre les épicycles et aplanir la route au système de Copernic ; Celio Calcagnini, après avoir écrit une ode latine, s’occupe de soutenir le mouvement de la terre et la fixité du soleil ; Pierio Valeriano, qui a cherché aux soupers de Goritz l’explication d’un hiéroglyphe égyptien, retourne à son habitation en rêvant à des vers sur la rose ; Machiavel se distrait de son travail sur l’art de la guerre en improvisant des satires ; Sadolet rassemble les éléments d’un travail exégétique tout en célébrant le retour à la lumière de quelques statues antiques ; Raphaël d’Urbin écrit des sonnets sur le verso de ses dessins ; Michel-Ange quitte son ciseau et son pinceau pour prendre la plume et jeter sur la première feuille de papier de délicieuses fantaisies de poète. Ces poètes philosophes, historiens, médecins, astronomes, étaient si nombreux les jours de réception au Vatican, que Valeriano s’est pris de pitié pour Léon X, dont il déplore l’infortune. Il nous montre cette tourbe de versificateurs s’abattant comme autant de mouches importunes, et venant troubler le saint-père à table, au lit, dans son palais, à la promenade, à l’Église, la nuit et le jour. Valeriano, qui se moque ainsi de ses confrères en Apollon, était poète latin, il cherchait à imiter dans ses vers Horace et Properce, dont il avait fait une heureuse étude. II aimait le monde créé, et plus d’une fois il y trouva des images dont il se servit pour rappeler la brièveté de tout ce qui vit ici-bas. Sa délicieuse strophe sur Rosine a dû vraisemblablement inspirer Malherbe : tous deux usent de la même comparaison pour peindre la rapidité avec laquelle se fanent et la rose et la jeune fille qui en porte le nom. Valeriano, né à Bellune en 1477, avait de bonne heure changé son nom de Gianpietro en celui de Pierio ou de Pierius. Il eut des maîtres renommés, Georges Valla, Jean Lascaris et Marc-Antoine Sabellico. Chassé de sa patrie, en 1509, par l’irruption des impériaux, il alla chercher un asile à Rome. Nous n avons pas besoin de dire que ce fut un prince de l’Église qui lui donna l’hospitalité ; à cette époque, la maison des prélats romains est, suivant l’expression d’un humaniste, le port où abordent les lettres fugitives. Jean-François de la Rovere, archevêque de Turin, logea l’exilé dans le château Saint-Ange. Pour un poète, c’était un séjour inspirateur que ce vieux môle d’Adrien, d’où l’œil pouvait errer sur les campagnes de Rome, voir le Soracte en hiver tout couvert de neige, la campagne verdoyante au printemps, les longs méandres du Tibre aux eaux jaunissantes, et le pont Saint-Ange incessamment traversé par des flots de peuple. Non loin de là était la demeure du cardinal Jean de Médicis, où Valeriano passait souvent la soirée. Le cardinal, devenu pape, n’oublia pas le neveu d’Urbain Bolzani, l’un de ses précepteurs : Pierio eut part aux libéralités du pontife, et fut choisi pour diriger les études d’Alexandre et d’Hippolyte de Médicis. A Rome vivait un Allemand du nom de Jean Goritz, qui exerçait l’office de juge, et dont la maison était le rendez-vous de toutes les célébrités. A certains jours de l’année, à la fête de Sainte — Anne entre autres, il donnait un repas splendide auquel il invitait les artistes, les prélats, les étrangers de distinction. Le repas achevé, les convives se rassemblaient dans les jardins contigus à la maison, et alors commençaient, sous la présidence de Bembo ou de Sadolet, et quelquefois de Goritz lui-même, des lectures sur divers sujets littéraires. C’est à l’ombre des hêtres de ce beau jardin que Flaminio (Marc-Antoine) et Jérôme Vida aimaient à rêver ; c’est en présence de ces inscriptions antiques dont il était rempli, que Pierio Valeriano conçut l’idée de son grand ouvrage sur les Hiéroglyphes. C’était la première fois que la science essayait d’expliquer ces énigmes gravées sur le granit depuis plusieurs milliers d’années. Valeriano crut avoir trouvé l’alphabet de cette écriture symbolique que nous ont léguée les Egyptiens : il s’est trompé sur la valeur des signes ; mais qui oserait accuser de présomption vaniteuse un savant qui avait passé des années en contemplation devant des obélisques ? Du reste, il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas la valeur phonétique de chacun des signes attachés sur la pierre par les Egyptiens que Valeriano s’est proposé de déterminer ; il n’a pas cherché à deviner la lettre, mais l’idée ou le symbole ; et il n’a pas seulement poursuivi l’emblème chez l’Égyptien, mais chez les Grecs et les Romains. Ne parlons pas de la patience monacale, de la sagacité toute gauloise, de la science linguistique qui brillent dans son œuvre. Quelque chose de plus merveilleux, c’est la connaissance que notre savant possède de tout ce qui touche à la civilisation des peuples anciens. On dirait qu’il est d’un autre inonde, et qu’il habita, si le système de Pythagore n’était pas une chimère, quelque âme qui se promenait autrefois dans les catacombes de Memphis, ou sur la Via Sacra de Rome, car il sait aussi bien son Egypte que son Italie. Quand il se trompe, et cela lui arrive, c’est avec tant de candeur, qu’on l’admire encore. Léon X protégea les recherches de l’antiquaire, et ce n’est ni la faute de Valeriano, ni celle du pontife, si l’alphabet égyptien ne fut pas trouvé à cette époque ; l’Égypte n’était pas ouverte, et c’était là seulement qu’on pouvait espérer de le déchiffrer. Quand il avait cherché jusque dans le silence des nuits l’origine ou la signification d’une allégorie antique, travail fastidieux d’érudit, Valeriano s’occupait d’une physiologie du lettré. La thèse qu’il se proposait de développer est bien triste : il voulait prouver que quiconque ici-bas veut se livrer aux Muses est dévoué fatalement à l’infortune. Rien de plus douloureux à parcourir que les pages où il a rassemblé, avec la minutieuse patience d’un Allemand, tous les genres de malheur qui sont venus fondre de son temps sur les hommes illustres qu’il avait connus et aimés. Il semble qu’un livre comme celui de Valeriano ne devait pas être écrit à !a cour d’un prince qui allait à la recherche d’un humaniste comme d’un trésor ; qui lui donnait des lettres de noblesse, un appartement au Vatican, un jardin, une maison, une prébende, un évêché, un chapeau de cardinal. Valeriano aurait pu se citer comme un exemple des faveurs qui attendaient, sous Léon X, tout homme qui courtisait les Muses. Bais Valeriano met parmi les infortunes dont le ciel afflige quiconque essaye d’écrire, les accidents nombreux de cette vie : la chute d’un cheval, la mort au milieu d’un repas, le naufrage en pleine mer, le coup de lance sur le champ de bataille, la fièvre, la phtisie ; et, sous ce rapport, on ne voit pas pourquoi l’homme de lettres échapperait à la loi commune. Vraiment Valeriano est un ingrat ! Mais, sans ces lettres que vous calomniez, mon noble ami, aurait pu lui dire Sadelet, où donc serais-je ? à Modène, dans l’officine de mon père le médecin. Et Bembo ? enterré dans un des fauteuils du sénat de Venise, patricien comme son père, et comme lui sans gloire ni renommée. Et vous-même vous n’assisteriez pas aux soupers de Goritz, vous ne nous expliqueriez pas à la lueur des flambeaux ce langage muet écrit sur la pierre en lettres dont vous seul avez le secret ; vous seriez encore au service de ces seigneurs de Venise dont vous étiez obligé de supporter la mauvaise humeur. Belle âme, du reste, plus encore que beau talent, Valeriano s’est peint dans chacun de ses ouvrages. C’est là qu’il faut l’étudier pour comprendre les louanges que ses contemporains lui ont décernées ; il n’avait pas d’ennemi. Ainsi que Sadolet, il avait conservé la longue barbe du siècle dernier, celle qui allait si bien à Jules II, formée de trois touffes s’amincissant à l’extrémité, comme le pape la porte dans le tableau peint par Raphaël, et qu’on admire au palais Corsini, à Rome. Valeriano, quand sous Léon X vint la mode des mentons rasés, ne voulut pas couper sa barbe ; et comme on riait quelquefois lorsqu’on le voyait passer, il crut faire taire les moqueries en prenant la défense de la barbe. Il soutient que la barbe est l’honneur du menton, comme les branches sont l’ornement de l’arbre. Cet ingénieux badinage ne parut qu’après la mort de Léon X. On croit que Valeriano s’occupa de la réformation du calendrier. Le calendrier, établi sous Jules César par Sosigènes, est fondé sur la révolution annuelle du soleil en trois cent soixante-cinq jours et six heures. Après quatre ans, ces six heures donnant un jour, il fut décidé qu’à la fin de cette période on compterait ce jour entier, et que l’année dès lors serait formée de trois cent soixante-six jours. Ily avait une erreur dans le calcul de l’astronome d’Alexandrie, une erreur de onze minutes sur la période entière des six heures ; de sorte que, dans l’espace de cent trente-quatre années, ces onze minutes formaient un jour de vingt-quatre heures. Il fallait une réforme : elle fut présentée au pape Jean XXIII, en 1442, par le cardinal d’Ailly, puis portée au concile de Constance en 1444, au concile de Bâle en 1436 et 1439. Nicolas V s’en occupa à son tour. Jean de Novare avait présenté à Jules II un projet de réformation. Le but du savant était de déterminer l’époque précise de la Pâque. La fête de la Résurrection de Jésus-Christ avait été fixée par le concile de Nicée au dimanche qui suivait le quatorzième jour de la lune de mars ; mais les 1.257 années écoulées depuis 325, époque de la première réforme opérée par le concile, plaçaient l’équinoxe du printemps au 10 ou au 12 de mars, au lieu du 21 du même mois. Jules Il comprit donc l’importance du travail de Jean de Novare. Léon X chargea les Pères du concile de Latran de s’occuper de la correction des tables alors en usage. Il écrivit aux évêques et aux patriarches de la catholicité de lui adresser dans un délai de quatre mois Ies observations des astrologues et des théologiens. Il lit la même prière au roi de la Grande-Bretagne, Henri VIII ; les directeurs des académies de l’Italie devaient lui transmettre le résultat de leurs recherches. C’est alors que l’évêque de Fossombrone, Paul de Middlebourg, écrivit un traité en 23 livres, sous ce titre : De recta Paschæ celebratione ; Basile Lapi, religieux de l’ordre des Augustins, son de Ætatum computatione et dierum anticipatione, et Antoine Dulciati son de Calendarii correctione. Ces trois ouvrages sont dédiés au souverain pontife, qui les remit à la commission nommée par le concile. Grégoire XIII devait terminer l’œuvre que la mort ne permit pas à Léon X d’achever. L’idée de la soustraction de dix jours de l’almanach en usage est due à Lilio. Pour prévenir une anticipation semblable à l’avenir, l’astronome calabrois voulut que les siècles dont le nombre ne serait pas divisible par 4 fussent des années communes ; elles étaient bissextiles dans le calendrier de Jules César. |