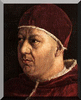HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXV. — CONCORDAT. - 1516.
|
La pragmatique
sanction de Louis IX et de Charles VII. - Est modifiée dans un temps de
schisme par les Pères de Bâle, et repoussée par le saint-siège. - Abus
qu’elle produit en France. - Louis XI veut l’abolir. - Elle est un moment
rétablie par Louis XII. - Concordat qui abroge la pragmatique. - Esprit de
cette constitution disciplinaire qui éprouve en France de vives résistances.
- Analyse de quelques-unes des dispositions du concordat. - Quel jugement on
doit en porter. - Les deux monarques se séparent. - Retour à Rome de Léon X.
- Sort de Julien de Médicis. Léon X et François Ier, pendant trois jours, s’occupèrent d’affaires sérieuses : de la question de Naples, — de la question des feudataires du saint-siège, — de la question de la pragmatique sanction. Le roi de France, maître de Milan, voulait chasser les Espagnols de l’Italie et s’emparer du royaume de Naples. Gomme il ne pouvait réussir ni dans l’un ni dans l’autre de ses projets sans l’assistance de Rome, il sollicitait l’intervention armée du pape. Le diplomate triompha du soldat. Pour Léon X, c’était vaincre que de gagner du temps. Il disait que Ferdinand était vieux, infirme, malade ; que la mort imminente de ce prince le délierait naturellement de ses engagements envers la maison d’Aragon, et qu’il aviserait alors si, dans l’intérêt de sa politique, il devait refuser ou accorder les secours dont la France avait besoin pour conquérir Naples. — Le roi comprit les raisons de Sa Sainteté, et la question fut réservée. François Ier avait reçu des services du duc de Ferrare et du duc d’Urbin. Pour le duc de Ferrare, il demandait la restitution des places de Modène et de Reggio ; pour le duc d’Urbin, le pardon du saint-siège. Léon X, sans refuser positivement la restitution des deux places conquises par Jules II, exigeait qu’on lui remboursât les 40.000 ducats d’or qu’il avait donnés à l’empereur pour l’investiture de cette double souveraineté. Or, comme François Ier n’était pas en état de payer cette somme, c’était une question à traiter plus tard. Le duc d’Urbin, neveu de Jules II, dont il avait commandé les armées, instrument docile des Français, sujet rebelle qui, après en avoir été requis, avait refusé de joindre ses troupes à celles de Sa Sainteté, semblait indigne d’intérêt comme de pitié. Le pape n’eut pas de peine à convaincre François Ier de la félonie du feudataire, qui dès lors fut abandonné. Restait la question relative à la pragmatique sanction, dont le roi de France, et le pape plus encore, demandaient l’abrogation. En droit ecclésiastique, on nomme pragmatique sanction un code ou recueil d’ordonnances qui règlent l’administration religieuse d’un royaume. Ln France, on connaissait deux pragmatiques, l’une de saint Louis, l’autre de Charles VII. Avant d’entreprendre sa seconde croisade contre les infidèles, Louis IX voulut assurer pendant son absence le repos de l’Eglise gallicane. Dans une ordonnance célèbre, il régla les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures et des autres bénéfices et offices ecclésiastiques. Quelques critiques doutent toutefois que la pragmatique qui porte le nom de Louis IX soit véritablement l’œuvre du monarque ; il n’en est pas fait mention dans l’histoire des démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII. En 1438, au mois de janvier, les Pères du concile de Bâle députèrent à Tours des ambassadeurs pour se plaindre à Charles VII de la conduite d’Eugène IV, qu’ils venaient de déclarer suspens. Le prince avait écouté leurs plaintes, et promis de s’occuper incessamment des affaires de l’Eglise, A Bourges, la même année, dans l’assemblée qu’il provoqua, se trouvèrent, outre le dauphin et les princes du sang, vingt-cinq évêques, cinq archevêques, plusieurs abbés, et beaucoup de députés des chapitres et des universités du royaume. Le roi présida l’assemblée, dont les séances s’ouvrirent le 1er mai. Les nonces d’Eugène, l’archevêque de Crète et l’évêque de Digne, et un docteur, y dénoncèrent la conduite des Pères de Bâle comme attentatoire au saint-siège, et prièrent le roi de reconnaître le concile de Ferrare que le pape venait d’ouvrir, et de révoquer la sentence de suspense portée le 25 janvier, à la trente et unième session, contre le légitime successeur de saint Pierre. Les députés bâlois, l’évêque de Saint-Pons de Tomières, l’abbé de Vézelay, le docteur Thomas de Courcelles, l’archidiacre de Metz, Guillaume Hugues, et un chanoine de Lyon nommé Jean de Manze, demandèrent que les décrets publiés par les Pères de Bâle fussent reçus et observés en France, que le concile de Bâle fût tenu pour légitime, que le décret de suspense porté contre Eugène IV eût force de loi dans tout le royaume, et que défense fat faite aux sujets de Sa Majesté de se rendre à Ferrare. Dix docteurs et prélats furent choisis pour examiner les décrets du concile de Bâle : l’examen dura jusqu’au 7 juillet. Ce jour-là, le roi publia l’édit connu sous le noua de pragmatique sanction, œuvre modifiée des Pères du concile, née par conséquent dans le schisme ; car les Pères avaient évidemment rompu l’unité. La pragmatique fut enregistrée au parlement de Paris le 13 juillet 1439. Rome refusa constamment de l’approuver : le concile de Bâle n’en voulut pas non plus. C’était, dit Pie II, une tache qui défigurait l’Église, un décret qu’aucun concile général n’avait porté, qu’aucun pape n’avait reçu ; un principe de désordre dans la hiérarchie ecclésiastique ; une confusion énorme des pouvoirs, où le laïque jugeait souverainement le prêtre, où la puissance spirituelle ne pouvait s’exercer que sous le bon plaisir de l’autorité séculière ; le parlement transformé en concile ; le pape devenu le vassal de quelques juristes. Pie II, qui s’exprimait ainsi à l’assemblée de Mantoue, en 1459, avait raison. Brantôme a raconté ce qu’était l’Église de France sous le régime de cette convention : un schisme était inévitable, si Louis XI ne l’eût prévenu en renversant l’œuvre de son père. Dans une lettre au pape, en date du 27 novembre 1461, Louis XI disait au pape : — Nous avons reconnu, très saint-père, que la pragmatique sanction est attentatoire à votre autorité, à celle du saint-siège ; que, née dans un temps de schisme et de sédition, elle finirait par amener le renversement de l’ordre et des lois, puisqu’elle vous empêche d’exercer la souveraine puissance que Dieu vous a déférée. C’est par la pragmatique que la subordination est détruite, que les prélats de notre royaume élèvent un édifice de licence, que l’unité qui doit lier tous les chefs chrétiens se trouve rompue. Nous vous reconnaissons, très saint-père, pour le chef de l’Eglise, pour le grand prêtre, pour le pasteur du troupeau de Jésus-Christ, et nous voulons demeurer uni à votre personne et à la chaire de saint Pierre. Ainsi nous cassons dès à présent et nous détruisons la pragmatique sanction dans tous les pays de notre domination ; nous voulons que le bienheureux apôtre saint Pierre, qui nous a toujours assisté, et vous, qui êtes son successeur, ayez dans ce royaume la même autorité pour les provisions de bénéfices qu’ont eue vos prédécesseurs Martin V et Eugène IV. Nous vous la rendons cette autorité ; vous pouvez désormais l’exercer tout entière. Rome fit éclater sa joie : tout n’était pas fini pourtant ; il fallait que l’abolition de la pragmatique fût revêtue des formes légales. Louis X : rendit une déclaration que de la Balue, évêque d’Angers, fut chargé de porter au parlement. Le parlement refusa de l’enregistrer. L’université avait encouragé la résistance des conseillers par un appel au concile général ; les poètes vinrent aussi, qui s’amusèrent à crier merci pour la pragmatique, dont ils n’avaient peut-être jamais lu une seule ligne. En 1479, Louis XI, qui croyait avoir à se plaindre de Rome, retira tout à coup la parole qu’il avait autrefois donnée au saint-siège, et voulut rétablir l’œuvre de Charles VII. A son avènement au trône, Louis XII confirma les dispositions principales de la pragmatique, dont plusieurs arrêts du parlement limitèrent l’autorité. Si ces disputes se fussent perpétuées, l’Eglise de France était menacée dans son repos, et le schisme introduit peut-être dans le sanctuaire. Jules avait ouvert le concile de Latran, où de sa pleine autorité il voulut étouffer ces ferments de discorde sans cesse renaissants. Il fit donc lire dans la quatrième session, le 10 décembre 1512, les lettres de Louis XI pour la suppression de la pragmatique. L’avocat consistorial en requit en forme l’abolition ; un promoteur demanda que les fauteurs de cette constitution, rois ou sujets, pussent être cités au tribunal du concile dans le terme de soixante jours, pour faire entendre les raisons qu’ils avaient pour soutenir un acte si contraire à l’autorité apostolique du saint-siège. Les Pères firent droit au réquisitoire, et décidèrent que l’acte de monition serait affiché à Milan, à Asti, à Pavie. Les procédures allaient commencer ; le royaume de France avait été mis en interdit. Louis XII comprit le danger ois il s’était jeté ; il songea sérieusement à se réconcilier avec le pape, en désavouant le conciliabule de Pise, et en promettant d’envoyer à Rome des prélats français pour prendre part aux actes du concile, et répondre sur le fait de la pragmatique. Seulement il demandait un délai, sous prétexte que les chemins n’étaient pas libres à cause de la guerre. Il eût sans doute tenu parole à la paix, dit l’historien de François Ier, si la mort ne l’eût prévenu. Son successeur, François Ier, avait reçu la même sommation et avait répondu dans les mêmes termes ; il voulait donner satisfaction au saint-siège. Le pape et le roi, avant même l’entrevue de Bologne, étaient d’accord sur la nécessité d’abolir la pragmatique. C’était une affaire trop grave pour être traitée dans le peu de jours qu’ils passèrent ensemble. En se séparant, ils laissèrent, le pape, les cardinaux d’Ancône et de Santi-Quatro ; le roi, le chancelier Duprat, munis de pleins pouvoirs pour terminer les différends qui trop longtemps avaient divisé l’Église et la France. François Ier prit congé de Sa Sainteté lé 15 décembre, emportant avec lui plusieurs grâces spirituelles et temporelles que lui accordait Léon X : la suppression des évêchés de Bourg et de Chambéry, nouveaux sièges élevés au détriment des églises de Lyon et de Grenoble ; l’autorisation de lever une décime sur tous les biens de l’Église de France ; l’abolition des censures que les prélats français avaient,encourues sous Jules II ; le privilège de nommer, sa vie durant, aux évêchés et aux abbayes de la Bretagne, de la Provence et du Milanais. Le pape, en outre, fit présent au prince d’une croix enrichie de pierres précieuses, estimée 15.000 ducats, et contenant un fragment du bois de la vraie croix, gros comme une noisette, dit la relation. Le chancelier Duprat travailla quelque temps, à Bologne, avec les commissaires du pape, à l’œuvre de discipline ecclésiastique qui parut sous le nom de Concordat, et fut publiée à Rome le 18 août 1517, avec l’approbation de Sa Sainteté. Citons quelques-unes des dispositions les plus importantes de ce traité : Les églises cathédrales et métropolitaines sont dépossédées, par les articles IV et X, du droit d’élection. En cas de vacance, et dans les six mois, le roi nomme un docteur, un licencié en droit ou en théologie, ayant toutes les qualités requises ; le pape confirme l’élection. Même disposition pour les abbayes et les prieurés conventuels. Dans chaque cathédrale, une prébende sera dévolue à un docteur, ou licencié, ou bachelier en théologie, qui fera preuve de dix ans d’étude dans une université. Ce prébendier, qui recevra le nom de théologal, sera obligé de faire des leçons au moins une fois la semaine, et pourra s’absenter du chœur sans rien perdre des émoluments attachés à la résidence personnelle (art. X). La troisième partie des bénéfices, quels qu’ils soient, appartiendra désormais à ceux qui auront pris des grades dans l’université (art. XI et XII). Le concordat détermine le temps des études : dix ans pour les docteurs et licenciés en théologie ; sept ans pour les docteurs et licenciés en droit et en médecine ; cinq ans pour les maîtres et licenciés ès arts ; six ans pour les simples bacheliers en théologie ; cinq ans pour les simples bacheliers en droit (art. XIII, XIV et XV). On choisira pour la collation d’un bénéfice le gradué le plus ancien ou le plus titré dans la même faculté, ou qui aura pris des degrés dans une faculté supérieure. Le docteur l’emportera sur le simple licencié, le licencié sur le bachelier ; la théologie l’emportera sur le droit, le droit sur la médecine ; et, pour honorer particulièrement les saintes études, les bacheliers en théologie seront préférés aux licenciés des facultés inférieures (art. XVII). Les cures des villes et des faubourgs ne seront conférées qu’à des gradués ou à ceux qui auront étudié trois ans en théologie ou en droit, ou bien à des maîtres ès arts (art. XX et XXI). Les clercs concubinaires seront punis par la soustraction de leurs bénéfices, et ensuite par la privation des bénéfices mêmes, et par l’inhabilité aux saints ordres (art. XXIX). Telle est la substance de ce concordat auquel Léon X attacha son nom ; couvre de sagesse dont la papauté a droit de se glorifier. Le pape disait, en parlant de la pragmatique, qu’elle abandonnait l’Église de France aux brigues, aux violences, à la simonie. Cette accusation était fondée. C’est une vérité incontestable que les élections canoniques rétablies par le concile de Bâle n’étaient qu’un mensonge. Dans chaque province, les seigneurs se rendaient maîtres au moins des principales dignités ; ils avaient en quelque sorte des droits à la nomination, comme patrons des églises ou comme descendants des pieux fondateurs. On a eu tort de reprocher au concordat d’anéantir nos libertés. Quelle part, dit ici un juge dont le témoignage ne saurait être suspect, quelle large part les souverains n’avaient-ils pas dans le système électoral ? La pragmatique leur laissait la prière et les bons offices. Or les prières et les bons offices d’un roi sont de véritables ordres ; et s’il arrivait qu’on refusât d’écouter les unes et les autres, de quels funestes effets pareil refus n’était-il pas suivi ! ... Si vous jugez l’ancien mode disciplinaire sous le point de vue romain, vous ne sauriez refuser de convenir que la pragmatique laissait au pape le droit de réformer les abus qu’elle pouvait faire naître : quelle source, par conséquent, de discussions, de démêlés, de désordres de tous genres !... Reconnaissons donc que le concordat de Léon X rétablit la paix dans l’Église de France, qu’il a fait plus de bien au royaume que la pragmatique. Ne nous étonnons pas qu’il ait essuyé, dès sa naissance, tant de querelles. Le clergé ne put voir tranquillement qu’on le privât de son plus beau droit, celui d’élire ses pasteurs : il sentit vivement cette perte ; il en appela au futur concile. Un changement si subit dans le gouvernement des églises étonnait tous les esprits ; le temps seul pouvait les calmer. Le temps est venu depuis que M. de Marca écrivait ces lignes si sages ; il a fait taire les plaintes du clergé, les doléances des parlements, les boutades des poètes, car la poésie elle-même avait entrepris de donner tort à Léon X. Sans doute, c’est une belle et sainte coutume que l’élection des pasteurs par le clergé lui-même dans les temps de foi, de piété, de paix ; mais quand les mœurs se corrompent, que les saintes études sont abandonnées, que les esprits sont agités, alors le scandale s’introduit facilement dans le sanctuaire. Ce n’est pas le plus digne qui souvent est élu, mais le plus riche ; le pauvre qui a de la science et de la vertu se voit préférer l’homme opulent, qui n’a que des trésors souvent mal acquis. Qu’on jette les yeux sur l’Église gallicane, et qu’on nous dise si, depuis le concordat, elle n’a pas gagné en science, en moralité, en vertus et en lumières ! Un moment, il y a de cela un demi-siècle, l’Église gallicane, l’Église concordataire fut mise à de terribles épreuves ; ne triompha-t-elle pas de la prison et de l’échafaud ? A la même époque à peu près, une autre Église, celle d’Allemagne, où l’élection capitulaire avait été conservée, fut tentée par son prince, Joseph II. Comment se tira-t-elle de cette épreuve ? l’histoire le dit assez. Et ce n’est pas seulement l’indépendance du clergé gallican que Rome préservait des atteintes signalées par tous les bons esprits, mais le prêtre qu’elle arrachait à cette ignorance où trop longtemps il était resté plongé, en exigeant qu’il étudiât trois ans en théologie pour obtenir une cure, dix ans pour gagner le doctorat, six ans pour être simple bachelier. Si ces conditions avaient été remplies par ceux que les chapitres décorèrent du titre d’évêque, nous n’aurions pas vu, à Bâle, le cardinal d’Arles se faire apporter les reliques de la ville pour les mettre sur le siège des évêques absents ; comme s’il n’eût pas dû savoir que J.-C. avait donné aux papes et aux évêques, et non à des châsses de saints, le pouvoir de terminer des questions de foi : c’est la réflexion du docte Berthier ; et sept évêques n’auraient pas consenti à déposer Eugène IV, quand les canons en demandent douze pour déposer un simple évêque, comme Nicolas de Cusa, un des nonces à la diète de Mayence, en 1444, l’observait justement. Le grand reproche que le clergé gallican, l’université, les parlements, les lettrés, si l’on veut aussi, faisaient à Léon X, c’est que sa bulle détruisait une œuvre disciplinaire depuis longtemps en vigueur dans l’Église de France. En cela ils méconnaissaient évidemment les droits du saint-siège. N’est-il pas des circonstances où une dérogation aux règles communes devient une nécessité ? Et qui décidera si ce temps est venu ? Le prêtre, qui n’a pas la plénitude du sacerdoce, branche, dit Thomassin, de cet arbre divin dont l’évêque est le tronc ? L’évêque, dont la juridiction, bien que divine, ne petit s’exercer que sur la matière assignée par le souverain pontife, qui peut l’étendre ou la diminuer, comme le cardinal de Lorraine le proclamait au concile de Trente ? La primauté ayant été donnée à saint Pierre, afin d’ôter toute occasion de schisme, dit saint Jérôme, le pape seul a le droit de faire des lois qui obligent l’Église ; mais ces lois, variables de leur nature, ne sauraient le lier au point qu’il ne puisse y déroger pour de justes raisons dont seul il est le juge. Léon X, après son entrevue avec François Ier, avait quitté Bologne et repris le chemin de Florence. C’était toujours avec une joie nouvelle qu’il revoyait sa ville natale et cette belle église de Santa-Maria del Fiore, où reposaient les restes de tant de néoplatoniciens qu’enfant il avait si tendrement aimés. Là était enterré, sous une dalle obscure, Marsile Ficin, auquel Léon X avait transféré, en 1487, le canonicat qu’il possédait dans cette église. En vain aurait-on cherché du regard la tombe qui enfermait les restes du glorieux réformateur de la philosophie de Platon ; il dormait là comme un homme qui n’eut fait aucun bruit en ce monde, quand Florence, sur l’observation du pape, songea à réparer son oubli et son ingratitude. Quelques années plus tard, Marsile avait son monument funèbre dans une église où tant de gloires sont ensevelies. Léon X avait à payer une dette d’enfance à ce sanctuaire de sciences et de vertus. Il voulut que les chanoines eussent désormais le rang de protonotaires du saint-siège, et le droit d’en porter l’habit dans les cérémonies publiques. Au moment où le pape entrait à Florence, les successeurs de Philippe Giunta, le grand imprimeur, préparaient une édition des œuvres de Jérôme Benivieni. Le chanoine de Santa-Maria del Fiore, après avoir favorisé le platonisme et chanté les miracles opérés par l’intercession du frère dominicain Savonarole, dont il s’était montré le fanatique admirateur, devait terminer sa triple vie de philosophe, de poète et d’artiste, par des Laudes à Marie, qui l’inspira plus heureusement que le frère de Saint-Marc. Ce retour à la vérité catholique par l’intercession de la Vierge est un phénomène qui se reproduit souvent dans la vie des néoplatoniciens de Florence. Nous l’avons déjà signalé en parlant de Politien. De retour à Rome, Léon X reçut des plaintes des habitants de Sienne contre Borghèse Petrucci, gouverneur de la ville : on l’accusait d’incapacité, de malversation, d’orgueil, de lâcheté. Borghèse servait mal les intérêts de l’Église ; on l’avait vu tout récemment, quand le saint-siège avait besoin d’une coopération active, déserter son poste et s’enfuir. Il fallait à Léon X une âme dévouée. Raphaël Petrucci, évêque de Grosseto et commandant du château Saint-Ange, était un homme capable, déterminé, et qui ne manquait pas de courage ; il avait donné à Léon X des gages d’une constance à toute épreuve et d’un véritable dévouement. Léon X lui confia le gouvernement de Sienne. Petrucci se mit en marche avec deux cents lances et deux mille hommes d’infanterie. Borghèse comptait sur quelques-uns de ses partisans, mais il fut abandonné dans le danger ; il n’osa le braver, et, la nuit, s’enfuit vers Naples, laissant la ville ouverte à Raphaël Petrucci, qui s’en empara sans coup férir. L’évêque de Grosseto, au lieu de l’amitié qu’il lui eût été si facile d’obtenir, ne gagna que la haine des habitants malheureusement cette haine était méritée. A peine arrivé à Rome, le pape reçut d’heureuses nouvelles de Florence : son frère Julien se rétablissait de jour en jour ; les médecins n’avaient plus aucune crainte. Ce n’était pas la première fois que la science s’était flattée de triompher du mal. L’année précédente, Léon, qui croyait à un retour à la santé, écrivait à Julien : Vous savez bien que je n’ai rien au monde de plus cher que vous. Je vous en conjure donc, laissez là les affaires, et ne songez qu’à vous rétablir, et pour vous et pour moi. Persuadez-vous bien que je veille sur vos intérêts comme si vous étiez près de moi, toujours à mes entés. Mon bon, mon tendre frère, si vous m’aimez, si vous croyez que je vous aime, courage ; ne pensez qu’à une seule chose, à votre guérison. Les douces espérances dont Vespuccio avait si souvent flatté Léon X s’évanouirent bien vite. Les médecins reparurent près du lit du malade, silencieux et mornes : leur art était désormais impuissant ; Julien ne pouvait être sauvé que par un miracle. Après de longues souffrances supportées avec un courage tout chrétien, Julien mourut, le 17 mars 1546, dans l’abbaye de Fiesole, n’ayant joui qu’un instant du bonheur que lui avait fait son frère bien-aimé, et emportant les regrets de Florence, qui pleura, à la mort de son premier magistrat, l’administrateur intègre, l’ami du peuple, le chrétien doux de cœur, le patriote passionné pour la gloire de son pays, le protecteur des lettres et des arts. Sa vie avait été traversée par des souffrances et des chagrins de toutes sortes. Pour les adoucir, Dieu lui avait donné, comme à son père, un inépuisable trésor de philosophie. Quand la douleur était trop vive, il avait, après la religion, les Muses pour la calmer. Il chantait dans l’infortune, tout comme avait fait Pierre. Crescimbeni dit qu’il ne se laissa pas gâter par le mauvais goût du siècle, c’est-à-dire par le naturalisme païen. L’Arioste a célébré dans de beaux vers les vertus de Julien ; Bembo l’a placé comme interlocuteur dans ses Asolani, et Michel-Ange a voulu travailler au tombeau qu’on lui fit élever dans la sacristie de Saint-Laurent. |