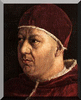HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXIII. — MARIGNAN. - MATHIEU SCHINNER. - 1515.
|
Dans la prévision
d’une invasion nouvelle des Français en Italie, Léon X cherche à gagner
Venise. - Bembo échoue dans sa mission. - Mort de Louis XII. - François Ier
forme le projet de reconquérir le Milanais. - Budé, envoyé à Rome, ne peut
réussir à rallier Léon X à la politique du nouveau roi. - Le pape, au premier
bruit de la marche des Français, se hâte de former avec l’empereur
d’Allemagne et le roi d’Espagne une ligue défensive et offensive. - Mathieu
Schinner. - Ses premières années. - Sa vie au camp. - Il marche avec les
Suisses à la rencontre des Français. - Bataille de Marignan. - Défaite des
Suisses. - François Ier s’empare de Milan. Au moment où Léon X travaillait ainsi aux progrès de la civilisation, en dotant Rome d’une université qui n’avait pas eu de modèle en Italie, la paix du monde allait être encore une fois troublée. Nous avons laissé les Français sur le revers des Alpes, après la bataille de Novare, gagnant les montagnes du Dauphiné, et essayant de se rallier dans les plaines du Lyonnais. L’Italie délivrée, le pape avait profité de la détresse de Maximilien, réduit à la dure nécessité de ne pouvoir payer ses soldats, et, moyennant 40.000 ducats d’or, il venait d’acheter de l’empereur la ville et l’État de Modène : heureuse acquisition que Jules II recommandait sur son lit de mort. Parme et Plaisance, réunies à Reggio et à 11Iodène, devaient être données par Léon X en apanage à son frère Julien, pendant que Laurent, fils de Pierre de Médicis, aurait régné sur la Toscane. Les négociations avec l’empereur avaient été conduites si secrètement, qu’on ne les connut qu’après la signature du contrat. Désormais la Romagne était à l’abri d’un coup de main ; avant de s’en rendre maître, il aurait fallu s’emparer de Reggio, de Parme et de Plaisance. Au besoin, l’armée pontificale pouvait se porter de Modène sur Lucques, sur Pise, sure Florence, et couper ainsi les communications de l’ennemi avec Milan et la Lombardie. Grâce à Mathieu Schinner, dévoué de corps et d’âme au saint-siège, les Suisses étaient tout prêts à barrer le chemin des Alpes aux Français, s’ils avaient envie d’envahir l’Italie. En politique habile, et dans la prévision d’une nouvelle expédition contre Milan, le pape entretenait les dispositions hostiles du roi de Naples et de l’empereur Maximilien contre Louis XII ; pourtant il ne rompait pas avec la France ; seulement, à l’exemple de son bisaïeul Une, il cherchait à tirer parti du maintien de l’équilibre européen au profit de sa puissance temporelle. La paix lui permettait de l’agrandir, de l’étendre, et de fonder l’indépendance du saint-siège. Un seul État en Italie s’obstinait à contrarier les combinaisons du pontife ; c’était Venise, qui non seulement refusait de se réconcilier avec l’Empire et Naples, mais restait fidèle à la France : or Venise et la France réunies pouvaient être maîtresses du monde ; il importait donc à Léon X de rompre cette alliance, qui compromettait le salut des autres nations. Jules II eût agi tout autrement que Léon X. Il aurait menacé de son courroux la république ; au besoin, il aurait pris cette épée qui allait si bien à ses mains, et Venise aurait eu peur, comme Mirandole, de la colère du pontife, et se serait décidée à se réconcilier avec les alliés de l’Eglise. Mais Léon X ne savait pas manier le glaive : la parole était l’arme dont il se servait dans ses négociations. Bembo fut donc chargé de porter à Venise les propositions de Sa Sainteté. ?fous connaissons déjà le secrétaire pontifical, orateur disert, qui s’est pris de passion pour Cicéron, qui cadence ses phrases en vrai poète, qui n’a souci que de ne jamais offenser l’oreille par des sons inharmonieux, et qui croit avoir séduit celui qui l’écoute, quand il a pu lui faire entendre sa mélodie de périodes sonores. Dans son voyage de Rome à Venise, l’ambassadeur avait eu tout le temps de préparer la harangue qu’il se proposait de lire au sénat. Son thème officiel était l’avantage d’une alliance offensive et défensive de Venise avec le saint-siège. L’orateur broda sur cet argument de collège des phrases qui, dans l’enceinte du gymnase romain, où professait Béroalde le jeune, auraient été accueillies par des murmures d’admiration, car elles sentaient l’antique. Bembo dérobait à Cicéron ce que tout écolier aurait pu lui voler, la période ou la forme ; mais la pensée ou la vie, il n’avait garde d’y toucher, t’eût été pour lui peine inutile que de l’essayer. La harangue fut admirée des humanistes nombreux de Venise, niais elle lit peu d’impression sur les sénateurs, qui nourrissaient contre Rome de vieux préjugés, apportés en partie de la Grèce par des Hellènes, ennemis de la suprématie du saint-siège. Nous nous rappelons Savonarole. Tous ces sermons éloquents nuis passionnés qu’il prononçait en chaire contre la cour de nome traversaient bien vite la Brenta, et, recueillis à Venise par quelque sénateur enthousiaste, étaient bientôt imprimés et jetés à profusion dans les universités italiennes. De sorte que si jamais l’envie vous prend de posséder les œuvres complètes du moine de Saint-Marc, c’est à Venise et non point à Florence qu’il faudra les chercher. Le sénateur vénitien de cette époque a beaucoup de traits de ressemblance avec notre parlementaire du dix-huitième siècle. Il a peur de l’ambition de la cour de Rome, et garde, dans un repos parfait de conscience, quelques places fortes que la république a volées à l’Église. Le sénat ne répondit officiellement au discours de Bembo qu’au bout de quelques jours. Il s’épuisait dans sa réponse en protestations de dévouement au saint-siège, nais il refusait de rompre avec le roi de France, auquel il communiquait la harangue de l’ambassadeur : déloyauté qu’il est bien difficile de justifier. Il est probable que, si la mort ne fût venue le surprendre, Louis XII eût rompu subitement avec le pape. On dirait que Bembo craignit de reparaître au Vatican ; car, au lieu de retourner auprès de Léon X, il chargea son ami Augustin Beazzano de porter à Rome la déclaration de la république vénitienne, pendant qu’il s’arrêtait à Pesaro, auprès d’Æmilia Pia et d’Élisabeth, veuve de Guidubald de Montefeltro, duc d’Urbin, et qu’il oubliait dans la société de ces femmes sa malencontreuse ambassade. Nous sommes sûr que Jules II ne se serait pas contenté de l’excuse imaginée par le négociateur : il n’aurait pas cru vraisemblablement à la maladie de Bembo. Pendant que l’humaniste essayait vainement de rallier Venise à la politique du saint-siège, survenait un, de ces événements qui déjouent toutes les combinaisons. Louis XII mourait le premier janvier 1515, réconcilié avec Rome, après avoir reconnu solennellement le concile de Latran, déploré le schisme qu’il avait favorisé, et promis d’abolir la pragmatique sanction, source de si graves désordres dans l’Église de France. Le prince qui lui succédait, François d’Angoulême, était jeune, beau, bien fait, ami des lettres presque autant que des femmes, d’une vive imagination, d’un courage à toute épreuve, et avide de plaisirs et de gloire. On l’avait vu assister à Bourres aux leçons d’Alciati, écoutant attentivement les poétiques paroles que le professeur italien jetait jusque dans l’enseignement du droit, et, ravi comme tout l’auditoire, attacher sa chaîne d’or au cou du maître en signe d’admiration. De toutes les conquêtes de Charles VIII en Italie, il ne nous restait que quelques hommes, Lascaris entre autres, que le duc d’Angoulême, le roi futur, avait pris sous sa protection. En montant sur le trône, François Ier avait ajouté à tous ses titres celui de duc de Milan, que sa femme, madame Claude, comme héritière des droits de Louis XII, son père, lui avait transféré en échange du duché d’Anjou, que le monarque cédait à madame Renée, l’autre fille de Louis XII. Les historiens de François Ier se plaisent à décrire la jeunesse de ce prince. On le voit prêter une oreille attentive aux exploits de nos soldats en Italie, aux récits du siége de Brescia, de la bataille de Ravenne, et pleurer quand Gaston de Foix meurt si glorieusement, regretté de ses ennemis eux-mêmes. Le titre de duc de Milan, qu’il venait de prendre, indiquait assez qu’il se chargeait de venger Gaston. Aussi jeune que le duc de Nemours, il n’était ni moins brave ni moins chevaleresque, et il eût donné volontiers sa couronne pour mourir aussi noblement que ce héros. La conquête du Milanais fut décidée ; nais il fallait que François cachât ses desseins aux puissances chrétiennes. Ln même temps qu’il organisait les préparatifs d’une nouvelle expédition en Italie, il leur faisait faire des ouvertures pour le rétablissement et le maintien de la paix. Il voulut connaître les dispositions de la cour de Rome ; Budé fut choisi pour ambassadeur auprès du saint-siège. Budé avait tout ce qui pouvait plaire à Léon X : il partait le latin comme Bembo, le grec comme Chalcondyle ; il savait sa Rome antique comme Pomponio Leto, et en belles manières il aurait pu le disputer à Bibbiena lui-même. Tout récemment il avait imprimé un traité sur les monnaies du Latium, œuvre d’antiquaire qui devait répandre son nom en Italie ; et il travaillait à des commentaires sur la langue grecque, un de ces livres d’érudition qui demanderaient, ce semble, pour être composés, plusieurs siècles passés dans un couvent. Budé fut accueilli du pape avec une extrême bienveillance ; il vit les humanistes de Rome ; il fut fêté par Sadolet, mais ne put déterminer le saint-siège à s’allier ouvertement à François Ier. Le roi croyait au succès de son ambassadeur, et plus encore, peut-être, à la reconnaissance de Léon Ÿ, dont le cousin, le cardinal Jules, venait d’être récemment nommé archevêque de Narbonne. Il aimait les Médicis, et plus d’une fois il s’était montré disposé à servir les intérêts de cette maison. Il comprit, du reste, la politique du pape, qui refusait d’unir ses armes à celles de la France, et qui préférait, comme père commun des fidèles, garder le beau rôle de médiateur et d’arbitre dans les querelles qui pourraient survenir entre les puissances du continent. Comme prince temporel, Léon X avait aussi des devoirs à remplir. Si, dans la lutte qui se préparait, le vainqueur voulait s’emparer des villes de Partie et de Plaisance, que Jules II avait réunies aux États de l’Église ; rétablir les Bentivogli, qu’il avait chassés de Bologne ; restituer au duc de Ferrare Modène et Reggio, qu’il lui avait enlevés ; relever ces feudataires du saint-siège, qu’il avait abattus ; l’ombre du grand pontife serait sortie de son tombeau pour dire à Léon qu’il devait défendre le patrimoine de Saint Pierre en recourant aux armes. François Ier fut plus heureux en Angleterre et à la cour du prince Charles de Bourgogne, petit-fils de l’empereur Maximilien. A Venise, les vieux sénateurs, qui avaient à peine écouté l’envoyé du pape, se décidèrent à renouveler l’alliance conclue avec Louis XII. A Gênes, Octavien Frégose, qui devait la vie peut-être à l’intervention de Léon X, promit aide et secours au roi de France. L’attitude de Léon X n’avait rien de menaçant pour François Ier, qui continuait ses préparatifs d’invasion en Italie. L’armée qu’il rassemblait dans le Dauphiné, et qu’il destinait à envahir le Milanais, était magnifique, bien plus belle que celle qu’avait conduite le roi Louis XII. Elle comptait 3.000 lances françaises, 26.000 lansquenets des Pays-Bas, 10.000 Gascons et Basques, 10.000 fantassins français, 1.500 hommes de cavalerie légère, 6 compagnies de reîtres italiens, et 72 pièces de canon de divers calibres. Les officiers avaient fait leurs preuves dans les dernières guerres. Nous connaissons déjà ce vieux Pierre de Navarre, immobile comme un roc au milieu des balles et des boulets dont il n’a guère été respecté, et qui, ne pouvant trouver la mort sur le champ de bataille, tomba prisonnier dans les mains des Français à Ravenne. A l’avènement du duc d’Angoulême à la couronne, Navarre appartenait encore à Longueville, qui l’avait reçu de Louis XII, et qui en demandait 20.000 écus d’or, destinés à payer une partie de la rançon à laquelle le duc avait été taxé lui-même en Angleterre. Le roi d’Espagne marchandait ; François Ier les offrit ; mais le capitaine voulait donner la préférence à son maître. Le roi continuait de marchander ; François compta la somme, et, quitte désormais envers son souverain, Pierre de Navarre tendit la main au roi de France, auquel il jura fidélité. Sa parole valait tout l’or que Christophe Colomb avait trouvé en Amérique, et son nom, plus que la rançon qu’on avait payée pour sa liberté. Ce nom était connu surtout parmi les Basques, qui, au premier appel de leur ancien chef, descendirent de leurs montagnes an nombre de près de 10.000, et vinrent se ranger sous son étendard. Les autres capitaines étaient tous des militaires renommés. Le duc Charles-Egmond de Gueldre commandait les lansquenets ; Tavanes, cette terrible bande noire, la terreur de l’ennemi, auquel elle faisait rarement quartier ; le duc de Suffolk, le comte de Wolf-Brandech et Michel d’Oppenberg marchaient à l’avant-garde. La Trémoille et le maréchal de Lautrec étaient à la tête de la chevalerie ; le duc d’Alençon conduisait l’arrière-garde. Infanterie, cavalerie, artillerie, se trouvèrent réunies à jour fixe à la lisière du Dauphiné, prêtes, au signal du prince, à s’ébranler pour envahir l’Italie, pendant qu’une flottille qui portait 400 hommes d’armes et 5.000 fantassins longerait les côtes de la Méditerranée et s’avancerait à pleines voiles sur Gênes. Les moments étaient précieux. Mathieu Schinner, qui avait prêté sa maison de l’Esquilin à Léon X pour y loger les humanistes, était en ce moment en Suisse, occupé à surveiller les mouvements de l’armée française. Il avait conçu un projet hardi, dont il s’était hâté de faire part à l’empereur : c’était de se jeter en France avec tous ses montagnards, pourvu qu’il eût la promesse d’être soutenu dans cette fabuleuse irruption. Schinner était si sûr de lui et de ses Suisses, qu’il ne demandait que 3.000 chevaux pour appuyer son invasion. L’empereur les lui refusa. Au premier bruit de la marche des Français, Léon X s’était empressé de conclure avec le roi d’Espagne et l’empereur d’Allemagne une ligue défensive et offensive. Les alliés faisaient de sérieux préparatifs de défense. Le péril était grand, pour le saint-siège surtout ; car, maître de Milan, François Ier voudrait nécessairement reprendre Parme et Plaisance, que Jules II avait enlevés aux Sforce. Il fallait sauver ces conquêtes. Léon X fut l’âme de la confédération italique, où le danger commun réunit bientôt, outre les monarques que nous venons de nommer, les ducs de Florence et de Milan. Le pape donna le commandement de, ses troupes à Julien son frère, après avoir béni les drapeaux et le bâton du général. Julien partit pour Milan, accompagné de la noblesse des deux grandes maisons romaines si longtemps ennemies du saint-siège, mais réconciliées avec l’Église depuis l’avènement de Léon X au trône, et qui allaient gaîment verser leur sang pour un maître qu’elles avaient fait trembler autrefois. La confédération ne fut pas heureuse. Au premier bruit de la marche des Français, Milan se souleva et chassa Maximilien, grand enfant sous la tutelle des Suisses, que, dans sa pénurie affreuse, il était obligé de payer en fausse monnaie qu’il faisait frapper exprès pour mettre un terme à des murmures qui l’étourdissaient. Octavien Frégose, sans avoir encore aperçu du môle de Gênes les voiles françaises, se dépouilla de son hermine dogale, prit le titre de gouverneur de la cité au nom du duc de Milan, François Ier, et ouvrit le port et les portes de la ville à Aymar de Prie, qui s’empara bientôt d’Alexandrie, de Tortone et d’Asti. Prosper Colonne, le capitaine le plus expérimenté de son temps, qui s’était vanté de prendre comme au trébuchet ces beaux oiseaux qu’on nommait Français, tombait, au moment ou il allait s’asseoir pour dîner, au pouvoir de ces oiseaux qui étaient de la nature des aigles. Car ils avaient franchi les Alpes comme s’ils eussent eu des ailes. Les Suisses nous attendaient, l’arme au poing, sur la route de Grenoble à Suze. Les autres chemins n’étaient praticables que pour l’ours des montagnes, hérissés et coupés qu’ils étaient de rochers, de torrents, de précipices, de neiges et de glaces. En moins de huit jours, les rochers étaient abattus, les précipices comblés, les torrents mis à sec, les neiges fondues, les glaciers abaissés ; et nos 72 pièces de canon, avec leurs affûts, portées à dos d’homme, traversaient des solitudes où jamais le pied d’un homme ne s’était posé. On croit lire un récit des Mille et une Nuits. Tout à coup, quand il n’y a plus qu’un pas à faire pour entrer en Italie, dont on aperçoit déjà le ciel lumineux, un roc de plusieurs centaines de pieds se dresse devant les Français. Navarre, l’Espagnol, se charge de le reconnaître. Il aperçoit dans les flancs de la montagne une ligne bleuâtre qui la traverse en zigzag ; cette ligne est trouée, remplie de poudre, et le roc saute en l’air avec une explosion affreuse, et se partage en deux, laissant un libre passage aux assaillants : l’Italie était conquise. Prosper Colonne restait tranquille à Carmagnole avec cinq cents hommes de toutes armes. Un détachement de l’armée française, après avoir traversé l’Argentière, longé la vallée de la Stura jusqu’à Rocca Sparviera, prend un sentier de mulets, entre dans la vallée de Grana, atteint Savigliano, et va se heurter contre Carmagnole. Colonne, averti par les coureurs du cardinal de Sion, se met en route pour rejoindre les Suisses à Pignerol. Entre lui et l’armée française est un fleuve qui nulle part n’est guéable : c’est le Pô. Il s’arrête donc un moment à Villefranche pour faire reposer ses soldats ; là, après avoir posé des sentinelles aux portes de la ville, il se met à table avec ses officiers, quand tout à coup Bayard, La Palice, Imbercourt, d’Aubigny, qui avaient pénétré en Italie par Briançon et Sestrière, entrent dans la salle du festin et font prisonniers tous les convives. Le malheureux essaya de se justifier. Que voulez-vous ? disait-il dans un mémoire qu’il publia ; j’en prends Dieu à témoin : le passage par où pouvaient pénétrer les Français était gardé par les Suisses ; le seul fleuve qu’ils pouvaient traverser était gros de neiges récemment fondues : on prévient des hommes, on ne prévient pas des miracles. Quelque chose d’aussi merveilleux que cette expédition à la manière des oiseaux de proie, c’est la frayeur qui saisit chacun des alliés du saint-siège. Maximilien l’empereur laisse don Raimond de Cardonne se morfondre à Vérone, dans l’attente de secours d’hommes qu’on lui promettait hier encore et qu’il n’obtiendra pas ; Ferdinand le Catholique, qui avait trouvé trop chère à vingt mille ducats la rançon du capitaine Pierre de Navarre, qui faisait sauter les rochers à la manière d’Annibal, garde prudemment l’argent qu’il a promis aux Suisses ; Charles III, duc de Savoie, reçoit splendidement François I et tâche de détacher les Suisses de la confédération ; les Suisses, mal pavés, commencent à prêter l’oreille aux propositions du prince ; les contingents de Berne, de Biel, de Fribourg et de Soleure, se mutinent et gagnent Arona, pendant que le reste des cantons fidèles marche sur Gallerate. Le pape seul faisait noblement son devoir : ses conseillers, Bibbiena entre autres, le pressaient de se rapprocher de François Ier, et d’abandonner volontairement Bologne, où les Bentivogli allaient chercher à rentrer, pendant que le duc de Ferrare profiterait de la conquête du Milanais pour recouvrer Modène et Reggio. Ils prétendaient qu’une résistance inutile compromettrait la sûreté des Etats de l’Église. Mais Jules, alors légat du saint-siège à Bologne, n’eut pas de peine à triompher de ces conseils pusillanimes, en montrant au pape le sort dont étaient menacés tant d’hommes généreux qui s’étaient compromis pour soutenir les intérêts de l’Église, si l’on abandonnait cette place, un des plus beaux joyaux de la couronne pontificale. Le pape écouta cet avis, et résolut d’attendre l’événement, sans céder une seule parcelle de cette terre acquise si noblement par Jules II, a moins qu’il n’y fût contraint par la force. La lutte, d’ailleurs, n’était pas finie ; les Suisses des petits cantons d’Uri, d’Unterwald, de Schwytz et de Glaris, s’avançaient à marches forcées sur Monza, pour couvrir Milan. Ils étaient au nombre de plus de trente mille, et avaient pour chef Mathieu Schinner, évêque de Sion, cardinal de la sainte Église et légat en Lombardie sous Jules II. Ce seul homme valait une armée. Depuis Mézerai jusqu’à M. Sismonde Sismondi, les historiens qui ont raconté les expéditions des Français en Italie n’ont donné dans leurs récits qu’un rôle odieux à l’évêque de Sion, Mathieu Schinner : c’est dans les annales allemandes, italiennes et suisses, qu’il faut étudier une des plus belles figures de la renaissance. A Sion on chante, dans de vieilles ballades, les hauts faits de ce prélat, dont on montre le, château en ruine, comme dans la vallée de l’Isère on arrête le voyageur pour lui faire voir l’habitation de Bavard. C’est des récits des historiens étrangers, de la correspondance de Pierre Martvr d’Angbieria, des légendes valaisanes, des manuscrits de l’abbaye de Saint-Maurice, que nous nous sommes aidé pour connaître le rôle que ce prélat joua dans les événements militaires du seizième siècle. Est-ce notre faute si notre appréciation ne ressemble pas à celle d’historiens qui, esclaves d’un faux patriotisme, ne peuvent se résoudre à rendre justice à un ennemi, surtout quand cet ennemi porte une robe ronde ou violette ? Nous ne partageons ni leurs antipathies ni leurs préjugés. Mathieu Schinner naquit à Muhlibach, petit village valaisan, dans le dizain de Couches, de pauvres gens qui cultivaient la terre. En Suisse, au moyen-âge, il y avait dans les grandes villes des écoles presque toujours tenues par des moines, où l’enfant pouvait aller apprendre à lire, et, s’il avait reçu du ciel d’heureuses dispositions, s’instruire dans les lettres humaines ; mais la science ne lui était pas donnée gratuitement, comme en Italie. La leçon finie, l’écolier, en Saxe, allait chanter sous la fenêtre des riches ; presque toujours la fenêtre s’ouvrait, et une femme paraissait qui jetait un grœschen au petit mendiant : le pain que ce liard l’aidait à acheter s’appelait le pain du bon Dieu, panis propter Deum. Je vois d’ici cette maison de bois d’Eisenach, vieille de plusieurs siècles, et qu’habitait Cotta quand Martin Luther, fils de Hans Luther de Mœhra, vint chanter son cantique de Noël pour demander l’aumône : les grands l’avaient repoussé, la pauvre veuve lui sourit, et lui donna quelques pièces de monnaie qu’if baisa dévotement. En Suisse, l’écolier chantait aussi, mais sur la place publique, quelque vieil air montagnard, puis il faisait le tour du cercle que sa voix avait formé, et, son bonnet à la main, mendiait sans rougir le pain du bon Dieu. Un jour, parmi les auditeurs de Mathieu de Muhlibach, se trouvait un vieillard qui, ravi de la figure de l’enfant, l’appela, l’interrogea, et se tournant vers les assistants, leur dit : Cet écolier sera votre évêque. Il disait évêque comme aujourd’hui nous dirions empereur ou roi ; car en Suisse l’évêque était le roi de la science, et par conséquent le monarque des intelligences. Mathieu apprit donc à lire à Sion. De Sion nous le voyons passer à Zurich, et de Zurich à Côme, où, sous Théodore Lucino, il étudie les lettres. L’enfant ne mendiait plus ; il avait, à force de travail et de succès, conquis le droit de s’asseoir sur les bancs de l’école : à dix-sept ans il savait le grec, l’italien et l’allemand. On assure qu’il avait peu de goût pour les poètes profanes de l’antiquité : il préférait Boëce à Virgile. Après l’Évangile, c’est le livre de Consolatione qu’il feuilletait le plus souvent. II disait, dans un vague pressentiment d’avenir, qu’il aurait un jour plus besoin de philosophie que de poésie. C’était, du reste, une de ces âmes contemplatives, comme on en trouve dans les pays de montagnes, qui se plaisent sur les hauts lieux, auprès d’un torrent ou d’une avalanche, partout où la nature physique étale quelque horreur. Schinner, à peine entré dans les ordres, était appelé à desservir une petite cure dans un village, où sa piété, dit la chronique, jeta toutes sortes de bonnes odeurs. L’évêque de Sion voulut se l’attacher et le lit chanoine de la cathédrale. A Sion, la chronique encore nous le représente prêchant le matin et le soir la parole de Dieu, apaisant les discordes, priant, et vivant dans la chasteté, si bien que, l’évêque étant mort, il fut choisi par le peuple pour administrer le diocèse : Jules II confirma l’élection. La prédiction du vieillard s’était accomplie. Avec son coup d’œil d’aigle, le pape avait bien vite deviné le prêtre valaisan. Nous nous rappelons le cri que Jules Il avait jeté quand le sacré collège, à l’unanimité, lui donna la tiare : Seigneur, délivrez-nous des barbares. Les barbares, c’étaient ces Français que Charles VIII avait amenés en Italie. L’évêque de Sion comprit le sens de cette prière, et se mit à l’œuvre pour aider Sa Sainteté à chasser les Français : œuvre, selon lui, toute catholique d’abord, car les Français en Italie, c’était la papauté captive ; œuvre patriotique ensuite, car, François Ier à Milan, la Suisse n’avait plus d’Alpes. Or, comme chrétien et comme Suisse, Mathieu Schinner voulait la double indépendance de son pays et du saint-siège. S’il eût vécu du temps de la domination autrichienne, il agirait prêté sur le Grutli le serment des trois libérateurs : il avait leur foi, leur courage, leur piété. Son Gessler, c’était François Ier. Pour en délivrer la Suisse, il aurait volontiers pris l’arc de Guillaume Tell. A défaut d’arbalète, il avait sous sa soutane un crucifix qu’il agitait au moment où le cor d’Uri sonnait la charge. Du haut du tertre où la balle ennemie pouvait facilement l’atteindre, il jugeait des coups de lance que ses montagnards portaient aux Français. Ses soldats l’aimaient et l’admiraient ; il savait les fasciner de la voix, de la parole et du regard. Il couchait sur la neige comme le dernier goujat ; il escaladait les pics de glace comme un chasseur de chamois, et vivait au camp comme un ascète, jeûnant plusieurs fois la semaine, ne mangeant jamais de viande, ne buvant que de l’eau, disant son bréviaire le matin et le soir, et restant en prière des heures entières la veille d’une bataille. Les historiens disent que jamais, depuis saint Bernard, parole sacerdotale n’avait été entraînante comme celle de l’évêque de Sion. A sa voix, Uri, Unterwald, Zug, Schwytz, c’est-à-dire les cantons en qui vit le souvenir du Grutli, s’ébranlent pour porter secours à l’Église menacée, guidés par Schinner, qui n’a pas plus peur du canon que des balles. On le trouve aux avant-postes, au centre, à l’arrière-garde, partout où il y a une lance à affronter, l’âme d’un soldat mourant à recommander à Dieu, un fuyard à ramener, un rocher à rouler sur l’ennemi. Winkelried n’était pas plus audacieux, l’ermite Nicolas de Flue plus confiant en Dieu, le soldat de -Morat plus amoureux du sol natal. Jules II devait récompenser tant de zèle pour le saint-siège : il nomma l’évêque de Sion cardinal du titre de Sancta-Potentiana et légat en Lombardie. C’était en 1512. Pâris de Grassi nous a donné quelques détails sur la cérémonie où l’évêque de Sion vint recevoir à Rome les insignes de légat. Le pape était sur son trône. L’évêque, ayant à ses côtés deux cardinaux, s’avance, fléchit le genou et reçoit de la main du pontife une croix d’or. De par cette sainte croix, dit le pape au légat, marche, triomphe et règne : in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. — Amen, répond l’évêque en baisant le pied, la main et la joue de Sa Sainteté. Et quelques jours après il marchait, et, revêtu du signe dont on l’avait armé, il triomphait des Français à Novare, puis rentrait dans son diocèse pour chanter un Te Deum en action de grâces, prêt à reparaître si ses ennemis repassaient les Alpes ; mais il avait eu soin de les garnir de lances et de canons, se reposant du reste, pour dormir tranquille, sur ces pics de neiges et de glaces, seul chemin par où, cette fois, les Français pouvaient pénétrer en Italie. Il aurait dû savoir à quel ennemi il avait affaire : les Français escaladèrent ces rochers. Ils n’étaient plus qu’à quelques journées de Milan, quand les Suisses, au nombre d’environ douze mille, appartenant en partie aux cantons de Fribourg et de Soleure, de Watteville à leur tête, prennent peur et gagnent le chemin d’Arona pour retourner dans leurs montagnes. Le cardinal est accouru ; il compte sur cette parole miraculeuse que Dieu lui donna ; il se présente aux fuyards, les harangue, et en ramène un bon nombre, tambour battant, jusqu’à Milan, où ses paysans des Waldstetten saluent son arrivée de leurs acclamations. Aussitôt, au son du tambourin, il rassemble ses soldats sur la place du Château, et là, dit le maréchal de Fleuranges, fait faire un rond, et lui au milieu en une chaise, comme un renard qui prêche des poules, leur adresse un discours. Le renard était un vrai lion : nous allons voir ce qu’étaient les poules dont parle le maréchal. C’était le 13 septembre (1515), au soir. Quelques heures de jour restaient encore. Les Suisses, au signal de Mathieu Schinner qui les précède en habits pontificaux, s’ébranlent et marchent sur San-Donato, qu’occupait l’armée française. De la position des confédérés, une digue élevée traversait de riantes prairies et conduisait au camp français, qui était assis au couchant, sur trois lignes séparées entre elles par des terre-pleins où l’armée était échelonnée. Le camp était adossé aux ruines d’un temple païen élevé par l’empereur Julien. Le roi était au centre, le duc d’Alençon à l’arrière-garde, le connétable de Bourbon au pied des débris antiques. La plaine où se déployait l’armée française s’étendait jusqu’au Tessin, entre une double ligne de collines légèrement ondulées et couvertes de maisons de plaisance. A droite du camp coulait le Lambro, qui arrosait de ses eaux une partie de la plaine entrecoupée de bouquets de bois, d’arbres fruitiers et de plants de vignes que protégeaient des arbres séculaires ; çà et là quelques habitations rurales variaient le paysage. De larges fossés avaient été creusés par Pierre de Navarre le long de la droite du camp, et remplis par le Lambro ; soixante-quatorze pièces de gros calibre battaient toutes les avenues. Les boucliers des archers, placés sur le parapet dans toute la longueur du front, et fortement liés entre eux, défiaient toute espèce d’attaque. Le bourgmestre Rust conduisait l’aile droite des Suisses, composée des gens de Zurich, de Schaffhouse et de Coire ; les bourgmestres de Lucerne et de Bâle menaient l’aile gauche. L’artillerie, composée de quatre coulevrines, était commandée par le capitaine Pontely, de Fribourg ; l’arrière-garde obéissait à Werner Steiner de Zug. Werner Steiner va se heurter comme un furieux contre les retranchements ennemis, où il est reçu à grands coups de canon ; il hésite, fléchit, et, écharpé par des décharges d’artillerie, va lâcher pied, quand, la lance au poing, accourt notre évêque avec ses montagnards. Le combat recommence. Cette fois c’est la ligne ennemie qui se rompt ; c’est l’artillerie de Pierre de Navarre dont le feu s’affaiblit ; c’est le canon français, qui a traversé à bras d’homme les Alpes helvétiques, dont s’empare ce bataillon d’enfants perdus qu’on reconnaît aux plumes blanches flottant sur leurs têtes. Le moment était critique, et, si le roi ne fût accouru, prenant en flanc les Suisses, le renard aurait conduit ses poules dans l’église de San-Donato pour chanter un nouveau 7e Deum. Animés par la voix du cardinal, qui au cri de France répond par le cri d’Uri, les montagnards résistent au choc, se servent de leurs courtes épées pour couper les jarrets de leurs adversaires, meurent et donnent la mort. Le carnage fut affreux : la nuit y mit fin. Les Français rentrèrent, sans être inquiétés, dans leurs retranchements ; les Suisses couchèrent sur le champ de bataille, François Ier sur un affût de canon. Mais la journée avait été belle pour les Suisses, qui s’étaient emparés d’une batterie française de huit pièces de canon qu’ils avaient aussitôt tournés contre l’ennemi ; la première ligne, commandée par le connétable de Bourbon, avait été mise en déroute, et Bayard lui-même avait été obligé de reculer. Pendant toute l’action, Schinner n’avait pas un moment quitté les premiers rangs. La bataille finie, il s’était occupé d’envoyer des vivres et des munitions à ses montagnards ; et, si on l’eût écouté, ses géants, c’est le nom qu’il donna cette nuit à ses soldats, seraient rentrés à Milan pour réparer leurs pertes ; et peut-être qu’il eût triomphé de l’irrésolution des chefs, qu’il avait formés en conseil de guerre, si quelques boulets français, qui vinrent tomber sur le tertre où les Suisses délibéraient, n’eussent forcé le conseil à se séparer. Au point du jour, les Suisses se réveillaient à la voix de Schinner, se jetaient à genoux pour faire à Dieu leur prière du matin, leur prière suprême peut-être, et écouter la harangue de leur chef. Guichardin, amoureux de l’antiquité, met dans la bouche de Schinner un discours dont la phrase se déploie et s’enroule comme celle de Tite-Live. Nous préférons le récit de Pierre Martyr d’Anghieria, qui, n’étant qu’à quelques lieues du champ de bataille, a pu recueillir des fuyards les paroles du cardinal. Sa harangue est courte, et sent Tacite ou Salluste, et beaucoup plus, il faut l’avouer, le soldat que le prêtre. Compagnons, leur dit-il, rappelez-vous Novare. Là vous étiez un contre dix, et vous avez mis en fuite les Français, et vous les avez chassés de l’Italie ! Ils se relèvent en front de bandière, et, aux sons rauques du cor alpestre, marchent à l’ennemi tous à la fois, à travers les corps de leurs frères tués la veille, qui jonchaient le terrain. Le choc fut terrible. Rust, le Zurichois, donne tête baissée dans les rangs des lansquenets, qui, étourdis du coup, chancellent, se débandent, se rallient aussitôt, et de nouveau sont obligés de reculer. Les Suisses avancent, mais lentement, sous le feu d’une artillerie terrible qui les protége. Les lignes françaises, trouées de toutes parts, étaient gravement compromises, quand le roi en personne arrive à la tête de ses gendarmes, se jette au plus fort de la mêlée, et ranime le courage des lansquenets, qui reviennent à la charge. La lutte renaît avec des chances variées, on crie victoire dans les deux camps : la victoire est encore incertaine ; Suisses et Français agitent des drapeaux enlevés à l’ennemi, en signe d’allégresse. Si l’artillerie du duc de Bourbon fait de larges brèches dans les rangs des montagnards, l’épée des hommes d’Uri, de Zug et d’Unterwald, est tachée glorieusement du sang français. Tout à coup, au plus fort de la mêlée, on entend crier : San-Marco ! San-Marco ! C’est d’Alviane qui arrive avec ses cavaliers, mais dont l’attaque est repoussée. Les deux ailes de l’armée française continuent le combat, mais mollement, et finissent par fléchir, laissant le centre aux prises avec l’ennemi, lorsque le gros de l’armée vénitienne survient pour prendre part à l’action : il y eut un moment d’hésitation parmi les Suisses. En ce moment, Trivulce fait rompre la digue du Lambro, dont les flots inondent le terrain occupé par les montagnards, qui ont deux ennemis à combattre : les Français dont le feu redouble d’activité, car l’instant est décisif ; et le soi trempé, glissant, qui se dérobait sous leurs pieds. II fallait céder. Les divers corps se réunissent, se rallient, et, par un mouvement combiné, se retirent, mais l’arme au bras, la mine fière, les rangs serrés, dans un silence lugubre, emportant avec eux leurs caissons, leurs canons, leurs bagages, leurs blessés, leurs prisonniers, et douze belles bannières de lansquenets, trophées de la journée. Une seule enseigne leur manquait, mais qu’ils avaient perdue et qui n’avait point été enlevée : le taureau d’Uri. Le roi ne veut pas qu’on les inquiète dans leur retraite ; mais les lansquenets se précipitent pour reprendre leurs drapeaux : peine inutile. Rodolphe et Dietig Salis font chèrement payer leur désobéissance à ces bandes indisciplinées. Tel est le récit incomplet, décoloré, de cette journée de Marignan, où périt la fleur de la noblesse française, et où 15.000 Suisses consentirent à mourir et non point à reculer. Les vaincus avaient pris le chemin de Milan. En route, la nuit, une des compagnies qui avaient le plus souffert s’arrêta, pour se reposer, dans une misérable grange. Le lendemain, la grange était cernée par les chevau-légers des Vénitiens, et les Suisses sommés de se rendre à discrétion. — Les Suisses ne se rendent jamais, dit le commandant. — En ce cas, on vous brûlera. — Brûlez-nous ! Et on les brûla. A Milan, les Suisses tinrent conseil et parlèrent de paix. Schinner, cet autre Annibal, aima mieux s’exiler que de traiter avec les Français. Il quitta donc Milan et se rendit à Inspruck. A Rome, dans l’église de Santa-Maria della Pietà, nous avons vu la tombe où reposent les restes de Schinner : c’était le soir, au soleil couchant. Seul, dans cette demeure silencieuse, il nous sembla que le sépulcre s’ouvrait, et que le cardinal nous apparaissait, comme à Marignan, le glaive des évêques de Sion à la main, le front haut, le menton sillonné de rides noires et profondes, l’œil gauche à demi fermé, tel que nous le représentent les images répandues dans le Valais. Reste dans ce tombeau, ombre illustre, sans crainte d’outrage de quiconque comprendra l’époque où tu vivais, et cette loi des temps féodaux qui te forçait, comme tant d’autres archevêques allemands, à revêtir le casque. Qu’importe que des historiens passionnés aient tenté d’outrager ta mémoire ! n’as-tu pas, pour la protéger, les louanges de Jules II, de Léon X, d’Adrien VI, qui célébrèrent tes vertus ? N’as-tu pas laissé parmi tes lettres ces lignes que t’adressait Érasme, qui ne flatta guère la pourpre : Médicis est mort ; je souhaite au saint-siège un homme qui vous ressemble ; à dire vrai, en connaissez-vous un qui ressemble plus à Votre Éminence que Votre Éminence elle-même ? N’as-tu pas pour toi ces mots du roi-chevalier, qui disait à Paul Jove : Rude homme que ce Schinner, dont la parole m’a fait plus de mal que toutes les lances de ses montagnards ! Les historiens de tous les partis s’accordent à célébrer le courage héroïque de François Ier dans cette terrible affaire. Pendant près de vingt-huit heures il ne mangea ni ne dormit. Deux fois le sort de l’armée était compromis, quand le prince, monté sure son cheval de bataille, sans crainte des boulets ennemis, arrive pour arrêter les Suisses. Il portait à Marignan une cotte d’armes d’azur semée de fleurs de lis d’or et un casque orné d’escarboucles, afin, disait-il, qu’on le vît de plus loin. La bataille gagnée, il voulut donner l’accolade à Bayard. Certes, ma bonne épée, s’écria le guerrier après qu’il eut été reçu chevalier par le roi, vous serez moult bien gardée et sur toutes autres honorée, et ne vous porterai jamais si ce n’est contre Turcs, Maures ou Sarrasins. Quand François aperçut le connétable de Bourbon, il lui dit en riant : Tu ne t’es épargné dans cette affaire non plus qu’un sanglier. Il porta la main à son casque en signe de respect et d’admiration, au moment où Trivulce venait pour le féliciter sur cette heureuse journée. Trivulce, qui s’était trouvé à dix-sept batailles rangées, disait que ce n’étaient que des jeux d’enfants auprès de celle de Marignan, vrai combat de géants. Les lansquenets se battirent admirablement à Marignan race barbare et corrompue, dit un vieil historien, dont le métier est de tailler, couper, voler, brûler, tuer, paillarder, blasphémer, faire des veuves et des orphelins ; garnements qui voleraient comme les mouches autour du diable, si le diable voulait les payer généreusement. Sur le champ de bataille de Marignan encore teint de sang, le roi donna l’ordre de célébrer trois messes solennelles, où les vainqueurs assistèrent sous les armes : l’une en signe de joie, pour remercier Dieu de la protection qu’il accordait à la France ; l’autre en signe de douleur, pour l’âme de tant de braves tombés si glorieusement ; la troisième en signe d’espérance, pour le rétablissement de la paix. Une petite chapelle, où l’on aurait recueilli les restes des chefs de l’armée française, devait porter aux siècles à venir le témoignage de la piété du prince envers celui qui donne et ôte les couronnes, et de sa reconnaissance pour les soldats morts à ses côtés. Les Suisses, après le départ du cardinal de Sion, sortirent de Milan, enseignes déployées et tambour battant, et rentrèrent, sans être inquiétés, dans leurs foyers. Ceux qui défendaient le château, où s’était enfermé Maximilien, étaient résolus à tenir jusqu’à la dernière extrémité ; mais le prince, au premier bruit de l’artillerie de Pierre de Navarre, prit peur, et, malgré les représentations de son conseiller Morone, voulut entrer en pourparler avec le vainqueur. Les conditions furent bientôt réglées : Maximilien renonçait à la souveraineté de Milan, en échange d’une pension annuelle de quelques milliers de florins et du titre de maître d’hôtel de Sa Majesté le roi de France. C’était faire bon marché de l’héritage des Sforce : l’ombre de Louis le More dut tressaillir dans sa tombe. Les Suisses résistaient encore ; il fallut, pour les contraindre à céder le château, un ordre signé de Maximilien, qui leur déclarait que, malgré leur opposition, il avait, par la force de sa volonté souveraine, disposé du château et de sa personne ducale en faveur du roi très chrétien. L’entrée de François Ier dans Milan fait magnifique ; on le complimenta en vers et en prose : la prose ne valait pas les vers. Il est vrai que ces vers étaient de Jean-Baptiste Egnazio, un des plus doctes humanistes de l’époque, et que Venise avait choisi pour féliciter Sa Majesté. Ce poème, où l’auteur célèbre les exploits des Français, fut imprimé plus tard, dédié au chancelier Duprat, et valut à l’auteur le médaillon en or du monarque. Un moment ces chants de joie cessèrent : Alviane venait de mourir à Ghedo le 1er octobre (1515). L’armée voulait transporter à Venise les restes de l’illustre capitaine ; mais il aurait fallu que Marc-Antoine Colonne consentit à laisser passer le cadavre, et Théodore Trivulce, fils du maréchal de France, ne voulut pas qu’on demandât un libre passage pour le corps d’un homme qui, vivant, n’avait pas besoin de permission pour forcer les lignes ennemies. André Navagero fut chargé de l’oraison funèbre du général. Il en fait un vaillant homme d’armes, un soldat sans peur, quelque chose d’antique. Alviane se délassait, dans la culture des lettres, des travaux de la vie militaire. Il fonda à Pordenone une académie qui devint bientôt célèbre ; il devina les talents poétiques de Jérôme Fracastor. L’Italie lui doit ce poète, dont il protégea l’enfance : pour nous, Fracastor vaut mieux que ses plus belles victoires. Alviane eût pu facilement faire sa fortune dans les guerres d’Italie ; il préféra mourir pauvre, et laisser à Venise le soin de donner du pain à la veuve et aux enfants d’un des plus célèbres capitaines de l’époque. |