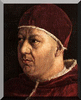HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXI. — LA VATICANE. - TACITE. - MANUSCRITS. - 1514-1515.
|
La sacristie sert
d’abord de bibliothèque à nos églises. - Premières bibliothèques catholiques.
- Soins des papes pour la conservation des manuscrits. - Nicolas V est le créateur
de la Vaticane. - Inghirami est nommé conservateur de cette bibliothèque par
Jules II. - Béroalde lui succède sous Léon X. - Recherche des manuscrits. -
Léon X achète des moines de Corbie quelques livres inédits de Tacite. - Il
veut publier une édition des œuvres de cet historien, et en confie le soin à
son bibliothécaire. - Un imprimeur de Milan veut contrefaire le Tacite. -
Léon X charge un grand nombre d’humanistes d’aller à la découverte des livres
anciens. - Ses libéralités envers les savants. - Musurus, Lascaris, Alde Manuce. La sacristie servit d’abord de bibliothèque à nos églises. L’évêque pensait avec raison que les actes de notre foi ne pouvaient reposer plus sûrement qu’à côté des vases sacrés destinés à la célébration de nos saints mystères. Justinien appelle la sacristie le trésor de nos chartes. Le Skeuophylax ou Keimeliarque dont il parle gardait à la fois et Ies diptyques et les registres ou livres de l’évêque. Plus tard, on comprit la nécessité d’affecter un local particulier aux livres de notre culte. Au cinquième siècle, l’évêque Paulin, en bâtissant une église à Nota, réservait dans l’édifice une salle spécialement destinée aux archives chrétiennes. Quand le nombre des manuscrits se fut accru, alors vint l’idée toute naturelle d’en confier la garde à quelque personne de confiance : le conservateur catholique au sixième siècle porte le nom de scrinarius ou de chartularius. Au septième siècle, nous trouvons à Constantinople un chartophylax attaché au service du patriarche. Ce chartophylax n’est autre que le bibliothécaire du pape à Rome, qui dans les anciens temps est appelé tantôt cancellarius, tantôt notarius. Toutefois la sacristie garda longtemps le dépôt des titres de notre vieille foi, dans des armoires de chêne dont un prêtre seul devait avoir la clef. A côté des manuscrits de nos Evangiles étaient placés des traités élémentaires destinés à l’instruction des jeunes lévites. En Italie, chaque jour après la grand’messe, un prêtre ouvrait l’armoire, en tirait une grammaire, et expliquait aux enfants de chœur rassemblés autour de lui les règles de la syntaxe latine. La première notion certaine que nous ayons de l’existence de bibliothèques ecclésiastiques ayant quelque importance est tirée d’une lettre de Jérôme à Pammachius, en 394. Plus tard, nous voyons saint Augustin doter l’église d’Hippone d’une collection précieuse d’ouvrages. Mais, longtemps avant lui, le pape Antère (238) formait, au rapport d’Anastase, dans une des églises de Rome, une bibliothèque agiographique. A l’époque de saint Grégoire le Grand, Rome était si riche en livres, que les princes et les évêques de la chrétienté s’adressaient au pape pour obtenir des œuvres ascétiques ou littéraires. Un moment les papes sont les commissionnaires littéraires du monde catholique. On écrit des Gaules à saint Grégoire : Très saint-père, envoyez-nous les Gestes de saint Irénée, dont nous avons le plus grand besoin ; et d’Alexandrie : Expédiez-nous le Martyrologe d’Eusèbe. Saint Amand évêque de Tongres, demande des livres à Martin Ier ; l’évêque de Saragosse a besoin des livres de morale de saint Grégoire ; Pépin s’adresse au souverain pontife pour solliciter quelques manuscrits grecs dont il veut faire don à l’abbaye de Saint-Denis ; l’abbé de Ferrière (Lupus) écrit à Benoît III pour lui demander les Commentaires de saint Jérôme sur Jérémie, l’Orateur de Cicéron, les Commentaires de Donat sur Térence, en promettant, si Sa Sainteté obtempère à sa demande, de restituer fidèlement les ouvrages. Les papes prêtaient, mais il arriva que les églises oublièrent de renvoyer exactement les manuscrits ; les papes alors ne laissèrent plus sortir un seul livre de Rome. On pourrait regarder Nicolas V comme le créateur de la Vaticane. Vespasiano y comptait de son temps plus de cinq mille manuscrits grecs ou latins. Le pape avait nommé conservateur de cette bibliothèque Jean Tortelli, célèbre grammairien. On sait qu’il entretenait un grand nombre de savants dont l’unique occupation était de parcourir la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, afin d’y chercher des manuscrits. Calixte III, Pie II et Paul II ajoutèrent de nouveaux trésors à ceux que Nicolas V avait si heureusement découverts. François Filelfe disait à Calixte III : Si vous voulez vivre dans la mémoire des hommes, imitez l’exemple de votre prédécesseur, Nicolas V ; aimez comme lui les livres et les savants. Paul II, passionné pour les manuscrits, les prêtait trop facilement aux humanistes, et oubliait de les redemander, double tort que lui reproche un de ses contemporains. On sait que Sixte IV eut le premier l’idée d’ouvrir la Vaticane au public romain. Il avait choisi pour son bibliothécaire Jean-André de’ Bussi. A l’évêque d’Aléria, le protecteur de Sweinheim et de Pannartz, succéda Platina, puis Aristotile Manfredi, Cristoforo Persona et Jean Laurent le Vénitien, tous hommes de science. Alexandre VI confia cette charge d’abord à deux Espagnols, Jérôme et Jean Fonsalida, ensuite à Julien de Volterre, archevêque de Raguse, qui l’exerçait encore en 1510. Inghirami venait de mourir, laissant vacante la place de bibliothécaire du Vatican, que lui avait conférée Jules II. C’était un littérateur d’une grande aménité de caractère, versé dans les langues anciennes et connaissant surtout parfaitement le latin. Il n’eût tenu qu’à lui de faire plus de bruit ; mais il préférait à la gloire le coin du feu en hiver ; en été, une promenade aux jardins de Sadolet ; le soir, après souper, une conversation avec quelques bons amis qu’il charmait par sa parole toujours douce et fleurie. Érasme le vit et l’aima, ravi, comme ceux qui avaient le bonheur de l’entendre, de tout ce qu’il jetait, en parlant, de traits inattendus, d’images pittoresques, de saillies spirituelles : causer était son talent. Il mourut jeune encore, d’une chute de cheval. Chose étonnante ! on l’épargna après sa mort, comme on l’avait épargné de son vivant. Seulement, à cette époque de dénigrement systématique, la satire, qui ne veut pas perdre ses droits, lui reproche une obésité que le sépulcre put à peine enfermer. Elle ajoute, il est vrai, qu’en mourant il partagea entre ses héritiers l’as qu’il laissa pour toute fortune : c’était finir honorablement. Le vieux Béroalde écrivait, après avoir écouté parler Béroalde son neveu : Vous verrez que de cette étincelle de science jaillira bientôt une lumière vive et radieuse ; l’enfant donnera raison au proverbe : Il y a beaucoup d’écoliers qui valent mieux que leurs maîtres. Philippe Béroalde, que Léon X venait de nommer bibliothécaire de la Vaticane, était heureux comme un roi au milieu de tous ces beaux livres que les libéralités du pontife savaient y rassembler. A cette époque, il y avait des bibliophiles qui passaient leur vie à courir le inonde pour découvrir des manuscrits : Politien les nommait des chasseurs de livres. Nul comme Sabeo (Fausto) ne flairait d’aussi loin un ouvrage inédit. Léon X, qui connaissait l’humaniste, l’avait employé d’abord à fouiller les abbayes, les monastères, les presbytères, les bibliothèques des princes ou des particuliers. Le savant se mettait en route, parcourait, à pieu le plus souvent, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Grèce, supportant, comme il le raconte poétiquement, la faim, la soif, la pluie, le soleil, la poussière, pour délivrer de l’esclavage un écrivain antique qui, en recouvrant sa liberté, reprend l’usage de la parole, et vient remercier en beaux vers son libérateur. Ce que nous admirons chez ces hardis explorateurs est moins le bonheur que le désintéressement. Pas un qui, au retour de ses longues courses, garde pour lui un seul de ces volumes adorables qu’il a cependant si bien gagnés. Et que sa tentation doit être vive à la vue de manuscrits aux lettres rehaussées d’or, aux miniatures dont le temps n’a pu ternir les fraîches couleurs, aux mille fantaisies calligraphiques qui montent, descendent et s’enroulent sur de blanches marges, à la reliure chargée d’arabesques dont Jean d’Udine lui-même, à l’aide du pinceau, n’aurait pu reproduire les caprices divins ! Aucun d’eux ne succombe ; on les voit qui reviennent à Rome, et déposent fidèlement aux pieds de Sa Sainteté des trésors dont ils se séparent les larmes aux yeux. Si vous saviez ce qu’ils leur ont coûté ! Quelquefois le possesseur connaît le prix de la relique séculaire qu’il tient enfermée sous clef ; il faut alors que l’humaniste emploie la diplomatie, la ruse, l’éloquence ; qu’il prie, qu’il s’attendrisse, qu’il fasse parler tour à tour le mort et le vivant : le mort, dont le Turc, demain, enlèvera l’œuvre inédite au maître de la maison, ou qu’un héritier ignorant laissera manger aux vers, ou qu’une servante vendra peut-être à l’épicier ; le vivant, c’est-à-dire le pape Léon X, qui attend avec impatience le volume pour le placer dans le palais du Vatican, le vêtir d’or et de soie, si l’âge et la poussière ont usé ses vêtements, le soustraire à la dent du temps en l’enfermant dans du cèdre, et le montrer comme une merveille aux rois de la terre qui passent à Roule. Au besoin, le diplomate a l’ordre de promettre au maître heureux du livre des prières et des indulgences, et, si rien ne peut l’attendrir, de lui offrir de l’or à pleines mains. Le manuscrit de Tacite que possédait l’abbaye de Corbie, en Allemagne, fut acquis par Léon X au prix de 500 sequins. C’est que ce manuscrit était bien précieux ; tous ceux qu’on connaissait étaient incomplets. A celui dont s’était servi à Milan, en 1495, François Puteolano, pour imprimer les Annales, il manquait les cinq premiers livres de I’historien : on venait de les retrouver dans un monastère de Westphalie ; et les moines, qui savaient le trésor qu’ils possédaient, n’avaient voulu s’en dessaisir qu’à pris d’or, même en faveur du pape : l’or avait été donné. Ajoutez que le Tacite de Milan était fautif, mal imprimé et sur mauvais papier. A cette époque où tant de morts ressuscitent, la joie de l’humaniste est souvent troublée en écoutant Horace ou Virgile sorti de la tombe parler une langue hérissée de solécismes. Un Milanais, typographe de son métier, mais artiste au suprême degré, va jusqu’à s’écrier que c’est un problème difficile à résoudre de savoir si l’invention de l’imprimerie a fait aux lettres plus de mal que de bien. Léon X voulait que le Tacite parût dans toute la pureté du texte antique, comme si l’historien eût revu lui-même les épreuves de son ouvrage. Il confia la direction de l’entreprise à Béroalde, son bibliothécaire, et l’impression à un Allemand établi récemment à Rome, Étienne Guilleret, du diocèse de Toul en Lorraine. Afin que l’un et l’autre pussent être récompensés de leur travail, et eussent l’honneur et les bénéfices de cette réimpression, il menaça d’une amende de 200 ducats d’or quiconque contreferait l’édition publiée à Rome. La bulle de Léon X, placée par l’éditeur en tête de l’ouvrage, renferme une magnifique glorification des lettres humaines, le plus beau présent, dit le pape, après la connaissance de la vraie religion, que Dieu, dans sa bonté, ait fait aux hommes ; leur gloire dans l’infortune, leur consolation dans l’adversité. Et le livre finit beaucoup mieux encore qu’il n’a commencé, par ces lignes qu’Érasme ne pouvait lire sans pleurer, et qui sont imprimées au-dessous des armes du pape : Au nom de Léon X, bonne récompense à quiconque apportera à Sa Sainteté de vieux livres encore inédits. L’annonce lit son effet : les volumes arrivaient de tous côtés, et la récompense était fidèlement donnée. Un moment, toutefois, Sa Sainteté fut sur le point de fulminer l’anathème dont elle avait menacé celui qui serait assez hardi pour réimprimer le Tacite, dont le privilège avait été concédé à Béroalde. A Milan vivait un imprimeur qui non seulement était un prote habile, un ouvrier plein de goût, mais un humaniste renommé : il s’appelait Minuziano, et avait étudié sous Georges Merula. Louis XII, en lui écrivant, mettait sur ses lettres : A maître Alexandre N4linutianus, professeur de rhétorique. Il occupa longtemps, en effet, dans cette ville, la chaire d’éloquence et d’histoire. On lui devait quelques éditions d’auteurs anciens, qui passaient pour fort correctes, entre autres celle des œuvres complètes de Cicéron, en quatre volumes in-folio. En apprenant que Béroalde allait éditer un Tacite avec les cinq premiers livres des Annales, il conçut l’idée de faire concurrence au bibliothécaire de la Vaticane, et il gagna, dit-on, un ouvrier de l’imprimerie pontificale, qui lui faisait passer les feuilles imprimées. Qu’on juge de l’indignation du pape ! Minuziano fut appelé à Rome pour rendre compte de sa conduite. Le pauvre imprimeur, qui ne connaissait pas Léon X, eut peur et se tint blotti dans son atelier, attendant que Dieu lui envoyât un ange : il vint, non pas du ciel, mais du sénat ; il s’appelait Ferretri. Le patricien, par amour du latin, promit d’aller à Rome, et d’intercéder auprès du pape en faveur du typographe. Béroalde joignit ses prières à celles du Milanais, et Léon X se laissa fléchir, mais à condition que le coupable s’excuserait dans une lettre autographe. La punition n’était pas bien sévère. Minuziano écrivit donc une épître bien tournée, où il mettait sur le compte de sa pauvreté son refus de faire le voyage de Rome, et implorait humblement son pardon. Il n’en fallait pas tant ; quelques jours après, notre imprimeur reçut un bref daté de Rome, et adressé par le secrétaire du pontife à son cher fils Minuziano. Et non seulement le pape pardonnait au typographe, mais il lui permettait de continuer l’impression du Tacite, qui parut en 1417. L’historien, s’il faut en croire Minuziano, qui l’affirme dans une spirituelle préface, quitta tout exprès l’Élysée, et vint à Milan pour dicter à l’imprimeur une lettre de remercîment à Ferretri. La lettre est écrite avec une recherche trop curieuse de mots pour qu’elle puisse être authentique. Tacite n’avait pas tant d’esprit. D’ailleurs Minuziano fait jouer au Romain un triste rôle : Tacite est métamorphosé en solliciteur, implorant la protection du sénateur milanais pour l’éditeur des Annales ! C’était un prélat, Ange Arcimbold, qui avait apporté au pape le manuscrit de Corbie. Dans cette chasse aux livres, des empereurs, des rois, des électeurs, des doges, étaient les pourvoyeurs de Léon X. Les commissaires ordinaires partaient de Rome munis de lettres de recommandation pour les princes dont ils devaient parcourir les États. Jean Heytmers de Zonvelben fut chargé de visiter l’Allemagne, le Danemark, l’île de Gothland. Le bruit courait à Rome qu’à Magdebourg, dans la bibliothèque des chanoines, se trouvait une partie des Décades de Tite-Live. Heytmers avait ordre d’en acheter à tout prix le manuscrit. Il devait être aidé dans cette négociation par l’électeur de Mayence, Albert, que Luther a depuis si fort maltraité. Le manuscrit était ailleurs. Heytmers avait également une lettre pour Christiern, roi de Danemark. Augustin Beazzano, que Bembo avait fait connaître à Sa Sainteté, eut mission de parcourir les États de Venise : il emportait une lettre où le pape le recommandait à la bienveillance du doge Lorédan, qui lui fit ouvrir les bibliothèques de tous les couvents de Venise. Beazzano y trouva quelques beaux manuscrits grecs. Au pape il ne fallait pas seulement des livres et des manuscrits, mais des hommes, et il n’épargnait aucune dépense pour s’en procurer : presque toujours il était heureux. II faut avouer qu’il eût été bien difficile de lui résister : cela arrivait pourtant. Il écrit à Nicolas Leoniceno : Vous savez si je vous estime, si je vous ai toujours aimé, si j’ai toujours fait grand cas de votre savoir. Bembo, mon secrétaire, qui vous chérit tendrement, et qui à Ferrare, adolescent, eut le bonheur, comme il s’en vante, de tremper ses lèvres aux eaux de cette philosophie dont vous possédez la source, à force de me parler de vous, me fait penser à vous offrir de nouveaux témoignages de mon attachement à votre personne. Il faut que vous me permettiez de faire quelque chose pour vos beaux talents acquis par tant d’étude. Parlez : si mon amitié peut vous être utile, je vous l’offre de nouveau ; demandez, vous obtiendrez de moi tout ce que vous voudrez. Nous avons cherché longtemps dans la correspondance des princes une lettre qui valût ce petit billet, sans pouvoir la trouver : il n’y a qu’un homme au monde qui ait jamais écrit de ce style, c’est Henri IV. Mais peut-être y a-t-il quelque chose de plus admirable que l’épître du pape, c’est la modestie du savant qui, content de boire aux sources abondantes de la philosophie antique, dont il détachait un rivulet pour ses deux élèves, Sadolet et Bembo, reste enseveli dans son obscurité, et refuse sans faste les offres brillantes de la papauté. Et ces beaux exemples de désintéressement ne sont pas rares à cette époque. Plus tard nous verrons un autre disciple de l’antique philosophie repousser toutes les avances que lui fera Léon X, et se complaire, comme un autre Diogène, dans son réduit, dont le soleil ne perce jamais l’obscurité. Sait-on ce que l’un et l’autre refusaient ? De belles et riches abbayes, car Léon était prodigue envers l’humaniste qu’il aimait ; une villa aux environs de Rome ; tous les trésors bibliographiques de la Vaticane ; et un logement dans l’habitation sur l’Esquilin, que le pape avait empruntée au cardinal de Sion absent, afin que, tout en étudiant, l’humaniste eût sous les yeux de belles fabriques, de beaux jardins et de belles forêts. C’est sur ces hauteurs que J. Lascaris, appelé par Léon X, enseignait à de jeunes Grecs la langue hellénique. Quand notre expédition en Italie, si malheureuse du reste, ne nous aurait valu que la conquête de Lascaris, il faudrait s’en réjouir. C’est le plus beau trophée que Charles VIII remporta lorsqu’il descendit les Alpes. A Paris, Lascaris eut une chaire de grec comme à Florence ; son premier, son plus noble écolier fut Budé. Le professeur, sous Louis XII, retourna en Italie, à Venise, où il enseigna le grec, de 1509 à 1513. Les jeunes gens auxquels il donnait des leçons sur l’Esquilin avaient été conduits de la Morée à Rome par Marc Musurus (Musuro), qui n’entendait pas seulement admirablement la langue grecque, mais parlait, au dire d’Érasme, le latin aussi bien que Théodore Gaza et Lascaris. Léon X lui écrivait, en 1513 : Comme j’ai le vif désir de faire revivre la langue et la littérature grecques, de nos jours presque éteintes, et d’encourager de tous mes efforts les belles-lettres ; que je connais, du reste, votre savoir et votre goût, je vous prie de nous amener de la Grèce dix à douze jeunes gens doués d’heureuses dispositions, qui enseigneront à nos Latins les règles et la prononciation de la langue hellénique, et formeront comme un séminaire ouvert aux bonnes études. Lascaris, dont j’aime les vertus et la science, vous écrira à ce sujet plus amplement. Je compte, en cette occasion, sur votre dévouement à ma personne. Musurus vint à Rome, apportant avec lui un exemplaire d’un Platon qu’Alde Manuce venait de publier, et dont il avait corrigé les épreuves ; un poème grec qu’il avait composé en l’honneur du pape, et une épître en prose de l’imprimeur à Sa Sainteté, mise en tête des œuvres du philosophe. Le Platon fut placé dans la bibliothèque de la Vaticane, Musurus bientôt récompensé par l’évêché de Malvoisie, et Alde Manuce honoré d’une bulle magnifique, où le pape rappelait les services que le typographe avait rendus aux lettres. Il lui accordait le privilège de vendre et de publier les livres grecs et latins qu’il avait imprimés, ou qu’il imprimerait plus tard, avec ces caractères italiques dont il était l’inventeur, et qui reproduisent, dit le pape, toute l’élégance de l’écriture cursive. Et afin que la cupidité ne vînt pas élever une concurrence nuisible, ruineuse peut-être pour l’imprimeur, le saint-père menaçait de l’excommunication quiconque violerait la défense du saint-siège. Seulement Léon X imposait une obligation à Manuce, c’était de vendre ses livres à bas prix ; il s’en rapportait du reste à la probité bien connue du typographe. Alde Manuce n’en manquait pas. Dans cette préface dont nous parlions, où l’imprimeur loue si finement le pape, il se représente, nouveau Sisyphe, roulant un rocher qu’il ne peut, malgré ses efforts, conduire jusqu’au sommet de la montagne : ce rocher, c’est le Platon qu’il a mis en vente, et qui, malgré tous les efforts de ses protes, laisse encore à désirer sous le rapport de la correction. Alde, vieilli dans le métier, succombe à la peine, peine incessante, et de jour et de nuit. II voudrait racheter au prix d’une pièce d’or chaque faute qui s’est glissée dans une de ses éditions : mal sans remède ; la faute est là qui le poursuit comme un spectre et l’empêche de dormir. Léon X n’avait-il pas raison de vanter la probité du Vénitien ? Il voulut le récompenser, d’abord en lui concédant le privilège dont nous venons de parler, puis en prescrivant au collège romain, qu’il allait réorganiser, de ne se servir que des livres classiques publiés par le savant typographe. |