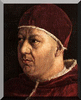HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XIX. — LE CONCILE DE LATRAN. - LES MONTS-DE-PIÉTÉ. - 1513 et suiv.
|
L’usure, au
moyen-âge, est exercée par les juifs. - Le frère Barnabé, moine récollet, a
la première idée des monts-de-piété. - II est secondé plus tard par un religieux
du même ordre, Bernardin de Feltre. - Succès des prédications du moine, qui
meurt en odeur de sainteté. - Cajetan, dominicain, attaque les monts comme
usuraires ; vive polémique qu’il excite. - Léon X y met fin en approuvant ces
établissements. L’usure est reine au moyen-âge. En vain Dante place-t-il aux enfers, dans le même sépulcre de feu, l’habitant de Gomorrhe et l’habitant de Cahours, c’est-à-dire l’impudique et l’usurier ; l’usurier rit de la sentence du poète, et continue son infâme trafic. La voix de l’Église est impuissante comme celle du Florentin. L’Italie reste donc en proie à la rapacité des juifs, qui prêtent à d’énormes intérêts, et en plein soleil font le métier que certains hommes d’armes en Allemagne pratiquaient à l’entrée d’une forêt, lorsque la nuit était venue. Un pauvre moine récollet, nommé Barnabé, sentit son cœur ému à la vue de ces populations pressurées par les Israélites, et il résolut de venir au secours de ses frères. Il monte donc en chaire, à Pérouse, vers le milieu du quinzième siècle, et ; après avoir jeté ses saintes colères à la face des lombards, des cahoursins, des juifs, tous ces mots étaient synonymes, il propose de faire dans la ville une quête générale dont le produit serait employé à fonder une banque qui viendrait en aide aux indigents. Sans doute que Dieu mit ce jour-là dans la vois du moine quelque chose d’entraînant ; car il était à peine descendu de chaire, que la ville répondait à l’appel de l’orateur, apportait des bijoux, des pierres précieuses, de l’or, de l’argent en abondance pour former les premiers fonds de cette philanthropique institution, dont une robe de bure avait eu l’heureuse idée. Alors l’ouvrier ne fut plus obligé de s’adresser au juif dans un moment de détresse ; quand il n’avait pas de quoi se nourrir ou nourrir sa famille, il venait avec ce qu’il trouvait de plus précieux dans son ménage, son gobelet d’argent, son anneau des fiançailles, ses vêtements du dimanche, et il recevait en échange une somme d’argent qu’il était obligé de rendre dans un court délai, mais sans autre intérêt qu’une somme minime, quelques liards au plus, pour les frais de l’administration. On donna à cette banque le nom de mont-de-piété, c’est-à-dire de masse, parce que les fonds de la banque ne consistaient pas toujours en argent, mais souvent en grains, en épices, en denrées de diverses sortes. Bientôt d’autres villes d’Italie suivirent l’exemple de Pérouse ; Savone, une des premières, eut son mont-de-piété. Le saint-siège encourageait dans ses bulles l’institution du frère Barnabé. il fallait organiser ces établissements de charité : on n’a que des notions imparfaites sur les éléments constitutifs des premières banques de providence en Italie. A Mantoue, le mont-de-piété était administré par douze directeurs, quatre religieux, deux nobles, deux jurisconsultes ou médecins, deux marchands et deux bourgeois. Ainsi l’élément populaire prédominait dans une fondation créée en faveur du prolétaire. Comme l’idée en appartenait au cloître, les moines presque partout étaient nommés directeurs à vie de l’établissement, taudis que les laïques n’en faisaient partie que pendant deux ans. La chaire chrétienne ne cessait d’exciter le zèle des populations en faveur des monts. Les récollets opéraient de véritables miracles ; on eût dit le temps des croisades revenu : les dames se dépouillaient de leur parure pour fonder de nouvelles banques ; l’or des Israélites dormait intact dans leurs coffres-forts. La charité, aussi ingénieuse qu’ardente, s’était constituée banquière des ouvriers ; elle prêtait aux malheureux travailleurs, et presque toujours sans intérêt. Les juifs, maudits par toutes les classes de la société, quittaient l’Italie et allaient porter ailleurs leur industrie ruineuse. Dans cette ligue contre les Israélites, un récollet du nom de Bernardin Thomitano, né à Feltre en 1433, se distingua surtout par ses succès. Le peuple le suivait en foule, et écoutait dans le ravissement ses imprécations contre des hommes qu’il appelait des vendeurs de larmes. Partout où le moine mettait le pied, un mont-de-piété s’organisait. Il en fonda à Parme, à Montetiore, à Assise, à Rimini, à Montagnana, à Chietri, à Narni, à Lucques. S’il trouvait, comme à Campo-San-Pietro, un juif qui refusât de faire l’aumône aux chrétiens, il le chassait de la ville. Toutes les entreprises, toutes les occupations du peuple israélite étaient l’objet des poursuites du moine, dit M. Depping. Les habitants de Sienne avaient fait venir depuis quelque temps un médecin juif dont la réputation était probablement bien établie ; ils lui avaient assigné un salaire pour qu’il eût soin de leur santé. Bernardin de Feltre ne cessa de décrier le médecin : il prêchait que c’était une impiété que d’avoir recours à l’art des juifs ; il rappelait tous les contes répandus chez le peuple sur la haine que les juifs portaient aux chrétiens ; il racontait qu’un médecin juif d’Avignon, étant sur le point de mourir, s’était souvenu avec délices d’avoir fait mourir par des drogues des milliers de chrétiens. Le moine avait dessein de parcourir les villes d’Italie : en vain les juifs, pour arrêter la marche de ce rédempteur populaire, essayaient-ils de soulever des orages sur son passage ; le frère marchait, dédaignant les menaces et les avances des lombards. Au moment où il allait entrer triomphalement à Aquila, une députation de juifs se présente la prière à la bouche, demandant au missionnaire, comme une grâce dont on conserverait à jamais le souvenir, de ne pas monter en chaire ou de ne pas prêcher contre les usuriers ; mais le moine pousse la porte de l’église, s’agenouille au pied des autels, prie, puis, du haut de la chaire, appelle la colère des habitants sur ces âmes vendues au démon de l’usure, et qui font métier de pressurer le peuple du Seigneur. Le soir Aquila avait son mont-de-piété, et l’Israélite était obligé de fuir une ville où il aurait été lapidé. Il est vrai que ces usuriers étaient sans pitié pour les chrétiens. A Parme, ils tenaient vingt-deux bureaux où ils prêtaient à 20 p. % ; le succès de la parole du moine s’explique donc facilement. En passant à Padoue, Bernardin de Feltre renversa toutes ces maisons de prêt, entretenues à l’aide des larmes du peuple, et la ville vit bientôt s’élever, grâce à la pitié de quelques hommes riches, une banque où le pauvre put venir emprunter, sur nantissement, au taux de 2 p. %. L’usure eut un moment de répit à la mort du frère Bernardin, en 4494. Jamais religieux ne fut aussi amèrement pleuré ; le peuple le regardait comme un envoyé céleste. Trois mille enfants vêtus de robes blanches, symbole de cette vie si pure que le frère avait menée sur cette terre, assistaient à ses funérailles, portant chacun un gonfanon où étaient brodés le nom de Jésus et l’image d’un mont-de-piété. C’est au nom de Jésus, que le frère invoquait au commencement et à la fin de ses sermons — il en prêcha trois mille six cents —, qu’il dut ces grands triomphes oratoires dont son ordre est à juste titre si fier. Et pourtant Dieu ne lui avait accordé aucun de ces dons extérieurs qui séduisent la multitude ; il était si petit, qu’à peine son buste dépassait d’un pied le banc de la chaire évangélique ; mais ce corpuscule ressemblait, comme dit le poète, à ces petits jardins tout remplis de pommiers aux doux fruits. Nul jusqu’alors n’avait su faire parler avec tant d’éloquence la misère populaire, porter à Dieu avec des accents plus déchirants les larmes du pauvre, faire gémir plus sympathiquement la voix de la veuve ou de l’orphelin. Et puis ce grand prédicateur menait la vie d’un ascète : il couchait sur la paille ou sur la pierre, jeûnait plusieurs fois la semaine, ne buvait que de l’eau, et restait quelquefois pendant plus d’une heure plongé dans les extases de la prière. A peine était-il décédé, que le peuple l’invoquait comme un saint, et que Dieu par divers miracles signalait à la reconnaissance des hommes les vertus de son serviteur. Le philosophe peut expliquer naturellement, nier, s’il le veut, les cures opérées par le simple attouchement de cette robe de bure que le frère avait si glorieusement portée : il accordera sans doute à Bernardin le titre de bienfaiteur de l’humanité, et, sans rougir, saluera cette image du mont-de-piété que les enfants portaient aux funérailles du moine : glorieux symbole auquel ses frères préfèrent avec raison l’auréole dont son front reluit au ciel, comme un arc lumineux qui se détache à travers ces nuages de gloire mondaine dont on voulut l’entourer sur cette terre. A peu près à cette époque, un moine se présenta pour renverser l’œuvre de Bernardin, et les juifs durent se réjouir du secours inespéré que l’éloquence venait leur apporter ; il appartenait à cet ordre des dominicains qui, suivant l’expression de Mélanchthon, s’était volontairement emprisonné dans la disciplinez de la primitive Eglise. Cajetan était à la fois un subtil argumentateur, un théologien rompu aux disputes de l’école, un casuiste érudit, un écrivain chaleureux, surtout un prêtre de vive foi et de mœurs exemplaires. Cajetan ne cherchait pas, comme on le pense bien, à venir en aide aux usuriers ; c’est l’usure au contraire qu’il poursuivait dans l’institution des monts-de-piété. Rigide thomiste, il désapprouvait le prêt à intérêt, quelque forme qu’il revêtit, et accusait formellement les fondateurs de ces banques de désobéissance aux commandements de Dieu et de l’Église. Au fond, les deux moines plaidaient la même cause, celle du pauvre : l’un en attaquant comme usuraire, l’autre en défendant comme charitable la banque populaire. La querelle dura longtemps. Les ordres s’en mêlèrent : celui de Saint-Dominique se signala par sa polémique toute théologique ; celui des capucins ou des frères mineurs, par une notion plus profonde des besoins de la société. Dans cet antagonisme des couvents, l’attitude de la papauté resta ce qu’elle devait être : la papauté se tut et écouta. Cependant Sixte IV, en 1484, à Savone, et, vingt-deux ans plus tard, Jules II, s’étaient formellement prononcés en faveur des monts-de-piété. Dans sa sagesse infinie, la papauté, si le dogme eût été mis en cause, aurait imposé silence à qui l’aurait attaqué ; niais elle ne voyait dans cette institution qu’une œuvre humaine dont il était permis à un simple religieux de contester l’efficacité, même quand Rome l’avait prise sous sa protection. C’est, nous le pensons, un bel exemple de tolérance politique que Jules II nous donne en laissant attaquer, brutalement quelquefois, les monts qu’un moine dominicain appelle ironiquement des monts d’impiété, et que Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI ont approuvés et protégés. Celui qui se distingua dans cette polémique est justement l’un des orateurs de Jules II, Cajetan, qui, au sortir de la chapelle pontificale où il a prouvé si éloquemment l’immortalité de l’âme, va bientôt, en véritable aristotélicien, accabler de ses arguments, pris dans la Bible, une institution que le pape a voulu lui-même fonder à Bologne, afin, dit la bulle, que la charité des fidèles qui formaient ces pieux établissements pût procurer aux pauvres des secours abondants, et prévenir les maux qui provenaient des usures dont les juifs fatiguaient les Bolonais. Ce qui ne nous surprend pas davantage, c’est que la plupart des arguments qu’un économiste moderne, M. Arthur Beugnot, a résumés contre les monts-de-piété, se trouvent dans l’écrit du dominicain. Au point de vue purement moral, le père niait que les monts fussent une institution de bienfaisance. La papauté résolut de terminer des disputes qui troublaient les consciences : les questions sur le prêt, en divisant les ordres religieux, jetaient dans les couvents des germes d’inquiétude qui menaçaient le repos de ces saintes retraites. Léon X voulait la paix ; le concile de Latran s’occupa donc, à la demande du pape, des monts-de-piété. Les Pères auxquels la question avait été déférée étaient connus par leur savoir et leur charité. L’examen fut lent, patient et profond : les livres nombreux des adversaires et des apologistes de ces maisons de prêt furent étudiés et comparés, et quand il ne resta plus aucune objection sérieuse à résoudre, l’autorité parla. Léon X, après une brève exposition de la dispute, reconnaît qu’un vif amour de la justice, un zèle éclairé pour la vérité, une charité ardente envers le prochain, ont animé ceux qui soutenaient ou combattaient les monts-de-piété ; mais il déclare qu’il est temps, dans l’intérêt de la religion, de mettre fin à des débats qui compromettent la paix du monde chrétien. Celui à qui le Christ con, mit le soin des âmes, le gardien des intérêts du pauvre, le consolateur de tout ce qui souffre, défend de poursuivre comme usuraires des établissements institués et approuvés par l’autorité du saint-siège apostolique, où l’on perçoit de l’emprunteur une somme modique pour couvrir des dépenses indispensables à leur gestion. Il les approuve comme de véritables institutions de charité qu’il est utile de protéger et de répandre. Après qu’on eut fait lecture du décret, le pape se tourna, suivant la coutume, vers les Pères du concile, pour leur demander s’ils approuvaient ce qui était contenu dans la cédule. Un seul des Pères se leva et refusa son approbation, parce qu’il savait par expérience, disait-il, que les monts sont plus nuisibles qu’utiles. C’était Jérémie, archevêque de Trani. Sa protestation fut enregistrée dans les actes du concile. Alors tout ce bruit de paroles qui, du couvent et de la chaire, avait passé dans l’école et jusque dans l’intérieur de la famille, s’éteignit comme par enchantement : la papauté avait parlé. Cajetan se tut, et avec lui tous ceux qui s’étaient ligués évangéliquement contre les monts-de-piété. Mais l’autorité souveraine ne condamnait pas leurs livres, qui continuèrent d’être réimprimés et de circuler jusque dans les Etats du saint-siège. On imposait silence à la parole vivante, niais on laissait subsister la lettre muette, quand cette lettre ne s’attaquait pas au dogme. La papauté n’a jamais fait la guerre aux idées, à moins cependant, comme nous allons le voir, que l’idée, en se reproduisant par la presse, ne compromît la société. |