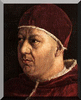HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XVIII. — CONCILE DE LATRAN. - 1513 et suiv.
|
Ouverture du concile
de Latran par Léon X. - Carvajal et Saint-Séverin y comparaissent,
souscrivent une formule de rétractation et sont solennellement absous. - Léon
X fait grâce à Ferreri, secrétaire du conciliabule de Pise. - Réformes
entreprises par Léon X. - Réforme du haut clergé, réforme des prêtres et des
moines. - Décret du concile sur l’éducation cléricale et sur les
prédicateurs. - Combien sont peu fondées les plaintes que l’Allemagne fit
entendre contre Rome, par l’organe de Hutten. - Idée sommaire des principaux
actes du concile de Latran, et nécessité de les étudier pour répondre aux
accusations du protestantisme. Nous nous rappelons qu’au moment où Jules II travaillait à l’accomplissement des glorieux projets qu’il avait conçus en ceignant la tiare, quelques prélats lie rougirent pas de se révolter contre le saint-siège, de mettre au ban de la chrétienté le courageux pontife, de l’accuser de simonie, et de provoquer son interdiction dans le conciliabule de Pise. A cette comédie sacrilège, jouée par quelques cardinaux indignes de la robe rouge qu’ils portaient, le pape répondit en convoquant le concile de Latran, où bientôt se réunirent, à la voix de leur pasteur, les évêques des diverses parties du monde. Le schisme, sans asile en Italie, fut obligé de se transporter en France, hué en chemin par les populations catholiques, et sifflé même par les enfants. Jules II mourut, comme il avait vécu, sans peur et sans reproche, et, sur le lit où il allait rendre sa belle âme à Dieu, il pardonna à ceux qui avaient trahi le vicaire du Christ, mais en exigeant qu’ils se réconciliassent avec l’Église, mère de miséricorde, mais aussi mère de justice. Léon X, à son avènement au pontificat, donna l’ordre qu’on lui préparât des appartements dans le palais de Latran, afin qu’il pût assister en tout temps aux délibérations de l’assemblée. Le 6 avril 1513, il ouvrit en personne la sixième session du concile. Après qu’on eut chanté le Veni Creator, le pape, se levant .adressa aux Pères du concile une allocution touchante. Il les conjurait au nom de Dieu, de sa mère, des saints apôtres, et de toute la milice céleste, de travailler sans relâche au rétablissement de la paix entre les princes chrétiens, et leur déclarait sa ferme intention de les tenir réunis jusqu’à ce que cette belle œuvre fût terminée. Les princes un moment dissidents s’étaient empressés d’adhérer au concile de Latran : Louis XII venait de le reconnaître. L’Église était ramenée à l’union. On sait qu’après l’ascension de Jésus au ciel, les apôtres se rassemblèrent à Jérusalem, et qu’à la suite de leurs délibérations ils formulèrent un décret conçu en ces termes : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. C’est là l’origine de ces grandes assises où, sous la présidence du successeur de Pierre ou de ses légats, l’Eglise veille sur le dogme et règle la discipline chrétienne. Le concile se forme en congrégations particulières, en congrégations générales, en sessions générales. Dans les congrégations particulières, les Pères sont en soutane et en manteau violet ; dans les congrégations générales, en rochet et en camail ; dans les sessions générales, en chape et en mitre. Ce sont les congrégations qui rédigent les décrets que doit publier le concile. L’ouverture du concile a quelque chose de solennel. On voit les Pères en chape et en mitre s’avancer processionnellement vers l’église où doit se tenir le concile. Le président marche le dernier. Au pied de l’autel il ôte sa chape, prend la chasuble, et commence la messe. Au moment de la communion, les Pères vont deux à deux à l’autel, et communient aussitôt après le célébrant. La messe achevée, après la prière pour l’Église et le pape, le célébrant bénit le concile. La session commence. Les Pères sont assis ; un secrétaire monte en chaire et lit le décret d’ouverture du concile. Les suffrages sont recueillis, et on déclare le concile ouvert. La cérémonie se termine par la profession de foi, la prestation du serment de chaque Père et la bénédiction pontificale. Dans les congrégations générales, au centre de la salie est un trône sur lequel repose le livre des Evangiles. Deux hommes manquèrent à l’ouverture du concile présidé par Léon X : c’étaient les cardinaux Carvajal et Saint-Séverin, qui, munis d’un sauf-conduit de Sa Sainteté, étaient partis pour Rome, afin de se réconcilier avec l’Église. Leur repentir était aussi sincère que leur schisme avait été éclatant. Ils venaient, en suppliants, demander pardon au chef de la chrétienté du scandale qu’ils avaient donné récemment au monde, et se soumettre, en enfants dociles, à toutes les peines canoniques que voudrait leur infliger le successeur du grand pontife qu’ils avaient si méchamment contristé. Le cardinal de Sion, Mathieu Schinner, qui depuis six ans, à la tête de ses montagnards suisses, cherchait, sans la trouver, l’occasion de mourir pour l’Église, eût voulu qu’on fermât les portes de la sainte cité à des prélats qui avaient trahi le Christ et son vicaire. Il rappelait à Léon X les paroles de Jules II étendu sur son lit de mort, et qui comme chrétien avait pardonné aux cardinaux schismatiques, mais comme prince avait demandé qu’on les repoussât, s’ils s’en approchaient jamais, d’une ville qu’ils ne devaient plus souiller de leur présence. Mais Léon X avait ouvert ses bras à ces exilés qu’un zéphyr céleste, disait-il, ramenait au repentir. Toutefois il voulait une expiation : En ce jour, ajoutait-il, la miséricorde embrassera sa saur la justice. Il choisit donc la salle du concile pour théâtre de la réconciliation des pécheurs avec leur sainte mère, et de leur châtiment exemplaire. Dépouillés par le maître des cérémonies des marques de leurs dignités, de cette barrette que Saint-Séverin étalait à tous les regards à la bataille de Ravenne, devant les rangs français ; de cette robe rouge que Carvajal portait si orgueilleusement lorsqu’à Pise et à Lyon il insultait aux cheveux blancs de Jules II ; les deux coupables, introduits dans la salle du concile par Pâris de Grassi, fléchirent le genou, courbèrent respectueusement la tête, et, après quelques instants passés dans cette attitude, se relevèrent tous deux. Alors Carvajal s’adressant à Sa Sainteté : — Très saint-père, lui dit-il, pardonnez-nous nos offenses ; ayez pitié de nous, de nos larmes, de notre repentir ; n’ayez pas égard à la multitude de nos iniquités, qui surpassent en nombre les grains de sable de la mer. Il se fit un moment de silence : tous les yeux étaient fixés sur les suppliants. — L’Eglise est une bonne mère, dit le pape en laissant tomber un doux regard sur les deus prélats ; elle pardonne à ceux qui reviennent à elle : mais l’Église ne voudrait pas, par une charité coupable, exciter le pécheur à faillir de nouveau. Afin donc que vous ne puissiez vous glorifier de vos iniquités, j’ai voulu vous châtier. Alors, au milieu d’un silence lugubre, chaque spectateur retenant son haleine pour entendre la sentence, le pape procéda par une série d’interrogations que nos deux pécheurs étaient obligés d’écouter sans mot dire, car il n’y avait pas pour eux de réponse possible. — N’avez-vous pas, demandait le pape d’un ton de voix sévère, contristé par votre ingratitude votre maître, votre bienfaiteur, votre père, votre juge, Jules II de glorieuse mémoire ? — N’avez-vous pas osé, à Pise, méchants que vous étiez, exciter le peuple à désobéir à votre sainte mère l’Église apostolique ? — N’avez-vous pas affiché sur les murs de la maison de Dieu une sentence de déchéance contre le vicaire du Christ ? Répondez, et prononcez vous-mêmes votre sentence. Les coupables, confus, baissaient la tête. — Eh bien ! reprit le pape, voici une cédule que vous allez signer ; si vous promettez de la souscrire, vous obtiendrez miséricorde du saint-siège apostolique. Tenez, lisez. Carvajal prit la formule, la lut rapidement à voix basse, et fit signe, en portant la main à son cœur, qu’il adhérait pleinement à ce qu’elle renfermait. — Lisez tout haut, dit le pape. — Très saint-père, je ne puis, parce que je suis enroué, reprit Carvajal. — Vous ne pouvez pas, ajouta le pape avec un léger sourire, parce que vous avez un mauvais estomac. Il ne faut pas d’hésitation ; vous êtes libres : si vous voulez souscrire franchement cette formule, dites-le ; sinon vous pourrez en liberté retourner à Florence, d’où vous êtes venus munis de notre sauf-conduit. Saint-Séverin prit alors la confession des mains de son complice, et la lut en vrai capitaine, comme une proclamation qu’il aurait adressée aux soldats qu’il guidait à Ravenne. Elle renfermait le désaveu complet de tous les actes dont ils s’étaient rendus l’un et l’autre coupables envers l’autorité du saint-siège. Cela fait, ils prirent une plume, signèrent la formule, se jetèrent à genoux, et reçurent l’absolution du pape. Léon descendit de son trône ; ce n’était plus un juge, mais un père. Il s’approcha de Carvajal, et lui prenant les mains — Maintenant, vous êtes mon frère et mon père, lui dit-il, puisque vous avez fait ma volonté ; vous êtes la brebis perdue de l’Évangile, qui a été retrouvée : réjouissons-nous dans le Seigneur. Il accueillit avec les mêmes paroles de douceur, le même serrement de main, le cardinal Saint-Séverin : et les deux coupables, arec les insignes de leur dignité, leur place désignée au concile, retrouvèrent la paix de la conscience, l’amitié du pontife et l’estime des membres du sacré collège ; une seule pénitence canonique leur était imposée, c’était de jeûner au moins une fois par mois pendant toute leur vie. Deux prélats (lui avaient opiné pour des mesures de rigueur contre les schismatiques ne voulurent point assister à cette scène de réconciliation. L’un, le cardinal d’York, obéissait probablement aux ordres de son maître, Henri d’Angleterre, qui ne comprenait pas alors une révolte contre le saint-siège ; l’autre, le cardinal de Sion, en voulait surtout aux rebelles pour avoir fait cause commune avec les Français, qu’il haïssait comme les montagnards d’Uri haïssaient autrefois les soldats de Gessler. Il y avait bien encore d’autres coupables, mais obscurs, si vous les comparez aux cardinaux : c’était, entre autres, Zacharie Ferreri, qui avait servi de secrétaire aux Pères du conciliabule, et quelquefois même de domestique, en affichant furtivement leurs décisions sur les murs d’une église. Ferreri, poète, pleura sa faute et demanda pardon à Léon X en prose et en vers. Le pape lui rendit jusqu’au nom de docteur dont il s’était servi dans l’intérêt du schisme, et qu’il avait placé en grosses lettres sur le titre de quelques écrits morts en naissant. Jamais souverain ne sut moins que Léon X garder le secret d’une belle action dont il n’était pas l’auteur. A peine les cardinaux avaient-ils obtenu leur pardon, qu’il se hâtait d’annoncer à l’empereur le repentir des coupables dans une lettre que nous ne chercherons pas à traduire ; car le sentiment est comme la grâce, intraduisible. En attendant, le concile poursuivait ses travaux sous la suprême inspiration de Léon X. Le temps va venir où l’Allemagne brisera violemment le lien spirituel qui l’unit à nome depuis tant de siècles. Nous l’entendrons, pour justifier sa révolte, alléguer je ne sais quelles ténèbres où languissait le clergé italien. Elle parlera d’une dégradation intellectuelle et morale qu’elle exagérera singulièrement ; et qui fournira à son poète lauréat Ulrich de Hutten des images plus poétiques que fidèles. Ulrich cependant était en Italie en 1514 ; il devait connaître les tentatives de la papauté pour l’amélioration des mœurs et de l’intelligence du clergé. Depuis bien des années Renne poursuit une réforme sacerdotale ; ce mot ne lui fait pas peur : elle l’a prononcé sous Nicolas V, sous Sixte IV, sous Innocent VIII, sous Jules Il. Mais réformer ce n’est pas briser, c’est au contraire créer une seconde fois. Est-ce que Léon XX ne vient pas de proclamer en plein concile la nécessité d’une réforme qui non seulement atteindra l’Italie, mais la république chrétienne tout entière ? Au sein du concile un comité de réforme a été nommé qui doit chercher les moyens non pas seulement d’améliorer les mœurs du clergé, mais de les ramener à la pureté des vieux temps et de l’âge des apôtres. Ulrich de Hutten ne connaît donc pas les actes du concile de Latran ? Au milieu de toutes les tempêtes qui menaçaient à la fois la double souveraineté du pape, Jules II ne cessait de s’occuper des besoins de l’Église. Si Dieu l’eût laissé vivre, il aurait entrepris, ainsi qu’il le disait, la réforme du clergé : son successeur n’avait garde de laisser périr une aussi sainte pensée. A l’exemple d’Alexandre III, Léon veut désormais qu’on n’élève au sacerdoce que des hommes d’un âge mûr, de mœurs exemplaires, et qui aient étudié longtemps sur les bancs de l’école. Il défend qu’on agite, comme c’était la coutume à Florence, de vaines questions sur la nature de l’âme : l’âme est immortelle. Il défend d’enseigner qu’il n’y a qu’une âme répandue dans le monde, ainsi qu’on le faisait dans quelques universités d’Italie : à chaque homme, quand il naît, Dieu donne une âme qui ne peut jamais périr. Cette science qu’il aime à glorifier, et qu’on appelle la maîtresse des sciences, la théologie, a trop été négligée jusqu’à ce jour : il faut qu’elle refleurisse. Bannie soit cette philosophie platonicienne qui l’a séduit lui-même ! Désormais qui voudra se livrer au ministère des autels devra connaître les Pères et les canons. Encore cette science, toute belle qu’elle est, ne lui suffirait-elle pas pour mériter d’entrer dans les ordres sacrés, si sa vie n’est exemplaire. Il faut qu’une fois dans le saint ministère le prêtre vive dans la chasteté et la piété ; il faut non seulement qu’il s’abstienne de faire le mat, mais qu’on ne puisse le soupçonner de pouvoir le commettre ; il faut qu’il soit comme une lampe allumée devant les hommes et qu’il honore Dieu par ses œuvres. Voilà pour le prêtre : mais, s’il s’agit d’un dignitaire de l’Église, combien le pape est plus exigeant ! Il veut que la demeure du cardinal soit comme un port, -un hospice ouvert à tous les gens de bien, à tous les hommes doctes, à tous les nobles indigents, à toute personne de bonne vie. La table du prélat doit être simple, frugale, modeste ; dans sa maison ne régneront ni le luxe ni l’avarice ; ses domestiques seront peu nombreux ; il aura toujours l’œil levé sur eux ; il punira leurs dérèglements, il récompensera leur bonne conduite. S’il a des prêtres à son service, ces prêtres seront traités comme des hôtes honorables. Vient-on frapper à sa porte, il regardera le client, et refusera, s’il vient solliciter des places et des honneurs, d’être son avocat à la cour ; s’il demande justice, au contraire, il intercédera pour lui. Il faut qu’il soit toujours prêt à plaider la cause du pauvre et de l’orphelin. S’il a des parents dans le besoin, la justice exige qu’il vienne à leur secours, mais jamais aux dépens de l’Église. L’évêque doit résider dans son diocèse, et, s’il en a commis l’administration temporaire à des hommes d’une conduite éprouvée, le visiter au moins une fois chaque année, afin d’étudier les besoins de son Église et les mœurs de son clergé. En mourant il n’oubliera jamais que sa fille bien-aimée, l’Église qu’il administrait, a droit aux témoignages de sa reconnaissance. Pas de vaine pompe à son enterrement : le bien qu’il laisse appartient aux pauvres ; ses héritiers ne pourront dépenser au delà de 4.500 florins pour la cérémonie funèbre. Il faut lire chaque ligne de ce décret pontifical sur le cardinalat, pour voir avec quel soin Léon X descend jusqu’aux moindres détails qui touchent à la vie intime des prélats dans leurs palais, avec leurs domestiques, avec leurs parents, avec leurs clients, à l’église, dans leur diocèse, à table même. Ainsi donc ce n’était pas une réforme qui n’atteignît que le pauvre prêtre dans son église que demandait le concile, mais une réforme qui s’étendît jusqu’au prêtre en robe rouge ou violette : Le champ du Seigneur, disait-il en 1514, a besoin d’être remué de fond en comble, pour porter de nouveaux fruits. Il faut l’entendre joignant sa voix à celle de l’Allemagne et de la France, et confessant que chaque jour des plaintes arrivent de toutes les parties du monde chrétien sur les extorsions de la chancellerie romaine : Hutten est plus amer, mais non pas plus explicite. Ce que le pape demande en ce jour, ce qu’il demande bien haut, afin qu’on l’entende au delà des Alpes, des Pyrénées, par delà les mers, c’est que désormais le fisc s’amende, qu’il cesse de pressurer ceux qui ont recours à lui, qu’il redevienne ce qu’il était dans les premiers temps de l’Église. Mais, pour arriver à cette pureté des temps anciens, il faut que le néophyte qu’on destine aux autels reçoive une éducation sévère, chaste et religieuse. A Florence, à Rome et dans toute l’Italie, on croyait, à la renaissance, avoir assez fait pour la culture de l’intelligence, quand on avait appris à un écolier à lire Virgile ou Théocrite, à connaître les dieux d’Ovide, à traduire les sondes de Platon. Léon X ne veut pas que l’âme se contente désormais de cette nourriture toute sensuelle. Il faut qu’elle sache qu’elle a été créée de Dieu pour l’aimer et le servir ; qu’elle pratique la loi du Christ, qu’elle chante à l’église nos saintes hymnes, qu’elle psalmodie à vêpres nos psaumes du prophète-roi, que chaque soir elle lise les faits et gestes de ces héros chrétiens que l’Église inscrivit parmi ses docteurs, ses martyrs et ses anachorètes. Il veut que l’enfant sache par cœur le Décalogue, les commandements de Dieu, les articles du symbole, son catéchisme enfin ; et que, sous la conduite de leurs maîtres, les élèves, laïques ou clercs, entendent la messe, les vêpres, le sermon, et emploient le dimanche et les jours de fête à célébrer le Seigneur. On n’a pas assez étudié les actes du concile de Latran. Qu’on ouvre le beau livre où Raynaldi les a reproduits, et l’on verra combien les plaintes de Hutten étaient injustes ! Il disait à Wittemberg, en 1518, que la papauté refusait d’écouter les gémissements de l’Eglise d’Allemagne ; il nous trompait. Voyez-la donc cette papauté représentée par Léon X ; quel zèle elle fait éclater au palais de Latran pour la gloire du catholicisme ! Ici, c’est le pape qui demande que les votes des Pères soient secrets, afin qu’ils puissent en toute liberté exposer leurs griefs, formuler leurs plaintes, proposer leurs réformes ; ailleurs, c’est l’abolition des taxes trop onéreuses de la chancellerie romaine qu’il provoque spontanément ; plus loin, c’est l’envoi de légats aux princes étrangers, hérauts de paix, qu’il arrête avec le concile. Voici une page de ce grand livre où le pape exige que les cardinaux et les abbés rétablissent à leurs frais les autels que la guerre civile a renversés. En voici une autre où chaque prélat est imposé suivant ses revenus, pour subvenir aux frais de cette glorieuse croisade que le saint-siège prêche depuis plus d’un siècle contre les Turcs. Lisez donc ces belles lignes : Princes, donnez-vous le baiser de paix ; vous n’avez qu’un ennemi à combattre, l’Ottoman qui menace la chrétienté. Prêtres du Seigneur, ceci s’adresse à vous ; écoutez bien : Désormais personne n’entrera dans le saint ministère s’il n’a fait un cours de théologie. Tournez la page ; Érasme ne se moquera plus, s’il revient en Italie, de l’ignorance des moines mendiants : aucun d’eux ne pourra prêcher la parole divine s’il ne remplit ces conditions, dont le juge ecclésiastique doit répondre sur le salut de son âme : âge mûr, probité, doctrine, prudence, mœurs exemplaires. — Ces sages règlements s’adressent à l’Église tout entière : il faut que les évêques des provinces chrétiennes veillent à l’exécution des décrets de Latran, et que, réunis en conciles provinciaux ou en synodes au moins tous les trois ans, ils s’occupent de l’amélioration des mœurs de leurs diocésains, et de la décision des cas de conscience controversés. Mais qu’ils n’oublient pas ces belles paroles de l’Écriture : Employez pour guérir les plaies des pécheurs l’huile et le vin, à l’instar du Samaritain, afin qu’on ne vous dise pas avec Jérémie : Est-ce qu’il n’y a plus de résine en Galaad ? est-ce qu’il n’y a plus ailleurs de médecin ? A l’époque de la renaissance, quand la philosophie de Platon passa de la Grèce en Italie, presque tous les esprits étudièrent l’astrologie : l’école de Florence, représentée par Benivieni, Marsile Ficin et d’autres prêtres de Santa-Maria del Fiore, l’enseignait publiquement dans ses vers ; le prédicateur la prêchait même en expliquant dans la chaire l’évangile du dimanche. A Rome, le moine prédisait la fin du monde, qu’il lisait dans les astres. Léon X, au nom de la religion, proteste contre ces superstitions, et défend d’effrayer l’imagination des fidèles par des peintures tirées d’un monde imaginaire. Machiavel avait dit en parlant des Florentins : Ce ne sont pas des enfants, et ils croient pourtant aux prédictions de Savonarole. Le pape ne voulut pas que le prêtre répétât en chaire le rôle du dominicain. Il avait vu quel parti l’incrédulité pouvait tirer de ces révélations surnaturelles que certaines âmes voulaient s’attribuer, et il défendit de toute l’autorité de sa parole, confirmée encore par l’assentiment du sacré concile, à quiconque enseignait en chaire, dans un cloître ou dans un livre, de prédire des événements dont Dieu seul s’était réservé le secret. L’autorité suprême avait besoin de protester contre des superstitions qui étaient protégées comme autant de vérités, non seulement dams quelques universités italiennes, mais jusque dans les couvents de l’Allemagne. C’est ainsi qu’à Spanheim, sur les bords du Rhin, l’abbé dont l’orthodoxie n’était pas plus douteuse que la science, Tritheim, vénéré de Jules II, avait publié le secret de se mettre, à l’aide des esprits célestes, en communication avec une personne absente. Non pas que le pape nie que Dieu ne puisse se révéler à des créatures privilégiées, et que ces créatures ne puissent prédire l’avenir ; il l’a dit, il le croit, et le déclare formellement ; mais il veut qu’on éprouve ces âmes qui annoncent les futurs contingents, et que les révélations que l’Esprit-Saint peut leur communiquer soient soumises à celui à qui Dieu dit parla bouche de son Christ : Vous êtes Pierre, etc. Nous avons vu ailleurs que, dans son noble enthousiasme pour cette littérature païenne dont les humanistes de la renaissance poursuivaient la glorification, le savant avait renoncé trop souvent à la langue de nos Écritures, en parlant de notre Dieu, du Christ, de sa mère, des anges : il lui semblait que, lorsqu’il avait appliqué au Sauveur des hommes une épithète tirée d’Homère on de Virgile, la puissance céleste devait apparaître aux regards dans un limbe plus lumineux. Malheureux travers dont le théologien lui-même ne sut pas toujours se préserver ! Il fallait une leçon à ces adorateurs fanatiques de l’antiquité ; elle leur fut donnée par le concile de Latran. C’est la langue de l’Évangile qu’il parte constamment ; c’est à la source de nos livres saints qu’il va s’inspirer ; les images qu’il emploie sont tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament. Une seule fois, à la dixième session, un vieillard au beau langage, l’archevêque de Patras, délaissa l’humble prose pour chanter en vers la reine des anges ; mais sa poétique invocation ne renferme aucune expression que le casuiste le plus sévère oserait blâmer. Il s’excuse si candidement, lui pauvre septuagénaire dont le luth ne rend plus que des sons plaintifs, de son appel aux Muses pour célébrer Marie, qu’il serait bien difficile de ne pas lui pardonner. Un moine augustin, dont nous dirons bientôt le voyage en Italie, de retour en Allemagne, raconte des prodiges qu’il n’a pas vus et qu’il ne pouvait voir assurément. Nous ne parlons pas du haut clergé romain, magnifiquement représenté à l’époque où Luther voyageait, et dont il dénigre l’intelligence, aux grands éclats de rire de ses disciples buveurs de bière, qui croient à l’ignorance de cardinaux tels que Caraffa, Frégose, Piccolomini. Nous ne dirons rien de ces 6.000 crânes d’enfants nouveau-nés, qu’il a trouvés dans le cimetière d’un cloître dont il n’a pas donné le nom. Il ne s’agit ici que de ce Christ qu’il a la prétention d’avoir révélé au monde chrétien, qui l’avait oublié depuis longtemps. Mais Luther ne connaît donc pas les actes de ce concile de Latran où à chaque page le sang de l’Homme-Dieu est glorifié, invoqué, adoré ? Ouvrez-les, et vous verrez le pape, les archevêques, les évêques, les prélats, les abbés, s’incliner à ce nom, et répéter ces belles paroles de l’apôtre : Il n’est d’autre fondement que celui qui a été posé, et ce fondement c’est Jésus-Christ. 1 Cor., ch. III, v. XI. Il a visité l’Italie tout récemment, et il n’a pas vu les symboles nombreux de la foi romaine au Christ rédempteur, sculptés ou peints sur les murailles des églises : ces calices suspendus sur presque toutes les chaires de prédicateur ; ces croix élevées à presque chaque coin de rue ; ces bons pasteurs placés sur 1a façade des maisons, et emportant sur leurs épaules les brebis égarées ; tous ces hymnes en pierre, en marbre, en bois, qui chantent le sang du Golgotha ! Raphaël venait de peindre le miracle de Bolsena, et Luther ne l’a pas vu ! Qui donc lui a dit qu’on ne croyait pas à Rome au sang du Christ ? Une épigramme peut-être qu’il emporte dans son bréviaire. A Naples et à Florence il est une secte poétique qui des anciens écrivains n’a étudié que les satiriques. Elle formule, quand elle parle latin, un arrêt historique en deux ïambes : Ce n’est pas à des têtes obscures qu’elle s’attaque, mais à tout ce qui a fait du bruit dans ce monde : tiare, diadème, toge, hermine. Elle se prend avec une sorte de volupté à tout ce qui se distingue du vulgaire par la naissance, la réputation, la fortune ou les dignités. A cette époque, chaque jour se produit une gloire nouvelle ; nulle ne veut aider à l’autre à faire son chemin ; un succès littéraire est une offense pour qui ne l’a point obtenu, et une épigramme le châtiment infligé ordinairement au coupable. Ce qu’il y a de malheureux, c’est que l’histoire, quand elle a voulu citer à son tribunal quelque royauté intellectuelle ou mondaine, est allée puiser dans cette urne de calomnies pour formuler son jugement. Il y a des poètes, comme Pontano, qui font l’épitaphe d’une femme vingt ans avant qu’elle soit descendue dans la tombe. Il y a des historiens qui ramassent l’anachronisme et s’en servent pour frapper cette femme. Vous en verrez d’autres accuser un chanoine tel que Politien, qui a prêché un carême dans l’église de Santa-Maria del Fiore, à de n’avoir jamais lu l’Écriture ; n et des hommes graves à l’instar de Mélanehthon enregistreront cette facétie comme une vérité révélée. Reuchlin, Ulrich de Hutten, Luther, Erasme, R. Agricola, en traversant l’Italie, recueillaient ces épigrammes, et, de retour dans leur patrie, les répétaient à leurs amis et les reproduisaient dans leurs écrits. Un jour on était tout étonné de voir l’épigramme encadrée dans un tableau de la société italienne le peuple prenait le livre, jurait sur la parole écrite, et l’épigramme devenait de l’histoire. La papauté devait empêcher les désordres de la presse ; et c’est ce qu’elle fit, comme nous le verrons bientôt. Cette parole dont elle voulait, avec raison, enchaîner la licence, ne s’attaquait qu’à l’intelligence, tandis que l’usure tarissait dans sa source la vie matérielle du peuple ; c’était une plaie sociale, entretenue par les guerres civiles, que Léon X voulait fermer. L’ouvrier, réduit à la misère, était obligé de recourir au juif, le lombard de ce temps-là, dont la pitié homicide tuait lentement le pauvre qui venait l’implorer. L’établissement des monts-de-piété est une pensée toute catholique, que Léon fit adopter au concile de Latran. |