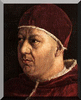HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XVI. — PREMIERS ACTES DE LÉON X. - 1513.
|
Lettres de Delfini et
d’Érasme à Léon X. - Le pape demande et obtient la grâce de Machiavel. -
Rappel de Soderini. - Le pape travaille à réconcilier entre eus les princes
chrétiens. - Avances qu’il fait à Henri VIII, roi d’Angleterre, à Louis XII,
roi de France. - Guichardin est chargé par la république de Florence de
complimenter Sa Sainteté. - Le repos de l’Italie est de nouveau menacé. -
Ligue de Louis XII et des Vénitiens. - Conseil que le pape adresse
inutilement au roi de France. - La ligue franco-vénitienne est défaite. -
Bataille de Novare. - Admirable conduite de Léon X après la victoire des
alliés du saint-siège. Pierre Delfini, qui avait écrit une si belle lettre au cardinal quand Soderini fut obligé de s’exiler de Florence, n’était plus à Fontebuona. Il avait été nommé supérieur de l’ordre des camaldules, et vivait à Venise au milieu de manuscrits dont il avait enrichi son couvent. En mourant il laissa un recueil de lettres que Jac. Brixianus, Breseiani, fit imprimer à Venise en 1524. Or, un moment, ce volume devint si rare, qu’on ne pouvait se le procurer, même en donnant de l’or à pleines mains, et qu’à Paris un exemplaire se vendit mille livres, comme nous l’apprennent les bénédictins Edmond Martène et Ursin Durand, qui l’ont fait entrer dans leur collection des Monuments historiques. Elles méritaient bien cette place glorieuse, ces lettres dictées par le cœur, et où comme dans un miroir se reflètent la piété, le savoir, la charité et toutes les vertus de Delfini. Un religieux camaldule nous dit que son général avait les cheveux blancs, la figure majestueuse, la parole douce et modeste. A Florence, les maîtres n’avaient pas manqué an fils de Laurent le Magnifique. Delfini, choisi pour lui enseigner les premiers éléments de la langue latine, et sans doute pour aider les autres professeurs, n’avait cessé de prophétiser que l’enfant attirerait un jour les regards. Avec quel soin le bon frère veillait à ce que le poison de la flatterie ne vînt pas corrompre les dons qu’il admirait dans son élève ! On a pu voir que Delfini, comme un ange gardien, vient à tout moment offrir son assistance à son disciple bien-aimé. Si le sort exile le cardinal, Delfini est là qui apprend au proscrit à supporter chrétiennement ce châtiment providentiel. Quand le ciel s’apaise, et que tes Médicis, éprouvés par le malheur, rentrent à Florence, une voix se fait entendre à l’oreille du légat de Jules II ; voix chrétienne qui ne ressemble guère à cette musique de paroles adulatrices dont on cherche à l’étourdir : c’est celle de notre camaldule. Dieu vient d’élever à la papauté le cardinal de Médicis, qui a pris le nom de Léon ; on peut être sûr que Delfini n’est pas loin : le voilà qui écrit au souverain pontife : Quoique plusieurs de vos ancêtres aient été de vrais lions en sagesse et en doctrine, je ne sais quel présage m’annonce que ce nom de Leo vous vient directement de Dieu. Vous l’avez pris, ainsi qu’il est écrit, comme un signe de sagesse et de terreur : de sagesse pour l’âme obéissante, de terreur pour l’âme rebelle ; il sera l’objet des respects et de la vénération de tout ce qui porte un nom chrétien. Soyez béni, car vous avez été fidèle aux exemples de la vieille race des Médicis : vos oreilles se sont ouvertes aux cris du pauvre et de l’indigent. Vous vous rappeliez sans doute les mots de l’apôtre : Soyez hospitalier ; c’est par l’hospitalité accordée aux anges que plusieurs ont trouvé grâce devant le Seigneur. Voilà ce que le bon frère disait à Léon X, pendant qu’Erasme, qui venait de quitter l’Italie, écrivait d’Angleterre au pape nouvellement élu : Léon X, vous nous rendrez le gouvernement heureux de Léon Ier ; la piété érudite et le goût musical de Léon II ; l’éloquence féconde et l’âme de Léon III, qui n’a ployé ni devant la bonne ni devant la mauvaise fortune ; la simplicité et la prudence, vantée par le Christ, de Léon IV ; la sainte tolérance de Léon V ; l’amour pour la paix de Léon VI ; la vie toute céleste de Léon VII ; l’intégrité de Léon VIII ; la bonté de Léon IX : voilà ce que vous nous rendrez ; nous en avons pour garants et ces noms sacrés qui sont autant d’oracles, et le passé, et l’avenir ! Combien le langage du moine est préférable à celui du philosophe ! Le Batave ne fait que répéter les hymnes que l’adulation vient d’écrire sur le fronton de tous ces temples, sur la corniche de tous ces arcs de triomphe, sur le socle de toutes ces statues de pierre, de bois, de carton, érigés en l’honneur de Léon X, et que Penni nous a si complaisamment décrits. C’est de la flatterie mise en belle prose, et dont Erasme attend une récompense ; il ne prête pas même ses louanges, il les vend. Mais le moine, c’est une leçon indirecte qu’il donne au pape, son ancien élève, car il n’a pas voulu perdre ses droits de professeur. Quoique vivant dans la solitude, il sait ce qui se passe dans le monde. Avant d’entrer au couvent, il avait beaucoup pleuré. Il aime ceux qui pleurent, et il voudrait que le pape essuyât leurs larmes. Au delà des mers est un exilé, Soderini, qui mourra si Léon X ne le rappelle. Dans les prisons de Florence gémit l’ancien secrétaire de la république, Machiavel, qui s’est laissé entraîner dans la conspiration de Boscoli contre les Médicis : il faut que le pape lui pardonne, s’il veut accomplir le précepte de l’Apôtre, et plaire à son vieux camaldule. Si le cardinal n’avait pas revu plus tôt cette chère Florence d’où l’avaient chassé les factions, c’est que toujours Soderini lui en avait barré le chemin. A son tour le gonfalonier avait éprouvé combien est fragile cette royauté que le peuple ôte ou rend dans un moment de mauvaise ou de bonne humeur. Heureusement Léon X savait combien est dur le pain que l’exilé mange sur une terre étrangère, et deux jours après son couronnement il rappelait le gonfalonier. Plus Soderini avait été malheureux, plus le bref du pape devait être affectueux ; on dirait que Delfini l’a dicté : ... Nous conjurons votre seigneurie, dit Léon X, aussitôt qu’elle aura reçu et notre lettre et notre bénédiction, de se mettre en route, et sans délai de venir nous trouver ; plus vous mettrez de diligence dans vos préparatifs de départ et dans votre voyage, plus nous serons heureux. Quel exilé aurait pu résister à de si tendres avances ? aussi le gonfalonier se met-il en chemin comme le pontife le veut, sur-le-champ, et sans songer à revoir cette Florence qu’il a gouvernée pendant dix ans environ. Il arrive d’un trait à Rome, tombe aux genoux du pape, qui le relève et l’embrasse tendrement. Désormais il n’y a plus de Florence pour le proscrit : sa patrie c’est Rome, où Léon X le traite en véritable souverain. Il a conservé le titre que le peuple lui conféra ; on dit à Rome : le gonfalonier Soderini. Logé sur le mont Citorio, il voit à ses pieds cette autre reine déchue qui, après sa chute, a comme lui gardé son vieux nom. Semblable à la ville éternelle, Soderini a des courtisans nombreux, devant lesquels il joue toujours le rôle de dictateur. Un jour, un de ses hôtes s’avise de rappeler ait proscrit le temps où il exerçait la première magistrature en Toscane. Le vieillard relève fièrement la tête, et demande depuis quand Soderini a cessé d’être gonfalonier de Florence. Du moins, sur la terre étrangère, Soderini était libre et voyait la lumière ; mais Nicolas Machiavel, plus malheureux, plongé dans un cachot, attendait avec ses complices l’heure du jugement. Il passait pour démocrate : sa haine contre ces marchands de laine qui, sous le nom de Médicis, s’étaient faits rois de Florence, éclatait à chaque instant, et l’on disait que, pour chasser les tyrans, il se serait servi de la plume et du poignard. Léon X réclama et obtint la liberté de l’écrivain, de Nicolas Valori et de Jean Folchi. Boscoli et Capponi auraient dû la vie à l’intercession du pape, si la justice, qui n’était guère patiente à Florence, ne se fût hâtée de demander et de verser le sang des deux conspirateurs. A peine Machiavel était-il sorti de prison, qu’il s’était hâté d’écrire à François Vettori, son protecteur, alors ambassadeur de Florence près de la cour de Rome. Me voilà donc libre, lui disait-il ; j’espère bien ne plus rentrer en prison, je serai plus prudent désormais ; les temps deviendront meilleurs, et les hommes moins soupçonneux. Vous savez la triste position de Messer Toto, je vous le recommande ; il voudrait, ainsi que moi, entrer au service de Sa Sainteté. Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir de notre seigneur : qu’il tache de m’employer, lui ou les siens. Je vous ferais honneur, j’en suis sûr. François Vettori répond sur-le-champ à son ami : A peine le cardinal de Médicis était-il élu pape, que je lui demandai votre liberté ; c’est la seule grâce que je sollicitai de Sa Sainteté ; et combien je suis heureux d’apprendre que vous êtes libre ! A présent, cher compère, je n’ai qu’une recommandation à vous faire, c’est de montrer du courage. Quand la fortune des Médicis se sera raffermie, vous ne resterez pas à terre. Machiavel n’avait pas été compris par François Vettori : ce n’était pas des consolations qu’il demandait à son ami ; à tout prix il voulait rentrer dans les affaires. Oui, répond-il à l’ambassadeur, tout ce que j’ai de vie, je le dois au magnifique Julien ; et, s’il plaît à mes maîtres de ne pas me laisser à terre, j’en aurai une grande joie, et je pense que je me conduirai si bien qu’ils auront lieu d’être contents de nies services. Au moment où Léon X rendait la liberté à Machiavel, le prisonnier travaillait à son livre du Prince, déification du fatum des anciens, ou de ce que la politique a nommé de nos jours nécessité. Il l’écrivait afin que ces Médicis qu’il avait voulu chasser de Florence, voyant combien était grande sa science politique, ne le laissassent pas languir plus longtemps dans la misère : car le gibelin ne pouvait pas supporter la pauvreté, qu’il regardait comme une chose infâme. Que Julien ou Léon X lui donne un emploi, même parmi ses familiers, le républicain ne se fera pas violence pour l’accepter. Il est prêt à rentrer au service de maîtres qu’hier encore il consentait à poignarder. Les Médicis eurent peur, et le laissèrent à terre. A Florence, où l’avènement de Léon X à la papauté fut fêté comme à Rome, un marchand avait inscrit sur un arc de triomphe : Au restaurateur de la religion, de la paix et des arts. Ce marchand avait compris et deviné Léon X. C’est bien à ces trois grandes œuvres qu’il songeait à se vouer en montant sur le trône. Le protestantisme a méconnu ce pontife : il n’en fait qu’un artiste auquel il veut bien accorder quelques louanges. Léon X fut un grand pape et un grand souverain. C’est dans cette triple vie de pape, de souverain, d’artiste, que nous l’étudierons. Jusqu’à son dernier soupir, nous le verrons travailler au triomphe de la paix et des lettres. Au lecteur catholique aveuglé peut-être par de funestes préventions puisées dans les écrits d’écrivains dissidents, nous ne demandons qu’une chose, c’est de n’ajouter foi qu’aux faits ; les faits sont la poésie de l’historien. Le rappel de Soderini, le pardon accordé aux conspirateurs florentins, et d’autres actes de générosité toute royale, causèrent dans Rome une joie inexprimable ; cette fois le peuple Et comme les poètes, il se mit à chanter dans des sonnets le successeur de Jules II. Léon X, dès qu’il paraissait en public, était accueilli par des cris d’admiration et de reconnaissance. Rome, après tant de luttes sanglantes, allait donc jouir du repos. Dieu semblait avoir suscité Léon X pour relever tout ce que le passé avait si fatalement renversé, pour apaiser les haines, réconcilier les esprits, ramener les cœurs égarés, réunir dans un même amour envers le saint-siège tous les souverains nationaux et étrangers. Tout est à étudier dans un prince qui débute sur le trône ; on ne doit pas le perdre un moment de vue ; il faut s’attacher à ses pas, le suivre dans son palais, l’accompagner hors de sa cour, et chercher surtout dans sa correspondance à surprendre les secrets de son âme. Voyons ce que gagnera Léon X à cette appréciation intime. Il existait à Florence de pauvres religieuses qui avaient souffert dans les guerres civiles dont cette ville avait été le théâtre. L’image de ces saintes filles, sincèrement attachées aux Médicis, se présente bien vite au nouveau pape, qui leur envoie deux cents écus d’or en signe de reconnaissance, leur demandant, pour ce petit présent, de recommander dans leurs prières, à Dieu et à la bienheureuse Vierge, celui qui n’a rien fait encore qui lui méritât le titre de vicaire de Jésus-Christ sur cette terre. Dans toutes les lettres qu’il écrit immédiatement avant et après son couronnement, ce qu’il demande avec le plus d’insistance, ce sont des prières pour le repos de la chrétienté. Trop de sang et trop de larmes ont été répandus. Un moment, sous Jules Il, le canon a cessé de gronder, et, dans ce court intervalle de repos, quelque chose de merveilleux s’est passé à Rome. On a vu accourir de toutes les provinces vers la capitale du monde chrétien les artistes les plus éminents. San-Gallo, Bramante, Fr. Giocondo, Michel-Ange, Raphaël d’Urbin, Peruzzi, Soddoma, sont venus visiter la ville sainte. C’est la papauté qui leur en fait les honneurs. La place de Saint-Pierre est un vaste atelier où l’on remue et où l’on travaille le marbre la nuit et le jour, et les collines qui l’environnent sont un vaste cimetière qu’on fouille incessamment pour en exhumer les statues antiques qui là dorment ensevelies depuis des siècles. A chacune de ces résurrections se trouve un poète qui chante la relique en latin ou en italien. Que la paix dure encore quelques années, et la Rome d’Auguste va renaître ; Léon X le Florentin veut y attirer toutes les gloires. Aussi comme il s’inquiète, en chrétien d’abord, puis en artiste, des dissensions qui menacent, même de loin, le repos des nations ! Sigismond, roi de Pologne, nourrissait contre Albert, marquis de Brandebourg, une vieille haine qui ne demandait pour éclater qu’une occasion favorable. Il fallait empêcher un conflit entre les deux princes. Alors la voix de la papauté était toute-puissante : on l’écoutait comme un écho de la voix même de Dieu. Le pape lui écrit : Au nom de l’intérêt et de l’amour paternel que je vous porte, modérez les transports de colère qui vous animent ; attendez l’arrivée du légat que je vous envoie, et qui écoutera vos plaintes et vos doléances respectives. Si vous le préférez, prenez pour arbitres les pères du concile de Latran, qui peuvent bien terminer les différends qui surviennent entre des rois, des ducs ou des princes. Albert dut à cette intervention du saint-siège la conservation de ses États, que Sigismond s’apprêtait à envahir ; mais il oublia bien vite le service que la papauté lui avait si généreusement rendu ; et lorsque, quelques années plus tard, un moine augustin vint prêcher la révolte contre Rome, un des premiers il renia la foi de ses pères. Il est vrai de dire que l’apostasie lui valut une couronne usurpée, les biens de l’ordre teutonique dont il était le grand maître, les revenus du clergé catholique, les pierreries des autels, et jusqu’aux celliers des couvents : la fidélité au saint-siège ne lui aurait donné que la paix de l’âme. Un autre prince catholique devait trahir plus cruellement encore le saint-siège et son bienfaiteur : c’était Henri d’Angleterre. On pourrait douter, en contemplant le portrait du monarque, peint par Holbein, que cette figure si pure, cette bouche si rosée, ce front si lisse, cet œil si doux, appartinssent au meurtrier d’Anne de Boleyn. Henri, à l’âge où l’âme insouciante ne rêve que plaisirs, s’occupait de choses sérieuses. S’il aimait à monter un cheval fougueux, à rompre une lance dans un tournoi, à danser dans un bal pour montrer les grâces de sa personne, il cherchait aussi la solitude pour étudier. Ses livres habituels étaient des livres de théologie ; saint Thomas d’Aquin était son auteur favori. Dans ses moments de loisir, il composait en musique des messes d’église. Ses ambassadeurs auprès des puissances étrangères étaient en général des aristotéliciens renforcés. Son légat à la cour de Rome, l’évêque de Worcester, s’était fait estimer de Jules II par sa prudence, sa probité, ses mœurs et sa science. Le cardinal de Médicis l’aimait d’une affection particulière, comme il le disait à tout le monde. L’évêque le voyait souvent, et la conversation roulait presque toujours sur le jeune Henri, qui promettait au monde un monarque accompli. Il fallait, par de douces paroles, attacher au saint-siège plus étroitement encore, s’il était possible, une âme si merveilleusement organisée. Celles que le pape lui adressa étaient faites pour charmer l’oreille d’un écolier qui se piquait de beau latin, et le cœur d’un prince qui se faisait gloire du titre d’enfant soumis de l’Église. Le pape s’attachait à relever en termes magnifiques les belles qualités du légat de Henri ; la piété, l’attachement au saint-siège du monarque anglais, les dons heureux que le ciel lui avait accordés, et qui germeront bientôt, disait-il, et produiront des fruits abondants pour la république chrétienne. En lisant ces lettres, vous retrouvez l’élève de Politien, amoureux comme son maître de l’épithète. C’est Bembo qui les écrivait le plus souvent, mais sous la dictée du pape, car la formule païenne ne s’y montre que rarement. De nos jours, le pape n’écrirait pas autrement. Le moindre des billets de Léon renferme quelques élans de dévotion à la Divinité ou à la Vierge Marie, aux saints apôtres, ou au patron de l’Italie ; son langage est partout digne et chrétien ; à chaque ligne c’est un parfum nouveau de charité : pour le pape, aimer est un besoin. Il dit à tout le monde. Je vous aime ; à Sigismond, au roi d’Angleterre, aux religieuses de Florence, à Raimond de Cardonne, vice-roi de Naples, au roi de France lui-même, Louis XII, qui avait souffert qu’on mît Jules II sur la scène. Je suis heureux, écrit-il à son frère Julien, que mon élévation au trône pontifical ait été accueillie avec joie par le roi de France. Oui, je suis de votre avis, il faut chercher à faire la paix avec ce monarque ; les raisons que vous alléguez me plaisent infiniment. Vous le savez bien, le plus ardent de mes désirs est de voir les cœurs de tous les princes chrétiens unis par les liens d’une sainte et mutuelle amitié. Si je souhaitai la paix quand la fortune m’était moins propice, quels vœux ne dois-je pas former pour l’obtenir, aujourd’hui que je suis vicaire du Christ, source et auteur de toute charité ? Je sais les marques d’affection que le roi vous prodigua quand vous fûtes forcé, dans des temps de troubles domestiques, de chercher un refuge en France ! Je connais l’intérêt que les monarques français ont toujours porté à Florence notre patrie, ainsi qu’à notre famille. Je n’ai point oublié non plus les services qu’ils ont rendus au saint-siège ; j’ai des dettes à payer, et je les acquitterai toutes, s’il n’y met obstacle. Qu’il le sache bien : je veux que vous lui disiez que je ne négligerai rien pour qu’il ne se repente jamais de s’être montré joyeux de mon avènement, surtout s’il me propose des conditions de paix justes, raisonnables, et n’engageant en rien l’honneur de ma couronne. Maintenant, si de nouveau l’Italie est exposée au fléau de la guerre, au moins la papauté n’aura pas de reproche à se faire ; elle parle en ce moment un langage tout évangélique. Léon X ne songe pas à venger l’injure que la France fit à Jules II, de si glorieuse mémoire. A Paris et à Lyon, on a vu la déposition du pape affichée sur les murs des églises. Son successeur oublie cet outrage ; c’est lui qui vient le premier demander et offrir la paix à Louis XII. C’est qu’il sent bien que la paix seule peut l’aider à exécuter les vastes projets dont il a conçu l’idée. Si les puissances le lui permettent, il rendra Rome l’asile de la piété, des sciences et des lettres ; il achèvera ce saint édifice que son prédécesseur a commencé ; et à la construction du temple dédié au prince des apôtres il convoquera tous les arts, il en fera quelque chose de merveilleux. Dans Rome il percera de nouvelles rues, il agrandira la bibliothèque du Vatican, et l’enrichira de manuscrits nouveaux ; il fera fouiller l’antique Forum et les vignes qui s’étendent autour de la ville, pour y chercher les œuvres des statuaires grecs et romains. Rome aura bientôt un gymnase où liront les professeurs les plus habiles qu’il pourra trouver en Italie. Il veut relever le culte de cette belle langue grecque qu’on parle à Florence, et qui servira non seulement à l’initiation des âmes à la philosophie antique, mais encore à l’étude des Pères de l’Orient, gloire impérissable de notre Église. La muse latine, qu’il aima dès son enfance, aura son collège et son académie dans la capitale du monde chrétien. Réveillez-vous, belle langue de Dante ! vous venez de trouver dans Léon X un ardent protecteur ; il ne pouvait vous oublier, vous que son père cultiva si glorieusement. Le pape sait par cœur la plupart des poèmes de Laurent le Magnifique, et, pour prouver que l’idiome italien peut lutter avec la langue de Virgile, il se plaît souvent à répéter la belle description de la Jalousie, que Laurent improvisait à sa villa Careggi. Florence, pour féliciter Léon lors de son avènement à la papauté, jeta les yeux sur Bernard Ruccelaï, historien latin, qui, à la manière de Salluste, son modèle, affecte d’enfermer tout un tableau dans une phrase ; mais Ruccelaï refusa l’insigne honneur de haranguer le nouveau pape. Alors la ville fit choix de Guichardin, qui, bien loin de répudier l’idiome de Pétrarque, songeait à décrire en langue vulgaire les événements militaires dont l’Italie venait d’être le théâtre. C’est en italien qu’il voulut parler au pape, c’est en italien que le pape lui répondit : lutte ingénieuse où l’un comme l’autre apporte ce qui le distingue particulièrement : l’orateur de la république sa phrase ample et sonore, le pape son expression élégante et facile ; tous deux s’étudiant, sous l’œil de Bibbiena et de Sadolet, qui assistent à cette entrevue, à donner à leur harangue une forme toute romaine. Le pape ne ressemble pas à son prédécesseur Jules II, qui, l’épée à la main, après être entré en vrai soldat à Mirandole à travers une pluie de feu, se troublait en face d’un pauvre petit envoyé d’une pauvre petite république, et cherchait péniblement une expression sans pouvoir la trouver. Léon X est un orateur disert, à qui jamais le mot propre ne fait défaut, et qui, mis à l’improviste sur une question religieuse, politique ou littéraire, répond toujours pertinemment. Au mois d’avril 1513, un religieux de l’ordre de Saint-François quittait Venise, et s’acheminait vers la capitale du inonde chrétien pour féliciter Léon X, auquel il avait donné pendant quelque temps des leçons de grec. C’était Valeriano Bolzani de Bellune, qui avait parcouru à pied la Grèce, la Syrie, la Palestine, l’Égypte, l’Arabie, et qui, pour l’a première fois, afin d’aller plus vite, se servait d’un cheval pour traverser le défilé pierreux d’Assise. C’était un glorieux représentant de la Grèce, dont il enseignait la langue : afin d’en faciliter l’étude, il avait composé une grammaire où les règles de l’idiome étaient tracées dans un latin qui ne manquait ni d’élégance ni de précision. Le premier ouvrage qu’Érasme, en arrivant à Venise, avait voulu se procurer, c’était le Rudiment de Bolzani, publié au mois de janvier 1497, chez Alde Manuce ; mais il était épuisé. Quand ses leçons, qui ressemblaient un peu à celles qu’on donne chez nos frères des écoles chrétiennes, étaient terminées, Bolzani prenait le chemin de l’imprimerie d’Aide, son ami, et se mettait à la casse comme un ouvrier. Il avait soixante-trois ans quand il vint, seul, par des chemins difficiles, pour baiser la main de son élève devenu pape. Le professeur s’était obstiné dans sa pauvreté. L’écolier fit tout son possible pour retenir son vieux maître ; il employa pour le séduire cette belle langue grecque qu’ils avaient apprise ensemble ; mais Valeriano Bolzani fut inflexible. II refusa tous les honneurs que le pape lui offrit, demandant pour toute grâce au souverain la permission de quitter Rome, de retourner à Venise, où, à défaut d’épreuves qu’il ne pouvait plus lire, car le travail lui avait usé les yeux, il avait les beaux arbres de son couvent à émonder. Léon X le rendit à ses jardins. Bolzani allait succomber encore à la tentation des voyages, et, pèlerin septuagénaire, chercher des mondes inconnus, quand il tomba d’une échelle sur laquelle il était monté pour tailler un arbre, se cassa la cuisse, et dut renoncer à sa vie des grandes routes. Au moment où Rome et Florence célébraient l’élection de Léon X, le repos de l’Italie était de nouveau menacé. Louis XII, qui ne pouvait renoncer au duché de Milan, venait de détacher Venise du Saint-Siège. Venise, cette vieille rivale de Rome, abandonnait des alliés qui l’avaient sauvée, et signait, le 15 mars 1543, avec le roi de France, un traité où elle garantissait au monarque le duché de Milan en échange de Crémone et de la Ghioradadda, que le prince abandonnait à la république. Pendant que Louis, au mois de mai, envahirait la Lombardie, les Vénitiens devaient, avec huit cents gens d’armes, quinze cents chevaux et dix mille fantassins, attaquer le Milanais. Au mois de mai, Louis de la Trémoille amenait à Suse douze cents hommes de cavalerie légère ; Robert de la Mark, surnommé le Sanglier des Ardennes, huit mille lansquenets ; et de Fleuranges et de Jamet, huit à dix mille Français recrutés de toutes parts. Les Vénitiens étaient à San-Bonifacio ; Barth. d’Alviane, à qui Louis XII avait rendu la liberté, commandait les troupes de la république. En face de forces si imposantes, Raimond de Cardonne abandonna Tortone et Alexandrie, et se retira sur la Trebbia. Les Suisses se replièrent sur Novare. La ligue franco-vénitienne fut heureuse : Alexandrie et Asti tombèrent au pouvoir des Français, dont la bannière flotta bientôt sur les clochers de Milan. Valeggio, Peschiera, Crémone, reconnurent l’autorité de Venise, et Antoniotto Adorno fut chassé de Gênes, et remplacé par Octavien Frégose, l’ami des Français. L’œuvre de Jules II était compromise : la Lombardie appartenait à l’étranger. A la première nouvelle du traité de Blois, Léon X s’était hâté d’écrire à Louis XII. La lettre du souverain pontife restera comme un modèle de douceur évangélique. Le pape engage son cher fils, au nom de Dieu, à renoncer à cette funeste expédition qui ne peut que causer de nouvelles douleurs à l’Italie : Nous avons vu de nos yeux, lui dit-il, et ce souvenir nous déchire le cœur, des villes incendiées ou ruinées, des églises violées et ensanglantées, des jeunes filles déshonorées, de saintes femmes immolées. N’est-il pas temps que l’Italie respire ? Si la guerre doit éclater de nouveau, qu’elle épargne au moins ce malheureux pays. Au nom du Dieu des miséricordes, nous vous en prions, songez au beau nom que vous portez ; rappelez-vous cotre ancienne tendresse pour le saint-siège. Si vos droits sont fondés, ayez recours aux négociations et non point aux armes. Nous sommes prêt à vous aider, à vous servir de toute notre bienveillance, de tout notre amour ; nous n’avons qu’un seul désir, c’est que la paix règne dans toute la chrétienté. Ces conseils ne furent point entendus. Alors Léon X, se rappelant l’exemple de Jules II, prend ses mesures pour préserver et sauver l’Italie. En moins de quelques semaines, il conclut avec Henri VIII d’Angleterre, l’empereur Maximilien et le roi d’Espagne, une ligue qui est signée à Malines le 5 avril 1513. Le pape comptait sur les Suisses. Mathieu Schinner, dont la haine contre les Français n’avait pas même besoin d’être réveillée, alla dans les montagnes d’Uri, d’Unterwald et de Zug, recruter de nouveaux soldats. C’est quelque chose de merveilleux que le dévouement au saint-siège de ces cantons alpestres. Un pâtre, sur la cime d’un rocher, fait retentir un cor : à ce son, tous les habitants des villages se rassemblent autour de l’église paroissiale ; un moine annonce en chaire la croisade nouvelle, et quelques jours après, souvent même le lendemain, ils partent pour le rendez-vous assigné, précédés d’une bannière où on lit en lettres d’or : Domitores principum. Amatores justitiæ. Defensores sanctæ romanæ Ecclesiæ. Trivulce s’était vanté de prendre les Suisses comme on prend du plomb fondu dans une cuiller. Ces Suisses étaient enfermés dans Novare. La brèche fut ouverte en quelques heures. Sien loin d’être effrayés, les assiégés firent dire au général français qu’il pouvait garder sa poudre pour l’assaut, et qu’ils étaient prêts à élargir la brèche. Cependant les recrues de Schwytz, d’Unterwald et d’Uri, arrivaient par le Simplon, le Saint-Gothard et le Vogelberg. Le Sanglier des Ardennes voulait qu’on allât sur-le-champ leur offrir la bataille ; Trivulce fut d’un avis contraire, la Trémoille fut de l’opinion du général italien. On décida qu’on lèverait le camp, et qu’on irait l’asseoir à quelque distance de Novare. Mais les Suisses, qui avaient reçu de nombreux renforts, résolurent d’engager l’action. Le 6 juin, ils s’ébranlaient en colonnes serrées, sous le canon ennemi qui leur emportait des files de cinquante hommes, abordaient les Français, les prenaient corps à corps, et se servaient pour les tuer de hallebardes et de dagues : c’était un duel plutôt qu’une mêlée. Après cinq heures d’une lutte acharnée, les Suisses se jetèrent à genoux pour entonner un vieux cantique montagnard en l’honneur de Marie : ils étaient vainqueurs ; huit mille cadavres français, un poignard dans le ventre, jonchaient le champ de bataille. La papauté a maintenant de grands devoirs à remplir ; voyons comment elle s’en acquittera. Marie Maximilien Sforce, chassé de Milan par ceux qui l’avaient reçu sous des arcs de triomphe, rentrait dans sa capitale, irrité contre ses sujets ; le sang allait couler peut-être : Léon écrit au prince : Rendez grâce à Dieu qui vient de vous donner la victoire, et montrez-vous digne de sa protection, en ne vous laissant pas succomber aux enivrements du succès. Non, ceux qui vous ont offensé ne voulaient pas votre ruine. Je vous en prie, je vous en conjure, au nom de l’amour que je vous porte, vengez-vous de vos ennemis, non pas par le châtiment, mais par la clémence... Encore une fois, je vous en prie, usez avec modération de votre victoire. Et Maximilien se laisse fléchir. Raimond de Cardonne, vice-roi de Naples, avait contribué à la victoire des Suisses ; Léon lui écrit : Je viens d’apprendre la victoire des Suisses et le retour de Maximilien à Milan. Combien je déplore la mort de tant de braves soldats, de tant d’illustres capitaines qui auraient pu rendre de si grands services à la cause chrétienne ! Ce que nous devons désirer, ce n’est pas la guerre, mais la paix ; ce n’est pas du .sang, mais de la pitié.... Vous avez, je le sais, une grande influence sur l’esprit de Maximilien : servez-vous-en pour lui prouver qu’il n’est rien qui sied à un prince comme la douceur, la bonté, la clémence. Qu’il oublie les injures, qu’il pardonne, qu’il s’étudie à gagner non pas la fortune, mais le cœur de ses sujets. Et le vieux général entend la voix du pontife et intercède efficacement pour des sujets révoltés. Le marquis de Montferrat avait livré passage aux Français qui marchaient sur Milan ; il allait être puni sévèrement, quand Léon intervient en sa faveur : Le prince était trop faible, écrit le pape au duc de Milan, pour s’opposer de vive force au passage des Français ; il vous aurait ouvert ses États si vous aviez voulu envahir la France. Pitié donc pour le marquis ! Si vous pratiquez la clémence, Dieu vous récompensera dès cette vie. Et Maximilien écoute encore une fois la voix de Léon X. Henri VIII, à l’instigation du saint-siège, au moment où Louis XII signait avec les Vénitiens le traité de Blois, passait à Calais avec un corps de troupes considérable. Le comte de Shrewsbury assiégeait Térouane ; le duc de Longueville, accouru pour secourir la place, avait livré bataille aux Anglais et avait été défait à Guinegate, dans cette terrible affaire connue sous le nom de la journée des Éperons. Cependant Louis XII sentait la nécessité de se réconcilier avec le saint-siège ; des propositions avaient été faites au pape. Léon X écrit à Henri VIII : On vient de m’apprendre vos victoires ; j’ai fléchi le genou, levé les mains au ciel et remercié Dieu. Ce n’est pas vous qui avez vaincu, c’est le Seigneur qui vous a donné la victoire : humiliez-vous, ce sera vous montrer digne de votre triomphe. Maintenant, qu’une seule pensée vous occupe : il n’est plus qu’un ennemi que vous deviez poursuivre, le Turc dont il faut dompter l’orgueil. Votre légat, l’évêque de Worcester, vous entretiendra plus longuement à ce sujet. Et Henri VIII rappelle ses armées, quitte Lille le 17 octobre, et arrive le 24 à son palais de Richmond. Ce sont là des choses qu’on raconte simplement : les louer, ce serait les gâter. |