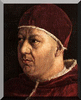HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XIV. — RÉTABLISSEMENT DES MÉDICIS. - MORT DE JULES II. - 1513.
|
Jules II veut punir
Soderini. - Portrait du gonfalonier. - Don Raimond de Cardonne, après le
congrès de Mantoue, est envoyé pour réduire Florence. - Soderini veut se
défendre, mais manque d’adresse. - Cordonne s’empare de Prato. - Soderini est
déposé et exilé. - Restauration des Médicis. - Le cardinal rentre à Florence.
- Comment il s’y conduit. - Julien est nommé chef de la république. -
Conspiration de Boscoli. - Machiavel est mis à la torture. - Mort de Jules
II. - Jugement sur ce pontife. - Lettre qu’il écrit à son frère. Il était un homme que Jules II voulait punir plus sévèrement encore que le duc Alphonse d’Este : c’était Soderini. Le pape, sans contredit, eût préféré trouver sur son chemin ou un serpent ou un lion, et Soderini n’était ni l’un ni l’autre ; non pas toutefois qu’il manquât de courage ou d’adresse, mais il ne savait se servir à propos ni de l’un ni de l’autre. Son courage était comme une lueur phosphorescente, qui ne brillait qu’un moment ; son adresse était petite, mesquine, et toujours transparente. Il se disait politique parce qu’il taquinait son ennemi. Il crut avoir percé Jules II au cœur quand il eut ouvert Pise aux cardinaux rebelles, et s’est montré plus ardent gibelin que Dante en vendant des vivres à l’armée française, après la bataille de Ravenne. Pour se perpétuer au pouvoir, il avait soin de caresser tous les partis ; il refusait de rappeler les Médicis, mais il les laissait correspondre avec leurs partisans intérieurs, et conspirer en plein jour. Cet homme a du reste des vertus réelles ; il est sobre à table, modeste dans ses vêtements, simple dans ses goûts, chaste dans ses mœurs, constant dans ses amitiés ; c’est un bon père de famille, mais qui n’a pas ce qu’on demande au premier magistrat d’une grande cité ; quand il faut punir, il hésite, et l’intérêt de son existence ne le fait pas même sortir d’une apathie plus réelle encore que calculée. Bernard Rucellai, de retour à Florence après un exil volontaire de plusieurs années, réunit chaque jour dans ses beaux jardins près du Prato une foule de jeunes gens qui s’amusent tout haut aux dépens du chef de l’Etat, et leurs épigrammes courent les rues, arrivent jusqu’au gonfalonier, qui les répète à ses amis, et souvent invite à sa table ceux qui les ont composées. Au grand conseil, sa parole est douce, timide et souvent embarrassée ; il faut l’étudier comme on étudie une énigme : non pas que Soderini soit dissimulé de son naturel, mais il aime les phrases où chacun peut trouver ce qu’il pense ; c’est l’orateur aux demi-teintes, le politique aux ambages. Luther l’aurait appelé du nom qu’il donnait à Erasme, le grand Amphibole. Soderini se croit fin parce que jusqu’à ce jour il a réussi à se faire oublier ; heureux, parce qu’il ne fait aucun bruit dans Florence ; habile, parce qu’il a servi tous les partis ; républicain, parce qu’il s’habille comme un homme du peuple ; grand seigneur, parce qu’il aime les arts : il ne s’aperçoit pas qu’au jour du danger personne n’accourra à son secours, justement parce qu’il n’a su dans sa vie amasser ni colères ni sympathies ardentes. Sa sentence est dans l’Écriture : il périra par où il a péché, par la tiédeur. Depuis quelque temps se tenait à Mantoue un congrès qui devait terminer diplomatiquement l’œuvre que les armes des alliés n’avaient pas encore achevée. Maximilien y était représenté par Mathieu Lang, cardinal de Gurck, homme rusé qui avait su conserver les bonnes grâces de l’empereur et du pape ; Jules II, par Bernard de Bibbiena, véritable homme d’Etat ; et la maison déchue de Florence, par Julien, frère du cardinal. Dès la première séance, Julien y fit entendre des plaintes amères contre l’administration de Soderini ; il accusait le gonfalonier de mauvais vouloir envers le saint-siège et de connivence avec Louis XII, deux crimes ou deux fautes qu’il devait expier par son expulsion de Florence. Le cardinal Soderini, ambassadeur de la république, défendait mollement son frère. Paul Jove lui reproche de n’avoir pas employé le seul argument qui pouvait sauver le gonfalonier, l’or répandu à pleines mains. Roscoë dit avec raison qu’il est permis de douter que le moyen indiqué par l’historien eût réussi : le renvoi de Soderini était arrêté dans les conseils du pape et de l’empereur. Florence fut donc mise au ban de la ligue, et don Raimond de Cardonne se mit en route pour conquérir la Toscane et rétablir la maison de Médicis. Il passa l’Apennin le 9 août 1542 ; le cardinal le suivit en qualité de légat du saint-siège. Cependant Florence, pour détourner l’orage, avait envoyé à Cardonne des ambassadeurs chargés de plaider les intérêts de la république. Quand il avait devant lui des Français, don Raimond de Cardonne marchait à l’ennemi en véritable Espagnol, c’est-à-dire lentement, de jour seulement, de peur d’embûches, se creusant le soir un lit dans la terre, pour être à l’abri de la bombe ennemie ; faisant fouiller chaque hallier, chaque buisson, chaque monticule, où quelque lance gasconne aurait pu se cacher. Mais maintenant qu’il s’agit d’un ennemi faible et désarmé, il ne marche pas, il court. Ses vedettes ne sont plus qu’à quelques milles de Florence, et son canon menace déjà Prato. Ces pauvres ambassadeurs de la noble république n’ont trouvé dans le vice-roi qu’un adversaire intraitable qui a parlé haut et brièvement : il faut aux alliés, pour la sûreté de l’Italie, deux choses : d’abord la déposition de Soderini, ensuite le rétablissement des Médicis. Soderini, dans cette extrémité, convoque le grand conseil. La parole du gonfalonier, comme celle d’un moribond, jeta quelques éclairs, surtout quand il montra les exilés rentrant dans Florence, après avoir mangé le pain de l’étranger, et tout pleins des souvenirs de leur chute et des rigueurs du peuple, dont ils voudraient se venger sans doute en confisquant les libertés nationales. L’assemblée s’émut, et les marchands de la rue des Calzajoli jurèrent de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour l’indépendance de la patrie. Rien n’est beau en ce moment comme le peuple florentin : ne rions donc ni de ces lances que le gonfalonier envoie, sous la conduite de Luca Savelli, au secours de Prato ; ni de ces misérables recrues battues par l’armée alliée sur les confins de la Lombardie, et qu’il rassemble à la hâte pour barrer le chemin aux Espagnols. Il croyait à l’expérience comme à l’habileté de Savelli, vieux condottiere blanchi dans les camps, et il espérait que ses miliciens débandés se changeraient en Spartiates : il se trompa, mais non pas aussi grossièrement que le croient certains historiens. La preuve, c’est que le général espagnol s’arrêta tout court, et cessa d’insister sur l’exil du gonfalonier. Ce qu’il demandait était moins encore le rappel des Médicis qu’une somme de trente mille ducats, et des vivres pour ses soldats qui mouraient de faim. Un autre que le gonfalonier aurait envoyé au camp ennemi l’or dont Cardonne avait le plus pressant besoin, puis les vivres dont manquaient ses soldats. Il hésita, et demanda aux pouvoirs de la république des conseils qu’il n’aurait dû prendre que de la nécessité : ce fut une faute irréparable. Rien n’égale la fureur avec laquelle Cardonne attaque sur-le-champ Prato (30 août). Au premier coup de canon tiré sur la place, une pierre se détache de la muraille et tombe ; la brèche est ouverte. Le soldat, excité par la faim et la vengeance, s’y précipite, franchit les fossés, pénètre dans la ville, massacrant hommes, femmes et enfants qu’il trouve sur son passage : c’est une boucherie horrible. Le sanctuaire lui-même allait être violé, livré aux flammes peut-être, avec ce troupeau de jeunes filles et de saintes femmes qui s’y étaient réfugiées afin d’échapper à la fureur des Espagnols, quand une robe rouge vint se placer à la porte de la cathédrale pour en défendre l’entrée aux vainqueurs : c’était celle du cardinal. Il fallait un autre homme que Soderini pour sauver Florence. Au lieu de rassembler le peuple, de le pousser vers Prato, et, les armes à la main, de mourir en soldat, il reste tranquille dans sa maison, attendant que le ciel fasse un miracle pour un magistrat qui s’endort dans sa chaise curule. Il est bientôt réveillé de sa léthargie en entendant frapper violemment à sa porte. Ce sont des jeunes gens de famille, partisans des Médicis, et guidés par Antoine-François Albizzi et Paul Vetiori, qui, l’épée à la main, se jettent sur le gonfalonier et lui crient : La démission ou la mort ! Soderini ne fit aucun geste de menace, ne proféra aucune parole d’indignation, ne fit entendre aucun murmure de douleur, mais baissa la tête en signe d’assentiment, et se soumit en véritable martyr à son triste sort. La victime a pu se taire par faiblesse ou par résignation ; mais l’historien doit flétrir l’attentat d’Albizzi et de Vettori aux lois du pays dans la personne du gonfalonier. Soderini a droit à notre pitié : pendant sa longue administration, il ne fit verser ni une larme ni une goutte de sang. C’est pour cela peut-être que Machiavel le place dans les limbes avec les enfants. Les conjurés ne perdent pas de temps ; ils assemblent les magistrats, font déposer Soderini et traitent avec le vice-roi. Le soir même, quelques groupes de cavaliers prenaient la route de Sienne, emmenant avec eux leur prisonnier, qui s’embarquait, quelques semaines après, dans le port d’Ancône, et faisait voile pour Raguse, moins heureux que Pierre de Médicis, dont il avait pris la place, car il n’avait pas les Muses pour compagnes d’exil. Le 31 août fut un beau jour pour le cardinal. Après dix-huit ans, le proscrit revoyait sa chère Florence, et rentrait dans ce doux nid que son frère nommait la patrie. Il revoyait ce vieux dôme de Santa-Maria del Fiore, sous lequel il s’était si souvent agenouillé pour faire sa prière ; le baptistère de Ghiberti, qu’il prenait dans son enfance tant de plaisir à contempler ; la pierre où son grand poète Dante s’asseyait pour méditer ; la Via Larga, où l’on avait relevé les bustes de Cosme et de Laurent. Voilà les deux petites chapelles claustrales où Savonarole prêchait l’Évangile ; voilà la porte du couvent de Saint-Marc, qu’un frère ferma impitoyablement au proscrit que la populace poursuivait à coups de pierres ; voilà la rue où seul, délaissé comme un malfaiteur, il rencontra Dovizi Bibbiena, désormais son compagnon d’infortune. Que de changements à Florence depuis que le peuple en chassa les Médicis ! Où sont Pic de la Mirandole, Chalcondyle, Politien, et tant d’hôtes illustres du palais de Laurent le Magnifique ? Il ne les reverra plus ; mais il lui reste encore de chauds amis à Florence : d’abord, ces jeunes gens du jardin de Ruccelai, qui travaillaient en plein jour au retour des bannis ; puis les humanistes, qui mêlent leurs acclamations à celles du peuple, et crient : Palle ! Palle ! et toutes ces saintes âmes qui n’avaient pas oublié le cardinal, qui le recommandaient à Dieu dans leurs prières, qui cherchaient à le consoler en lui adressant quelqu’un de ces manuscrits qu’elles avaient sauvés des mains de la populace. Soyez béni entre tous, pieux camaldule, Pierre Delfini, qui vous montrâtes toujours si fidèle au cardinal votre élève ; qui, dans les jours de prospérité, lui parliez un langage sévère ; qui l’encouragiez dans le malheur, le recommandiez à la Providence, et qui reparaissez aujourd’hui pour lui donner des conseils de charité ! Vous ne les aviez pas épargnés à Savonarole, ces paternels avertissements, mais il ne voulut pas vous écouter ; Jean sera plus docile. Le bon frère écrivait donc au légat : Je vous recommande vos concitoyens, je vous recommande Florence et son peuple, je vous recommande surtout ceux qui purent autrefois vous offenser, s’il en existe ; vous qui êtes si doux de cœur, si bon, si généreux, vous les recevrez tous dans vos bras, vous rendrez à tous le bien pour le mal. Votre nature est d’aimer et d’obliger ; tous le savent, tous apprendront bientôt combien le salut de la cité vous est cher. Pierre Delfini ne parle pas ici en courtisan, il connaît le cœur du légat. Jamais aussi restauration ne coûta moins de larmes que celle des Médicis. Florence retrouvait dans le cardinal un ami, un protecteur, un père, un citoyen dévoué. Il est des tentations auxquelles il aurait pu sans doute succomber, et l’historien les aurait facilement excusées : il pouvait exiger la restitution de tous les biens dont sa famille avait été dépouillée au mépris du droit des gens ; il demanda seulement la faculté de les racheter de ses deniers, en payant les améliorations qui pouvaient en avoir accru la valeur. Ceux qui avaient acheté à vil prix les manuscrits que Laurent avait payés si cher purent les garder comme un héritage de famille. Au palais de la Via Larga étaient autrefois des bronzes de Corinthe, des statuettes de maîtres grecs, des tableaux de vieux peintres ombriens, des bijoux émaillés d’orfèvres florentins ; on savait ceux qui les possédaient, on ne leur dit rien. Quelques-uns d’eux voulurent restituer des trésors qui ne leur avaient même pas coûté le prix de la matière : le cardinal consentit à les racheter, et refusa de les reprendre. Le lendemain de son entrée à Florence, il se leva de bonne heure, entendit la messe à Saint-Laurent, et pria longtemps sur le tombeau de son père. On lui montra une vieille bible dont le Magnifique avait fait présent au clergé de cette église ; il la prit, la baisa pieusement et la couvrit de larmes. Le cardinal était heureux ; il répétait avec son frère Pierre : Mes cendres reposeront donc à côté de mon père, dans cette patrie qu’il avait faite si belle et si glorieuse ! Cette douceur de caractère que Delfini loue avec tant d’expansion, fit commettre au cardinal une grave faute : il affecta de se tenir à l’écart, quand on agita la question de la réorganisation des pouvoirs. Comme il ne voulait point entraver l’action populaire, le consilio grande, où dominaient des influences hostiles à la maison de Médicis, il fut maintenu dans ses attributions et conserva le droit d’élire les magistratures principales de la république. On décida, par une loi proposée et acceptée le 7 septembre au grand conseil, que le gonfalonier serait élu annuellement, et qu’on adjoindrait aux quatre-vingts citoyens revêtus de dignités éminentes les gonfaloniers des dix, les ambassadeurs et les commissaires de guerre : les quatre-vingts devaient choisir les dix de guerre et les huit de garde, qu’élisait le grand conseil. J.-B. Ridolfi fut élu gonfalonier : c’était un partisan fanatique de Savonarole, qui probablement n’eût attendu qu’une occasion favorable, l’éloignement des troupes espagnoles de Florence, pour chasser les Lédicis. Dans une cité travaillée par les factions, il fallait bien se garder de ranimer le parti des Frateschi ; le légat comprit trop tard qu’il avait eu tort de se tenir en dehors des délibérations, et que la forme de gouvernement existant en 1494 pouvait seule protéger l’existence politique des Médicis. Ses amis demandaient un coup d’État, en d’autres termes, la violation de la constitution nouvelle, reconnue par Julien lui-même, le frère du cardinal. Pressé par ses conseillers, le cardinal y consentit. Au jour convenu, le palais où le conseil tenait ses séances est envahi par des hommes armés qui chassent les magistrats, improvisent un conseil où l’on fait entrer les partisans de l’ancienne maison, déposent Ridolfi et proclament Julien comme chef de la république. Le peuple ne fit pas même attention à ce coup d’Etat, et continua, quand il vit passer le cardinal, de crier Palle, et de demander à s’enrôler dans l’un des trois ordres créés par les Médicis pour l’amuser : l’ordre du Diamant, imaginé par Laurent le Magnifique ; l’ordre de la Tige du lis, inventé par Laurent, fils de Pierre de Médicis, et l’ordre du joug, créé par le cardinal. Si tous les citoyens de Florence avaient ressemblé au secrétaire d’État Nicolas Machiavel, les Médicis seraient rentrés plus difficilement dans Florence. Il n’avait que vingt-neuf ans quand il fut d’abord élu chancelier de la seigneurie, puis nommé secrétaire de l’office des dix magistrats de liberté et de paix, charge importante qu’il occupait depuis longtemps. A la première nouvelle de l’approche du cardinal, il avait parcouru le territoire de la république pour organiser une conspiration contre ces Médicis qu’il regardait comme les oppresseurs de son pays ; mais partout il avait trouvé des âmes indifférentes qui n’avaient pas voulu répondre à son appel. Il revint donc à Florence, prêt à saisir une occasion favorable pour les chasser de nouveau. Elle se présenta bientôt. Parmi les jeunes gens qui s’étaient cachés le jour où les Médicis avaient recouvré le pouvoir, il n’en était aucun dont l’âme fût froissée comme celle de Pierre-Paul Boscoli. Les historiens contemporains nous le représentent alimentant dans la lecture des anciens son enthousiasme pour la liberté : le poignard de Brutus l’empêchait de dormir ; il résolut de s’en servir pour frapper les tyrans de Florence. Il lui fallait un Cassius ; il le trouva dans Augustin Capponi. Ces deux hommes et d’autres encore se furent bientôt entendus : on résolut de se défaire à tout prix des Médicis. II paraît que machiavel entra dans la conjuration. Malheureusement pour les républicains, Capponi laissa tomber par mégarde, dans la maison de Pucci, la liste des conjurés ; les magistrats avertis firent arrêter Boscoli, Capponi et Machiavel, qu’on mit à la torture. Le crime était patent : Boscoli et Capponi payèrent de leur sang le sang qu’ils voulaient verser ; Machiavel, protégé par l’éclat des services qu’il avait rendus à la république, dut attendre en prison la clémence de ses nouveaux maîtres. En 1500, il était ambassadeur à la cour de Louis XII ; en 1502, auprès de César Borgia ; puis tour à tour en France, à Sienne, à Piombino, à Pérouse ; enfin auprès de Maximilien, empereur d’Allemagne. De semblables têtes ne tombent pas ; on les achète, cela fait moins de bruit, et Machiavel était disposé à faire bon marché de la sienne. Quelque temps après la conspiration de Boscoli, Jules II mourut ; c’était un événement que cette mort, qui arriva le 21 février 1513. François Ier disait de ce pape, en s’adressant à Léon X : Nous n’avons pas eu d’ennemi plus acharné, nous n’avons pas connu de guerrier plus terrible sur le champ de bataille, de capitaine plus prudent. En vérité, sa place était à la tête d’une armée plutôt que de l’Église. C’est un jugement que nous n’acceptons pas : Jules II fut encore plus grand pape que grand homme de guerre. Si, pour être pape, il faut savoir protéger les droits de l’autorité menacée par quelques cardinaux schismatiques, défendre dans un concile les enseignements apostoliques, n’appeler dans ses conseils que des hommes de science et de piété, donner au monde l’exemple d’une chasteté de mœurs irréprochable, veiller sans cesse à l’administration de la justice, garder la foi jurée, pardonner à ses ennemis, se confier en Dieu dans l’infortune, faire l’aumône, aimer les pauvres, épargner le trésor public, n’en distraire pas un denier pour les siens, puis mourir en bon chrétien, Jules II était digne de la tiare. Nous avons de la peine à nous séparer de ce pontife-roi. Écoutons-le encore un moment ; voici ce qu’il écrivait de son lit de mort à son frère : Mon cher frère, c’est au cardinal Sixte Gaza de la Rovere qu’il s’adresse, vous ne comprenez pas pourquoi je me fatigue ainsi au déclin de la vie. A l’Italie, notre mère commune, je voudrais un seul maître : ce maître, ce serait le pape. Mais je me tourmente inutilement ; quelque chose nie dit que l’âge m’empêchera d’accomplir ce projet. Non ! il ne me sera pas donné de faire pour la gloire de l’Italie tout ce que mon cœur m’inspire. Oh 1 si j’avais vingt ans de moins ! si je pouvais vivre au delà du terme ordinaire, seulement assez pour réaliser mes desseins. Mais j’ai bien peur que toutes mes fatigues ne soient dépensées en vain ! N’est-ce pas un beau rêve que l’idée de cette monarchie italienne sous le sceptre d’un pape tel que de la Rovere ? Que n’eût pas été Rome sous un prince qui se levait à quatre heures du matin, ne dormait qu’une ou deux heures, à table ne mangeait qu’un œuf et un peu de pain, et qui, après avoir dompté les Baglioni, les Bentivogli, les Vénitiens, les Français, assiégé la Mirandole, réduit Bologne, enlevé aux ennemis du saint-siège trente places fortes, doté sa capitale de rues nouvelles, de places magnifiques, d’aqueducs grandioses, mourut en laissant plusieurs millions ? C’est alors que Jules aurait pu mettre en pratique cette maxime qu’il aimait à répéter : Les belles-lettres sont de l’argent pour le peuple, de l’or pour les nobles, du diamant pour les princes. |