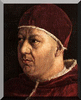HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XII. — DÉLIVRANCE DU LÉGAT DE JULES II. - 1512.
|
Les princes amis des
Français se rallient à la politique de Jules II. - Les Suisses accourent au
secours du pape. - La sainte ligue est partout victorieuse. - Résultats de
l’expédition de Louis XII en Italie. - Le cardinal, prisonnier des Français,
est délivré à Cairo. - Bologne est obligé de capituler. - Alphonse d’Este
vient implorer son pardon à Rome. - L’Arioste à la cour de Jules II. Jules II avait raison de ne pas désespérer de l’avenir. Pendant qu’effrayés de la défaite de Ravenne, les cardinaux romains conseillaient au pape de s’embarquer à Ostie, Jules de Médicis, admis dans le consistoire, y lisait les dépêches du légat ; le cardinal y racontait tout ce qu’il avait vu, la déroute des alliés ; mais aussi les pertes énormes en hommes, en chevaux, en canons, qu’avaient essuyées les vainqueurs, qui n’avaient plus de chef depuis la mort de Gaston de Poix. A Ravenne, l’Italie avait appris à connaître l’infanterie espagnole, que l’artillerie française avait écharpée, mais non pas anéantie, et qui avait opéré sa retraite sous le feu des boulets, avec autant d’ordre que de courage. A Bologne, à Brescia, les populations, domptées et décimées par la famine et le feu, commençaient à se lasser de l’étranger. Le supplice de Louis Avogrado et de ses deux fils avait jeté la consternation dans Venise, qui s’apprêtait à venger son capitaine. La plupart des officiers allemands à la solde de Louis XII, gorgés de butin, aspiraient au repos, et n’attendaient que le moment propice pour quitter l’armée française et regagner leur patrie. Les pères du concile de Milan n’avaient aucun ascendant sur les soldats ; ce n’était plus au bruit des rires, mais à coups de pierres qu’on les poursuivait dans les rues de Milan. Jules de Médicis confirma tous les renseignements donnés par le légat. Alors le courage revint aux membres du sacré collège, et Jules II put, sans être inquiété par des clameurs pusillanimes, poursuivre la délivrance du continent italien. Les princes et les peuples se ralliaient à sa politique. Le roi d’Espagne, inquiet pour l’Aragon, comprenait enfin qu’il fallait s’opposer aux envahissements de l’étranger, et promettait au pape les meilleurs officiers de son armée. Maximilien d’Autriche, qui convoitait -Milan et peut-être le duché de Bourgogne, cette belle province qu’il regardait comme un fief de l’Empire, négociait secrètement avec les Vénitiens, et témoignait le désir d’entrer dans la sainte ligue. Le cardinal de Sion, ce Guelfe ardent, qu’avait si bien compris Jules II, faisait retentir dans les montagnes de la Suisse le cornet des trois libérateurs. Les paysans des Waldstetten traversaient les Alpes dans l’espoir d’un riche butin que leur promettait le cardinal. Pour eux, délivrer l’Italie, c’était la pressurer, la piller, la dévorer ; malheureux pays où vainqueurs et vaincus, ennemis et alliés, se jetaient comme autant d’oiseaux de proie, attirés par la richesse de son sol, ses belles moissons, ses grasses prairies, ses draps fins et ses sequins ! On peut suivre, comme dans l’expédition de Cecina décrite par Tacite, la marche de ces bandes mercenaires, au sang et aux ruines dont elles marquent leur passage. Le peuple italien, accoutumé à changer de maître souvent plusieurs fois dans la journée, avait fini : par ne plus croire qu’à la force brutale, et saluait de ses murailles tout clairon qui sonnait la victoire, sauf à le poursuivre à coups de pierres quand il sonnait la retraite. Les événements vont vite : chaque jour Jules II se rend à Saint-Pierre pour remercier la Providence d’un nouveau bonheur. Bergame vient de se révolter ; Gênes a fait sa révolution, chassé le gouverneur français, proclamé Frégose pour doge, et s’est engagée à payer 12.000 ducats au cardinal Schinner ; Parme et Plaisance ont ouvert leurs portes aux troupes de l’Église ; les Grisons, alliés du saint-siège, se sont emparés de Chiavenne et de la Valteline ; Maximilien Sforce, fils du duc Louis, a été reconnu comme duc de Milan. Il fallait voir avec quels transports les Italiens recevaient les Suisses arrivant de Coire au secours de la sainte ligue : soldats fabuleux, moitié hommes, moitié animaux, ayant la tête couverte d’un casque de cuivre, la poitrine d’une peau d’ours ou de buffle, et brandissant dans les mains une pique haute de dix -huit pieds, sous laquelle, en cas de défaite, ils s’abritaient comme le hérisson sous ses aiguillons. Malheur aux Français qu’on trouve isolés ; leur sang paye bien vite celui qu’ils versèrent à Ravenne, à Brescia, à Bologne. Les suisses rassemblés à Coire s’étaient avancés, par le pays de Trente et par le Véronais, jusqu’à Villafranca, où les pontificaux les attendaient avec quatre cents hommes d’armes, huit cents chevau-légers, six mille fantassins et quinze à vingt pièces de canon. La lutte recommença ; mais cette fois les forces n’étaient plus égales. C’est à peine si La Palice pouvait opposer aux trente mille hommes des alliés sept cents lances, quatre cents lansquenets et deux mille fantassins. C’est été de la folie que d’essayer de tenir la campagne avec des forces semblables. Il se retira donc sous les murs de Pontevico. La place était forte, et la position bien choisie : de là il pouvait se porter au secours de Milan, de Bergame, de Brescia, qu’occupaient des garnisons françaises. Maximilien, qui voulait pouvoir se vanter auprès de ses nouveaux alliés d’avoir contribué à l’expulsion des Français, les trahit en donnant l’ordre à ses Tyroliens de déserter, avec armes et bagages, les rangs de La Palice, et de regagner les montagnes d’Inspruck. Il fut obéi. La Palice eut un moment l’intention de tenter la fortune à Pavie ; mais, entouré de toutes parts, menacé de voir sa retraite coupée, il quitta la ville et vint s’enfermer dans Asti : l’Italie était délivrée. Milan n’a pas plutôt appris la fuite de La Palice, qu’il se révolte et fait sa révolution, une révolution comme on en faisait à cette époque, à l’aide du couteau. Un matin la populace se porte chez les négociants français, les massacre, jette leurs corps par les fenêtres ; pille leurs caisses, leurs caves, leurs magasins, et, repue de vin, de viande et de sang, parcourt les rues en criant : Mort aux Français ! qui n’étaient plus que des cadavres. Les paysans, devenus soldats, attendent les convois des fugitifs sur le chemin du Simplon, et, cachés derrière quelque rocher ou quelque bouquet de pins, tuent et dépouillent les traînards. Voilà comment se termina l’expédition de Louis XII en Italie : ce ne fut ni le couteau du Milanais, ni le tocsin des églises, ni le fusil du paysan, ni le canon de Pierre de Navarre, ni la lance de 18 pieds des montagnards suisses, qui chassèrent les Français de la Romagne et de la Lombardie, mais le cri poussé par le pape : Seigneur, délivre-nous des barbares. Sans Jules II, notre étoile n’eût pas pâli de longtemps en Italie, et Louis XII eût peut-être été maître de Rome. Parmi tous ces princes, nos alliés ou nos adversaires, il n’en est pas un qui agisse franchement. Donnez le Milanais à Maximilien. qui dans son livre rouge tient note chaque jour de tous les chagrins qu’il reçoit des Français, et il ne vous retirera pas ses Tyroliens ; assurez au roi d’Aragon la dîme du clergé de ses Etats, et il équipera pour vous douze belles galères ; au duc de Ferrare livrez la Mirandole et Concordia, et il vous fera présent de ses meilleurs canons ; promettez à Soderini qu’il mourra gonfalonier dans son palais de Lungo-l’Arno, et Pietra-Santa vous appartiendra en toute propriété ; ajoutez aux possessions du roi d’Espagne quelques places en Italie, et son grand capitaine, Gonsalve de Cordoue, est à vous pour toujours. Pas un de ces souverains, nationaux ou étrangers, ne songe sérieusement aux intérêts du saint-siège, à l’intégrité de la Romagne, à la délivrance de l’Italie, à la gloire du catholicisme, au salut des arts et des lettres. Jules il domine toutes ces têtes couronnées, comme la coupole de Saint-Pierre la flèche des autres églises. Il a un but, lui, un plan, une idée : c’est l’affranchissement de son pays qu’on envahit et qu’il veut sauver. Ne nous parlez pas de son ambition ; n’est-elle pas sanctifiée par le but qu’il a devant lui, et où il arrivera malgré la fièvre qui le retient au lit, comme après la proclamation du conciliabule de Pise ; malgré les mouvements insurrectionnels du peuple romain, comme le jour où Pompée Colonne, évêque de Rieti, et Antoine Savelli, parlent de monter au Capitole pour proclamer la république ; malgré le serment que Louis XII a fait graver à Milan sur une monnaie d’or, où le destin de Rome est écrit en trois mots : Perdam Babylonis nomen ; malgré les pleurs de ses cardinaux, qui lui montrent, après la journée de Ravenne, les galères préparées à Ostie pour emmener le pontife vaincu. Est-ce que le pape seul aurait le privilège de ne pouvoir se défendre ? Qu’on nous dise que Jules aimait trop le casque et la cuirasse ; qu’il maniait trop bien l’épée ; qu’il restait trop longtemps à cheval : cela est possible ; cela est écrit non seulement dans l’histoire, mais sur la pierre, sur l’airain, sur la toile. hais avouons que l’œuvre la plus belle qu’un monarque tentera jamais dans l’intérêt d’un peuple, le salut de sa nationalité, n’aurait pas été accomplie par une de ces natures froides et tièdes, sans défauts comme sans vertus. Pour comprendre les grands résultats de la politique de Jules II, placez-vous à la porte de Milan, sur la route du Simplon, en ce moment où l’armée française opère sa retraite. De cette glorieuse armée que Louis XII a formée avec tant de peine, il ne reste plus qu’un petit nombre de soldats mutilés dans les cent batailles que leur livra leur implacable adversaire, et n’emportant de tout cet or qu’ils ont trouvé dans le sac des villes que deux ou trois florins que les paysans armés s’apprêtent à leur voler. Leurs canons les embarrassaient pour traverser les montagnes, ils les ont encloués, jetés dans la rivière, abandonnés à l’ennemi ; presque tous leurs chefs sont morts glorieusement sur le champ de bataille, ou sont couverts de blessures que le temps sera long à guérir. De toutes leurs conquêtes les Français n’ont sauvé que quatre à cinq cardinaux, prélats sans importance qui ont voulu se commettre avec un homme de la taille de la Rovere, et qui, confondus à la queue de l’armée avec les goujats et les vivandiers, parlent sérieusement de refaire en France leur synode de Pise, où ils n’avaient pour spectateurs que des enfants. Notre beau trophée, c’est un cardinal resté fidèle à son Dieu comme à son prince, le cardinal Jean de Médicis. Qu’un soldat tombe mourant sur le chemin, c’est la bénédiction et le pardon du légat qu’il implore. Le cardinal, emmenant avec lui l’abbé Bengallo, son aumônier, était parti de Milan sous l’escorte de cinquante archers. Arrivé à Cairo, où l’on traverse le Pô sur un bac, le cardinal se sentit fatigué, et demanda au chef de l’escouade à passer la nuit dans le village, ce qui lui fut accordé. Pendant que les soldats étaient occupés à chercher une auberge pour le légat, la foule s’assemblait autour des prisonniers. Le bon abbé Bengallo se mit alors à narrer longuement les infortunes de son maître ; comment il avait été fait prisonnier à Ravenne, les tourments qu’il avait essuyés depuis sa captivité, ceux qu’on lui préparait en France, où probablement il finirait bientôt ses tristes jours. Et tout cela, disait l’aumônier, quand les Français sont chassés de l’Italie ; que l’Europe tout entière s’arme contre eux ; qu’il ne faudrait qu’un homme de cœur pour délivrer un des plus fermes soutiens de l’Église, que le pape aime si tendrement, et qui n’a pour escorte qu’une poignée de soldats. En voilà un qui rendrait service à l’Italie, à son prince, à Sa Sainteté, au inonde entier ! Et puis, comme il serait généreusement récompensé, et par la cour de Rome, et par la famille des Médicis, et par tant d’autres seigneurs ! comme il serait riche tout d’un coup ! A ce beau discours de l’abbé Bengallo assistait un certain Zazzo, qui avait fait la guerre, et qui sembla touché du triste sort du légat, autant qu’ému de la pathétique narration de l’aumônier. Sur-le-champ il fait signe au prisonnier, et va trouver Octavien Isimbardi, le seigneur de l’endroit. Octavien s’attendrit au récit du vieux soldat, et promet de l’aider à délivrer le cardinal. Il a bientôt trouvé dans le village des hommes déterminés, et le projet d’enlèvement est aussitôt arrêté. Le cardinal, au lever du soleil, demande quelques heures encore pour se reposer de ses fatigues. Les soldats de garde montent dans le bac en attendant le légat, qui gagne au pas le rivage, quand des hommes déguisés, l’épée à la main, se jettent sur le bateau, le détachent et le poussent dans le courant. Le cardinal passa la journée à Cairo, caché en lieu sûr, et le lendemain traversa le fleuve, et, conduit par Isimbardi, alla frapper à la porte d’un château dont le propriétaire, Bernard Malaspina, lui ouvrit les portes. C’était un parent d’Isimbardi, mais attaché de cœur à la cause française. Toutes les prières d’Isimbardi furent inutiles ; les domestiques conduisirent le cardinal dans un donjon, qu’il ne devait quitter que pour retomber dans les mains de son ennemi. Trivulce avait été averti par Malaspina de la capture du légat. Voici ce qu’on raconte : Trivulce, d’origine italienne, homme de cœur, ne voulut pas tremper dans cette violation des droits de l’hospitalité. Il fit répondre au messager secret de Malaspina qu’il n’avait pas besoin du légat ; qu’une robe rouge de plus ou de moins dans les mains des Français ne rétablirait pas leurs affaires ; qu’il rendait la liberté au prisonnier. Malaspina déconcerté fit ouvrir au légat les portes du donjon, et publia le lendemain que ses serviteurs infidèles ou négligents avaient laissé échapper le captif. Ægidius de Viterbe voit dans cette délivrance un véritable miracle. Un si bon guelfe, ajoute Pâris de Grassi, méritait bien l’assistance du ciel. Cette fois le cardinal n’a plus de péril à courir ; partout sur son chemin il trouve des chevaux qui l’emportent comme le vent, des visages amis et des hôtes bienveillants. Sa belle conduite sur le champ de bataille de Ravenne, son humanité envers les soldats, son courage et sa présence d’esprit dans le danger, son dévouement à Jules II, lui avaient gagné tous les cœurs. Son entrée à Plaisance fut une véritable ovation. A Mantoue, François Gonzague, qui en était le souverain, le reçut avec des marques de respect et d’admiration, -et le conduisit à la villa d’Andes, la patrie de Virgile, où la pureté de l’air, le repos et les soins dont il fut entouré eurent bientôt rétabli sa santé, altérée par tant de travaux et d’infortunes. Ce fut une bienheureuse nouvelle pour le saint-père que la délivrance de son légat ; il aimait maintenant le cardinal comme un père pourrait aimer son fils. Il l’avait tiré de la foule et lui avait donné la croix d’or ; il en était fier. Il n’est pas rare de voir des natures âpres, mais riches, succomber comme à leur insu aux séductions d’âmes aimantes. C’est ainsi qu’au rapport de Condivi, Michel-Ange s’amusait avec des enfants, après avoir dessiné quelque figure fantastique de géant. Tous les bonheurs venaient à la fois au pape : aujourd’hui c’était une ville importante, demain une place forte, une autre fois une province tout entière, qui se soumettaient au saint-siège. Parme et Plaisance, ces deux bras de l’exarchat de Ravenne, comme les nommait Jules II, reconnurent son autorité aux acclamations des habitants, qui choisirent, pour leur servir d’interprète auprès du pontife, Jacques Bajardo, un des citoyens les plus distingués de Parme. Les poètes mêlaient leurs hymnes aux accents de joie des populations, et chantaient dans Jules II le libérateur de l’Italie. L’altière Bologne, après la retraite des Bentivogli, fut obligée de capituler le 10 juin. Jules avait lieu d’être irrité contre les habitants de cette cité ; il parlait de la raser, de la ruiner, de l’abattre à coups de canon. Mais la colère passa rapidement : une heure de sommeil avait le pouvoir de calmer le vieillard. Dieu eut pitié de la ville coupable : il lui envoya un ange gardien, le cardinal de Médicis, qui prit en main les intérêts de la cité dont il avait été nommé gouverneur, plaida noblement la cause des vaincus, et les réconcilia bientôt avec le pape. Par ses soins, les portes de Bologne s’ouvrirent aux exilés que leur attachement au saint-siège avait forcés de s’expatrier. Avec des hommes tels que le légat, les haines s’apaisent bien vite. Il est certain que le peuple révolté n’aurait plus mis en pièces la statue de Jules II. Après les villes et les citadelles, les hommes vinrent faire leur soumission au saint-siège. Le duc Alphonse d’Este songea un des premiers à se réconcilier avec Jules II. Pendant tout le temps de la domination française en Italie, il s’était montré l’un des plus obstinés ennemis du pontife. Ce n’était pas seulement un courtisan accompli, un bon soldat, mais un capitaine savant dans la manœuvre du canon. Nous avons vu de quelle utilité l’artillerie de ce prince avait été à la sanglante journée de Ravenne. La bataille allait finir, quand Fabrice Colonne tomba dans les mains d’Alphonse. Louis XII réclama plus d’une fois ce prisonnier, qu’il voulait faire conduire en France : nais le duc résista ; les Français ayant été expulsés, il donna la liberté au captif, mais probablement avec l’intention secrète de se servir de Colonne pour faire la paix avec Jules II. Fabrice consentit à jouer le rôle de négociateur, et il fut plus heureux à la cour du Vatican que sur le champ de bataille : mais Jules II exigeait que la réparation fût aussi éclatante que l’avait été l’offense. Au mois de juin 1512, le duc, muni d’un sauf-conduit, quitta ses États et partit pour Rome. Admis devant le pontife, la couronne ducale sur la tête, il s’agenouilla, et, avec les marques du repentir le plus profond, prononça ces paroles de soumission : Père très saint et très clément, je reconnais et je confesse avoir péché plus d’une fois contre la divine majesté, contre la personne sacrée de votre béatitude, vicaire du Christ sur cette terre, et contre le saint-siège, dont mes frères, mes ancêtres, et nous surtout, avions reçu tant de bienfaits. Les sanglots lui coupèrent un moment la parole ; il continua : Je viens donc, agenouillé devant la face de Votre Majesté, embrasser vos genoux, et implorer humblement mon pardon. Il inclina la tête en silence. Alors le pontife s’approchant du suppliant : Duc, vous dites vrai ; vous avez péché, et grièvement et souvent, contre le saint-siège apostolique. Et voyez ce que j’ai fait pour vous ! Vous alliez être la proie des Vénitiens, je vous délivrai de leurs mains, et vous nie trahîtes ! J’avais chassé de Bologne les Bentivogli qui se disposaient à faire leur paix avec moi, quand vous les encourageâtes dans leur félonie, en les prenant sous votre protection. J’aurais pu confisquer vos États, je n’en fis rien. En ce moment le roi de France menaçait d’envahir Ferrare, je vous nommai gonfalonier de la sainte Église, et, pour vous aider à résister au monarque, je vous envoyai des troupes et des subsides. Louis XII voulait avoir à vil prix le sel de vos salines, je vous engageai à résister à ses prétentions ; je vous envoyai de nouvelles troupes, des subsides nouveaux ! Et à tant de bienfaits vous répondîtes plus tard en vous liguant avec mes ennemis ; alors je vous dépouillai de votre duché. Vous vous vengeâtes par le meurtre, la rapine, les ruines, la profanation des églises et le schisme ; car vous avez pactisé avec les schismatiques. Mais Dieu ne pouvait souffrir des énormités semblables ; il chassa miraculeusement les Français de l’Italie. Privé de l’appui de Louis XII, et voyant les Suisses accourir de leurs montagnes au secours du saint-siège, vous vous repentîtes ; mais ce repentir ne vient pas du cœur, c’est la nécessité qui l’a produit. Vous voilà implorant votre pardon : à l’exemple du Christ notre maître, je ne puis ni ne dois vous le refuser : soyez donc absous. Le duc se releva. Le pape voulait réunir Ferrare aux États de l’Église : il fit offrir au prince en échange la ville d’Asti. L’offre fut repoussée, et le duc apprit bientôt que ses États avaient été envahis par les troupes pontificales. A l’aide de Marc-Antoine Colonne, il put s’échapper de Rome. Il se cacha d’abord dans la forteresse de Marino, puis parcourut l’Italie, déguisé en moine, en soldat, en chasseur, en valet, pour échapper aux émissaires du pape. Quand il crut le moment propice, c’est-à-dire la colère du pontife apaisée, il rentra dans sa capitale aux acclamations des habitants. -tais cette terrible image de Jules, qu’il avait vue devant lui pendant si longtemps, ne lui laissait plus de repos ; les beaux vers de son poète n’avaient pas même le pouvoir de chasser les funèbres visions qui le tourmentaient le jour et la nuit. Pour les dissiper, il résolut d’envoyer à Rome une ambassade solennelle ; mais il ne trouva pas d’ambassadeur, la peur glaçait toutes les âmes. A la fin, un jeune homme s’enhardit et promit d’intercéder auprès de Sa Sainteté : c’était l’Arioste. Le poète partit, demanda et obtint une audience. L’Arioste, en sa qualité de poète, crut devoir parler au pontife le langage de ces fiers paladins qu’il s’apprêtait à mettre en scène ; mais Jules II l’interrompit en le menaçant de le faire jeter dans la mer, s’il ne se montrait plus respectueux. Le poète fit comme son maître, eut peur et s’enfuit en s’écriant : Jamais il ne m’arrivera d’aller à Rome pour calmer la grande ire de Jules II. Cette colère était trop vive pour durer longtemps. Le poète et le soldat, un moment inquiétés dans leur retraite, se défendirent avec courage, laissèrent le pape tranquille, et finirent par rentrer dans les bonnes grâces du saint-siège, sous Adrien d’Utrecht, ce pape allemand qui eut trois passions dans sa vie : la paix, l’étude et les pauvres. En ce moment, un autre poète s’y prenait autrement que l’Arioste pour donner quelques heureux conseils à Jules II. Augurello disait au pape Ne méprisez pas le pauvre petit présent que vous apporte le poète. Celui que vous représentez sur cette terre, le créateur de toutes choses, laissait venir à lui les enfants. Il est fâcheux que l’Arioste n’ait pas adressé une supplique à Jules II ; le pape aimait les beaux vers. |