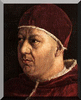HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XI. — JULES II. - 1503-1512.
|
Élection de Jules II.
- Son portrait. - Il s’empare de César Borgia et le force à restituer les
forteresses du Saint-Siège. - Le cardinal gagne l’amitié du neveu de Jules
II. - Sa conduite à Rome. - Dangers que court la royauté temporelle du pape.
- Quelques cardinaux se détachent de l’autorité, et convoquent un
conciliabule à Pise. - Soderini favorise les prélats rebelles. - Jules II
nomme le cardinal de Médicis son légat à Bologne. - Le cardinal part pour
réduire cette ville qui vient de se révolter. - Il est obligé d’en lever le
siège. - Gaston de Foix attaque et prend Brescia. - L’armée du pape se retire
et vient se poster près du Rancone. - Bataille de Ravenne. - Mort de Gaston
de Foix. - Le cardinal tombe dans les mains des Français. Alexandre VI venait de mourir. La mort de ce pape dut réveiller un moment les factions que sa main de fer avait su comprimer. Le peuple ne comprit la perte qu’il avait faite que lorsqu’il se vit de nouveau menacé par cette foule de barons qui profitaient de l’interrègne pour ravager les campagnes de Rome. Alors il fallut bien reconnaître que Borgia était, par-dessus tout, l’homme du peuple. Un pape de race italienne n’aurait jamais osé ce que l’Espagnol tenta si hardiment, en arrachant le domaine de l’Église à des feudataires plus puissants que le pontife même. Tout en nous inclinant devant les hautes vertus de Pie III, nous ne pouvons nous dissimuler que dans ces temps difficiles il fallait, pour régir le double monde que la Providence livrait au pape, une autre tête que celle du neveu d’Ænéas Sylvius, et surtout un autre bras.
Voilà pourtant celui qui ne sait pas dire un mot en face d’une robe rouge sans se reprendre, que nous allons voir d’abord aux prises avec César Borgia, l’homme de Machiavel. Les Vénitiens s’étaient jetés dans la Romagne, avaient surpris Faenza, et menaçaient les autres places de la province. Il fallait les chasser des Étais de l’Église. Délivrez-nous, Seigneur, des barbares ! s’était écrié Jules II, quand on vint lui dire qu’il était pape ; et par barbares il entendait d’abord l’étranger, puis tous ceux qui retenaient quelque parcelle du patrimoine de Saint-Pierre. Jules envoie des ambassadeurs à Venise, qui plaident vainement devant le sénat la cause du saint-siège : on ne les écoute pas. II se rappelle alors qu’il tient entre ses mains un capitaine auquel la plupart des villes de la Romagne sont restées fidèles, parce qu’il les a délivrées des bandits qui les pillaient, et qu’il maintient par le sang et les supplices la sûreté des rues et l’administration de la justice. Jules fait arrêter Borgia. César, étonné de ce grand coup de foudre, en demande le motif : on lui répond qu’il sera libre dès qu’il aura restitué ou fait rendre au pape, comme il l’a du reste promis, toutes les places fortes de la Romagne ; en d’autres termes, quand il aura chassé jusqu’au dernier Vénitien des terres de l’Église. On peut juger de la colère du Valentinois, qui se vantait d’avoir fait donner la tiare à Jules II, et qui, pour prix de son dévouement aux Rovere, avait reçu le titre de gonfalonier de la sainte Église. La liberté, pour César, c’était plus que la vie : les forteresses seront restituées. Voici un blanc seing qu’il donne pour gage de son obéissance ; mais ses lieutenants refusent de le reconnaître ; l’un d’eux même, don Diégo Ramiro, qui tient Césène, fait pendre aux créneaux de la citadelle Oviedo, porteur des ordres du prince. A ce sang méchamment versé le pape répond en confinant le duc dans un château qui, depuis, en souvenir du prisonnier, a porté le nom de tour de Borgia. Pour la première fois de sa vie, César avait trouvé son maître. : il fallait qu’il restituât, ou qu’il languît peut-être toute sa vie entre quatre murailles ; son choix ne pouvait être douteux. Cette fois il comprend que la ruse a fait son temps ; des ordres sérieux sont donnés aux commandants des forteresses occupées par ses partisans. Presque tous obéissent, et dans quelques mois le pape recouvre, sans effusion de sang, des châteaux forts où César comptait se maintenir, et le duc, dirigé sur Ostie sous la conduite de Carvajal, cardinal de Sainte-Croix, s’embarque bientôt à Nettuno pour Naples. Il allait quitter cette ville, quand, au mépris d’un sauf-conduit que lui avait délivré Gonsalve de Cordoue, il est arrêté par Nugno Campijo, qui le déclare prisonnier du roi son maître. Et Sannazar, sans pitié pour une si grande infortune, lui le poète du malheur cependant, se met à chanter : Omnia vincebas, sperabas omnta, Cæsar ; Omnia deficiunt, incipis esse nihil. Le coup qui frappait si soudainement Borgia dut être sensible au cardinal de Médicis ; car l’Espagnol avait plus d’une fois montré quelque intérêt à la famille déchue. D’un autre côté, des mots échappés au pape, son affection connue pour Soderini, le gonfalonier de Florence, son amitié pour Machiavel, l’un et l’autre ennemis déclarés des Médicis, ne laissaient au cardinal que peu d’espoir dans une restauration contre laquelle tout jusqu’alors semblait avoir conspiré, le ciel lui-même avec ses tempêtes. Un autre, à la vue de cette alliance des éléments et des hommes contre sa famille, aurait désespéré de la cause des exilés et serait rentré dans le repos. Mais il avait appris que l’homme, ainsi que-les éléments, peut être vaincu par une inébranlable volonté, et il l’avait, cette volonté. Il se rappelait Pic de la Mirandole luttant seul avec son innocence contre les théologiens qui l’accusaient à nome d’hérésie, et finissant par triompher de tous ses ennemis qu’on disait si puissants : il imita le savant. Ce qu’il devait éviter en ce moment, c’était d’agir, de travailler ouvertement en faveur des bannis, heurtant ainsi la politique ou les préventions d’un maître qu’il avait intérêt à ménager. Il continua donc ; ce genre de vie tout littéraire qu’il avait mené dans les derniers temps du pontificat d’Alexandre VI, tenant salon ouvert aux artistes de Rome et de l’étranger ; fouillant le Campo-Vaccino ou les vignes voisines pour y chercher quelque belle statue décrite par Pline ; relevant, à la façon de Pomponio Leto, des inscriptions lapidaires, ou collationnant, en compagnie de Bibbiena et de G. Cortese, le texte d’un manuscrit d’Horace ou d’Homère. Parfois il allait surprendre Sadolet dans son habitation du Quirinal, pour lui demander l’explication d’une phrase obscure de Cicéron. Le soir, au coucher du soleil, il dessinait une ruine antique, ou bien encore il se délassait à faire de la musique, attendant avec confiance que la Providence lui envoyât quelque bon ange pour rétablir sa maison. L’ange vint sous les traits d’un jeune homme dont Rome admirait les grâces, les mœurs, la bonté et le savoir. Son vieil oncle, le pape Jules II, qui l’aimait vivement, l’avait fait d’abord cardinal, puis vice-chancelier du saint-siège : il s’appelait Galeotto de la Rovere, et était fils d’une sœur du saint-père. Poètes et prosateurs, tous ceux qui parlent de Galeotto vantent les admirables qualités du cœur et de l’esprit dont le ciel avait doué ce jeune homme. Il avait les mêmes goûts que le cardinal : il aimait la poésie, la peinture, la sculpture, la musique, et surtout les livres. Son bonheur était de feuilleter les beaux manuscrits qui faisaient autrefois partie de la bibliothèque de Laurent de Médicis, et que le peuple avait dispersés, mais que Soderini, quand on en découvrait, laissait restituer au cardinal : car il faut rendre justice au gonfalonier ; s’il faisait la guerre aux Médicis, il épargnait leurs livres. Quelquefois, dans une de ces causeries du soir entre le cardinal et les humanistes romains, Galeotto prenait la parole pour prédire l’avenir. Il croyait que l’exil avait usé son vieil oncle, qu’il aimait beaucoup du reste ; il le voyait succomber sous le poids de l’âge, des infirmités et des affaires ; Rome avait perdu son pontife, le collège des cardinaux s’assemblait, et Jean de Médicis était nommé pape par acclamation. Il n’est pas besoin de dire qu’il donnait sa voix à son ami, et que tous les prélats présents la lui donnaient aussi. La prophétie de Galeotto s’accomplit ; un seul des électeurs ne vota pas au scrutin : c’était justement notre prophète, que le ciel ravit trop tôt à l’amour des Romains. Jean ne cacha pas son chagrin ; il versa d’abondantes larmes sur ce trépas subit, et longtemps il ne put entendre parler sans pleurer de son noble ami. Les pleurs recommençoient, nous dit Paul Jove, sitost que l’occasion ramenoit quelque propos d’une personne qui luy avoit esté si chère, et qui avait à son égard rempli tous les devoirs d’une parfaite amitié et d’une charité chrestienne. Ces devoirs d’une charité chrétienne, c’étaient les doux propos que Galeotto échangeait avec son oncle touchant le cardinal, si bien que le pape se mit à aimer de toute son âme Jean de Médicis, qui ne parlait, de son côté, qu’avec admiration du pape ; car il avait compris tout ce qu’il y avait dans ce pontife de grandeur d’âme, de profondeur d’esprit, d’intelligence d’artiste et de souverain. Il ne perdait pas de vue, du reste, les intérêts de sa famille. Il n’avait qu’une pensée, le rétablissement des Médicis. Le temps le servait admirablement, comme il sert toujours quiconque a la patience d’attendre. Lucrèce, sa sœur, travaillait efficacement à Florence à cette couvre toute filiale. C’était une femme de mœurs exemplaires, d’un beau courage, qui parlait aussi bien qu’elle se conduisait. On lui doit plus d’une conversion. La plus éclatante fut, sans doute, celle de Jacques Salviati, son mari, un des citoyens les plus puissants de la république, patriote enthousiaste, admirateur fanatique de Savonarole, et qui avait fini, grâce à Lucrèce, par ne plus comprendre comment on avait chassé de Florence les descendants de Cosme, et pris pour maître Soderini. Le gonfalonier de Florence était un honnête homme, mais qui manquait d’adresse, comme le remarque Machiavel. Il aurait pu, sinon vaincre, du moins affaiblir ses ennemis en feignant de servir les Médicis. Il croyait, ajoute le même historien, imposer avec le temps silence à ses ennemis par son affabilité, ou leur échapper par sa bonne étoile. Comme il était jeune encore, il cherchait à triompher de la jalousie de ses rivaux sans brusquerie, sans violence et sans trouble : il ignorait que la fortune est changeante, et l’envie implacable. Il voulait être populaire, et s’aliénait par conséquent la noblesse, qui le poursuivait, dans le conseil, de ses soupçons et de ses moqueries : mais il avait reçu du ciel un caractère impassible ; s’il n’avait pas le courage de punir l’injure, il avait la force de la supporter. Mais au moindre choc ces natures tombent pour ne plus se relever ; c’était au cardinal à choisir le moment pour renverser le gonfalonier. Ln attendant, sa conduite était habile : personne n’eût pu se douter qu’il était intéressé dans les affaires de Florence. Ses amis étaient presque tous des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des artistes, gens qui d’ordinaire n’excitent pas de soupçons. La politique était bannie de ses salons ; on y discutait, comme à la cour du duc d’Urbin, la prééminence de la peinture sur la sculpture, la nature du beau, les règles du coloris et du dessin. Mario Maffei et Thomas Inghirami, tous deux de Volterre, étaient les orateurs qui le plus souvent en venaient aux prises. Le cardinal aimait à leur jeter comme défi la solution de quelque problème philologique, parce que, les raisons manquant aux deux rivaux, ils y suppléaient par des moqueries et des facéties, des saillies et des concetti qui excitaient les applaudissements ou le rire des auditeurs. Souvent le même orateur soutenait deux thèses opposées. On remarquait l’art avec lequel le maître de la maison savait écouter, sa facilité à résumer les débats, son choix heureux de paroles, les grâces de son esprit la solidité de son jugement. Quelquefois il mettait en présence deux professeurs de droit, et alors la lutte était vive et docte ; le cardinal montrait qu’il n’avait point oublié les leçons de ses maîtres de Pise. Il parlait à son tour, et on l’écoutait dans le ravissement ; car autant sa phrase, quand il traitait de poésie, était harmonieuse, autant elle était grave quand il dissertait sur le droit civil ou canonique. Mais, fidèle à ses instincts, il savait, quand l’entretien s’épuisait, revenir adroitement à ce qu’il nommait ses amours. Un jour qu’on avait trouvé dans les ruines transtibérines une statue de Lucrèce, quelqu’un demanda des vers sur cette heureuse découverte. Le cardinal était poète, il fit parler la pierre. S’il accueillait avec prévenance ses partisans, il n’avait pour ses adversaires avoués aucune parole amère ; tout au plus se permettait-il à leur égard quelqu’une de ces plaisanteries qu’il savait si bien dire, véritables coups d’épingle qui égratignaient sans déchirer. Quand il venait à parler de Laurent, il était éloquent d’inspiration filiale. Alors il rappelait, dans un magnifique tableau, tous ces beaux génies antiques que son père avait fait connaître au monde italien ; cette meute de flaireurs de manuscrits qu’il entretenait à si grands frais en Orient ; le petit berceau de chèvrefeuille sous lequel Politien avait écrit ses Sylves ; la rampe verdoyante de Fiesole, que chaque soir Laurent gravissait avec Ficin ; la petite table paternelle, où tout artiste pouvait s’asseoir deux fois la semaine ; le beau jardin de Saint-Marc, rempli de statues antiques, et où Michel-Ange venait s’essayer à la sculpture ; et la riche bibliothèque de la Via Larga, où plus d’une fois Savonarole avait puisé quelque image magnifique contre les Médicis. Quand, par hasard, la conversation s’établissait sur Pierre, le malheureux proscrit, des larmes roulaient dans les yeux du cardinal, et, d’une voix interrompue par les sanglots, il disait tout ce qu’il est d’affreux sur la terre de l’exil pour une âme patriote ; alors il récitait des vers de Dante, et les auditeurs émus se pressaient autour de lui, et montraient par des signes muets combien ils s’associaient à sa douleur fraternelle. Une ou deux fois la semaine il invitait à sa table les principaux lettrés de Rome. Pendant le repas, un de ses secrétaires, ordinairement Bibbiena, lisait une épître d’Horace, une satire de Juvénal, ou bien quelques scènes d’une comédie de Plaute. Le repas achevé, les convives se rassemblaient dans le salon du cardinal, et alors commençaient les disputes philologiques. On n’avait pas alors, comme de nos jours, de doctes commentaires sur les textes anciens : le vieux monde romain était à peine connu ; pour l’expliquer, presque pas de pierres ou de marbres, enfouis qu’ils sont profondément dans le sein de la terre ; les rois de la glose n’étaient pas nés. Il fallait donc s’en rapporter à l’intelligence lexicologique de l’humaniste, qui souvent avait le don de la divination, comme ou peut le voir dans les Miscellanea de Politien. Sous le rapport du tact et du goût, de la notion du mot et de la pensée, personne ne pouvait le disputer à l’élève de Marsile Ficin. Il tenait à Rome une maison splendide, prêtait à tous ceux de ses partisans qui se trouvaient dans le besoin, et jamais ne leur demandait le payement même d’une vieille dette : cette prodigalité de grand seigneur était chez lui une maladie héréditaire. Heureusement il avait des amis nombreux qui croyaient à son étoile, et qui venaient à son secours quand sa bourse s’épuisait ; il empruntait du reste comme il prêtait, de la meilleure grâce du monde. Plus d’une fois il fut obligé de vendre sa vaisselle, mais jamais on ne le vit toucher à ses livres, à ses tableaux ou à ses statues, dont l’aspect le consolait dans l’adversité. Sa grande âme, dit Paul Jove, loin de succomber sous le chagrin de quelques incommodités passagères, savait si bien cacher ses peines secrètes, qu’on eût dit, à voir son visage égal et tranquille, qu’il avait au ciel d’infaillibles ressources. Il disait à l’un de ses amis qui lui faisait peur de l’avenir : Un grand homme citant l’ouvrage du ciel ne peut jamais manquer de rien, quand il ne manque pas de courage. Il avait une vive foi en Dieu, et regardait comme une lâcheté de douter de la Providence ; et vraiment il aurait eu tort de ne pas y croire, car cette Providence veillait sur lui comme sur son enfant chéri. Il se montrait digne d’elle par une pureté de mœurs que tous les historiens, même protestants, ont reconnue. Cette époque est le règne de la satire ; quand un auteur est prêt à publier ses pensées, il regarde tristement son livre, auquel il dit, comme Benivieni : Va, mon enfant, à la garde de Dieu, attends-toi aux morsures des serpents. L’homme mordait alors comme le serpent : il épargna Jean de Médicis. En ce moment la royauté temporelle du pape et la nationalité de l’Italie couraient de véritables dangers : Rome fut heureuse d’avoir Jules II pour pontife. Louis XII avait passé les Alpes pour venger la défaite de Charles VIII : c’était toujours la même idée folle qui troublait l’intelligence du monarque français ; il lui fallait en Italie une position militaire, grande ou petite, à Naples ou à 3ü1an. Avec l’Italie il avait la Méditerranée, avec la Méditerranée l’Orient, avec l’Orient la Terre-Sainte. Tout réussissait à Louis XII ; il avait chassé de Milan Louis Sforce, qui venait d’entrer prisonnier à Lyon, dompté les Vénitiens, et menaçait la Romagne. L’Italie allait être une province française, si Jules II fût resté dans le repos ; il en sortit. A peine est- il délivré de César Borgia, qu’à la tête de vingt-quatre cardinaux et de quatre cents gens d’armes, il marche sur Pérouse pour en chasser le tyran qui l’opprime. Délaissé par tous ceux qui l’entouraient au moment du danger, Baglioni n’a pas d’autre ressource que de venir implorer la clémence de son souverain, qui lui pardonne. Dès ce moment, Pérouse rentre sous la domination de l’Eglise, et recouvre son collège de républicains et ses vieilles franchises municipales. Bentivoglio régnait à Bologne comme Baglioni à Pérouse, par la terreur et le sang ; il veut se soumettre, mais il fait ses conditions. Jules lui répond de Césène, le 10 octobre 1506, par une bulle qui le déclare rebelle lui et les siens, livre leurs biens au pillage, leurs personnes à l’esclavage, et le lendemain il entre l’épée au poing dans Bologne, dont il rétablit les anciennes libertés. Un moment Jules occupe toute la scène, on n’aperçoit que lui : on le voit étouffer ses ressentiments contre Venise, qui refusait aux sujets du pape la liberté de commerce et de navigation sur l’Adriatique ; lever l’interdit jeté sur la république, en recevoir les ambassadeurs à la porte de Saint-Pierre ; obtenir de Ferdinand d’Espagne Fabrice Colonne, un des plus braves capitaines de l’époque, avec quatre cents lances ; lever des Suisses sur les bords du lac de Côme ; équiper une flotte que douze galères vénitiennes vont rejoindre, sous la conduite de Gritto Contarini, et donner pour auxiliaire à l’armée de mer Marc-Antoine Colonne, qui vient de lever dans le pays de Lucques une cavalerie et une infanterie redoutables. Il voulait chasser l’étranger. La lutte n’était pas égale : Maximilien, en infanterie, avait dix-huit mille lansquenets allemands, six mille fantassins espagnols, six mille partisans, deux mille fantassins à la solde du due de Ferrare, plus de six mille hommes de cavalerie, cent six pièces de canon de siège, et six bombardes si grandes qu’on ne pouvait les placer sur des affûts. L’armée du roi de France était encore plus formidable. D’abord le succès ne répondit pas aux espérances du pape ; ses troupes furent battues. Alors quelques cardinaux se détachent du saint-siège, et convoquent à Pise un concile, où ils ont l’insolence de citer le pape pour rétablir, disaient-ils, l’ordre et la discipline ecclésiastiques. C’était un attentat contre l’autorité du chef spirituel de la chrétienté, que la révolte de Carvajal, de Saint-Séverin, des cardinaux de Saint-Malo, de Bajosa et de Cosenza ; ajoutons, une lâcheté envers un prince malheureux. Ils croyaient le lion mort ; mais le lion, que la fièvre tenait couché dans son lit, se réveilla bientôt : il n’était qu’endormi. Il se lève tout souffrant, le corps brisé, mais l’âme sans atteintes-, va faire sa prière à l’autel des Saints-Apôtres, et se rend à l’armée qui bloquait en ce moment la Mirandole. On était au mois de décembre (1511) ; la neige tombait en abondance, mêlée d’une grêle de balles que les assiégés dirigeaient de leur camp. Jules, à cheval, après avoir arrêté les dispositions du siège, commande lui-même le feu. La brèche est ouverte, et le pape, à travers la mitraille, l’épée en avant, entre dans la ville, qui obtient son pardon. Grand et beau caractère, comme le remarque Ranke, qui s’apaise aussi vite qu’il s’irrite. Les cardinaux avaient décrété un conciliabule ; Jules convoque un concile à Latran, et les rebelles sont sifflés par le monde catholique quand on apprend qu’ils n’ont donné que quatre mois aux prélats étrangers pour se rendre à Pise. Il paraît qu’ils ne connaissaient pas mieux leur géographie que leur devoir de chrétien. Soderini fit une faute en cédant Pise aux cardinaux révoltés pour y tenir leur conciliabule : c’était de sa part un acte d’hostilité contre le saint-siège, et une manifestation imprudente en faveur des Français. Avec le caractère de Jules, on pouvait s’attendre à quelque grand éclat. Le pape fut noble et prudent : il fit avertir le gonfalonier de se tenir sur ses gardes, de ne plus travailler au succès des armes françaises, d’éloigner d’une ville encore toute en désordre des cardinaux félons. Mais Soderini, ébloui par les victoires de Louis XII, peut-être par l’éloquence de Carvajal, ou cédant aux sollicitations de son frère, le cardinal Soderini, refusa d’écouter les sages avis du pontife. On ne comprend pas que des hommes qui avaient appris à connaître, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, le caractère de Jules, aient pu se flatter un instant de triompher du pape, rêver un autre concile de Bâle pour y déposer comme indigne un souverain élu par acclamation, et former le dessein de placer la tiare sur le front d’un ambitieux comme Carvajal. Mais Dieu, qui veillait sur son Eglise, n’aurait pas permis une semblable iniquité. Jules II avait fait son devoir de père en avertissant Soderini ; comme prince, il en avait un autre à remplir. Pour déjouer les trames de son ennemi, il nomma le cardinal de Médicis légat à Bologne ; ce choix était significatif. Revêtu d’une charge aussi importante, le cardinal pouvait travailler à la chute du gonfalonier et an rétablissement des Médicis ; c’était un nouvel adversaire pour Soderini, qui en comptait déjà de nombreux jusque dans les conseils. Soderini crut avoir écarté le danger qui le menaçait personnellement en transportant le concile à Florence, afin de faire peur au pape, et de s’attacher plus étroitement Louis XII ; mais la noblesse s’opposa fortement au séjour des cardinaux à Florence, et Soderini fut obligé de céder. Le peuple, dans la crainte d’un interdit, fit cause commune avec l’aristocratie. L’autorité du gonfalonier reçut ainsi une double atteinte dont il était difficile qu’elle se relevât. Chassés par les Pisans, consignés à la porte des églises, honnis sur le grand chemin, repoussés de Florence, ces pères, qui croyaient représenter le monde chrétien, n’eurent que le temps de se sauver à Milan, où, le courage leur étant revenu, ils s’amusèrent, cachés derrière l’ombre royale de Louis XII, à fulminer des foudres contre cette grande majesté qui siégeait au Vatican, et qui laissa pour le moment le soin de sa vengeance aux poètes italiens. Les pères furent mis en chanson. Au commencement de décembre 1511, le cardinal résolut de réduire à la raison Bologne, où le peuple venait de renverser la statue du pape, chef-d’œuvre de Michel-Ange ; il l’avait traînée dans les rues, couverte de boue, mise en pièces, et il en avait envoyé les débris au due de Ferrare, qui bientôt en fit faire un canon qu’il baptisa du nom de Jules II. Riais la véritable image du pontife restait intacte, cette tête que la populace n’avait osé frapper, soit par admiration pour le sculpteur florentin, soit par peur de cet œil de pape que l’artiste avait su rendre si menaçant. Le cardinal avait ordre, non pas de punir l’insolence de mutins prêts à inaugurer une autre statue quand les Français auraient quitté Bologne, mais de reprendre une place importante qu’on regardait comme la clef de la Romagne. Le légat conduisait sous Raimond de Cardonne huit cents cavaliers et huit mille fantassins, commandés par Marc-Antoine Colonne, Jean de Vitelli, Malatesta de’ Baglioni et Raphaël de’ Pazzi. A Rome, le cardinal, quelques jours avant son départ, reçut de l’Arioste une lettre qui lui fut remise par le prieur de Sainte-Agathe. Le poète, en habile courtisan, félicitait d’abord le légat sur la dignité dont il venait d’être revêtu, et finissait en le suppliant de lui accorder la dispense des tria incompatibilia, c’est-à-dire qu’il voulait conserver des bénéfices ecclésiastiques sans entrer pour le moment dans les ordres. On reconnaît dans cette épître, à quelques exagérations poétiques, le chantre futur du Furioso. L’Arioste demande non seulement une dispense en règle, mais une dispense qui ne passe pas par les bureaux de la chancellerie romaine, qui ne lui coûte rien en un mot, et il s’excuse de ce qu’il appelle ses extravagances, en rappelant au légat l’amour qu’il porta toujours au cardinal, dont D’a reçu bien d’autres promesses. Or notre poète était justement l’hôte du duc de Ferrare, qui avait fait un si insolent usage du bronze de Michel-Ange ; le commensal de la duchesse, qui n’aimait guère le pape ; l’heureux possesseur, grâce aux libéralités de son souverain, d’un petit jardin où plus d’une fois il avait écrit des vers mordants contre Jules II. Mieux qu’un autre, le légat savait dans quels péchés contre le saint-siège le poète était tombé, et pourtant l’Arioste obtint ce qu’il demandait. Bologne sommée refusa de se rendre. Elle était défendue par des hommes de cœur, tels que Lautrec, Ives d’Allègre, Visconti, surnommé le grand diable, et Spinaccio. Le peuple montrait contre le pape une incroyable animosité, et comptait, pour se soustraire aux justes ressentiments de Sa Sainteté, sur l’épaisseur des murailles de la ville, sur la valeur des Français, et sur l’arrivée prochaine de Gaston de Foix, due de Nemours, qui était à vingt-quatre ans le premier capitaine de l’époque. Le cardinal, inquiet des mouvements de Gaston, demandait qu’on pressât le siège, qu’on risquât un coup de main hardi contre la place ; il répondait de lui comme de ses soldats. On voit qu’il avait reçu des leçons de Jules II. Malheureusement il avait affaire à des officiers espagnols qui voulaient employer contre la place, d’abord la famine, puis la flamme ; on essaya donc de la flamme quand on vit que la faim était impuissante. Marc-Antoine Colonne pointa contre un des bastions une coulevrine énorme dont les projectiles couvrirent les fossés de cadavres, pendant que Pierre de Navarre conduisait une mine, dans la rue de Castiglione, sous la chapelle de la Vierge dite del Baracane, dont la chute devait ouvrir une large brèche aux assiégeants. Une explosion terrible eut lieu, dont les feux illuminèrent tout à coup l’intérieur de la place ; la chapelle ébranlée s’agita sur sa base, parut se rompre en deux, et finit par se rasseoir sur le sol, comme dans un tremblement de terre. A ce spectacle, les Espagnols, au moment de monter à l’assaut, s’arrêtent immobiles d’admiration et d’effroi, croyant que la Vierge combat contre eux, pendant que les assiégés remercient Marie de sa protection miraculeuse et jurent de mourir pour la gloire de son nom. Cependant Gaston s’avançait à marches forcées au secours de la place. Bientôt du haut des bastions on aperçut dans la plaine, à travers des tourbillons de neige, un cavalier monté sur un cheval blanc, et portant un heaume à la bourguignonne, tel que Vasari l’a peint dans un de ses tableaux, tout bardé de fer, la mine haute et fière, le casque surmonté d’un panache rouge, que le vent et le pas de la monture agitaient de mouvements divers. C’était le beau Gaston, qui bientôt fit son entrée dans la place au son des tambours et des clairons, au bruit des canons, des acclamations des assiégés et des vivat de la populace. Il amenait avec lui treize cents lances, six mille lansquenets et huit mille soldats à la solde de la France. L’armée alliée avait perdu tout espoir de forcer Bologne ; elle en leva le siège, et fit sa retraite en bon ordre et sans être inquiétée par la garnison. Gaston, après avoir laissé quelques milliers d’hommes dans Bologne, s’était dirigé vers Brescia, faisant faire jusqu’à cinquante milles par jour à sa cavalerie, sans débrider. En chemin il rencontre deux corps ennemis, l’un sons le commandement de Jean-Paul Baglioni, près d’Isola della Scala ; l’autre sous celui du comte Guido Rangone, qu’il attaque, culbute et disperse. Arrivé devant Brescia, il somme la ville de se rendre ; le gouverneur, le provéditeur André Gritti, jure de s’ensevelir sous les ruines de la place. Le 19 février 1512, au matin, la garnison de la citadelle, que les Vénitiens, en s’emparant de Brescia, n’avaient pu forcer, se jette, sur un signal, dans la ville que Gaston attaque de tous côtés ; on se bat dans les rues, sur les places publiques, dans les églises et les monastères, sur le toit des édifices. Les chevaliers français combattent pieds nus, afin de ne pas glisser sur un terrain trempé d’eau. Gaston est partout ; on le reconnaît moins encore à son panache rouge qu’aux rudes coups qu’il porte. Avogrado, l’un des commandants vénitiens, n’a que le temps de s’échapper par la porte de Saint-Nazaire ; mais, atteint dans sa fuite, il est pris et pendu avec ses deux fils comme traître et rebelle. André Gritti est obligé de remettre cette vieille épée qu’il teignit si souvent du sang français ; les mures officiers meurent en combattant ; le vainqueur marche sur des cadavres. Huit mille morts sont les trophées de cette horrible journée. Bayard, qui le premier était monté à l’assaut, refusa la rançon que lui offrirent les deux jeunes filles de la maison où il alla prendre son logement, et Gaston fit pendre en sa présence quelques soldats qui avaient osé forcer un monastère de jeunes filles. Pendant que Gaston enlevait ainsi d’assaut Brescia, le cardinal, campé à Budrio, se disposait à passer le Pô pour secourir la place : malheureusement ses lieutenants mettaient plus de temps à prendre une délibération que Nemours à s’emparer d’une citadelle. Il n’y avait que le vieux Jules II capable de lutter d’activité avec un jeune homme de 24 ans. À peine a-t-il connu, par les dépêches de son légat, la marche merveilleuse de Gaston, qu’il distribue des commissions à Troïle Sabelli, à Gentile Baglioni, pour recruter de la cavalerie ; à Capochio, gentilhomme romain, pour former de nouveaux cadres d’infanterie : l’Espagne et Venise, réveillées par ses remontrances, équipent dix mille fantassins suisses ; Mathieu Schinner, qu’il a décoré de la pourpre romaine, traverse le pays des Grisons pour presser la levée de six mille montagnards ; et Maximilien, alarmé des succès du capitaine français, rompt, moyennant une somme de 50.000 florins, avec Louis XII, et se ligue avec les Vénitiens, pendant qu’excité par le légat, Henri VIII consent à envahir la Normandie et la Bretagne. Gaston n’était pas seulement un capitaine d’une prodigieuse activité, un soldat d’une bravoure fabuleuse ; c’était un homme doué d’une haute pénétration ; il avait deviné son ennemi. Sans crainte de dégarnir Brescia, il va présenter la bataille aux Espagnols. F. Colonne et de Navarre occupaient sur une hauteur une position formidable où leur artillerie, bien servie, devait avoir raison de la furie française ; ils attendaient. Mais, à la vue des bannières ennemies, un mouvement électrique remue toutes ces masses immobiles comme un mur ; les soldats rompent leurs rangs, courent vers la tente du cardinal, se jettent à genoux, inclinent la tête, et demandent la bénédiction que le légat leur donne avec la croix d’argent que le pape avait bénie. On put voir du camp français ce spectacle pieux. Gaston voulait se battre ; mais Ives d’Allègre, en homme prudent, contient l’impétuosité de son jeune ami : du doigt il lui montre ces chasses de soldats agenouillés, ces vieilles barbes espagnoles blanchies dans le combat, et ce terrain déclive si propre à l’artillerie. Gaston l’écoute, et, après quelques insignifiantes escarmouches de cavalerie, lève son camp et va se poster sur la gauche d’Imola, dans l’intention de surprendre Ravenne, ou de livrer bataille aux confédérés, qui ne manqueront pas d’accourir au secours de la place. Mais le cardinal, pour prévenir les desseins de Gaston, se hâte d’envoyer à Ravenne Marc-Antoine Colonne, avec quelques escadrons de cavalerie. Gaston, à peine arrivé devant la place, dresse les échelles et ordonne l’assaut. Les assiégés firent vaillamment leur devoir ; artillerie, mousqueterie, pierres, grenades, poutres, ils faisaient usage de toutes sortes d’armes : de part et d’autre le sang payait le sang. Pendant quatre heures on se battit sur les remparts. Cette journée, qui coûta la vie à 1.500 hommes, fut glorieuse pour Marc-Antoine Colonne, qui, du haut des murailles où il resta constamment comme un simple soldat, vit les assaillants rentrer dans leurs lignes. Gaston avait réussi toutefois à ébranler ces lourdes nasses d’Espagnols qui venaient, mais lentement, au secours de Ravenne. Après avoir laissé un corps considérable devant la place, afin de n’être point attaqué sur ses derrières, il prit la résolution d’aller offrir le combat aux confédérés. Les Espagnols avaient fait halte au pont de Ronco, nommé Viti sous les Romains. Là, Pierre de Navarre avait fait creuser sur le bord de la rivière un fossé profond derrière lequel il avait posté son infanterie, que protégeait une véritable montagne de chariots, de fascines et de claies ; le long de la digue, sur un terrain en pente, vingt pièces de canon et deux cents hacquebuttes, placées sur des chariots armés de spontons, et servies par d’habiles artilleurs, devaient répondre au feu de l’ennemi. Les Italiens avaient pour chef Fabrice Colonne ; la cavalerie légère était conduite par le marquis de Pescaire ; l’armée alliée tout entière était sous les ordres du cardinal, chef de la ligue sainte. Médicis n’avait ni épée ni cotte de mailles ; son costume était celui de sa dignité, une robe rouge, une croix sur la poitrine, une espèce de bonnet carré sur la tête. Monté sur un cheval turc, il allait d’une arme à l’autre, des rangs espagnols aux lignes italiennes, saluant de la main les officiers, encourageant les soldats, exhortant les uns et les autres à faire leur devoir, au nom de Jules II, leur maître spirituel ; au nom de cette Italie, leur mère, ou leur patrie d’adoption. Si vous jetez les regards dans les rangs de l’armée française, vous trouverez à l’arrière-garde, commandée par La Palice, un autre cardinal, Frédéric Saint-Séverin, marchant à la tête des troupes, armé de pied en cap, le casque en tête, l’épée au côté, le baudrier sur l’épaule. On le reconnaît à sa haute stature, à sa barbe épaisse, et aux insignes de légat qu’il porte devant lui ; car il représente, dans le camp français, les cinq pères du concile de Pise : homme d’énergie qui a la tête de Jules Il sans en posséder le cœur, qui tirerait l’épée au besoin, peut-être entrerait par une brèche à la Mirandole, mais ne pardonnerait pas aux habitants vaincus. Cependant l’armée française arrivait par détachements sur la rive gauche du Ronco, où elle formait tranquillement ses lignes. Si l’on eût suivi l’avis de Fabrice Colonne, les alliés auraient traversé la rivière et fait un mauvais parti aux divisions ennemies, isolées les unes des autres à d’assez longs intervalles ; mais Pierre de Navarre refusa de bouger : les Espagnols restèrent donc dans leurs retranchements, et épaulés par les digues du Ronco. Au dire des maîtres de l’art, cette immobilité systématique fut une faute. La bataille s’engagea d’abord à coups de canon : l’artillerie joua, de l’une et de l’autre rive, pendant près de deux heures, mais avec un avantage marqué pour les alliés, dont les boulets faisaient de larges trouées dans les rangs de la gendarmerie française. C’était un combat en règle que voulait Gaston, mais l’ennemi s’obstinait dans ses positions : il résolut d’aller l’y trouver. Il fait donc jeter sur le Ronco un pont de bateaux que ses Allemands passent au pas de course sous le feu de la mitraille, pendant que les Gascons et les Picards traversent la rivière vers un gué favorable. C’était le moment pour Navarre de se porter avec son infanterie à la rencontre de ces corps détachés, qu’il eût infailliblement écrasés ; les prières de Fabrice Colonne furent encore inutiles. Alors ce capitaine tire son épée en s’écriant : A moi, mes amis ! ne périssons pas par la faute d’un mécréant (moro) ; et il marelle droit à l’artillerie d’Ives d’Allègre. Mais son mouvement est aperçu par Alphonse d’Este, duc de Ferrare, qui s’ébranle à son tour ; et bientôt Fabrice, entouré de toutes parts, se voit compromis et perdu. Il essaye de se défendre, quand une voix lui crie : Romain, ne te fais pas tuer ; rends-toi, la journée est finie. — Qui es-tu ? demande Fabrice. — Je suis Alphonse d’Este, répond la voix, ne crains rien. — Je me rends, dit Fabrice, mais sous condition que tu ne me livreras pas aux Français. Le marquis de la Padule, embarrassé dans les buissons dont le terrain est semé, ne peut mener que des escadrons rompus, et éprouve la fortune de Fabrice ; Pescaire va se heurter contre une aile des Français, et, reçu l’arme au poing, est obligé de se replier, abandonnant au vainqueur son artillerie, ses étendards et ses équipages, pendant que Cardonne, étourdi par le feu de l’artillerie, se débarrasse des insignes de son commandement, et opère sa retraite, suivi par Carvajal et Antoine de Leva. Biais la bataille n’était pas finie ; restait cette terrible infanterie espagnole qui n’avait pas encore donné, et dont les soldats, couchés à plat ventre pour éviter le boulet ennemi, se relèvent tout à coup au signal de leur chef, et marchent au pas de charge contre les Allemands, que bat en flanc l’artillerie placée le long des fossés, et dont pas une pièce n’a été prise. Il y eut un moment d’hésitation dans les rangs des lansquenets. Emser, leur capitaine, et M. de 11lolart, pour montrer le cas qu’il faut faire des tireurs italiens, dressent une table du premier morceau de planche qu’ils trouvent sous la main, demandent du vin à un goujat, et boivent au succès des Français, quand un boulet emporte la table, les verres et les deux buveurs. Le choc des Espagnols fut terrible, comme serait celui d’un rocher qui se détacherait d’une haute montagne. Les lansquenets portaient des piques de 16 à 18 pieds de long, un énorme corselet de fer, mais point de boucliers ; les Espagnols avaient une courte épée, un poignard, un bouclier, une armure complète qui leur garantissait la tête, les jambes et le corps. On eût dit qu’ils avaient lu la veille le récit d’une affaire des Suisses avec les Bourguignons de Charles le Téméraire. Ils glissaient, s’allongeaient, rampaient sur le terrain à la manière du serpent, et s’entortillaient autour de la jambe des lansquenets. Les Allemands essayaient, mais en vain, de se servir de leur lance, qui ne frappait que dans le vide. Aussi l’affaire eût-elle été promptement terminée, si d’Allègre d’abord, puis Gaston, ne fussent venus avec leurs gendarmes pour délivrer les Allemands. Pris ainsi par devant, en flanc et par derrière, les Espagnols ne purent résister ; ils tirent retraite, mais au pas et dans un ordre parfait, serrés autour de leurs enseignes, qu’ils ne perdaient pas un moment de rue, et faisant expier dans le sang la témérité des chefs ennemis qui cherchaient à les entamer. Gaston, pour venger la mort d’Ives d’Allègre, percé d’un coup de pique, s’était jeté tête baissée avec quelques cavaliers dans un gros d’Espagnols, quand un soldat le blesse en le désarçonnant. Lautrec crie au soldat : Ne le tue pas, c’est le frère de votre reine ; mais l’Espagnol impitoyable lui traverse la gorge de son épée, tandis que Lautrec tombe frappé de vingt coups de dague, et que, par un mouvement subit, la gendarmerie française s’arrête d’admiration ou de fatigue, laissant ces vieilles bandes espagnoles, mutilées et saignantes, opérer en repos leur retraite. Les Français étaient vainqueurs, mais jamais triomphe n’avait été si chèrement acheté. Ils laissèrent sur le champ de bataille dix mille cinq cents hommes et la fleur de leur noblesse. Gaston de Nemours seul valait une armée. Chacun bientôt fut adverty de la mort de ce vertueux et noble prince, le gentil duc de Nemours, dont un deuil commença au camp des François, si merveilleux, que je ne cuide point, s’il fût arrivé 2.000 hommes de pied frais et 200 gens d’armes, qu’ils n’eussent tout défait. L’Arioste attribue le succès de cette journée au duc Alphonse : Ce grand capitaine, dit-il, eut la gloire de vaincre dans les champs de la Romagne Jules II et les Espagnols. Voilà bien le poète qui a deux plumes d’or à son service l’une pour demander au légat du saint-siège une bulle gratuite de dispense, l’autre pour chanter l’ennemi de son bienfaiteur. S’il s’était fait raconter les détails de cette affaire, une scène l’aurait heureusement inspiré. A côté d’Alphonse, qui se bat vaillamment sans doute, et qui n’attache la lance à son cheval que lorsqu’il n’a plus d’ennemis à vaincre, était une figure sacerdotale à peindre, celle du cardinal au moment où, s’arrachant du champ de bataille couvert de mourants qui implorent sa suprême bénédiction de la main et du regard, il les réconcilie avec Dieu, les absout et leur ouvre les portes du ciel. La scène est belle assurément, et l’Arioste l’aurait dignement célébrée. Pendant qu’il accomplit ainsi, au risque de la vie, ses devoirs de prêtre, le cardinal ne prend pas garde aux rires moqueurs d’un cavalier épirote qui le raille sous son chapeau rouge et sa croix d’or, et tombe sous un coup de javelot que lui porte un Bolonais ; d’autres cavaliers épirotes accourent, la dague au poing ; pour tuer le légat, quand Frédéric Gonzague de Bozzolo survient pour le dégager : le cardinal était prisonnier. Frédéric l’envoya sur-le-champ au cardinal de Saint-Séverin. Il faut le dire à la louange de ce père du conciliabule de Pise, il eut pitié du légat, qu’il traita courtoisement, en galant chevalier. De son propre mouvement il fit donner à Jules de Médicis un sauf-conduit pour venir au camp des Français adoucir les regrets de son cousin : qu’il soit loué de sa généreuse commisération ! Deus jours après, Jules prenait le chemin de Rome, porteur de dépêches dans lesquelles le cardinal rendait compte au pape de la bataille. Il attrait fallu voir Rome au moment où arrivait la nouvelle de cette terrible journée de Ravenne ; on eût dit qu’Attila, comme autrefois, frappait à la porte du Peuple ; les cardinaux, les mains jointes, suppliaient Sa Sainteté de faire la paix avec les vainqueurs, d’équiper des galères, de fuir loin de Rome. Jules ressemblait alors au Moïse de Michel-Ange ; on aurait pu mettre la main sur sa poitrine, on n’eut pas surpris une pulsation de plus dans le cœur du noble vieillard. Son œuvre n’était pas accomplie ; s’il avait eu peur, il n’aurait pas sauvé la nationalité italienne. Jamais prisonnier n’avait été l’objet de prévenances semblables à celles dont on entourait le légat : c’est qu’il représentait cette papauté vénérée de ceux même qui faisaient ta guerre à son chef visible. On renversait la statue de Jules II ; trais, quand le pape passait, on s’inclinait pour lui demander sa bénédiction. A Bologne, les Bentivogli, à force de doux soins, parvinrent à faire oublier au cardinal la perte de sa liberté. Sur sa route, quand par ordre de Louis XII on le conduisait à Milan, une noble dame de Modène, Blanche Rangone, vendit ses joyaux pour secourir le légat : charité tout évangélique qui ne tarda pas à être récompensée ; le cardinal n’oubliait que les injures. A Milan, il vit venir à lui le cardinal Saint-Séverin, les Trivulce, les Visconti, les Pallavicini, tout ce que la ville renfermait d’illustres citoyens ; c’était là que le conciliabule avait transporté ses assises. Chaque matin un crieur public, placé devant la porte de la cathédrale, sommait le pape de comparaître en personne, pour répondre de sa conduite, devant ces fils ingrats que le peuple de Milan sifflait, comme avait fait celui de Pise. Les enfants se pressaient sur les pas de Carvajal, qu’ils saluaient du sobriquet de Papa, vraisemblablement parce que ce cardinal, Jules II déposé, se voyait déjà les clefs de Saint-Pierre dans les mains ; malheureux qui les eût bientôt laissées choir, trop lourdes qu’elles étaient pour ses mains débiles ! Le temps n’était pas loin où les cardinaux dissidents allaient tomber sous les coups de cette impitoyable divinité qu’on nomme le ridicule. A Rome venait de s’ouvrir le concile de Latran, le péristyle du concile de Trente. Le 3 du mois de mai 1512, on vit descendre du Vatican un vieillard dont les cheveux avaient blanchi dans les souffrances de l’âme et du corps ; c’était Jutes II qui se rendait à la basilique de Latran, assisté de tous ses cardinaux, de quatre-vingt-trois évêques, de prélats, de députés, de grands dignitaires nationaux et étrangers. A sa vue, le peuple fléchissait le genou. L’empereur Maximilien, Henri VIII d’Angleterre, le roi d’Aragon, la république de Venise, étaient représentés dans le cortège pontifical par leurs ambassadeurs. Pendant que Rome assistait à cette glorieuse cérémonie, un autre spectacle, qui avait bien aussi sa grandeur, se passait à Milan. Le légat prisonnier absolvait, au nom du pape, ceux qui par obéissance aux ordres de leur souverain avaient pris les armes contre le saint-siège. La foule était grande autour du cardinal : gendarmes français, lansquenets allemands, cavaliers albanais, montagnards suisses, qui, à Ravenne, à Brescia, avaient porté de si furieux coups aux soldats de la sainte ligue, s’inclinaient pieusement pour recevoir le pardon du légat. |
 Jules II, élu le 31 octobre 1503, à l’unanimité des
suffrages, pour succéder à Pie III, devait être le Moïse de l’Italie. Nous ne
connaissons pas dans l’histoire un homme prédestiné à porter une couronne qui
réunisse en lui, comme Jules II, toutes les qualités qui font les grands
rois. Trouvez dans sa vie un instant où vous puissiez lire sur sa figure la
passion qui agite son âme. Il est impénétrable à l’œil comme à l’oreille, et
cependant étranger à la dissimulation ; hardi à concevoir un projet, et
jamais imprudent quand il s’agit de l’exécuter ; sa détermination est prompte
et toujours calculée. Il est patient dans l’infortune, courageux dans le
danger, miséricordieux dans la victoire. Vous pouvez rêver pour lui toutes
sortes de grandeurs, il remplira toujours dignement les vues de la
Providence. Si vous en faites un condottiere, à l’exemple de Sixte IV, son
oncle, quand il lui donna le commandement des troupes pontificales contre les
révoltés de l’Ombrie, il se battra valeureusement, et sera le père de ses
soldats ; si vous lui mettez dans la main le ciseau du sculpteur, il fera
jaillir du marbre quelque figure ressemblant au David de Michel-Ange ; si
vous l’élevez à la royauté, il fera tout ce que, plus tard, Napoléon fit de
merveilleux. Seulement, n’essayez pas de lui donner une chaire de professeur,
car, lorsqu’il voudra parler, sa langue s’embarrassera ; il cherchera le mot,
comme un écolier tremblant, et le corrigera souvent trois fois, et toujours
malheureusement, ainsi que le rapporte Paris des Grassis.
Jules II, élu le 31 octobre 1503, à l’unanimité des
suffrages, pour succéder à Pie III, devait être le Moïse de l’Italie. Nous ne
connaissons pas dans l’histoire un homme prédestiné à porter une couronne qui
réunisse en lui, comme Jules II, toutes les qualités qui font les grands
rois. Trouvez dans sa vie un instant où vous puissiez lire sur sa figure la
passion qui agite son âme. Il est impénétrable à l’œil comme à l’oreille, et
cependant étranger à la dissimulation ; hardi à concevoir un projet, et
jamais imprudent quand il s’agit de l’exécuter ; sa détermination est prompte
et toujours calculée. Il est patient dans l’infortune, courageux dans le
danger, miséricordieux dans la victoire. Vous pouvez rêver pour lui toutes
sortes de grandeurs, il remplira toujours dignement les vues de la
Providence. Si vous en faites un condottiere, à l’exemple de Sixte IV, son
oncle, quand il lui donna le commandement des troupes pontificales contre les
révoltés de l’Ombrie, il se battra valeureusement, et sera le père de ses
soldats ; si vous lui mettez dans la main le ciseau du sculpteur, il fera
jaillir du marbre quelque figure ressemblant au David de Michel-Ange ; si
vous l’élevez à la royauté, il fera tout ce que, plus tard, Napoléon fit de
merveilleux. Seulement, n’essayez pas de lui donner une chaire de professeur,
car, lorsqu’il voudra parler, sa langue s’embarrassera ; il cherchera le mot,
comme un écolier tremblant, et le corrigera souvent trois fois, et toujours
malheureusement, ainsi que le rapporte Paris des Grassis.