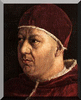HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE X. — MORT DE PIERRE DE MÉDICIS. - 1498-1503.
|
Deuxième tentative de
Pierre de Médicis. - Il échoue. - Le cardinal à la cour d’Urbin. - Il voyage
en différentes parties de l’Europe. - Il retourne en Italie, et retrouve
Julien de la Rovere à Savone. - Il arrive à Rome, et s’occupe d’arts et de
lettres. - Ses réunions. - Troisième tentative de Pierre de Médicis, qui est
trahi par César Borgia. - Il s’engage dans l’armée française, et meurt devant
Gaëte. La mort de Savonarole délivrait les Médicis d’un implacable ennemi. Tant que le moine aurait régné dans Florence, le grand rebelle de Machiavel n’avait aucune chance de retour au pouvoir. Le moine de Saint-Marc était un de ces hommes qui ne regardent pas à une tête de plus ou de moins ; si cette tête les embarrasse, ils la font tomber, sauf à invoquer pour se justifier la nécessité, cette loi suprême du peuple. Pierre, s’il eût été pris lors de sa tentative contre Florence, serait mort à cette heure, comme ses partisans Tornabuoni, Ridolfi, et le gonfalonier del Nero. II semble que contre un homme de cette trempe toutes les armes eussent été bonnes pour les Médicis : il faut reconnaître toutefois qu’ils ne trempèrent pas dans le complot, s’il y en eut un, des Compagnacci contre le religieux ; innocent ou coupable, le sang de Savonarole ne saurait retomber sur les proscrits. L’exilé qui soupire après une patrie dont il fût injustement privé aime à se repaître d’illusions ; il mourrait s’il devait cesser d’espérer. Cette espérance, qui ne l’abandonne jamais, il la met, pauvre malade, jusque dans les astres : c’est que, comme Pierre le disait poétiquement, pour un banni il n’est pas de nid plus doux que celui où il naquit. Les Médicis croyaient l’heure venue de leur retour à Florence. Qui pouvait désormais leur en fermer l’entrée ? Le moine qui veillait à la porte de la ville était mort, et ses cendres avaient été jetées dans l’Arno par la main du bourreau. La ville était en proie à la faim, à la misère, aux haines domestiques. Charles VIII, obligé de quitter cette Italie dont Savonarole, au nom de Dieu, lui décernait l’empire, venait de rentrer en France et d’y mourir. Pendant qu’au Château-Neuf, à Naples, il s’amusait à jouer Alexandre VI et ses alliés dans des comédies qu’il achetait de quelque poète affamé, le pape signait avec Maximilien, l’empereur d’Allemagne ; Ferdinand et Isabelle, le roi et la reine d’Aragon et de Castille ; la république de Venise et le duc de Milan, une ligue offensive et défensive contre la France. Son cousin, le roi Louis XII, n’était point encore en état de repasser les monts. Venise, où la tête d’un proscrit était sûre de trouver un lit de repos, avait à venger les traitements que Paul Vitelli, général florentin, avait fait subir tout récemment aux canonniers qui défendaient le château de Buti, et auxquels il avait fait couper les poings. Ces tristes trophées enterrés pour cacher sa cruauté, Vitelli s’était acheminé vers Pise la rebelle, dont il pressait le siège. C’est dans ce moment que les trois frères Médicis vinrent demander à Venise de faire rentrer Florence sous leur obéissance. La proposition fut acceptée. Deux corps expéditionnaires devaient attaquer la ville, après avoir soumis les places qu’ils rencontreraient sur leur passage : l’un allait longer l’Apennin et descendre dans la plaine d’Arezzo et de Cortone ; l’autre prenait le chemin de Marradi. Les chefs des deux corps étaient des condottieri renommés : on citait surtout le vieux Guidubald, Baglioni, Paul des Ursins et Barth. d’Alviane. Marradi fut emporté, au mois de septembre 1498, presque sans coup férir ; mais le château résista. Il était défendu par un homme de cœur, Donato Cocchi qui ne voulut écouter aucune proposition. On essaya le canon ; l’artillerie ne fut pas plus heureuse que la séduction. Alors l’armée vénitienne prit le parti d’attendre l’arme au bras, certaine que la garnison, qui manquait d’eau fraîche, finirait par capituler ; mais une pluie d’orage, comme celle que nous avons vue tomber quand Pierre apercevait déjà la coupole du Dôme, vint déjouer les calculs des assiégeants : il fallut lever le siége. Alors les confédérés se répandent par pelotons, les uns dans le pays de Faenza, les autres à travers le territoire de Forli, pillant, brûlant sur leur passage les propriétés des alliés de Florence. Vitelli en ce moment faisait une guerre de partisan aux soldats des Médicis, les harcelait, leur coupait les vivres, enlevait leurs caissons, tuait leurs traînards ; de sorte que, refoulés à Bibbiena, qui les avait reçus avec enthousiasme, ils furent trop heureux de trouver dans le général ennemi un soldat généreux qui leur permit de se retirer après avoir mis bas les armes. L’épée de Vitelli faisait l’effet de la parole de Savonarole. Quelques mois plus tard, le vainqueur était arrêté à Cascina, conduit à Florence, jugé et décapité pour avoir laissé échapper Pierre de Médicis. C’est ainsi que Florence payait la gloire. Pierre s’éloigna sans se laisser abattre par ce nouveau coup du sort. Il savait maintenant qu’il pouvait compter sur des amis dévoués ; qu’à Florence les préventions contre la maison de Médicis s’affaiblissaient chaque jour ; que l’exil ne serait pas perdu pour ses deux frères Jean et Julien ; c’était une école de malheur où tous deux faisaient l’apprentissage de vertus qui honoreraient la pourpre. Tout ce qui portait une âme d’artiste à Florence regrettait les bannis ; Politien était mort du chagrin que lui avait causé la chute de ses bienfaiteurs. Élève de Ficin, il restait à Pierre des consolations que personne, Savonarole lui-même, s’il eût vécu, n’aurait pu lui ravir. Il revint aux muses pour apaiser ses chagrins ; il leur disait, en jetant un dernier regard sur cet horizon où semblait flotter l’image de sa ville bien-aimée : Me voici loin de mon beau jardin ; mais une douce voix vient murmurer à mon oreille : A qui n’est pas mort le chemin du retour n’est jamais fermé. Pour échapper aux noires idées qui l’obsédaient, le cardinal résolut de quitter l’Italie et, sur la terre étrangère ; d’aller, en oubliant l’ingratitude de ses concitoyens, étudier les mœurs, les institutions, la culture intellectuelle des autres peuples. Il se rappelait Pic de la Mirandole, dont l’âme s’était formée dans les voyages ; Érasme, dont le nom commençait à retentir en Italie, et qui, pour féconder son imagination, parcourait la France, l’Angleterre et l’Allemagne ; Rodolphe Agricola, qu’il avait vu souvent aux leçons de Politien et de Ficin : il résolut d’imiter ces belles intelligences. C’est à Urbin, où il s’était un moment retiré, que Jean conçut le projet de son voyage littéraire. A cette époque, Urbin ressemblait à la petite ville de Weimar sur la fin du dernier siècle, où tout ce qui brillait alors dans les lettres allemandes, Herder, Gœthe, Schiller, Wieland, ambitionnait de passer quelques heures. Sur le sol granitique où s’élève Urbin, le duc Frédéric avait fait construire un palais, ou plutôt une ville, où il avait réuni avec un goût exquis tout ce qui pouvait réjouir l’artiste ou l’humaniste : des statues de marbre et de bronze, des tableaux de l’école ombrienne, des instruments de musique, et surtout des manuscrits grecs, latins, hébreux, qu’il avaient fermés, comme de véritables reliques, dans des couvertures d’or et de nacre ; beaux trésors au milieu desquels il s’éteignit doucement à l’âge de soixante-dix ans. Le soin amoureux des livres avait gagné jusqu’aux écoliers, qui employaient l’argent qu’ils recevaient de leurs parents pour étudier à Bologne ou à Paris, à faire rehausser de lettres d’or quelque curiosité bibliographique. Le fils de Frédéric, Guidubald, enrichit l’héritage paternel de merveilles nouvelles qu’on venait visiter, en pèlerinage, de, tous les points de l’Italie. Pendant six ans, c’est-à-dire de 1598 à 1505, Urbin fut le rendez-vous et comme l’hôtellerie de toutes les gloires du monde latin. Un écrivain allemand, M. Passavant, dans son Histoire de Raphaël, a mis fort habilement en scène ces figures diverses qui viennent passer tour à tour dans les salons du prince : André Doria, le Génois célèbre, qui reçut du duc, en qualité de feudataire, le château de Sascorbaro ; Octavien Frégose, homme de guerre aussi habile qu’audacieux ; Frédéric Frégose, son frère, que Jules II fit archevêque de Salerne, et que Paul III décora de la pourpre romaine ; le comte Louis de Canosse, d’abord évêque de Tricarico, puis de Bayonne sous François Ier ; le comte Balth. Castiglione, l’auteur du Libro del Corteggiano, œuvre qui, sous le rapport littéraire, vivra tant que la langue italienne sera parlée ; Pierre Bembo, qui faisait les vers comme Pétrarque, philosophait comme Platon, écrivait en latin comme Cicéron, et qui a tracé un ravissant tableau de la cour dont il faisait l’ornement ; Bernard Bibbiena, ce beau jeune homme, fou de gaîté, qui, dans sa Calandra ; rappelle la manière de Plaute, et qui aurait été le premier auteur comique du siècle, si Léon X n’eût jeté sur les épaules du poète la robe rouge de cardinal ; César Gonzague de Mantoue, qui commentait Polybe ; Alexandre Trivulce, un des meilleurs capitaines de son siècle, et qui mourut en héros sous les murs de Reggio ; Jean Cristofano Romano, qui posait le ciseau du sculpteur pour prendre la plume et prouver que le groupe du Laocoon n’est pas d’un seul bloc ; Bernard Accoiti, surnommé l’Gnico, à cause de son talent d’improvisation ; l’Allemand Fries, qui, selon Bembo, écrivait en italien comme un Siennois ; Emilia Pia, sœur d’Hercule Pio, seigneur e-e Carpi, femme du comte Antoine de Montefeltro, et dont le savoir égalait la beauté ; Eléonore Gonzague, ange de grâce et d’esprit, attirant à elle tous les cœurs. Séjour charmant que cette ville d’Urbin, où le temps se passait à disserter sur le néoplatonisme, sur la peinture, la sculpture, la musique et l’histoire. Le cardinal ne s’arrêta que quelques semaines à Urbin, assez de temps toutefois pour y gagner l’amitié des hôtes illustres qui s’y trouvaient alors. Les compagnons de voyage dont il avait fait, choix étaient tous connus par leur dévouement à la maison de Médicis : on pense bien qu’il ne pouvait oublier le secrétaire de Laurent et de Pierre, Dovizi Bibbiena. Avant de partir, le cardinal dressa le plan de son itinéraire scientifique. La caravane se proposait de visiter l’Allemagne, les Pays-Bas, la Hollande, l’Angleterre, la France, et peut-être l’Espagne, si l’étoile à la lueur de laquelle elle comptait marcher ne l’abandonnait pas. Ils voyageaient de conserve, comme des vaisseaux qui vont à la recherche de terres lointaines : point de marques extérieures de dignités, point de préséance de rang, de fortune ou d’âge ; c’était une république nomade, où chacun tour à tour exerçait les fonctions de chef, c’est-à-dire de guide. Aujourd’hui qu’on s’embarque avec un sac de nuit seulement pour faire le tour du monde, nous sommes tentés de rire de cette charte fastueuse de voyage improvisée par le cardinal : mais nous avons la vapeur, les chemins de fer, la poste, trois modes de locomotion inconnus au seizième siècle, où le pèlerin n’avait pour cheminer qu’un mulet de montagne qui posait le pied sans trembler sur les angles des rochers, mais qui devait se coucher longtemps avant le soleil, dormir douze heures, et se reposer au moins deux jours entiers par semaine. Il fallait avoir quelque maladie dans le cerveau, quelque vœu pieux à remplir, quelque amour désordonné du grand air ou de la science, pour entreprendre une excursion lointaine. La grande route voyait tout et ne disait jamais rien. Ici c’était un reître galopant à cheval pour détrousser, au nom de Dieu, le voyageur ; plus loin un condottiere qui, n’ayant rien trouvé dans son chemin, se dédommageait de sa mauvaise fortune sur la défroque d’un pauvre pèlerin ; ailleurs, des bandes de bohèmes qui faisaient métier de dire l’avenir, dont le passant était obligé de se faire découvrir un voile au prix de sa bourse tout entière ; plus loin, des barons qui épiaient l’étranger du haut d’une tour, tendaient des chaînes de fer jusque sur le sentier, et demandaient pour péage les meilleures hardes du voyageur. Hutten, Beatus Rhenanus, Rodolphe Agricola, nous ont raconté les mille tribulations que devait subir celui quine se contentait pas de l’horizon de son clocher. Malheur au voyageur qui, comme Erasme, aime un bon gîte, un vin vieux, une mule au pas mesuré, une chaude couche quand l’heure du repos est venue : il faudra que, semblable au Batave, il dorme sur la paille ou dans des draps de toutes les couleurs, qu’il boive d’un vin qui fait sauter la cervelle, qu’il enfourche une monture boiteuse, qu’il enfonce dans la poussière, qu’il soit brûlé du soleil, dévoré par les insectes voltigeant autour de lui, qu’il descende dans une auberge ou plutôt dans un hypocauste où il risquera de périr asphyxié, et, si sa monture meurt sous lui, qu’il loue à grands frais une mauvaise charrette qui mettra deux jours et deux nuits à faire le trajet d’Amiens à Paris. De Douvres, traverse-t-il le détroit, il tombera dans les mains de douaniers qui allégeront sa bourse, bien légère déjà, de toute monnaie au coin du souverain étranger, sous prétexte que l’édit du prince prescrit qu’elle ne peut contenir qu’un certain nombre d’angelots à la figure du monarque dont le voyageur vient de quitter les Etats. La caravane prit le chemin de Venise, traversa les montagnes du Tyrol, visita les villes, les églises, les bibliothèques, les monuments de l’art qu’elle trouvait sur sa route. Le nom des Médicis était connu dans toute l’Allemagne, où leurs malheurs récents avaient excité les plus vives sympathies. Dès qu’on connut à Augsbourg l’arrivée du cardinal, le peuple vint en foule aux portes de la ville pour le saluer. A Ulm, le soldat de garde ayant avisé cette escouade aux vêtements italiens, conçut quelques craintes, lui barra le chemin, et refusa de la laisser passer outre. Le gouverneur, n’osant relâcher les voyageurs, prit le parti de les faire conduire sous escorte jusqu’à Inspruck, où se trouvait l’empereur. Maximilien Ier était un prince qui portait glorieusement son épée d’or, et attirait à sa cour les lettrés allemands c’est lui qui devait donner à Ulrich de Hutten, pour un poème, 400 ducats et une couronne d’olivier ; au poète toscan Inghirami, le titre de comte palatin, et l’aigle d’Autriche pour armes. Il reçut nos voyageurs avec toutes sortes d’égards et de distinctions, le cardinal surtout, dont il admirait le courage. Il connaissait les malheurs de Pierre, il en parla le cœur ému ; au moment de se séparer, il remit au prélat un passeport revêtu du sceau impérial, et une lettre de recommandation pour Philippe, gouverneur des Pays-Bas. Philippe eut pour ses hôtes les bons soins qu’avait eus son père. Après quelque temps de séjour dans l’abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, où l’abbé les reçut gracieusement, ils résolurent de passer en Angleterre ; mais, la mer étant grosse, ils eurent peur des flots et partirent pour la France. Arrivés à Rouen, ils inspirèrent quelques craintes au gouverneur de la ville, qui les fit enfermer dans la citadelle, malgré les protestations du cardinal. Qu’étaient devenus ces beaux rêves que Jean de Médicis formait avant de quitter Venise ? Son odyssée ne ressemblait guère à celle que lui avait si souvent contée Pic de la Mirandole. Prisonnier dans une forteresse où, pour tromper les ennuis de la captivité, il n’avait pas même la ressource de la lecture, car les livres ne faisaient que de naître, il dut attendre une lettre de Pierre son frère, pour recouvrer sa liberté. Cette lettre fut longtemps en chemin : elle arriva enfin du camp des Français, où le grand-duc se trouvait avec Louis XII, et le cardinal put reprendre cette vie des champs qu’il semblait aimer si vivement. Il visita le long espace qui s’étend de Rouen à Marseille, s’arrêtant de préférence dans ces cités provençales où il retrouvait l’air, les mœurs, les costumes et presque le langage de son Italie. Il semblait que le ciel prît à tâche d’éprouver la constance des voyageurs ils avaient à peine quitté la rade de Marseille, qu’ils furent assaillis par une violente tempête et obligés de relâcher à Savone. Nous nous rappelons le cardinal de la Rovere, qui, le jour de l’élection d’Alexandre VI, quitte Rome et va se jeter dans Ostie, tant il a peur du pontife. Depuis il n’a cessé d’errer en Italie. Il ne peut trouver sur son chemin une image, un souvenir, une ombre de Borgia, qu’il ne se hâte de fuir. Ce n’est pas du reste la colère, mais les ruses d’Alexandre VI qu’il redoute. Jamais deux hommes nés sous un ciel ardent n’eurent moins de ressemblance. Le cardinal de la Rovere est brusque, impétueux, irascible, mais franc comme un soldat. Ses emportements sont de la nature de l’éclair, ils ne laissent pas de traces ; c’est Michel-Ange en robe rouge. Il ne cherche que la nature tourmentée, que les grands blocs de marbre, que les couleurs chaudes et transparentes. Aussi le trouvez-vous presque toujours dans un arsenal, au milieu des canons, en pleine mer sur un vaisseau, caracolant sur la rampe d’une montagne, et, dans ses voyages, portant une cotte de mailles sur la poitrine : belle figure toute rayonnante de lumière et qu’eût aimée Rembrandt. Julien de la Rovere reçut splendidement Jean de Médicis : ni l’un ni l’autre ne se doutaient alors que le sort réunissait à la même table trois exilés qui ceindraient un jour la tiare : la Rovere, sous le nom de Jules II ; Jean de Médicis, sous le nom de Léon X ; Julien de Médicis, sous le nom de Clément VII. Le cardinal, après un court séjour à Gênes, qu’habitait sa sœur, Madeleine de Médicis, femme de François Cibo, prit le chemin de Rome. La ville éternelle avait changé d’aspect. La main de fer d’Alexandre VI s’était appesantie sur ces brigands titrés qui faisaient des rues désertes de certains quartiers autant de repaires d’où vous les voyiez fondre en plein jour sur les marchés publics, pour rançonner, piller ou tuer vendeurs et acheteurs, et quelquefois même sur les palais des cardinaux, qu’ils dévalisaient en tolite liberté. Alexandre avait été sans pitié ; les galères, la corde ou le couteau avaient fait prompte justice de ces bandits. Les rues étaient presque aussi tranquilles la nuit que le jour. Les marchés étaient libres, les greniers abondants ; on ne redoutait plus la famine, et l’herbe avait cessé de croître sur les places publiques. Par ordre du pontife, des rues avaient été percées, l’université agrandie, les écoles multipliées, des hospices richement dotés, d’anciens aqueducs restaurés, quelques glorieux restes d’antiquité relevés. Si la paix avait régné en Italie, il est certain qu’Alexandre aurait le premier produit une partie des merveilles qui signalèrent les règnes de Jules II et de Léon X. Castiglione, Bembo, l’Arioste, ont célébré la protection que ce pape accordait aux lettres. Inghirami, envoyé comme nonce en 1494 à la cour de Maximilien, empereur d’Allemagne, avait été nommé chanoine de Saint-Pierre par le pontife, et décoré du titre de prélat. Thomas Inghirami, qui devait sa fortune littéraire à Laurent de Médicis, accueillit avec empressement le fils de son bienfaiteur, et contribua sans doute à effacer de l’esprit d’Alexandre VI les préventions que le pape avait conçues contre Jean de Médicis. De son côté, le cardinal évita soigneusement de se compromettre, et réussit à se faire oublier en se mettant à l’étude de l’antiquité avec une ferveur toute juvénile. Amoureux du vieux monde latin, il se levait le matin avec le soleil, et, après avoir entendu la messe, venait frapper à la porte de son secrétaire endormi, qu’il réveillait au bruit de ces vers d’Ausone : Mane
jam clarum reserat fenestras, Jam
strepit nidis vigilax hirundo : Tu,
velut primam, mediamque noctem, Parmeno, dormis. Et tous deux s’acheminaient vers quelques-unes de ces vignes qu’on fouillait alors, attentifs à toutes les bonnes fortunes que la pioche réservait aux explorateurs. La statuette qui reparaissait à la lumière était saluée par un double cri de joie et célébrée souvent, le soir, par le cardinal et son secrétaire. Après l’avoir généreusement payée, ils la lavaient soigneusement de ses souillures séculaires, et la transportaient comme une relique dans le cabinet du prélat, où bientôt arrivaient, avertis, une foule d’archéologues, d’humanistes, de sculpteurs, de savants, qui cherchaient son nom, le trouvaient quelquefois, lui en donnaient un le plus souvent, et chantaient sa résurrection en vers grecs ou latins. Douces jouissances qui ne pouvaient inquiéter Alexandre VI ! Le pape avait fini par s’attacher au cardinal : il avait raison, car l’adolescent était un modèle de vertus. Nous avons dit comment, à l’expulsion des Médicis, la belle bibliothèque formée dans le palais de la Via Larga, par Laurent le Magnifique, fut dévastée ou dispersée. Bernard Ruccellai, témoin oculaire, a pleuré la perte de tous ces beaux trésors comme celle d’une personne bien-aimée. Quelques manuscrits, échappés par une sorte de miracle à la fureur du peuple, forent transportés au couvent de Saint-Marc. Mais, en 1496, la république eut besoin d’argent et les mit en vente. Les moines les rachetèrent au prix de cinq mille ducats ; c’est une bonne action : mais les livres avaient encore d’autres dangers à courir. Savonarole, à chaque grande colère d’Alexandre, en choisissait un des plus beaux dont il faisait présent au favori de Sa Sainteté ; la colère revenait, et les manuscrits s’en allaient de Florence. Alors quelques jeunes gens de famille se constituèrent gardiens de la bibliothèque, et prirent le parti de transporter les livres au palais de la seigneurie, pour les mettre à l’abri de l’envie et de l’insulte. Après la mort de Savonarole, ils rentrèrent au couvent de Saint-Marc. Quand les dominicains, pressés par le besoin, résolurent de s’en défaire, le cardinal, pour ne pas effrayer le gonfalonier, les racheta, mais un à un : Soderini eût pu les voir passer sous ses fenêtres ; il fermait les yeux. Le cardinal eut donc sa bibliothèque, peu nombreuse mais bien choisie, et qu’il enrichit de toutes les belles éditions d’auteurs grecs et latins publiés en Italie depuis l’invention de l’imprimerie. Bibbiena en fut nommé conservateur : il fallait bien récompenser la fidélité de ce bon jeune homme, qui depuis dix ans serrait au cardinal de compagnon de route, de secrétaire, de copiste, de lecteur, de camérier ; qui se connaissait en peinture, improvisait, sténographiait, faisait des sonnets et des odes, et, au besoin, remplissait la charge de chef d’office quand son maître donnait à dîner. Médicis eut bientôt sa petite cour à Rome, formée d’âmes d’élite, ne vivant et ne parlant que de ruines, d’antiquités, d’arts et de lettres. Pendant qu’il assiste aux fouilles du Campo Vaccino ; qu’il rassemble dans son musée, avec un amour d’artiste, ses conquêtes archéologiques de chaque jour ; que le soir, fatigué de ses longues courses à travers les ruines de Rome, il relit, pour se délasser, quelques-uns de ces poètes latins que ses précepteurs lui apprirent à vénérer ; qu’il écoute dans une douce extase les vers d’Inghirami, il rêve au rétablissement de sa maison. Il n’a qu’une pensée, c’est de rentrer dans le palais de la Via Larga, construit par Michelozzi. Jamais enfant n’aima son père avec une plus ardente tendresse : comme il serait heureux le jour où il pourrait entendre crier dans la Via Larga : Palle ! Palle ! Pierre, son frère, est tourmenté du même désir. Il a beau chanter, et quelquefois même en grand poète, l’image de sa chère Florence est toujours là qui l’excite, le presse, et le pousse à tenter de nouveau la fortune. Cette fois il a su mettre dans ses intérêts le plus grand capitaine de l’époque, César Borgia. Pauvre fou qui ose se fier à un homme tel que le Valentinois ! César, au commencement de 1500, s’avançait donc vers Florence pour y rétablir les Médicis. Il était à la tête de 7.000 hommes d’infanterie et de 1.000 chevaux environ. A Barberino, Bentivoglio l’attendait avec 200 hommes d’armes et 2,000 fantassins. Mais, au lieu d’attaquer la ville, qu’il aurait pu facilement emporter, il se mit à négocier. Pierre Soderini comprit que César voulait se faire acheter : il lui donna de l’or, et César s’éloigna. Mais, l’argent dépensé, César reparut (1502) avec une armée plus nombreuse que la première, où tout ce qui savait manier la lance en Italie s’était empressé de s’enrôler. Chaque jour amenait sous les drapeaux de Borgia des capitaines renommés : c’étaient Vitellozzo Vitelli, François des Ursins, Pandolfe Petrucci, Jean-Paul Baglioni, Oliverotto da Fermo. Ces chefs de condottieri éblouissaient les regards, tant leurs vêtements étaient brillants ; ils montaient des chevaux napolitains qui fendaient l’air, et leurs épées étaient d’un acier trempé à Damas même. On eût dit qu’ils allaient à quelque partie de plaisir ; et c’en était une pour eux que de voir les villes, à leur approche, empressées de se soumettre. Cortone, Anghiari, Borgo San Sepolcro, Arezzo, n’osèrent pas même se défendre. Jamais Florence n’avait couru de si grands dangers. Pierre pouvait espérer d’être enterré près de son père dans l’église de Saint-Laurent. Mais Soderini veillait. Tout récemment Louis XII avait promis sa protection à la république : le moment était venu de rappeler au monarque ses engagements, et Soderini se chargea de cette mission. Il devait réussir, car, si Borgia s’emparait de Florence, le sort de l’expédition de Louis XII était compromis. Supposez que, comme Charles VIII, il soit obligé d’abandonner l’Italie, le Valentinois, avec ses condottieri, pouvait lui barrer le chemin des Alpes. Le roi, qui se trouvait à Milan, détache sur-le-champ un corps de troupes qui reçoit l’ordre d’attaquer Borgia s’il refuse de quitter la Toscane. Le Valentinois, cette fois, ne demande pas qu’on lui fasse un pont d’or pour s’éloigner, une simple menace du monarque suffit. Alors Florence, dans l’ivresse dit double succès obtenir par Soderini, lui décerne le titre de gonfalonier à vie, c’est-à-dire qu’elle se donne de plein gré un autocrate. Soderini représentait le parti de la laine, c’est-à-dire la bourgeoisie ; c’était un homme modéré, qui aimait les lettres sans les cultiver, et qui habitait alors une petite chambre toute modeste près du pont Alla Carraja. On lui donna pour représenter la république cent écus d’or par mois, environ douze cents francs de notre monnaie. Quelques mois après, Alexandre VI mourait. N’interrompons pas notre récit pour quelques pages qui restent à l’histoire de Pierre de Médicis. Par pitié, qu’on nous dise le parti que doit prendre le malheureux banni ? Tornabuoni, del Nero, ont péri d’une mort ignominieuse pour avoir conspiré en sa faveur ; Vitelli a payé de son sang un mouvement de compassion pour le proscrit ; le ciel a par deux fois arrêté aux portes de Florence le prétendant que Borgia vient de trahir indignement. Du moins, s’il est malheureux, il a montré dans sa mauvaise fortune du courage et de la constance. Il n’y a plus que la mort qui puisse le délivrer ; il la veut, mais une mort de soldat. Il s’engage donc, le 29 décembre 1503, dans l’armée française, où pendant quelque temps sa place est aux avant-postes. Sur les bords du Garigliano, Alviane était venu attaquer La Trémoille ; l’action fut chaude et longtemps disputée, mais les Français durent céder. Enveloppé dans la fuite de La Trémoille, Pierre frète une galère qui va le transporter avec quatre pièces d’artillerie à Gaëte, qu’il veut empêcher à tout prix de tomber dans les mains de Gonsalve, général espagnol, quand le bâtiment sombre et s’abîme dans les flots. Le lendemain la mer jeta sur le rivage le corps du malheureux prince, que quelques moines déposèrent dans une tombe solitaire, où rien ne rappellera le souvenir du fils de Laurent, pas même la devise que Politien, en des jours plus heureux, avait composée pour son élève et son ami : in
viridi teneras exurit flamma medullas. Ainsi finit misérablement, en face du château de Gaëte, Pierre de Médicis, que Valeriano (Bolzani) a bien eu raison de placer parmi les lettrés malheureux. S’il fût mort dans le palais de ses ancêtres, au milieu de ces beaux livres qu’il aimait et lisait, entre les bras de quelques humanistes, comme son père, l’histoire aurait été moins sévère envers lui : elle flatte ceux qui meurent sur le trône, et n’a pas même de pitié pour qui finit obscurément dans l’exil. |