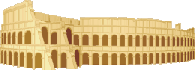JULIEN L'APOSTAT
TOME SECOND. — JULIEN AUGUSTE. - JULIEN ET LE PAGANISME - JULIEN ET LES CHRÉTIENS : LA LÉGISLATION.
LIVRE VII. — JULIEN ET LES CHRÉTIENS : LA LÉGISLATION.
CHAPITRE II. — LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT.
|
I. — Julien à Pessinonte et à Ancyre. Julien venait de passer cinq mois à Constantinople. On a vu comment ils avaient été remplis. Réorganiser la cour et réformer l'administration ; restaurer le culte païen, et le renouveler, lui aussi, par de profondes réformes ; commencer, au sujet du christianisme et des chrétiens, une politique tolérante en apparence, dissolvante et provoquante dans les détails : telle avait été, pendant ce court laps de temps, l'œuvre par laquelle Julien avait entrepris de réagir, sur tous les points à la fois, contre la politique intérieure de Constance. Mais à l'extérieur il ne voyait guère autre chose à faire que de continuer les traditions de son prédécesseur. Celui-ci avait passé une partie de sa vie à guerroyer contre les Perses. Les meilleures pages écrites par Julien sont peut-être celles où il raconte les péripéties des campagnes, mêlées de succès et de revers, que Constance mena contre eux en 338, en 348 et en 350. C'est le renouvellement de la guerre de Perse qui, en donnant à celui-ci l'occasion de demander à Julien une partie des troupes de Gaule, pour renforcer l'armée d'Orient, fut la cause indirecte de la révolution militaire de 360 ; encore en 361, au moment même où Julien marchait contre lui, Constance eût été obligé de livrer bataille à Sapor, si une terreur superstitieuse n'avait déterminé tout à coup la retraite de ce dernier. Le continuel danger qui, de l'immense et indécise frontière qui le séparait des possessions des rois Sassanides, semblait toujours au moment de fondre sur l'Empire romain, avait ainsi retenu pendant la plus grande partie de son règne Constance en Asie, à portée du séculaire champ de bataille où tant de fois le sang des Romains et des Perses se mêla aux eaux du Tigre et de l'Euphrate. La pensée d'assurer à son tour la sécurité de l'Asie romaine, comme aussi l'espoir de renouveler en Orient sur des ennemis dignes de sa renommée les exploits qui l'avaient immortalisé en Germanie, attirait maintenant Julien sur les traces laissées par Constance. Il rêvait d'effacer par une offensive hardie le souvenir des luttes défensives de son prédécesseur, de se jeter au delà du Tigre, comme naguère il s'était jeté au delà du Rhin, peut-être d'écraser sous ses coups la puissance des Perses, et d'annexer à l'Empire de Rome les pays du soleil. Mais, avec son expérience des choses militaires, il sentait qu'une aussi aventureuse campagne n'était pas de celles qui s'improvisent en quelques semaines : et il avait résolu de s'établir à Antioche, pour l'y préparer à loisir. On connaîtrait mal Julien, cependant, si l'on attribuait son départ de Constantinople et son entrée en Asie au seul désir de se rapprocher des Perses. L'espoir de rendre au paganisme tout son lustre, dans cet Orient qui avait vu naître la plupart des superstitions antiques, mais où le christianisme avait plus qu'ailleurs étendu ses conquêtes, fut probablement aussi pour beaucoup dans cette migration. Cinq ans plus tôt, Julien savait oublier ses préoccupations religieuses pour ne se souvenir, quand les circonstances l'exigeaient, que de ses devoirs de chef d'État. Alors qu'il suivait, à la tète de ses troupes, les rives de la Meuse et du Rhin, sa pensée, devenue subitement nette et lucide, se détournait des dieux adorés au fond du palais de Lutèce, pour s'appliquer tout entière aux opérations militaires et ne plus voir que l'ennemi. Le dévot superstitieux, le rhéteur obscur et compliqué, disparaissait complètement alors : seul demeurait le général. Mais, depuis un an déjà, cette aisance à reprendre possession de lui-même, cette heureuse faculté de dédoublement, s'étaient altérées chez Julien. L'homme que la marche la plus audacieuse et la plus rapide venait de porter en quelques mois de Paris à Constantinople n'était déjà plus le chef qui avait battu les Germains à Strasbourg ou les Francs en Toxandrie. Même pendant cette extraordinaire expédition, Julien avait laissé le païen déteindre sur le général, et la superstition entraver le commandement. Nous nous sommes déjà demandé si, au cas où Julien, en Italie, en Illyrie ou en Thrace, eût rencontré des adversaires, au lieu de trouver toutes les voies libres devant lui, il aurait mené à une aussi sûre victoire une armée dès lors occupée de présages et endoctrinée par les devins. C'est avec des qualités d'homme d'État et d'homme de guerre encore diminuées qu'il va maintenant passer en Asie. On l'y verra occupé de mener la campagne contre l'idée chrétienne au moins autant que de préparer la guerre contre les Perses, au risque d'accroître les divisions entre ses sujets à l'heure même où il aurait le plus besoin de rassembler ceux-ci dans un effort unanime contre l'ennemi commun. Julien se mit en route vers le milieu de juin 362[1]. Il avait depuis longtemps préparé son armée à le suivre, réunissant fréquemment les soldats, les passant en revue, leur adressant des harangues, et leur faisant d'abondantes distributions d'argent[2]. C'est probablement lors d'une de ces distributions que se produisirent les faits rapportés plus haut, au sujet des soldats chrétiens. Julien débarqua à Chalcédoine, d'où il gagna Nicomédie. Cette ville passait depuis longtemps pour l'une des plus belles de l'Empire. Elle avait été la résidence de Dioclétien au commencement du quatrième siècle, et ce prince s'était plu à lui donner l'aspect d'une véritable capitale. Par la multitude de ses édifices publics et privés, dit Ammien, elle ressemblait à une région de la Ville éternelle[3]. Mais, au moment où y passa Julien, Nicomédie n'offrait qu'une ombre de sa récente splendeur. Un épouvantable tremblement de terre l'avait à demi renversée en 358. Ses murailles ne paraissaient plus que cendres et débris. Son sénat municipal était appauvri, la masse des habitants réduite à la misère. Quand Julien y fit son entrée, il ne put retenir ses larmes à la vue des décurions et des magistrats qui venaient au-devant de lui pauvrement vêtus, suivis d'une foule en haillons : son émotion s'accrut encore quand il reconnut parmi ces malheureux des gens qu'il avait fréquentés lors de son second séjour, ou même quand on lui en montra, dit Ammien, avec qui il avait été en rapport dans son enfance, pendant l'année passée sous la tutelle de son parent, l'évêque Eusèbe[4]. Julien vint généreusement au secours de tant de maux, et fournit les fonds nécessaires à la réparation des monuments ou des maisons[5]. La grande voie romaine que suivait Julien le mena en ligne droite à Nicée[6] ; puis, infléchissant brusquement à gauche, parallèlement au cours du Sangare, le conduisit à la frontière de la Galatie[7]. Dans sa hâte de visiter, même au prix d'un long détour, le principal sanctuaire de la Mère des dieux[8], il abandonna, probablement à Juliopolis, la route qui se dirigeait vers Ancyre, et, traversant le Sangare, puis le Timbres, s'engagea dans le massif montagneux derrière lequel s'étendait Pessinonte. Sans doute, la ville sainte était déchue depuis longtemps. La corporation de prêtres qui régnaient jadis comme des rois sur les pays d'alentour[9] avait perdu son importance après la conquête romaine. Dès le second siècle avant notre ère, la pierre noire, symbole de la déesse, s'était vue transporter à Rome, où elle recevait encore, au temps de Julien, les hommages des grands et du peuple. Mais Pessinonte, l'ancienne ville phrygienne, maintenant englobée dans les limites de la Galatie, demeurait le berceau antique du culte de la déesse. Le temple bâti, dit-on, par le roi Midas, et orné par la piété des Attales, subsistait encore, montrant, malgré leur vétusté, son superbe naos et ses portiques de marbre blanc. Même privée de ses anciennes richesses et de ses anciens privilèges, même dépouillée du précieux simulacre dont Rome s'était enrichie, Pessinonte n'avait pas cessé d'être, pour un dévot comme Julien, l'un des lieux les plus vénérables, l'une des capitales religieuses du monde païen. Julien fit de sa visite dans cette ville un véritable pèlerinage. Il se rendit au temple, pour y adorer la déesse. On ne nous dit pas quels sont les prêtres qui l'y reçurent ; mais il est vraisemblable qu'Arsace, nommé par lui grand prêtre de la Galatie, était accouru pour lui faire les honneurs du sanctuaire, et qu'en tête du chœur des prêtresses paraissait la vertueuse Callixène[10]. Julien ne sortit du temple qu'après avoir immolé des victimes, chanté des hymnes[11], offert de riches présents, et obtenu une réponse de la déesse[12]. On croira aisément que beaucoup des habitants de la ville observèrent ce spectacle avec plus de curiosité que de sympathie. La Galatie, dont la première évangélisation remontait à l'âge apostolique, comptait au quatrième siècle de nombreux chrétiens. Tous, parmi eux, n'étaient pas d'humeur à supporter patiemment la renaissance du paganisme. Il y en avait de jeunes, dont le sang bouillonnait. Pendant le séjour de Julien à Pessinonte, l'autel de la Mère des dieux fut renversé. Deux jeunes gens, auteurs de ce sacrilège, furent amenés devant l'empereur. Grégoire de Nazianze raconte, avec sa verve accoutumée, leur comparution. Mettant Julien lui-même en scène : L'un d'eux, dit-il, pour avoir insulté la Mère de tes dieux et jeté à terre son autel, comparut devant toi en accusé : mais il entra comme s'il eût été un triomphateur, et, après avoir bravé ta pourpre, raillé tes vaines et inutiles paroles, il sortit[13], aussi libre et aussi confiant que s'il avait quitté la salle d'un festin. L'autre fut battu avec des lanières de cuir, qui mettaient ses entrailles à nu : la torture le laissa presque expirant, et peu s'en fallut qu'il ne succombât sous les coups. Telle était son intrépidité, que, dès qu'il voyait quelque partie de son corps épargnée par les bourreaux, il leur reprochait de lui faire injure, en privant de la sainteté conférée par la souffrance les endroits qu'ils n'avaient pas lacérés. Leur présentant une jambe, sur laquelle ils n'avaient point passé les ongles de fer, il les exhorta à ne pas l'oublier[14]. Si telle était l'exaltation des chrétiens, on sera tenté d'admettre que de la part des païens de Pessinonte y répondait un ardent fanatisme. Il n'en était rien, cependant. Les païens de la ville aimée des dieux, comme l'appelle Julien[15], étaient tièdes, et entraient dans ses vues sans aucune ardeur. Les prêtres eux-mêmes manquaient de ferveur : quelques-uns poussaient l'indifférence jusqu'à laisser, sans s'émouvoir, leurs femmes, leurs enfants ou leurs serviteurs professer le christianisme. Julien éprouva pour la première fois, pendant son court séjour à Pessinonte, le désappointement mêlé de surprise qu'il ressentira souvent durant son voyage à travers l'Asie romaine. D'après les rapports intéressés de ses flatteurs, il s'était imaginé qu'il avait suffi d'un mot de lui, ou au moins d'un édit de sa main, pour relever partout l'ancienne religion. Il avait cru que non seulement les temples, à son signal, allaient être matériellement ouverts, mais encore que les cœurs auraient aussitôt tressailli d'amour pour les dieux. Il s'apercevait, au contraire, qu'en beaucoup de lieux l'obéissance à ses ordres avait été purement extérieure, mais que rien dans les sentiments de la foule ne s'était trouvé changé. C'était pour lui une grande peine. Il le laissa voir à Pessinonte. Pour une affaire que nous ignorons, les habitants avaient imploré son aide. Peut-être la ville avait-elle souffert d'un tremblement de terre ou d'un incendie ; peut-être demandait -elle un allègement d'impôts. Julien fit sentir que ses grâces seraient au prix d'une recrudescence de ferveur religieuse. En quittant la ville, il écrivit au grand prêtre de Galatie : Je suis disposé à secourir Pessinonte, si ses habitants se rendent propice la Mère des dieux. Ceux qui, au contraire, les méprisent non seulement sont coupables, mais encore, chose triste à dire, encourront mon ressentiment. Car je ne crois pas juste de montrer de la bienveillance ou de la pitié aux hommes qui haïssent les dieux immortels[16]. Fais-leur donc comprendre que, s'ils désirent de moi quelque faveur, ils doivent venir tous ensemble, en suppliants, devant la Mère des dieux[17]. Julien avait fait un long détour pour descendre à Pessinonte : remontant probablement par le même chemin, il regagna la voie qui menait à Ancyre. Cette métropole de la Galatie était encore, au milieu du quatrième siècle, une grande et florissante cité. Centre pour la province du culte de Rome et d'Auguste, elle montrait avec orgueil le temple célèbre, dont les murailles portaient la longue inscription où sont relatés les Gestes du premier empereur romain. Les ruines que l'on retrouve encore sur son territoire attestent le grand nombre et l'importance de ses édifices : Je n'ai vu aucune ville, si ce n'est Rome et Athènes, — écrit un voyageur savant, — où s'offrent de tous côtés aux regards autant de vestiges de l'époque romaine[18]. Il est à remarquer même que la proportion des inscriptions en langue latine y est beaucoup plus considérable que dans les autres cités des provinces asiatiques : ce qui indique l'importance du commerce entretenu par Ancyre avec l'Occident, et la multitude des fonctionnaires nés en pays latins qui y séjournaient[19]. Ancyre n'était pas seulement l'une des villes où florissait le culte officiel de Rome et d'Auguste : celui de Cybèle y était aussi en honneur[20], Si l'on en croit un document hagiographique, la déesse aurait été adorée là sous les traits de Minerve Bérécynthe, et son culte s'y serait joint à celui de Diane, également populaire en Galatie[21]. Les rites célébrés en l'honneur de ces déesses avaient probablement un caractère orgiastique : on parle de processions conduisant leurs statues au bain sacré, parmi les danses, les chœurs de chanteuses, les orchestres de femmes[22]. Il semble qu'à Ancyre les païens aient été moins tièdes que nous ne les avons vus à Pessinonte, ou que la restauration de l'idolâtrie par Julien ait plus vite réveillé en eux le fanatisme. On le voit par le rôle qu'ils jouèrent dans le procès instruit, pendant les premiers mois de 362, contre un prêtre catholique, nommé Basile, que depuis longtemps son zèle pour l'orthodoxie avait mis en évidence. Basile, écrit l'historien
Sozomène, était un intrépide défenseur de la foi
chrétienne. A l'époque où Constance monta sur le trône, il avait déjà résisté
courageusement aux ariens[23]. Pour ce motif, les sectateurs d'Eudoxe lui interdirent de
tenir des assemblées religieuses[24]. Quand Julien fut devenu seul maitre de l'Empire, Basile
parcourut toute la contrée, exhortant en public et en particulier les
chrétiens à demeurer fermement attachés à leur doctrine, et à, éviter la
souillure des sacrifices et des libations des gentils. Il les pressait de
refuser les honneurs que l'empereur leur offrait, et leur disait que ces
faveurs passagères seraient punies de la mort éternelle. Ces occupations
l'avaient rendu suspect et odieux aux païens. Un jour qu'il voyait ceux-ci
offrir publiquement un sacrifice, il s'arrêta, et, gémissant tout haut, pria
Dieu de préserver les chrétiens de tomber dans ces erreurs. Arrêté pour ce
fait, il fut déféré au gouverneur de la province. Ayant, pendant le procès,
souffert de nombreux tourments, il consomma intrépidement son martyre[25]. Les Grecs, suivis par le martyrologe romain, marquent au 22 mars la fête de Basile, ce qui semblerait placer ce martyre environ deux mois et demi avant le voyage de Julien à Ancyre. La Passion du saint[26], pièce intéressante[27], mais qui passerait difficilement pour une relation tout à fait originale et contemporaine, dit au contraire qu'il mourut le 28 juin[28]. Elle fait comparaître Basile devant Julien lui-même. On vient de voir, par ce qui s'était passé à Pessinonte, que Julien ne dédaignait pas d'interroger en personne les chrétiens, et même de présider à leurs tortures. Rien ne rend invraisemblable en soi l'assertion des Actes : si on l'admet, il faudra considérer la date du 22 mars soit comme celle de l'arrestation de Basile et du commencement de son procès, soit comme celle de quelque translation de reliques[29]. Sur un point, le récit des Actes concorde avec celui de Sozomène. Ils disent que le supplice du saint fut ordonné par un magistrat, après que le prince eut quitté Ancyre. L'historien rapporte, de même, que le martyre de Basile eut lieu en dehors de tout jugement de l'empereur[30]. Cela même est très vraisemblable. Le départ de Julien avant la fin du procès semble un trait pris sur nature. Julien (on aura plus d'une fois occasion de le montrer) évitait avec un grand soin de faire des martyrs. Il laissait facilement prononcer contre les chrétiens des sentences de mort, et avait des excuses prêtes pour les magistrats qui auraient en ceci excédé leurs pouvoirs : mais, personnellement, il s'abstenait. Quelle que soit, d'ailleurs, la date du procès, et que Julien ait été ou non à Ancyre au moment où il fut instruit, une chose, dans tous les cas, reste certaine : le martyre lui-même, sans autre motif que les efforts de Basile pour détourner du culte idolâtrique les chrétiens d'Ancyre. On ne lui reprocha pas, comme aux jeunes gens de Pessinonte, d'avoir commis une violence matérielle, mais seulement d'avoir usé de son influence morale pour empêcher les apostasiés. C'est pendant son séjour à Ancyre que Julien commença, par une loi du 17 juin[31], — connue le 29 juillet en Occident[32], — de réformer selon ses idées l'enseignement public. Avant d'étudier cette réforme, qui eut un si grand retentissement et produisit si peu d'effet, il est nécessaire de dire quel avait été jusque-là le régime de l'enseignement dans le monde romain. II. — La liberté de renseignement dans le monde romain. La liberté de l'enseignement fut entière dans le monde romain jusqu'en 362. En Grèce, où toute l'organisation sociale reposait sur la cité, l'éducation des enfants était minutieusement réglée par la loi, et surveillée de très près par les magistrats. A Rome, où la famille fut, à l'origine, beaucoup plus puissante, et où le pouvoir du magistrat s'effaçait devant celui du père, les choses se passèrent tout autrement. Pendant la période républicaine, nul ne songea à mettre une limite soit au droit du père de famille sur l'éducation de ses enfants, soit même au droit de l'instituteur sur l'ordre et les matières de son enseignement. Chez nous, dit Cicéron, l'éducation n'est ni réglée par les lois, ni publique, ni commune, ni uniforme pour tous[33]. Une seule fois, avant le moment où le grand orateur parlait ainsi, les censeurs avaient montré quelque velléité d'intervenir dans une question d'enseignement : ce fut quand s'établirent à Rouie les premières chaires de rhétorique. La vieille moralité romaine s'effrayait à la pensée que, pour imiter les Grecs, des Latins enseigneraient à traiter la parole comme un art[34]. Mais la résistance à cette innovation dura peu. Vraie pour son temps, la phrase que nous avons citée de Cicéron restera vraie pour les temps qui suivront. Malgré ses accès de despotisme, la jalousie de ses princes pour tout ce qui touchait à leur autorité, la facilité avec laquelle ils imaginaient des complots et accablaient la pensée libre sous l'accusation de lèse-majesté, l'Empire lui-même n'essaya pas de mettre la main sur l'enseignement. Quand il se crut appelé à organiser, dans une mesure encore fort discrète, une éducation publique, il se garda bien de la rendre uniforme par des règlements, et surtout de lui sacrifier l'éducation privée. Celle-ci demeura libre à tous les degrés et sous toutes les formes. L'État romain, qui légiférait sur tout, n'eut pas l'idée de faire entrer dans le cercle de sa législation ce domaine réservé. Même quand il se montra le moins libéral, il respecta cette liberté. L'éducation complète, telle que les siècles, non les lois, l'avaient faite, comprenait à Rome, comme chez nous, trois degrés. Naturellement, beaucoup de Romains s'arrêtaient au premier. D'autres ne cherchaient pas à atteindre le troisième. Les privilégiés seuls traversaient tour à tour les enseignements primaire, secondaire et supérieur, et passaient successivement par l'école des commençants, par la classe du grammairien et par la salle de conférences du rhéteur. Dès les premiers temps de la République, on voit ouvertes les petites écoles, ordinairement communes aux deux sexes : c'est en se rendant à une école du Forum que Virginie subit l'outrage qui amena la chute des décemvirs. Les villes de province possédaient aussi leurs écoles : nous savons par Horace, par Martial, par Prudence, comme par une peinture de Pompéi, que le magister avait quelquefois la main assez dure. Quant aux grammairiens, ou professeurs de l'enseignement secondaire, on a sur eux, grâce à Suétone et à Quintilien, d'assez nombreux détails : on sait même combien les plus en vogue pouvaient gagner par an, et l'on voit que pour certains d'entre eux l'enseignement des lettres était, au temps de l'Empire romain, un métier fort lucratif. Nous sommes assez bien renseignés aussi sur le programme des études, et nous pouvons, sans un trop grand effort d'imagination, nous donner le plaisir de suivre en classe les élèves[35]. Ajoutons que l'internat était alors chose inconnue, et que c'étaient des externes qui partaient le matin de la maison paternelle pour aller s'asseoir dans la salle où professait le grammairien. Quant à la rhétorique[36], le complément ou, mieux encore, le couronnement de l'éducation romaine, elle était devenue l'étude nécessaire des jeunes gens qui se destinaient aux luttes de la vie publique ou à celles du barreau. Le grammairien les avait initiés à toute la culture classique : connaissance approfondie des deux langues que parlaient alors les nations civilisées, imitation des grands modèles littéraires, lecture des historiens et des poètes, et leur avait appris à développer leurs idées par des compositions écrites. Si l'on ajoute que le grammairien leur avait enseigné en même temps la musique et la géométrie, on conviendra que, malgré les lacunes que ce programme laisse apercevoir à des yeux modernes, il méritait, comme celui de notre baccalauréat, la qualification d'encyclopédique que lui donne Quintilien. La tête ainsi bourrée de connaissances, les étudiants passaient au cours du rhéteur. Celui-ci leur apprenait à mettre toute cette science en pratique, à parler leur pensée, à soutenir des thèses, à débattre des causes imaginaires. Par Suétone, qui a fait la1biographie de quelques rhéteurs célèbres ; par Quintilien, qui nous a laissé la théorie de leur enseignement ; par Sénèque, qui a recueilli des modèles des déclamations auxquelles s'exerçaient leurs élèves, nous connaissons assez bien ces parlottes où, sous l'œil et avec les avis d'un mettre expérimenté, les jeunes Romains de bonne famille apprenaient à manier l'arme de l'éloquence[37], et d'où ils sortaient préparés à tous les combats de la parole publique, capables de haranguer une assemblée populaire, de plaider un procès, d'opiner dans un tribunal, de discuter dans un sénat. Pour tout dire, il convient d'ajouter que beaucoup d'eux, rompus à toutes les souplesses de l'éloquence, emportaient de cet enseignement supérieur l'art de soutenir avec un égal talent, mais aussi avec une égale indifférence, le pour et le contre, et de mettre leur scepticisme au service de leur ambition. L'État romain ne parut prendre un intérêt direct au haut enseignement qu'à l'heure où, les grandes luttes politiques ayant cessé, la parole publique, jadis arme de guerre, ne fut plus qu'un ornement, à peine une épée de parade. C'est sous les premiers Flaviens, puis sous les Antonins, que l'on commence à voir des professeurs dotés aux frais du trésor public. Vespasien, le premier, accorda aux rhéteurs, sur les fonds de l'État, un salaire annuel de 100.000 sesterces (25.000 francs)[38]. Hadrien, Antonin, Marc Aurèle établirent aussi des chaires de rhétorique et de philosophie dans les provinces. A leur exemple, les villes fondèrent et dotèrent des chaires de toute sorte, grammaire, droit, médecine. Les empereurs aidèrent ce mouvement, en accordant aux professeurs l'exemption de toute charge publique, impôts, tutelle, service militaire, logement des soldats. Alors s'établirent, sans contrôle de l'État, mais favorisés par lui, ces groupements de maîtres de toute sorte qui, en beaucoup de cités, formaient l'équivalent d'une ou de plusieurs de nos Facultés, en quelques autres ressemblaient déjà aux grandes Universités de notre temps, ou mieux encore à celles du moyen tige. Les détails que Libanius et saint Grégoire de Nazianze donnent sur l'Athènes du quatrième siècle, avec ses étudiants divisés par nations, leurs habitudes turbulentes, leurs fêtes, leurs plaisanteries, leur goût de l'argumentation et de la dispute, les rivalités des professeurs, les coutumes et les mœurs des élèves, font songer au Paris universitaire de Robert Sorbon ou de saint Louis, à la Montagne Sainte-Geneviève du treizième siècle encore plus qu'au moderne Quartier Latin. Si nous avons moins de détails sur les autres Universités de l'Empire romain, sur Antioche ou Alexandrie, sur Césarée de Palestine ou Césarée de Cappadoce, sur Constantinople, sur Rome même, Bordeaux, Autun, Trèves, Carthage ou Sagaste, nous en savons assez, cependant, pour reconnaître qu'elles se rapprochaient beaucoup de ce tableau. Quelques-unes avaient leur spécialité propre : dans Athènes, c'étaient les philosophes et les sophistes qui dominaient, bien que toutes les sciences y fussent enseignées, et que même un étudiant voué avant tout aux lettres, comme saint Basile, y pût, nous dit-on, prendre aussi quelque connaissance de la médecine : cependant celle-ci et, avec elle, les sciences mathématiques et naturelles étaient mieux représentées à Alexandrie, et quand Césaire, le frère de saint Grégoire de Nazianze, voulut les étudier, il quitta Césarée de Palestine, où l'on enseignait surtout la littérature, pour aller s'établir dans la métropole égyptienne, qui était le principal foyer des connaissances scientifiques. Mais si l'on voulait, en Orient, approfondir le droit, c'était dans la ville toute juridique de Beyrouth qu'il fallait aller de préférence[39]. En Gaule, les rhéteurs de Bordeaux étaient célèbres, et par leur influence, par les générations d'étudiants qu'ils avaient formées, la pureté de la langue et jusqu'à l'élégance des manières et des costumes se conservèrent longtemps dans toute l'Aquitaine[40]. Avec eux rivalisaient les professeurs d'Autun : les panégyriques prononcés par ceux-ci, à diverses époques du quatrième siècle, gardent la tradition du bon latin, et diffèrent très sensiblement de la langue décadente que l'on écrivait ou que l'on parlait alors : ajoutons que le palais universitaire d'Autun, entouré de portiques sous lesquels était peinte la carte en couleurs de l'Empire romain, devait avoir grand air : et si l'on doit juger de l'importance des fonctions par celle du traitement, le recteur, qui touchait 600.000 sesterces (120.000 francs) par an, devait être un très gros personnage[41]. Il y eut donc, à partir du second siècle, ou même des dernières années du premier, un haut enseignement officiel. Mais il ne gêna en rien les mouvements de l'enseignement libre. En face des écoles fondées par l'État ou par les villes, ouvrait qui voulait une école de rhétorique, de philosophie ou de grammaire. La concurrence était parfois très vive, et ne tournait pas toujours à l'avantage des professeurs officiels. Vers l'âge de vingt-cinq ou vingt-six ans, Libanius, qui devait devenir un des plus célèbres rhéteurs du quatrième siècle, avait ambitionné une des chaires que l'État entretenait à Constantinople, et dont le titulaire était nommé par l'empereur. Un autre candidat lui fut préféré. Résolument, Libanius ouvrit un cours libre de rhétorique. Les auditeurs affluèrent. On désertait pour l'entendre les spectacles et les courses. Au bout d'un mois, il eut quatre-vingts élèves, tandis que l'école de son rival demeurait vide. Lui, c'est l'empereur qui le nourrit, disait-il ; moi, ce sont les pères de mes élèves qui me font vivre[42]. Les autorités de Constantinople ne voulurent pas en avoir le démenti. On destitua le professeur maladroit, et on le remplaça par un rhéteur de grand renom. Libanius le défia à une sorte de joute oratoire, et s'y montra tellement supérieur à ce nouveau rival que la foule siffla l'élu des pouvoirs publics et porta en triomphe le représentant de l'enseignement libre. Plus d'une fois, sans doute, les privat-docent durent ainsi battre les maîtres de l'enseignement officiel ; du moins, aucune loi ne s'opposait à ce qu'ils les battissent. Point ne leur était besoin d'autorisation pour dresser une chaire en face de celle qu'entretenait l'État ou la municipalité, et la faveur publique restait seule juge, en dernier ressort, du mérite des concurrents. Même les divisions religieuses n'apportèrent aucun obstacle à la liberté de l'enseignement. On se tromperait fort si l'on croyait que, pendant les trois siècles qui précédèrent le triomphe du christianisme dans l'Empire, les fidèles furent privés du droit ou des moyens d'enseigner. Quand un édit de persécution était promulgué, les professeurs chrétiens étaient sans doute exposés aux poursuites, comme la masse des adorateurs du Christ ; mais jamais une des lois dirigées contre la foi chrétienne ne contint, à l'adresse de ses adhérents, l'interdiction de tenir école. Pendant les années (fort nombreuses) où les chrétiens jouirent d'une paix au moins relative, la carrière de l'enseignement, soit public, soit libre, leur resta ouverte. On tonnait parmi eux des instituteurs primaires, comme ce magister primus dont M. de Rossi a découvert l'épitaphe dans la catacombe de saint Calliste, ou ce maitre d'école qui fut martyrisé à Imola par ses élèves à la suite d'un édit de persécution, mais qui jusque-là avait professé en toute liberté, et même avec une sévérité dont ses jeunes auditeurs tirèrent une cruelle vengeance[43]. Des fidèles furent aussi parmi les maîtres de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. On trouve chez nous, écrit au troisième siècle le rhéteur converti Arnobe, beaucoup d'hommes de talent, des orateurs, des grammairiens, des professeurs d'éloquence, des jurisconsultes, des philosophes[44]. Les chrétiens possédèrent même, deux siècles avant Constantin, des établissements libres d'enseignement supérieur : telle fut l'école d'Alexandrie, fondée par Pantène et illustrée par Clément. Sur ses bancs s'asseyaient non seulement des adeptes de la nouvelle foi, mais encore des philosophes païens, et même de grandes dames : c'était, à proprement parler, une école des hautes études religieuses. Le plus célèbre de ses maîtres, Origène, eut de nobles personnages pour disciples, fut en correspondance avec des gouverneurs de province, des impératrices, et aux yeux de tous, aussi bien hors de l'Église que dans l'Église, compta parmi les plus grandes forces intellectuelles de son temps. Si le paganisme militant ne chercha pas à éteindre, aux mains des chrétiens, le flambeau de la science, le christianisme triomphant n'essaya pas davantage de restreindre, au préjudice des païens, la liberté de l'enseignement. Les représentants les plus autorisés de l'Église firent toujours preuve, à cet égard, d'une grande largeur d'esprit. On voit en Osrhoène, à la fin du troisième siècle, un évêque prendre comme juges, dans une conférence publique avec un hérésiarque, quatre professeurs païens[45]. Ni Constantin ni Constance ne se montrèrent plus intolérants. Sous leur règne, les païens Jamblique, Eustathe, Edesius, enseignent librement à Éphèse ou à Pergame les doctrines du néoplatonisme. Les deux frères du néoplatonicien Maxime, Claudien et Nymphidien, professent, l'un, la philosophie à Alexandrie, l'autre, la rhétorique à Smyrne. Aminus, le père du sophiste païen Himère, est rhéteur en Bithynie ; Himère suit la même carrière en Attique et en Béotie. Les deux Patera, descendants d'une famille de druides, et gardant comme un titre de noblesse les traditions du paganisme national, professent successivement la rhétorique à Bordeaux. Le célèbre sophiste Themistius jouit de la faveur de Constance, dont il prononce deux fois le panégyrique, et qui, après l'avoir nommé sénateur de Constantinople, lui fait ériger une statue à Rome. Libanius, païen déclaré, poursuit, à Nicomédie, la brillante carrière commencée à Constantinople, et est même rappelé dans cette ville par un ordre de l'empereur pour y continuer son enseignement. Le Code Théodosien contient une loi rendue par Constantin en 321, qui punit très sévèrement quiconque injurie ou moleste les médecins, grammairiens ou professeurs[46] ; son savant commentateur, Godefroy, suppose que Constantin les veut protéger contre la mauvaise humeur des habitants qui, dans certaines villes, surtout en Orient, où le christianisme était devenu dominant, voyaient d'un œil peu bienveillant cette classe d'hommes, composée presque partout de païens obstinés. Sous les premiers empereurs chrétiens, dit M. de Rossi, les professeurs de l'art oratoire étaient très attachés au paganisme, dont ils enseignaient la brillante littérature. Quand le rhéteur Marius Victorinus, vers le milieu du quatrième siècle, se présenta à l'église chrétienne et monta dans la chaire, comme devaient le faire les catéchumènes, pour y réciter le symbole de la foi et y faire profession de christianisme, les fidèles ne pouvaient en croire leurs yeux ni leurs oreilles, tant étaient grands l'étonnement et la joie à la vue d'une conversion si rare et d'un courage qui semblait héroïque. Les plus puissants des patriciens et du sénat romain, passionnés eux-mêmes pour le paganisme, en conservaient avec grand soin l'enseignement dans les chaires des rhéteurs païens. Cela dura tout le quatrième siècle[47]. III. — La législation scolaire de Julien. Tel était le régime vraiment libéral sous lequel avait vécu et s'était développé l'enseignement dans le monde romain, depuis les plus lointaines origines jusqu'au milieu du quatrième siècle. A ce moment, la guerre contre l'Église a depuis longtemps cessé. Deux générations de princes chrétiens ont déjà occupé le trône des Césars. Les religions, autrefois ennemies, maintenant rivales, comptent un nombre à peu près égal de sectateurs. Qu'un tour de roue de la Fortune rendit pour un temps le pouvoir à un prince païen, son intérêt, l'intérêt de la cause qui avait ses préférences, devait être de maintenir cette trêve, en gardant aux représentants lettrés des deux cultes l'aiguillon d'une salutaire concurrence. La conduite tenue par Constantin, malgré l'enivrement de la victoire, et par Constance, en dépit de l'ardeur de ses sentiments religieux, traçait d'avance à leur successeur Julien la voie large et simple dans laquelle il était appelé à marcher. Mais, quand son fanatisme le sollicitait, Julien était incapable de s'arrêter à ces solutions mitoyennes dont se contente la sagesse politique. Aucune réforme, si radicale qu'elle fût, ne lui semblait inopportune ou imprudente. Il faisait naître, au besoin, des problèmes que ses devanciers n'avaient point connus. Ainsi agit-il pour la question de l'enseignement. Rien ne l'obligeait à y prendre un rôle quelconque. S'il y eut même une question de l'enseignement, c'est Julien qui l'inventa[48]. Et s'il la posa seul, sans aucune indication reçue de l'opinion publique, sans que rien ni personne demandât qu'elle tilt posée, et contrairement à toutes les traditions et à toutes les coutumes, ce fut pour obéir à ses haines intellectuelles, à sa passion de sectaire. Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire la loi du 17 juin, qui prépara ses réformes, et l'édit qui, en les consommant, dévoila complètement ses intentions. La loi est, à première vue, d'apparence assez anodine.
Elle a pour objet de régler l'état et la nomination des professeurs publics
qui occuperont les chaires fondées dans les principales villes de l'Empire. Il importe, dit-elle, que
ceux qui se vouent à l'enseignement excellent par les mœurs d'abord, et
ensuite par l'éloquence. Mais, parce que je ne puis être présent à la fois
dans toutes les villes, j'ordonne que quiconque veut enseigner ne s'élance
pas subitement et sans garantie à cet emploi, mais, après en avoir été jugé
digne par l'ordre des curiales, l'obtienne en vertu de leur décret, et du
consentement unanime des meilleurs. Car ce décret me sera transmis pour être
examiné, afin que, revêtus d'un plus grand honneur, ils dirigent, en vertu de
notre jugement, les études des cités[49]. Sous ces termes modérés se cache une inquiétante innovation. Jusqu'à la loi du 17 juin 362, les villes étaient maitresses de la nomination aux chaires fondées par elles, et peut-être même aux chaires rétribuées par l'État. Elles pouvaient y appeler ceux de leurs concitoyens ou même des étrangers qu'elles en jugeaient dignes, et qui leur paraissaient le plus capables d'enseigner avec profit et avec éclat. C'est ainsi que saint Basile, à son retour de l'université d'Athènes, fut nommé par ses compatriotes de Césarée à une chaire de rhétorique, et que, jaloux de l'attirer de la Cappadoce dans le Pont, les habitants de Néocésarée lui envoyèrent une députation, composée des premiers de la cité, pour lui offrir chez eux une autre chaire, qu'il refusa[50]. Par la première partie de sa loi, Julien semble confirmer les précédents, en donnant le choix des professeurs à l'ordo de chaque cité, c'est-à-dire à l'assemblée des curiales et des magistrats. Mais, dans la seconde partie de la loi, il réduit ce droit de nomination directe à un simple droit de présentation. Le décret émané des premiers de la ville devra lui être soumis, et ne deviendra valable qu'après avoir été revêtu de son approbation. Ce décret pourra, par conséquent, être rejeté par l'empereur, si les candidats qui s'y trouvent désignés ne sont point agréables à ses yeux. Il est permis de croire que, à la date et dans les circonstances où la loi fut rédigée, cela voulait dire que des professeurs pratiquant la religion de Julien, et en faisant la base de leur enseignement, seraient seuls acceptés par lui. Cependant, si le but de la loi était d'attribuer en fait aux païens le monopole de l'instruction publique, elle ne suffisait pas à l'atteindre. Car, d'une part, elle statuait seulement sur les nominations à venir, et laissait en possession de leurs chaires les professeurs anciennement nommés ; d'autre part, elle ne touchait pas aux professeurs libres, et l'on a vu, par l'exemple de Libanius, que ceux-ci pouvaient quelquefois, par leur talent, conquérir une situation supérieure à celle des maîtres officiels. Il restait à faire un pas en avant, plus net et plus hardi : Julien l'accomplit par l'édit qui porte le numéro 42 dans le recueil de ses lettres[51]. La lecture de ce singulier monument législatif est curieuse, et ne laissera pas de surprendre les jurisconsultes habitués au langage impersonnel de nos lois, ou les savants familiers avec l'impérieuse brièveté des anciens textes, sénatus-consultes, rescrits, statuts municipaux, que les Codes romains ou les recueils d'inscriptions nous ont conservés. Même les constitutions impériales rendues au sujet des chrétiens dans les moments de persécution religieuse gardent le même style rapide et clair : qu'on lise, à titre d'exemple, le rescrit de Trajan à Pline, ou même celui d'Hadrien à Minucius Fundanus. Ce beau langage juridique s'est altéré dès la première moitié du quatrième siècle. Certaines lois de Constantin et de Constance, surtout parmi celles qui touchent aux matières religieuses, ont déjà l'allure de proclamations ou de manifestes. Cependant, même alors, toute tradition de l'ancien style n'a pas disparu. Elle ne s'obscurcit complètement que sous la plume impatiente et brouillonne de Julien, dont les défauts naturels sont peut-être encore aggravés par la collaboration indiscrète de Maxime et de ses autres inspirateurs néoplatoniciens[52]. Que l'on compare l'édit de Milan, accordant en 313 la liberté des cultes, à celui par lequel Julien supprime, cinquante ans plus tard, la liberté de l'enseignement, on reconnaîtra que, dans le premier, la gravité du langage reste digne des idées généreuses qu'il traduit, tandis que, dans le second, l'abaissement du style correspond au trouble des pensées et à l'abaissement de l'idéal. Au milieu d'un déluge de phrases qui contiennent,
confondus, l'exposé des motifs et le dispositif de ce singulier édit, il en
est une qui se détache de l'ensemble parce qu'en elle se résume toute la
pensée de Julien. Tous ceux, dit-il, qui font profession d'enseigner, devront désormais avoir
l'âme imbue des seules doctrines qui sont conformes à l'esprit public.
C'est une de ces formules élastiques et vagues qui se prêtent à toutes les
tyrannies. L'esprit public, pour Julien,
c'est la croyance aux divinités du paganisme, c'est le culte païen, ce sont
les mœurs païennes. L'esprit public, c'est la
haine du christianisme. L'esprit public, c'est
l'apostasie de l'empereur. L'esprit public, c'est
l'esprit particulier de son gouvernement. Et c'est à cet esprit public qu'une aveugle intolérance
s'efforcera d'amener, par un mélange de violence et de ruse, les générations
nouvelles, bien que, dans l'Empire romain, à cette heure partagé entre deux
cultes, la moitié au moins des pères de famille soient chrétiens,
c'est-à-dire repoussent pour eux-mêmes et pour leurs enfants l'esprit public de Julien, veulent, pour eux-mêmes et
pour leurs enfants, le contraire de ce qui est pour Julien l'esprit public. Telle est la théorie que Julien substitue au principe libéral à l'abri duquel, sous tous les régimes politiques et au milieu de toutes les divergences d'opinions et de croyances, s'était jusqu'à ce jour développé sans entraves l'enseignement dans le monde romain. Mais au service de la théorie, il faut maintenant mettre les moyens. C'est ici que l'hypocrisie sectaire parait dans tout son lustre. Le fond de l'enseignement classique, à l'école du grammairien, — enseignement secondaire, — comme à celle du rhéteur ou du sophiste, — enseignement supérieur, — consistait dans l'étude ou l'imitation des poètes, des orateurs et des historiens de l'antiquité. Ces poètes, ces orateurs et ces historiens, ayant vécu avant l'ère chrétienne, ou au moins avant le temps de la grande diffusion du christianisme, étaient tous des païens. Les uns, comme Homère, Hésiode ou Virgile, mettaient sans cesse en scène les dieux. Les autres, comme Hérodote ou Thucydide, comme Démosthène, Isocrate ou Lysias, comme Cicéron, Tite-Live ou Tacite, croyaient au moins en ces dieux et y voyaient les inspirateurs des actions humaines[53]. Pour commenter leurs poèmes, leurs histoires ou leurs plaidoyers, il faut, déclare Julien, partager leurs croyances[54]. Faire admirer les beautés païennes de ces grands écrivains, quand on accuse d'erreur ou d'impiété leurs doctrines, c'est pécher contre la logique, contre les convenances, et même contre la probité professionnelle. C'est enseigner le contraire de ce qu'on pense, c'est tenir école de ce qu'on croit mauvais, c'est imiter le marchand sans honneur et sans conscience, c'est vivre des écrits d'auteurs dont on repousse les opinions, c'est faire preuve de la plus sordide avarice et se déclarer prêt à tout endurer pour quelques drachmes. Le sophisme est ici trop visible. Un professeur peut très honnêtement commenter Homère, l'admirer et le faire admirer à ses élèves sans croire aux dieux d'Homère. A plus forte raison peut-il montrer aux futurs orateurs la dialectique, l'élégance nerveuse, le sobre pathétique des discours de Démosthène, ou, par l'étude de Thucydide, apprendre aux futurs historiens l'art de la composition et du récit, sans qu'il ait besoin, pour le faire avec fruit, de partager les croyances des contemporains de Démosthène ou de Thucydide. Même l'étude de la philosophie, dont Julien ne parle pas, peut être utilement entreprise sous la direction de maîtres qui réservent la liberté de leur pensée personnelle, puisque aussi bien il n'est pas, dans l'antiquité, deux philosophes professant la même philosophie, et que, s'il y eut des païens philosophes, il n'y eut pas de philosophie païenne. Le raisonnement de Julien n'a pas besoin d'être réfuté : il ne tient pas debout. Lui-même, évidemment, ne le prend pas au sérieux, bien qu'il le développe avec la stérile abondance dont il est coutumier. L'important est la conclusion à laquelle il arrive et le dispositif qui en ressort. Je laisse, dit-il, le choix aux maîtres, ou de ne pas enseigner ce qu'ils ne croient pas bon, ou, s'ils veulent continuer leurs leçons, de commencer par se convaincre réellement eux-mêmes, et ensuite d'enseigner à leurs disciples, que ni Homère, ni Hésiode, ni aucun des auteurs qu'ils expliquent et qu'ils accusent d'impiété ne se trompent au sujet des dieux. La phrase est obscure et ambiguë, comme presque tout ce qu'écrit Julien ; mais son contemporain et son coreligionnaire, l'historien Ammien Marcellin, qui fut l'ami de Julien et le compagnon de ses campagnes, la traduit avec une précision toute militaire : Il interdit l'enseignement de la grammaire et de la rhétorique aux maîtres chrétiens, à moins qu'ils ne se convertissent au culte des dieux[55]. Plus de professeurs, ni publics, ni libres, sans un billet de confession païenne. On connaîtrait mal le législateur sectaire du quatrième siècle, — et le législateur sectaire de tous les temps, — si l'on n'ajoutait tout de suite que ce monument d'intolérance se termine par le couplet habituel en l'honneur de la liberté. Si les maîtres païens ont désormais seuls le droit de donner l'enseignement classique, tout jeune homme qui voudra suivre leurs leçons n'en sera pas empêché. Mais personne n'y sera contraint. Les chrétiens demeureront libres de s'abstenir. Peut-être serait-il juste de les guérir malgré eux, comme on fait pour les frénétiques, mais nous leur accordons à tous la permission de rester malades. Il subsiste donc encore, pour les étudiants chrétiens, une ombre de liberté. D'une part, on ne les force pas d'aller aux écoles païennes ; d'autre part, on ne leur en ferme pas l'entrée. Mais cette ombre de liberté leur fut presque aussitôt enlevée, si l'on en croit les écrivains ecclésiastiques. Ceux-ci laissent entendre, en effet, qu'un second édit de Julien vint corriger et compléter le premier en l'aggravant. Saint Augustin dit que Julien fit défense aux chrétiens d'apprendre et d'enseigner les lettres humaines[56] : docere semble ici faire allusion au premier édit, dont nous avons encore le texte, et discere à un second, dont le texte serait perdu. Rufin, de qui la jeunesse fut contemporaine des mesures prises par Julien au sujet de l'enseignement, dit aussi que ce prince interdit aux chrétiens l'étude des belles-lettres[57]. Ainsi s'exprime également Sozomène[58]. Socrate est encore plus explicite : Julien, dit-il, défendit aux chrétiens par une loi de fréquenter les écoles, de peur, selon son expression, que, s'ils aiguisaient leurs langues, ils ne répondissent plus facilement à la dialectique des païens[59]. On est tenté de voir, avec MM. Bidez et Cumont, dans ces paroles un lambeau d'un second édit sur l'enseignement[60]. Un autre lambeau de ce document perdu se retrouve peut-être dans une phrase citée par saint Grégoire de Nazianze critiquant les réformes scolaires de Julien. Notre langue est à nous, écrit l'empereur, et c'est à nous qu'il appartient de parler grec, comme il nous appartient de vénérer les dieux ; mais il vous convient de demeurer dans votre état stupide et rustique, vous dont toute la sagesse se résume en ce seul mot : Crois[61]. Cette phrase ne se rencontre pas plus que celle de Sozomène dans l'édit venu jusqu'à nous : elle semble impliquer, pour ceux qui s'obstinent à demeurer chrétiens, une défense de sortir de leur état stupide et rustique, c'est-à-dire une défense d'étudier les lettres : elle autorise à penser qu'il existe un second édit, formulant cette défense, qui n'était pas contenue dans le premier. C'est bien l'opinion de Tillemont. Il n'y a rien, dit-il, de plus célèbre dans toute la persécution de Julien que la défense qu'il fit aux chrétiens, par une loi expresse, dès le commencement de son règne, d'apprendre les lettres humaines et d'étudier les auteurs païens, ne voulant qu'on reçût dans les collèges que ceux qui adoreraient les idoles. Cette loi suivit apparemment celle qu'il publia pour défendre aux chrétiens d'enseigner[62]. Cependant, toute probable que soit cette opinion, elle n'est pas absolument évidente. D'édits de Julien sur la situation des chrétiens vis-à-vis de l'enseignement public, on en connaît un seul, celui qui, dans le recueil de ses lettres, porte le numéro 42 : il est vraisemblable que les deux fragments rapportés par saint Grégoire et par Sozomène proviennent d'un second édit sur la même matière : mais on pourrait, à la rigueur, admettre aussi qu'ils viennent de quelque autre pièce. Du reste, la non-conservation, dans le recueil des actes et des lettres de Julien, du second édit ne prouve pas non plus contre son existence, car ce recueil nous est venu avec un tel désordre et de telles lacunes, qu'on ne peut rien conclure de sa teneur présente. Ce qui semblera plus grave, c'est qu'Ammien Marcellin parait connaître seulement le premier édit. Au moins ne fait-il mention que de la défense d'enseigner. Bien que cet argument négatif n'ait pas une très grande valeur, étant donné le vague où se tient ordinairement Ammien dans tout ce qui n'est point récits militaires, cependant le manque, sous sa plume, de toute allusion à un édit relatif non plus aux maîtres, mais aux élèves chrétiens, peut laisser quelque doute sur l'existence de celui-ci. On se demande alors si les écrivains religieux, qui ont fait allusion à une défense pour les chrétiens de fréquenter les écoles d'enseignement classique, n'ont point employé des termes généraux, exacts non quant au fait lui-même, mais seulement quant à ses conséquences. L'édit sur les maîtres pouvait en effet, même s'il ne devait pas être complété par un autre, suffire à écarter de l'enseignement classique les chrétiens attachés à leur foi. C'était une arme à deux tranchants. Ou la majorité des pères de famille chrétiens s'abstiendrait dorénavant d'envoyer ses enfants aux écoles de grammaire et de rhétorique, les priverait, par conséquent, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, et les condamnerait à l'infériorité intellectuelle, ou les jeunes chrétiens continueraient à demander à l'enseignement public la connaissance des lettres humaines ; mais, privés désormais de s'adresser à des maîtres professant leur religion, ils seraient condamnés à n'entendre que des leçons où les auteurs païens seraient expliqués sans correctif, ou même dans un but avoué de propagande. Après une ou deux générations, une partie de la jeunesse chrétienne serait retournée au paganisme, une autre partie aurait volontairement renoncé aux hautes études, serait devenue incapable de répandre ou de défendre des idées, et de prendre part aux affaires publiques. Les grands lettrés chrétiens du quatrième siècle, dont plusieurs avaient été les condisciples de Julien à l'université d'Athènes, et devaient à l'éducation qu'ils avaient reçue la variété de leurs connaissances, la perfection de leur style, la puissance de leur action oratoire, n'auraient pas de successeurs. La pensée chrétienne resterait enfermée à l'église, et serait privée désormais des moyens de rayonner sur le monde. Le premier édit de Julien aurait donc suffi à empêcher les chrétiens d'apprendre aussi bien que d'enseigner. En vertu de ses dispositions, les écoles de littérature classique devenaient des séminaires de paganisme. On n'y permettait plus un enseignement neutre, borné aux seules matières d'histoire ou de philologie. Le professeur qui voulait expliquer les auteurs classiques était tenu de le faire en adorateur des dieux. Des parents chrétiens ne pouvaient guère, désormais, envoyer, avec sécurité de conscience, leurs fils s'asseoir au pied de chaires d'où tombait un tel enseignement. Si l'on admet qu'il y eut un seul édit, on dira avec Gibbon : Les chrétiens eurent la défense directe d'enseigner ; ils eurent l'interdiction indirecte d'apprendre, puisqu'il leur devint moralement impossible de fréquenter les écoles païennes[63]. IV. — Les conséquences de la législation scolaire. On aimerait à connaître l'accueil fait par l'opinion publique à la législation scolaire de 362. Elle fut sans doute reçue avec enthousiasme par les païens à courte vue, qui croyaient à la durée de l'œuvre de Julien et s'associaient à son fanatisme. Répondant, vingt ans plus tard, à une requête présentée à Gratien par la portion païenne du sénat de Rome, saint Ambroise reproche aux pétitionnaires de solliciter des privilèges, eux qui naguère, par une loi de Julien, refusèrent aux chrétiens le droit, qui appartient à tous, de parler en public et d'enseigner[64]. Si l'on prend ces paroles à la lettre, elles montreraient que, même en Occident, l'acte de Julien avait été bien accueilli d'un grand nombre de sénateurs, et peut-être avait obtenu l'approbation officielle du sénat. Cependant, même parmi les partisans de l'ancien culte, une minorité intelligente parait avoir montré des sentiments contraires. Il y eut sans doute, dans la portion distinguée et vraiment politique de la société païenne, des hommes plus confus que satisfaits de se voir attribuer, en matière d'enseignement, un monopole qu'ils n'avaient pas demandé. L'un des représentants les plus honnêtes et les plus éclairés qu'ils aient eus à cette époque, Ammien Marcellin, si favorable cependant à Julien, n'essaie pas de cacher ses sentiments sur l'atteinte portée par celui-ci à la liberté d'enseigner. C'est, dit-il, un acte barbare, qu'il faut couvrir d'un éternel silence[65]. Sur la population chrétienne, l'effet de l'édit fut assez complexe. On doit le dire à leur honneur, un grand nombre de professeurs aimèrent mieux descendre de leurs chaires, soit officielles, soit libres, que d'abandonner leur religion. Saint Jean Chrysostome cite des médecins, des sophistes, des orateurs[66]. L'édit que nous avons analysé parle seulement des rhéteurs et des grammairiens : les médecins n'y sont point nommés. Mais la loi du 17 juin soumettait, on s'en souvient, à l'approbation de l'empereur toute élection à des chaires municipales. Dans beaucoup de villes, la médecine était enseignée[67]. Saint Basile, étudiant les lettres à l'université d'Athènes, y suivit aussi quelques cours de médecine[68]. Il se peut que Julien ait retiré l'autorisation à tous les professeurs de médecine qui refusaient de faire acte de paganisme : il se peut même qu'il ait enlevé aux médecins non professeurs, qui demeuraient chrétiens, les exemptions et les privilèges que les lois leur avaient accordés en même temps qu'aux membres de l'enseignement[69]. On ne sera pas surpris que Julien ait cherché à restaurer complètement dans la médecine l'idée païenne, lui qui croyait fermement à une thérapeutique surnaturelle, et attribuait à l'intervention directe d'Esculape la guérison d'un grand nombre de maladies. Parmi les professeurs de lettres, plus directement visés par l'édit, il y eut probablement des défections : quelques-uns suivirent sans doute l'exemple que, même sans attendre la nouvelle réforme, avait donné le sophiste Ecebole. Mais d'autres, qui étaient à la tète de l'enseignement public, sacrifièrent courageusement leur situation à leur foi. On cite parmi eux Victorinus, qui professait à Rome avec éclat[70], et Prohæresius, qui enseignait à Athènes[71]. Prohæresius avait été jadis appelé en Gaule, puis à Rome, par Constance : son savoir et son talent y avaient obtenu un tel succès qu'une statue lui fut élevée sur le Forum, avec cette inscription : Rome, reine du monde, au roi de l'éloquence[72]. Il avait ensuite occupé une chaire à Athènes, où probablement Julien fut un de ses élèves, en même temps que saint Basile et saint Grégoire de Nazianze. Dans une lettre de 361, Julien l'appelle l'homme aux discours abondants et rapides comme le fleuve dont le cours se répand dans les campagnes, le proclame rival de Périclès par l'éloquence, et l'invite à devenir son historiographe[73]. Après l'édit de 362, il rougit d'exclure de l'enseignement public un maitre de ce renom et de ce mérite, et lui fit offrir de garder sa chaire à l'université d'Athènes. Prohæresius ne voulut pas d'une faveur déshonorante, et refusa noblement de séparer son sort de celui des autres professeurs chrétiens[74]. La législation sur l'enseignement est un des faits révélateurs de la persécution de Julien. Elle en montre le caractère. Ce n'est pas, comme aux siècles précédents, la persécution violente et sanglante, bien que, en des circonstances exceptionnelles, et sous des prétextes divers, le sang chrétien y ait aussi coulé. C'est la persécution bénigne, insidieuse, qui n'attaque pas de front, mais emploie les moyens obliques. Elle travaille à semer les divisions, fait marché avec les consciences, les place entre l'intérêt et le devoir. Par une série de mesures, dont aucune n'est absolument illégale, mais qui, rassemblées, constituent la plus monstrueuse tyrannie, elle cherche à mettre peu à peu les chrétiens à l'écart de toutes les fonctions publiques, à leur ravir en détail leurs droits de citoyens, à les pousser doucement hors la cité, hors la loi. Elle affiche même la prétention de leur faire accepter cette déchéance comme un fait acquis, contre lequel il n'y a pas de recours. Une telle manière de procéder n'émeut pas l'opinion des indifférents ; elle ne donne aux victimes ni l'occasion de résister par la force (le nombre des chrétiens l'eût aisément permis au milieu du quatrième siècle), ni celle de confesser plus éloquemment leur foi en se laissant immoler pour le Christ. Son plus grand succès sera de faire des résignés, c'est-à-dire, si elle y parvient, des vaincus. La naïveté de certains chrétiens parut tendre à ce résultat. Dans leur haine de l'idolâtrie, ils s'applaudirent de voir Julien rendre difficile aux fidèles l'étude des classiques païens. Malsaine et pleine de périls, disaient-ils, est la culture grecque, fondée sur la pluralité des dieux[75]. Et ils ajoutaient que Julien, en fermant une source empoisonnée, avait accordé à l'Église le plus grand bienfait qu'elle pût attendre de lui. Quelques lettrés chrétiens acceptèrent trop facilement cette situation. Par une phrase de son édit, Julien, parlant des professeurs qui persisteraient à demeurer fidèles au Christ, les avait dédaigneusement renvoyés dans les églises des Galiléens interpréter Matthieu et Luc. Il y en eut qui se figurèrent qu'on pourrait demander aux Écritures Saintes la matière d'un enseignement non d'Église, mais d'école, en tirer une littérature à l'usage des chrétiens, mettre les Psaumes en odes pindariques, les livres de Moïse en hexamètres, l'Évangile en dialogues à la manière de Platon, composer même, dans le style d'Euripide et de Ménandre, des tragédies et des comédies sacrées, improviser, en un mot, toute une bibliothèque de classiques chrétiens pour remplacer ceux dont Julien voulait ôter l'usage aux fidèles. Cette tentative fut faite, dit-on, en collaboration par les deux Apollinaires, l'un, le père, ancien sophiste de Beyrouth, devenu prêtre à Laodicée, l'autre, le fils, lecteur de l'Église de cette ville, dont il fut ensuite évêque. Rien n'est resté des ouvrages qu'on leur attribue[76]. Mais le témoignage de Socrate et de Sozomène, quand même il ne serait pas de première main, rend difficile d'en contester l'existence. Le jugement des deux historiens sur le mérite littéraire de ces écrits est assez contradictoire. Sozomène dit que, par eux, les Apollinaires se sont rendus égaux aux plus renommés d'entre les Grecs[77]. Socrate dit, au contraire, que le souvenir de leurs œuvres s'effaça, aussitôt que les chrétiens, après la chute de Julien, eurent pu reprendre l'étude des classiques anciens[78]. Cela suppose que ces écrits, même s'ils eurent une vogue momentanée, étaient de peu de valeur. Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui. Les compositions littéraires des deux écrivains de Laodicée offrirent vraisemblablement les défauts de l'improvisation, joints à ceux du pastiche. Sozomène, qui les admire, dit qu'elles furent produites très rapidement[79]. Et il semble que les principales qualités littéraires des Apollinaires soient celles que saint Basile reconnaît à l'un d'eux, une extrême facilité et une abondance sans égale[80] Certes, l'idée que la poésie ne serait pas éternellement obligée de se couler dans le moule de la pensée antique, et, sans abandonner les formes, les mesures et les rythmes consacrés, trouverait un jour une source de pures inspirations dans les récits grandioses de l'Ancien Testament ou dans les touchants épisodes du Nouveau, ne manquait pas de justesse, et, en un certain sens, devançait l'avenir. Mais on ne pouvait, sans illusion, nourrir l'espoir de remplacer sur commande, par de froides imitations et de hâtives ébauches, les œuvres immortelles, fruit des plus beaux génies, où depuis plusieurs siècles toutes les générations lettrées avaient appris l'art de penser clairement et de bien dire. Il fallait, pour se croire capable d'en produire sans retard l'équivalent, ou beaucoup de naïveté ou beaucoup de présomption. On ne crée pas à volonté des modèles : on ne naît pas ancien : on ne s'improvise pas classique. Même en reconnaissant, avec l'historien Socrate, que les copies de tous les genres littéraires et de toutes les formes poétiques données par les Apollinaires purent être pendant quelques mois d'un utile secours aux professeurs chrétiens, dépossédés du droit de commenter à leurs élèves Homère ou Hésiode, cependant on ne peut que se réjouir, avec le même historien, du peu de temps que dura ce régime intérimaire, et de la rapidité avec laquelle les événements permirent aux jeunes générations chrétiennes de revenir à l'ancien système d'études. Sur ces questions, — qui rappellent par certains côtés la querelle des anciens et des modernes au dix-huitième siècle, ou mieux encore la question des classiques chrétiens, soulevée au milieu du siècle qui vient de finir, — Socrate a écrit des pages très remarquables. Il montre un réel sens historique dans la manière dont il répond aux esprits chagrins qui regrettaient que les écrits des Apollinaires n'aient point remplacé définitivement, dans l'éducation des jeunes chrétiens, les poètes et les prosateurs anciens que Julien avait voulu en bannir. Une telle pensée, si elle avait prévalu, n'eût abouti qu'à faire le jeu de Julien, qui n'avait rien tant à cœur que de voir les fidèles se détourner des sources éprouvées où les meilleurs apologistes de la religion avaient trempé leur style et assoupli leur dialectique. Jamais, dit-il, le Christ et ses apôtres n'ont rejeté comme dangereuse la sagesse antique. Beaucoup de philosophes approchèrent de la connaissance du vrai Dieu, combattirent efficacement la sophistique de leur temps, prouvèrent contre les épicuriens la providence divine. Tout ce que l'antiquité a de bon appartient de plein droit à la religion chrétienne, qui est la vérité totale. Même là où les anciens se trompent, ils fournissent à leurs adversaires des moyens de discussion, c'est-à-dire des armes pour combattre leurs erreurs. L'apôtre saint Paul était familier avec les classiques. Dans ses écrits ou dans ses discours, il cite Épiménide, Aratus, Euripide. Les plus célèbres docteurs de l'Église ont, depuis l'origine du christianisme, suivi la même tradition. On les a vus, jusque dans l'extrême vieillesse, cultiver la science des Grecs, et pour en reconnaître les points faibles, et pour entretenir en eux-mêmes, par une gymnastique continuelle, l'art de la parole et la vigueur du raisonnement[81]. Que cette argumentation de l'écrivain du cinquième siècle reproduisit avec exactitude l'état d'esprit de la portion saine et modérée de la population chrétienne en 362, l'exemple des grands Cappadociens, saint Basile et saint Grégoire de Nazianze, suffit à le montrer. Dans sa belle homélie sur la manière de lire avec fruit les auteurs profanes, saint Basile tracera le programme d'une éducation à la fois classique et chrétienne[82]. Mais saint Grégoire fera à la législation de Julien une allusion plus directe dans les invectives écrites au lendemain de la mort du persécuteur. Au commencement de son premier discours, il affecte d'en parler avec quelque dédain. Julien, dit-il, a voulu nous ôter l'usage de sa langue : il a craint qu'elle ne rendit plus irrésistible la réfutation de ses doctrines ; comme si nous ne méprisions pas tout l'attirail littéraire, et ne mettions pas notre confiance dans la seule force de la vérité ! Il a voulu nous empêcher de parler grec ; il n'a pu nous empêcher de parler vrai[83]. Mais cette indifférence affectée ne tient pas jusqu'au bout. Quand, après avoir passé en revue les principaux actes de Julien, il arrive aux mesures contraires à la liberté de l'enseignement, l'indignation qui couvait dans son sein se donne enfin libre cours. Nombreux et graves sont les motifs de haïr Julien ; mais sur aucun point il ne s'est montré plus haïssable. Qu'avec moi s'indigne quiconque aime l'éloquence et appartient comme moi au monde de ceux qui la cultivent ! Car j'ai abandonné aux autres tout le reste, richesse, noblesse, gloire, puissance, tout ce qu'on recherche et rêve ici-bas : je m'attache à la seule éloquence, et je ne regrette rien des fatigues endurées sur terre et sur mer pour la conquérir. Plaise à Dieu que moi, et ceux que j'aime, nous la possédions dans toute sa vigueur ; car je l'aime plus que toute autre chose, seules exceptées les choses divines et les invisibles espérances ![84] Revenant sur ce sujet dans son second discours, saint
Grégoire emploie, en s'adressant à Julien, une locution homérique : Voilà, ajoute-t-il ironiquement, ce que t'envoient ceux que, par ta grande et merveilleuse
loi, tu prétendais exclure de la culture des lettres ![85] Le littérateur impénitent triomphe, presque avec
excès, de l'échec de la tentative antilibérale où Julien compromit, même aux
yeux des païens, une partie de sa renommée. FIN DU SECOND TOME. |