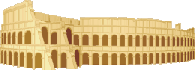LES ESCLAVES CHRÉTIENS
LIVRE III. LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE.
CHAPITRE IV. DIMINUTION DU NOMBRE DES ESCLAVES ET PROGRÈS DU TRAVAIL LIBRE AU IVe ET AU Ve SIÈCLE.
|
I Le christianisme servit efficacement la cause du travail libre en combattant le luxe. Il amena par là, dès la fin du IVe siècle, une diminution notable dans le nombre des esclaves. Le luxe, c'est-à-dire la prodigalité excessive, égoïste, amollissante, improductive, est foncièrement antipathique à l'esprit chrétien. Non-seulement celui-ci a pour essence le renoncement, le sacrifice, mais encore il exige impérieusement de ses fidèles deux choses, le travail et l'aumône : l'excès du luxe rend impropre à l'un et tarit les sources de l'autre. Les Pères des premiers siècles se placent à ce point de vue pour le combattre. Tertullien, Clément d'Alexandrie, ont écrit dans ce sens des pages pleines d'éloquence et de vigueur ; les moralistes et les prédicateurs du IVe siècle, d'une époque où, le contrepoids des persécutions faisant défaut, la société chrétienne était plus exposée à glisser sur cette pente, qui l'eût ramenée promptement aux murs païennes, livrent au luxe une guerre acharnée, presque violente. Saint Jean Chrysostome ne craint pas de faire entendre aux voluptueux de son temps le pas du barbare qui s'approche[1] : il porte d'une main intrépide le fer et le feu dans les plaies ouvertes sous ses yeux : il semble que lui et les écrivains religieux du IVe siècle aient senti la nécessité de se hâter, de poser promptement, en vue de l'avenir, les bases définitives d'une civilisation nouvelle, afin que, si une partie des contrées éclairées par la lumière de l'Évangile vient un jour à être submergée par le flot barbare, les assises de l'édifice social reconstruit par le christianisme demeurent inébranlables. Les Pères du IVe siècle ont trouvé et mis en lumière
toutes les raisons propres à combattre ce qu'un écrivain moderne a appelé notre ennemi le luxe. Ils voient en lui la négation
même de l'esprit chrétien, un sujet de raillerie et de scandale pour les
infidèles. Paul, dit saint Jean Chrysostome, a défendu l'or et les perles : les Grecs rient de nous et
s'imaginent que notre religion est une fable. Vous entrez dans l'église,
ajoute-t-il, les mains et le col chargés d'or. Si Paul venait, Paul terrible
et aimable, terrible aux pécheurs, aimable à ceux qui vivent pieusement, il
élèverait la voix et dirait : Il faut que les femmes soient parées, mais non
d'or, de perles et d'étoffes précieuses[2]. Et si, ensuite, un païen entrait et voyait, dans le haut
de l'église, les femmes couvertes d'ornements, et, dans le bas, Paul parlant
ainsi, ne dirait-il pas : Voilà une comédie ! Certes, il ne se passe point de
comédie parmi nous, mais ce païen serait scandalisé[3]. Paroles bien
graves, et toujours vraies, si l'on voit dans l'or et les perles, choses
insignifiantes en elles-mêmes, et que le grand orateur, pas plus que
l'apôtre, ne songe assurément à proscrire d'une manière absolue, un symbole
de ce faste immodéré qui, étalé par des sectateurs de l'Évangile, ne choque
pas moins les incrédules du me siècle que les païens du IVe. Saint Jean
Chrysostome signale encore dans l'amour du luxe et dans la vanité puérile
qu'il engendre une atteinte à la dignité humaine : on s'habitue à honorer
dans l'homme non lui-même, mais les brillants accessoires dont il est
entouré. Beaucoup, aujourd'hui, aiment mieux être
admirés pour le pavé de leurs maisons et la beauté de leurs escaliers que
pour ce qui fait vraiment l'homme. Les uns veulent être admirés pour leurs
statues, les autres pour leurs vêtements, leurs palais, leurs mules, leurs
voitures, les colonnes qui décorent leurs demeures. Ils ont perdu les
qualités véritables de l'homme, et ils cherchent autour d'eux de quoi se
faire une autre gloire, digne de risée[4]. C'est surtout
comme l'ennemi de l'aumône, le meurtrier des pauvres, que les Pères de
l'Église attaquent le luxe. Ils parlent avec véhémence, mais le fond de leur pensée
reste toujours modéré. Je ne vous demande pas,
dit Lactance, de diminuer ou d'épuiser votre
fortune, je vous demande d'employer mieux votre superflu[5]. Ce superflu mal employé,
c'est le luxe. Si la femme oblige son mari à
dépenser pour l'ornement d'un vil corps tout son bien, plus que son bien, la
source de l'aumône est nécessairement tarie[6]. Saint Jean
Chrysostome fait appel à la pitié des femmes, à leur propre intérêt : Quand vous vous promenez, portant à vos oreilles ces
bijoux d'un prix énorme, pensez à tous les ventres affamés, à tous les corps
nus à cause de vos parures. Qu'il vaudrait mieux nourrir tant de vies défaillantes,
au lieu de percer le bas de cette oreille et d'y suspendre la nourriture de
mille pauvres ! Vous précipitez ainsi vos maris dans l'adultère, car, au lieu
de les élever à l'amour de la sagesse, vous leur apprenez à aimer en vous ce
qui vous fait ressembler à des courtisanes[7]. Riche, prends garde, s'écrie saint Ambroise : le pauvre pleure sa nudité devant ta maison, et tu
cherches de quels marbres précieux tu revêtiras tes pavés ! le pauvre te
demande un peu d'argent, un peu de pain, et ton cheval presse de ses dents un
frein d'or ! Quel jugement se prépare pour toi, ô riche ! La seule pierre de
ta bague pourrait sauver la vie de tout un peuple d'affamés[8]. Le pauvre ainsi
sacrifié au luxe, c'est, pour les Pères de l'Église, le Christ lui-même. Ô suprême démence ! le Christ se tient à ta porte en
habits de pauvre, et tu n'en es pas touché ![9] Saint Jean
Chrysostome veut que le premier soin du riche soit de l'assister : il
condamne même le luxe déployé pour l'ornement des églises, si le pauvre est
négligé. A quoi bon charger de vases d'or la table
du Christ, si en la personne des pauvres le Christ meurt de faim ? Donne-lui
à manger d'abord, et du superflu tu orneras sa table. Tu donnes un calice
d'or, et tu ne fais pas l'aumône d'un verré d'eau ! A quoi bon orner la table
sainte de voiles tissés d'or, si tu refuses au Christ des vêtements ?[10] Saint Jean
Chrysostome se tourne ensuite vers certains chrétiens qui, dès cette époque,
reprochaient à l'Église la possession de biens temporels et se plaignaient hypocritement
que le soin de leur administration nuisit aux fonctions spirituelles des
prêtres : A cause de votre dureté, dit-il, l'Église possède des maisons, des champs, des immeubles....
Pourquoi n'est-ce plus comme au temps des apôtres ?
parce que nos pères, prévoyant votre cupidité, craignant que vous ne laissiez
périr de faim les churs des vierges, des orphelins et des veuves, ont été
contraints de constituer un patrimoine aux églises.... Si chacun de vous donnait une obole, il n'y aurait plus de
pauvres, nous n'éprouverions pas tant d'embarras dans l'administration des
choses temporelles, et le : Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et
suis-moi, serait dit à propos aux chefs de l'Église au sujet des biens de
l'Église[11].
Savez-vous, dit-il ailleurs, combien l'Église d'Antioche, dont le revenu total
représente, réunis, celui d'un riche et celui d'un homme de fortune moyenne,
fait vivre quotidiennement de veuves et de vierges ? trois mille. Ajoutez les
prisonniers qu'elle nourrit dans la prison, les malades qu'elle entretient
dans l'hôpital, les pauvres valides, les étrangers, les mutilés, qui
reçoivent d'elle des vivres et des vêtements sans épuiser ses ressources. Si
dix hommes seulement voulaient faire ce qu'elle fait, il n'y aurait pas un
seul pauvre[12]. Tel était
l'idéal que les écrivains religieux de la fin du IVe siècle opposaient aux
voluptés et aux vices de leur temps. Quelquefois, dans leurs écrits, la réaction contre le luxe et l'oisiveté antiques, contre ce mépris du travail et des pauvres qui avait déshonoré le monde païen, paraît excessive : les idées économiques, à cette époque, étaient loin d'avoir le caractère rigoureux et précis que la science moderne, à la lumière de l'expérience et des faits, leur a donné. Quand écrivait saint Jean Chrysostome, par exemple, la société commençait à peine à se dégager, sous l'influence chrétienne, du chaos économique, véritable négation de toute loi, où, par l'esclavage, par l'oppression du travail libre, elle avait été retenue pendant de longs siècles. Il est naturel que le langage de l'orateur trahisse, dès qu'il touche à ces matières, quelque inexpérience, quelque incertitude, ou paraisse empreint de ces exagérations qui sont inséparables de toute pensée non encore mûrie par une étude patiente et comparée des faits. Ce qu'il faut voir dans ses idées, c'est leur grandeur, leur générosité, leur nouveauté. Saint Jean Chrysostome, en maint endroit de ses écrits, ou plutôt de ses discours, a tracé, comme Platon, le plan de sa république idéale : mais combien elle diffère de celle rêvée par le philosophe ! Dans l'une, le mépris, presque la haine du travail manuel : dans l'autre, une idée exagérée, ou du moins trop exclusive, du rôle qui lui est réservé dans les sociétés chrétiennes. Ainsi, saint Jean Chrysostome voudrait bannir de la cité tous les arts de luxe, depuis la peinture décorative et la broderie jusqu'aux inventions des cuisiniers et des saleurs : il n'admet que les occupations nécessaires à la vie[13]. Le grand commerce, qui va chercher les soies et les métaux précieux au delà des mers, le choque comme inutile[14]. Saint Augustin, de même, voit avec défaveur le négoce et les spéculations qui occupent l'âme sans fatiguer le corps : il leur préfère le travail des mains, qui laisse à l'âme sa liberté[15]. Dans une de ses homélies, saint Jean Chrysostome exprime par une image frappante plutôt que juste la supériorité du travail manuel sur la richesse oisive. Il suppose deux villes, l'une exclusivement ha-. bilée par des riches, l'autre renfermant exclusivement des pauvres. La première, dit-il, ne pourra se suffire à elle-même, à moins d'appeler à son aide des artisans. Au contraire, voyons la ville des pauvres. Supposons qu'elle ne contient rien de ce qu'on appelle les richesses, c'est-à-dire ni or, ni argent, ni pierres précieuses, ni étoffes de soie, ni tentures de pourpre, ni broderies d'or. Cette ville souffrira-t-elle ? Non. S'il faut y bâtir, on n'a point besoin d'argent ou de perles, mais de mains calleuses, endurcies au travail, de bois, de pierres. S'il faut tisser des vêtements, on n'a pas besoin d'or ou d'argent, mais de mains, de femmes laborieuses. S'il faut travailler la terre, s'il faut travailler le fer, les pauvres encore suffiront. Quel besoin aura-t-on des riches, dont la présence détruirait une telle cité ?[16] Il n'est pas nécessaire de faire ressortir ce qu'a de chimérique la conception de cette Sparte chrétienne. C'est une image oratoire plus encore qu'une théorie présentée sous une forme absolue et rigoureuse. Dans une autre homélie, saint Jean Chrysostome reconnaît l'utilité sociale de la richesse. De même, dit-il, que chaque artisan a son art, de même le riche, qui ne sait ni fabriquer l'airain, ni construire un navire, ni tisser, ni bâtir, ni faire aucune chose semblable, doit apprendre à user des richesses comme il convient, et à faire l'aumône aux pauvres, ce qui est le premier des métiers[17]. On ne peut définir plus magnifiquement une des principales fonctions de la richesse dans les sociétés chrétiennes. Cependant, même en expliquant et en rectifiant par ce texte celui qui a été cité précédemment, il est difficile de ne pas apercevoir une lacune dans la pensée de saint Jean Chrysostome. A force de réagir contre le luxe et l'oisiveté antiques, et d'exalter la conception chrétienne du travail, il semble ne pas voir clairement le rôle nécessaire du capital : la richesse est pour lui la source de l'aumône, mais non l'auxiliaire, et, en quelque sorte, le multiplicateur des forces productives du travail. Cette erreur était à la fois inévitable et innocente à une époque où l'on commençait seulement à entrevoir, à la lumière de l'Évangile, la vraie place du travail libre dans la société, à une époque où les esclaves constituaient encore le premier des capitaux, et où la plus grande partie de la richesse créée par eux se dissipait dans les prodigalités d'un luxe improductif. Les sociétés antiques, par l'effet de cette double cause presque inséparable, l'esclavage et le luxe, ne dépassèrent pas économiquement cette période moyenne où le travail de l'homme est l'élément prépondérant dans la production[18]. Le capital n'y eut jamais qu'une importance secondaire. Pour qu'il prît la place qui lui appartient dans le jeu des forces économiques, il fallait que ces deux obstacles fussent renversés, ou du moins affaiblis. C'est à quoi travaillèrent avec ardeur les Pères de l'Église. Ils firent la guerre au luxe, et tout à l'heure nous les verrons lutter avec énergie pour amener dans la société chrétienne la diminution du nombre des esclaves, acheminement à l'abolition future de l'esclavage. Il se peut que quelques-uns d'entre eux paraissent ignorer, ou même méconnaître, le rôle nécessaire du capital, ne pas apercevoir clairement sa nature précise et sa valeur exacte : la science sociale n'était pas née à l'époque où ils écrivaient. Mais, s'il n'en possédèrent pas les termes et n'en parlèrent pas toujours le langage, ils firent plus et mieux : ils posèrent les fondements sur lesquels elle s'éleva. En réconciliant les hommes libres et les arts manuels, ils ont rétabli dans un ordre conforme aux lois naturelles les conditions du travail et de la production : en réfrénant autour d'eux le luxe, et surtout le pire des luxes, celui qui consiste en la possession souvent inutile et improductive d'un grand nombre d'esclaves, ils ont favorisé, sans le savoir peut-être, mais par une conséquence logique de leurs efforts, le développement des capitaux utiles. S'ils ont quelquefois employé en parlant du travail, en luttant pour lui faire sa place, des termes excessifs, ils ont été moins loin dans cette exagération de la vérité que les philosophes et les politiques de l'antiquité païenne n'avaient été dans l'erreur opposée : ils ne l'ont tant exalté que pour le venger et le laver de mépris séculaires. II Dans la cité imaginaire de saint Jean Chrysostome, le
travail seul règne, mais c'est le travail libre : il n'y est point fait
mention des esclaves. On sent qu'ils n'ont point de place dans une telle
cité. Si on peut la comparer à Sparte, c'est à Sparte sans les ilotes. Les
Pères de l'Église, en même temps qu'ils s'appliquaient à réhabiliter le
travail manuel, s'efforçaient de diminuer par tous les moyens le nombre des
esclaves. Seuls, quand l'esclavage était encore debout, ils osaient rêver une
société sans esclaves. Ils en comprenaient la possibilité, et c'est en ceci
que, même si on les étudie au seul point de vue économique, on peut les
considérer comme ayant eu l'intuition du monde moderne, comme en étant les
précurseurs. On ne trouve jamais exprimée dans un
écrivain antique, dit M. Boissier, ni comme
une espérance éloignée, ni comme un souhait fugitif, ni même comme une
hypothèse invraisemblable, cette pensée que l'esclavage pourra être un jour aboli[19]. Cette pensée,
au contraire, se rencontre souvent dans les Pères de l'Église, plus rare et
plus timide dans les temps qui précèdent la victoire politique du christianisme,
plus accentuée au IVe siècle, à l'époque où la religion triomphante se sentit
en mesure d'appliquer au monde romain les conséquences sociales des principes
proclamés par elle. Dès la fin du IIe siècle, Clément d'Alexandrie s'élève avec énergie contre le nombre immodéré des esclaves. Il engage les chrétiens à retrancher toute espèce de luxe. Ne vous inquiétez, dit-il, ni des chevaux ni des esclaves... Rejetez cette multitude de vases, de coupes d'or et d'argent, ces troupes d'esclaves[20]. J'ai cité plus haut le tableau tracé par lui, avec une verve indignée, de l'excessive division du travail qui, dans les maisons romaines, attachait d'innombrables serviteurs aux plus inutiles et aux plus méprisables emplois[21]. C'est là le vice qu'il s'efforce le plus de combattre. A quoi bon cette multitude d'échansons, quand une seule coupe suffit à vous désaltérer ?[22] Il voudrait poser des bornes à l'usage immodéré et au luxe extravagant des bains : il voudrait surtout supprimer les nombreux esclaves qui n'avaient d'autre occupation que de servir leur maître dans le bain. Il faut user des bains de telle façon qu'on n'y ait besoin le l'aide de personne. Avoir des multitudes d'hommes gour verser l'eau, c'est faire servir à son plaisir la peine les autres[23]. La pensée et l'expression sont ici extrêmement modérées : l'écrivain n'attaque pas de front l'esclavage, il s'applique seulement à persuader aux chrétiens de réduire l'emploi de leurs serviteurs au strict nécessaire. Mais la règle qu'il pose est formelle, et son application retrancherait de la société le plus grand nombre des esclaves : La mesure des besoins de votre corps, dit-il aux chrétiens, doit être la mesure de vos possessions : ce qui les dépasse est superflu[24]. Saint Jean Chrysostome tire hardiment les conséquences de
ce principe. En quoi un riche diffère-t-il d'un
pauvre ? Comme le pauvre, il n'a qu'un ventre à nourrir. Mais, dit-on, il en
a un grand nombre, il faut qu'il nourrisse des serviteurs et des servantes.
Pourquoi a-t-il de nombreux serviteurs ? Dans les vêtements, dans la
nourriture, il faut se contenter du nécessaire : de même en ce qui concerne
les serviteurs. A quoi donc sont-ils utiles ? A rien. Un seul serviteur
devrait suffire à un maître : bien plus, deux ou trois maîtres n'auraient
besoin d'avoir, pour les servir tous ensemble, qu'un seul esclave[25]. »On sent que,
dans sa pensée, c'est là une concession : son idéal serait la suppression
absolue des esclaves. Dieu nous a donné des mains et
des pieds afin que nous n'eussions pas besoin d'esclaves. Aucune race
d'esclaves n'a été créée en même temps qu'Adam : la servitude a été la peine
du péché la suite, de la désobéissance. Mais le Christ est venu, et l'a
détruite ; car, en le Christ Jésus, il n'y a ni esclave ni libre[26]. C'est là le
fond de sa pensée ; il continue : C'est pourquoi il
n'est pas nécessaire d'avoir d'esclaves : ou si on le croit nécessaire, que
l'on en ait un deux tout au plus[27]. Dans ses
homélies sur la Genèse, saint Jean Chrysostome insiste sur l'esclave unique
donné par Laban à chacune de ses filles lors de leur mariage : Voyez-vous la grandeur de cette philosophie ? donne-t-il
des troupeaux d'esclaves ?[28] Il ne craint pas
de laisser voir que, s'il concède aux chrétiens la possession d'un esclave,
c'est par ménagement pour leur faiblesse. Qui sont,
demande-t-il, ceux qui corrompent l'état présent des
choses ? ceux qui vivent avec modération et probité, ou ceux qui inventent
sans cesse de nouvelles et injustes délices ? ceux qui ont des phalanges
d'esclaves, ou ceux qui ont un seul esclave ?[29] et je ne parle pas ici, continue-t-il, du suprême degré de la sagesse, mais de celle que peut embrasser
le commun des hommes. L'Église paraît, au Ir siècle, avoir voulu mettre des bornes au commerce des esclaves, en considérant comme meilleur, plus conforme à l'esprit chrétien, de posséder des esclaves nés dans la maison que d'en acheter au dehors. Il me semble voir dans quelques mots de saint Jean Chrysostome un blâme indirect contre les achats d'esclaves : il énumère les richesses d'Abraham : Voyez, dit-il, de quoi elles se composent. Ni champ, ni maison, ni luxe superflu ; mais des brebis et des veaux, des chameaux et des ânes, des esclaves et des servantes. Et afin que vous sachiez d'où lui était venue cette multitude d'esclaves, l'Écriture ajoute en un autre passage : Tous étaient nés dans sa maison[30]. L'éloquent orateur, dans son ardeur à combattre le nombre exagéré des esclaves, ne craint pas de toucher les cordes les plus délicates et les plus sensibles ; il s'efforce d'amener, par la jalousie, les femmes à renvoyer une partie de leurs servantes. Il est agréable, dira-t-on, d'avoir sous ses ordres une multitude de servantes. C'est la plus désagréable des satisfactions, tant elle est mêlée de soucis. Le plus cuisant de tous est la présence, dans une nombreuse réunion de servantes, de quelque femme remarquable par sa beauté. Et, dans cette multitude d'esclaves, cela n'est pas rare, car les riches s'efforcent de rassembler dans leur maison non-seulement de nombreuses, mais de belles servantes. Et quelles seront les tortures de la maîtresse, si l'une d'entre elles, l'emportant par sa beauté, ou séduit le cur du maître, ou tout au moins devient l'objet de son admiration ! L'épouse pleurera alors, sinon sur son amour perdu, au moins sur cette beauté qui surpasse la sienne et cette admiration qui s'y attache[31]. Il faut voir avec quelle ironie l'orateur chrétien
flagelle les murs fastueuses des riches qui, selon la coutume antique,
traînaient après eux dans les rues des troupeaux d'esclaves. Ayant deux serviteurs seulement, dit-il, nous pouvons vivre. Car là où plusieurs vivent sans un
seul serviteur, quelle excuse avons-nous si deux ne nous suffisent pas ? Ayez
donc, si vous le voulez, deux serviteurs. Eh quoi ! direz-vous, n'est-ce pas
une honte pour une ingénue de marcher suivie de deux serviteurs seulement ?
La vraie honte est de se faire suivre d'un plus grand nombre. Vous riez peut-être
de mes paroles. Croyez-moi, marcher escorté de nombreux esclaves, voilà ce
qui est honteux. Cela vous fait ressembler à des marchands de moutons ou à
des marchands d'esclaves. Ce n'est pas la multitude des valets de pied qui
signale la femme ingénue. Car, quelle vertu y a-t-il à posséder beaucoup d'esclaves
? Cela n'est pas de l'âme : et ce qui n'est pas de l'âme n'est pas un signe
de naissance libre. Celle qui se contente de peu, voilà la vraie ingénue[32]. Saint Jean Chrysostome ajoute à ces vigoureuses paroles un argument nouveau. L'opinion publique, grâce au christianisme, commençait à se former sur ces questions : les foules ne supportaient plus aussi patiemment la vue des esclaves innombrables que le faste des riches traînait après soi. Dites-moi, s'écrie l'orateur, quelle est celle qui se fait bien voir du peuple assemblé sur le forum ? celle qui conduit avec elle beaucoup de serviteurs, ou celle qui en conduit un petit nombre ? Cette dernière, et plus encore celle qui vient seule[33]. Ailleurs il est plus pressant et plus dur : il fait retentir aux oreilles des riches les sentiments de révolte qui grondaient sourdement dans le cur de la foule : Quand tu passes dans ton char, beaucoup de gens ne te regardent pas, mais regardent le brillant harnais de tes chevaux, les esclaves qui te précèdent et qui te suivent, et ceux qui ouvrent pour toi un chemin dans les rangs pressés du peuple : toi, ainsi escorté, ils te détestent, et te considèrent comme un ennemi public[34]. III Le peuple inconséquent s'indignait ainsi à la vue des trop nombreux esclaves possédés par les riches, sans songer que lui-même en retenait un non moins grand nombre enchainé à ses plaisirs. Nous avons peine à comprendre aujourd'hui ce qu'était la passion du théâtre dans l'antiquité, et combien de milliers d'êtres humains étaient contraints de la servir. Le théâtre ne prenait pas aux spectateurs deux ou trois heures seulement de la soirée : c'étaient des journées entières, quelquefois plusieurs jours de suite, que le peuple des villes passait à s'enivrer de la folie du cirque, l'impureté de la scène, la cruauté de l'arène, la vanité du gymnase[35]. Ces plaisirs, à l'époque païenne, tenaient lieu de la religion, dont ils constituaient une partie, la seule ayant gardé de l'action sur les foules ; de la vie publique, qui, sous l'empire, n'avait conservé quelque réalité que dans les provinces, où elle se concentrait entre les mains d'un petit nombre d'hommes, pour qui elle était moins un privilège qu'un fardeau ; du travail, à peu près abandonné par les personnes libres ; de la vie de famille, dont les murs païennes avaient relâché les liens, et dont, même à l'époque chrétienne, les émotions exagérées de la scène faisaient paraître fades les tranquilles jouissances. Les âmes étaient vraiment captives du théâtre. Il les avait faussées, amollies, rendues incapables de sentiments justes et d'émotions modérées. Il avait tout rempli de son atmosphère factice. Non-seulement la population des grandes villes ne pouvait se passer de lui[36], mais, dans de petites villes de province, comme Orange, on voyait s'élever l'un près de l'autre un théâtre magnifique où plus de sept mille spectateurs s'asseyaient à l'aise, un vaste hippodrome dont les portiques abritaient vingt-cinq mille personnes, un amphithéâtre où les places se comptaient encore par milliers[37] : tout cela pour une cité gallo-romaine de médiocre étendue et pour le canton rural qui l'entourait ! Quand on songe qu'il en était ainsi pour toutes les cités provinciales, que soit les ruines, soit les inscriptions nous montrent dans chacune d'elles des édifices consacrés à des fêtes de toute sorte, et que sous l'empire tous les dignitaires municipaux étaient obligés de se ruiner en jeux publics, on se rend compte de la quantité presque effrayante de malheureux, la plupart esclaves, qui, à des titres divers, servaient aux plaisirs du peuple. Qu'on se rappelle Rome, lors de la conjuration de Catilina, tremblant devant les familiæ de gladiateurs qu'elle renfermait dans ses murs : qu'on y ajoute les innombrables danseuses[38], mimes, histrions, comédiens, saltimbanques, cochers, que toutes les villes de l'empire nourrissaient à l'exemple de la capitale : ce n'étaient pas des troupes, c'étaient des armées qu'il fallait posséder pour alimenter des représentations qui duraient non quelques heures, mais quelques jours de suite. Encore n'était-ce là qu'une partie des malheureux asservis aux folies et aux impuretés de la scène. Quand il quittait le théâtre public, où il avait partagé les émotions de la foule, le patricien dégénéré de Rome ou même de Constantinople, cette seconde Rome, en retrouvait chez lui l'enivrante et débilitante atmosphère. Le théâtre était installé à son foyer. Le goût du faux, des vaines apparences, du bruit étourdissant, de l'éclat extérieur, des gaietés faciles, des sensations violentes, régnait en maître dans son âme, que nulle passion sérieuse et profonde ne remplissait : le riche Romain passait ses jours et ses nuits à se donner à lui-même une comédie continuelle : dans sa demeure remplie de baladins il reproduisait cette vie théâtrale qui lui était devenue aussi nécessaire que l'air qu'il respirait. Sa maison même était parfois machinée comme un théâtre : on voyait le plafond de sa salle à manger, composé de lames mobiles, s'entrouvrir pour laisser tomber sur les convives des pluies de fleurs ou des couronnes : les lambris de ses appartements étaient changeants comme des décors : le service de ses festins était réglé comme une comédie ou un ballet. Dans ses parcs ou même dans ses appartements il assistait, spectateur égoïste, à des combats d'hommes ou d'animaux : il avait ses lions, ses bestiaires, ses gladiateurs domestiques, comme il avait son orchestre, ses churs, ses comédiens, ses tragédiens, ses danseurs et ses mimes. Les plaisirs privés absorbaient ainsi presque autant de gens de théâtre que les plaisirs publics. L'Église fit les plus grands efforts pour mettre fin à cet état de choses. Elle agit directement dans ce sens par les prédications de ses évêques, les écrits de ses docteurs, les canons de ses conciles : elle agit indirectement en inspirant aux empereurs chrétiens des lois quelquefois timides, souvent mal observées, courageuses cependant, quand on songe à l'attachement de toutes les classes de la société pour ces plaisirs. Peu d'intérêts plus grands avaient sollicité sa vigilance. Il s'agissait non-seulement d'arracher au péché des milliers d'âmes que les nécessités de leur condition plus encore que leur volonté retenaient engagées dans les liens d'une profession pleine de périls, mais surtout de lutter pour la civilisation chrétienne elle-même contre une passion dont les excès mettaient en péril tous les résultats conquis péniblement par trois ou quatre siècles d'évangile, de vertus et de martyre. Un peuple capable de menacer d'incendie la maison d'un préfet qui avait voulu distribuer aux pauvres l'argent destiné aux jeux publics[39], de se battre pour des cochers et des histrions quand les armes des barbares entouraient les murs de ses villes[40], de se plaire aux turpitudes de la majuma[41], n'était pas loin de perdre toute charité, tout patriotisme, toute pudeur : il ne serait resté aucun fruit du travail dépensé pour élever les âmes à une religion vraie, sérieuse, efficace, qui lût autre chose qu'une vaine formule, si les chrétiens s'étaient habitués, comme le leur reproche saint Jean Chrysostome, à passer indifféremment de l'église, mi ils venaient d'entendre commenter l'Évangile de saint Jean, au théâtre, où ils allaient contempler des courtisanes nageant dans une piscine[42]. L'habitude de la vie laborieuse, péniblement rendue à la société chrétienne par les efforts et les exemples de l'Église, eût été vite emportée aussi par les séductions du théâtre. Quand les histrions, dit encore saint Jean Chrysostome, nous voient délaisser nos ateliers, nos métiers, nos gains, tout, en un mot, pour courir aux spectacles, ils s'y donnent avec plus d'ardeur et d'empressement[43]. Tant que les chrétiens avaient formé un petit peuple persécuté, ils n'avaient pas eu de peine à se défendre contre cet attrait périlleux, dont les gardait la ferveur des premiers âges, le danger présent, et l'isolement nécessaire dans lequel ils vivaient : devenus la majorité, la puissance politique, la 'société elle-même, ils avaient perdu ces contrepoids, et se trouvaient envahis par des murs publiques presque entièrement païennes, qui avaient survécu à la défaite du paganisme. Là était le péril : et c'est pourquoi, bien que les Pères antérieurs au IVe siècle, Tatien, Athénagore, saint Cyprien, Tertullien, aient énergiquement attaqué les vices du théâtre et les cruautés de l'amphithéâtre, c'est à partir du IVe siècle que commence à proprement parler la lutte de l'Église contre ces plaisirs voluptueux ou barbares et en faveur des malheureux qui en étaient les esclaves. Il s'agissait de sauver la société chrétienne en abattant ces restes menaçants du paganisme : ce ne fut pas trop pour cela de l'influence du clergé et de la puissance du législateur, unis dans une même uvre de préservation sociale. Bien que tendant vers un but semblable, l'Église et la politique impériale se trouvaient placées, pour l'atteindre, dans des conditions différentes. La première, uniquement préoccupée du péril des âmes, n'avait cessé de professer sur les spectacles criminels de l'antiquité les principes les plus absolus. Elle rangeait les combats de gladiateurs, les représentations des histrions et des mimes, parmi les pompes du diable, comme les appelle saint Cyrille[44]. Sans avoir égard au trouble momentané qui pouvait en résulter dans la vie municipale ou provinciale, elle excommuniait les curiales revêtus de sacerdoces municipaux ou provinciaux qui, après leur conversion au christianisme, avaient eu la faiblesse non-seulement de sacrifier, mais même de donner des jeux, munus tantum dederunt[45]. Elle exhortait le peuple fidèle à faire le vide autour des gladiateurs et des comédiens[46]. Elle frappait ceux-ci d'excommunication[47], et n'hésitait pas à demander leur bannissement[48]. Elle s'efforçait, par tous les moyens, d'agir sur les âmes et d'effrayer les consciences. La politique impériale était tenue à plus de ménagements. Pour traduire en lois les désirs de l'Église, il lui fallait remonter, en quelque sorte le courant populaire. Chaque pas lait dans cette voie la mettait en présence d'un obstacle : elle avait à compter avec la résistance passive d'un peuple qui, n'ayant plus de droits politiques, n'en était que plus tenace à défendre ses plaisirs. Il est curieux d'étudier la législation des empereurs chrétiens sur les spectacles, les combats de gladiateurs et la condition des gens de théâtre. Elle hésite, elle se reprend, elle avance, elle recule, elle semble animée de mouvements contradictoires. A travers ces lenteurs et ces difficultés, la pensée chrétienne y fait cependant son chemin. Au commencement du Ve siècle, les esclaves des plaisirs publics et privés étaient moins nombreux, des jeux obscènes ou cruels avaient été supprimés, un grand nombre de personnes avaient échappé aux liens de la condition scénique. La victoire avait été contestée, elle était encore incomplète sur bien des points, mais un progrès immense s'était déjà accompli dans le sens de la morale et de la liberté, et il était dû tout entier à l'esprit chrétien. L'extrême lenteur avec laquelle furent abolis les combats de gladiateurs montre combien cette victoire était difficile. Les Pères de l'Église n'avaient cessé de s'élever contre ces barbares plaisirs du monde romain. Quand le christianisme, en la personne de Constantin, fut monté sur le trône, leur voix devint plus haute et plus pressante. Il faut les abolir, Tollenda sunt nobis[49], s'écrie Lactance, profitant de la liberté que lui donnait sa position officielle de précepteur du fils de l'empereur ; en parlant ainsi, il était l'interprète de tout le clergé chrétien. Constantin avait l'âme assez généreuse pour entendre cet appel. Dans un rescrit daté de Béryte en Phénicie, l'année même du concile de Nicée (325), il s'exprime en ces termes : Au milieu de la tranquillité civile et de la paix domestique, il ne doit pas y avoir de combats sanglants. C'est pourquoi nous défendons absolument qu'il y ait des gladiateurs : ceux qui, à cause de leurs crimes, ont été condamnés à combattre en cette qualité, devront être employés aux travaux des mines[50]. Cette loi atteignait et libérait dans une certaine mesure deux classes d'esclaves, les esclaves du laniste, ces familiæ gladiatorum dont parlent si souvent les auteurs classiques, et les condamnés ou esclaves de la peine, servi pnæ. Les termes du rescrit de 325 et ceux par lesquels l'historien Sozomène y fait allusion[51], sont trop formels pour qu'on y doive voir une loi purement locale, s'appliquant à la seule Béryte, une des villes de l'Orient où les combats de gladiateurs et toutes les sortes de spectacles étaient le plus en honneur : il semble bien que ces dispositions s'étendaient à tout l'empire. Elles tombèrent presque immédiatement en désuétude. Libanius vit, en 328, des gladiateurs combattre à Antioche[52]. Par une loi de 357, Constance défend à tout homme faisant partie de l'armée ou de la milice palatine de s'engager comme gladiateur[53]. Valentinien et Valens, en 365, interdisent de condamner des chrétiens aux jeux de l'arène[54]. Symmaque, saint Ambroise, saint Augustin, témoignent que ces combats existaient encore de leur temps, au moins en Occident[55]. Ils ne cessèrent tout à fait qu'en 404. Honorius était alors à Rome. Dix ans auparavant, Théodose avait comblé de joie les chrétiens en déclarant définitivement abolis les sacrifices païens, non-seulement publics, mais privés[56]. Prudence supplie Honorius de compléter l'uvre de son père en déclarant à son tour abolis les combats de gladiateurs[57]. Les vers du poète n'eussent peut-être pas suffi à amener ce résultat sans le dévouement héroïque du moine Télémaque qui, accouru du fond de l'Orient, où ces jeux cruels avaient presque entièrement cessé, à Rome, où avait appris qu'ils gardaient toute leur vogue, se jeta un jour dans l'arène au milieu des combattants, et, au moment où il s'efforçait de les séparer, fut lapidé par les spectateurs. Le martyre du généreux moine mit fin pour jamais aux combats de gladiateurs. Comme un autre héros du dévouement chrétien se jetant au milieu de nos troubles civils, il eût pu dire : Je désire que mon sang soit le dernier versé. Honorius prononça immédiatement la suppression des ludi gladiatorii[58]. Les hommes et les femmes de théâtres, scnici, scnic, étaient véritablement asservis aux plaisirs publics. Non-seulement un très-grand nombre de ceux qui, à des titres divers, paraissaient sur la scène, étaient esclaves, appartenant soit à un chef de troupe ou à un entrepreneur de jeux, soit même à un particulier qui, après leur avoir fait donner une éducation spéciale, les louait ensuite comme histrions[59] ; mais encore les personnes de condition libre qui montaient sur le théâtre, et dont plusieurs y faisaient une grande fortune, cessaient de s'appartenir : le public acquérait un droit sur elles, et même sur leurs enfants. Les scnici ne pouvaient plus abandonner la carrière théâtrale, et cette profession devenait héréditaire : leurs fils, leurs )filles étaient tenus de la suivre. Les gens de théâtre étaient enchaînés aux plaisirs publics comme les curiales à la curie, les collegiati à la cité, les gens de métier à la corporation. C'était la condition commune au IVe siècle. Mais cette servitude était particulièrement odieuse quand elle imposait à des hommes et à des femmes une profession contre laquelle leur conscience protestait, que l'Église condamnait, que la loi elle-même déclarait infâme. Tel était cependant le sort des scnici. Il ne leur était pas plus permis d'abandonner le théâtre qu'il n'était permis à l'esclave de fuir la maison de son maitre. Bon gré, mal gré, il fallait que ce jeune homme se résignât à reproduire devant la foule les gestes impudiques des mimes, que cette jeune fille chaste se fit sur la scène l'égale et l'imitatrice des courtisanes : ainsi le voulait la loi de leur naissance. L'Église fit les plus grands efforts pour rompre cette horrible chaîne. Les princes chrétiens, poussés par elle, mais retenus par la passion populaire, qui ne se laissait pas arracher facilement ses favoris, opérèrent avec timidité et lenteur des réformes incomplètes. La première est une loi de 374, rendue par Valentinien[60]. Il y est dit que les scnici ou scnic qui, en danger de mort, demandent les sacrements, peuvent les recevoir. La discipline ecclésiastique voulait, en effet, qu'à l'article de la mort la reconciliatio ne fût refusée à personne[61]. S'ils guérissent, ajoute Valentinien, ils seront libérés de leur condition, et n'y pourront être ramenés de force. Mais il faut, pour cela, que leur demande ait été présentée aux gouverneurs ou aux curateurs des cités, et que des inspecteurs envoyés par ceux-ci aient déclaré que l'acteur ou l'actrice qui veut se convertir est vraiment en danger de mort. On voit ce qu'une pareille concession a de timide : elle ne laisse au scnicus qui veut se convertir en bonne santé aucun moyen de le faire. Il ne semble point qu'il en ait jamais été autrement pour
les hommes voués au théâtre. En 399, les évêques de la province d'Afrique
demandèrent à Honorius que si quelqu'un appartenant
au théâtre, si quis ex qualibet ludicra arte, veut devenir chrétien,
il lui soit permis de se délivrer de cette tache, et qu'il ne puisse ensuite
être contraint par personne à reprendre sa profession[62]. Les codes ne
rapportent aucune loi d'où l'on puisse conclure que leur requête ait été
accueillie. En ce qui concerne les femmes, cette réforme était accomplie
depuis longtemps. En 371, l'année même où fut publiée la loi citée plus Mut,
Valentinien déclara que les filles des scnic,
si elles mènent une vie honnête, auront le droit de ne pas suivre la
profession maternelle : celles qui vivent dans le désordre y seront seules
contraintes[63].
Gratien alla plus loin : par une constitution datée de Milan, en 380, et dans
laquelle il est difficile de ne pas reconnaître l'inspiration de saint
Ambroise, il exempta de la profession scénique les femmes qui, nées dans cette fange, se seraient converties au
christianisme[64].
Il fut interdit de les ramener de force au théâtre, à moins, dit une loi
postérieure (381), que, retombant dans
le désordre, elles ne prouvent par là le peu de sincérité de leur conversion[65]. Un passage
d'une des homélies de saint Jean Chrysostome, en même temps qu'il donne de
curieux détails sur la passion qu'excitaient les femmes de théâtre à la fin
du IVe siècle, offre le commentaire naturel de la loi de 380. N'avez-vous pas entendu parler, dit-il à ses auditeurs
d'Antioche, de cette courtisane phénicienne qui a
vécu de notre temps et qui dépassait toutes les autres en infamie ? Elle
exerçait dans notre ville son métier honteux : elle occupait sur le théâtre
le premier rang : son nom était partout célébré, non-seulement ici, mais
jusqu'en Phénicie et en Cappadoce. Elle a dévoré les richesses d'un grand nombre
: bien des jeunes gens ont été séduits par elle : beaucoup disaient que pour
prendre ainsi tant de monde dans ses filets, il fallait qu'elle ajoutât à sa
beauté le charme des arts magiques. Le frère même de l'impératrice fut un de
ses captifs. Elle exerçait une véritable domination. Tout à coup, je ne sais
comment, ou plutôt je sais bien par quelle force, subitement changée, elle
recouvra la grâce de Dieu, méprisa toutes ces choses, rejeta ces séductions
diaboliques, et s'élança en courant vers le ciel. Rien n'était plus honteux
que cette femme quand elle paraissait sur la scène : personne ne fut plus
chaste que cette pénitente revêtue du cilice. Le préfet, excité par
plusieurs, voulut la ramener au théâtre : des soldats armés essayèrent
vainement de l'y entraîner par la force : ils ne purent l'arracher à la
compagnie de vierges qui lui avaient donné asile[66]. Il est probable
que leurs efforts cessèrent quand la pénitente ou la supérieure du couvent
qui s'était ouvert devant elle eut invoqué la loi. Une autre classe de gens de théâtre attira la sollicitude
de l'Église et l'attention du législateur. La possession par les particuliers
de mimes, de comédiennes, de danseuses, de joueuses de flûte, formant une
sorte de troupe domestique, comme c'était l'usage chez les riches, offrait
pour la morale les plus grands périls. C'était l'esclavage antique dans ce
qu'il avait de pire, exerçant son influence au sein des maisons chrétiennes. Qui ne prendrait pour un débauché et un méchant homme,
dit Lactance, celui qui entretient des comédiens
dans sa maison ?[67] Pendant tout le
cours du IVe siècle, cette coutume subsista. L'Église s'en effrayait : le
concile de Laodicée, tenu en 372, interdit aux prêtres de rester dans un
festin après l'arrivée des thymelici[68]. C'était surtout
la dignité de la vie domestique, à laquelle le christianisme avait tout fait
pour ramener les hommes, qui était menacée par ces murs théâtrales. Parlant
aux chrétiens que la passion du théâtre en détournait, saint Jean Chrysostome
s'efforce de les ramener aux sentiments vrais, à la nature, à la poésie des
choses, à la poésie plus intime du foyer ; il s'écrie, avec cette grâce et,
si l'on ose dire, cette fantaisie charmante qui se mêlait souvent, dans sa
parole, à la plus énergique éloquence : Si vous
voulez récréer votre âme, allez dans les vergers, au bord des fleuves, près
des lacs ; contemplez les jardins, écoutez le chant des cigales, fréquentez
les tombeaux des martyrs. Vous avez une femme, des fils : est-il une joie
égale à celle-là ? Vous avez une maison, des amis : quoi de plus charmant, de
plus précieux ? Qu'y a-t-il donc, dites-moi, de plus aimable que les enfants
? Qu'y a-t-il de plus doux qu'une épouse, pour l'homme qui veut être chaste ?
On cite un mot prononcé par des barbares, et plein de philosophie. Entendant
parler de ces théâtres criminels et de leurs importunes voluptés, ils
disaient : Les Romains ont inventé ces plaisirs, comme s'ils n'avaient ni
femmes ni enfants, montrant par ces paroles que rien n'est plus doux que
des enfants et une femme, à qui veut vivre honnêtement[69]. S'il parlait ainsi
aux hommes qui fréquentaient les spectacles publics, on comprend qu'il
s'élevât avec la plus grande énergie contre ceux qui, suivant son expression,
faisaient de leur maison un théâtre, changeaient
leur maison en décoration de théâtre[70], contre ces riches
qui, en pleine civilisation chrétienne, vivaient comme des contemporains de
Pétrone, et mêlaient à leurs repas des joueurs de
cithare et de flûte, des mimes, des danseuses et des courtisanes[71]. Tous les Pères
de l'Église parlent de même. Chassez de votre maison,
dit saint Jérôme, les joueuses de flute, les
chanteuses, et tout ce chur du diable, mortelles sirènes[72]. Théodose
partageait ces sentiments quand, en 385, il envoya le rescrit suivant à Cynégius,
préfet du prétoire : Il est défendu à tous d'acheter
des fidicinæ, d'en instruire, d'en vendre, d'en faire paraître dans
les repas ou les spectacles ; que personne ne possède, même pour son plaisir,
des esclaves musiciennes[73]. Il ne paraît
point que cette loi ait été strictement observée ; plusieurs des textes qui
viennent d'être cités lui sont postérieurs ; Arcadius, évêque d'Amasée, qui
vivait sous les fils de Théodose, montre encore les musiciennes et les
danseuses faisant partie du personnel des festins[74]. Cependant, il
semble qu'elle ait produit, quelque effet en Occident. Dans la salle à manger de qui vous souvenez-vous d'avoir
vu un danseur ou une danseuse ? demande, dans Macrobe, un des convives
du consul Prætextatus[75] : bien qu'il ne
soit pas question ici des musiciennes, auxquelles s'applique spécialement la
loi, il paraît résulter de ce passage, et d'autres encore, des Saturnales,
que la discipline des festins était, dans le grand monde de Rome, devenue
plus sévère quelques années après la constitution de 385. Claudien loue de
même Stilicon de n'avoir point admis de chanteurs et de joueurs de cithare à
ses repas[76]. Une seconde loi de Théodose, édictée neuf ans après celle-ci, est inspirée par le même esprit. Les danseurs ou les pantomimes avaient sous leurs ordres des esclaves, qui figuraient dans les représentations. Les plus méprisés de ces histrions étaient connus sous le nom de thymelici : ils associaient ordinairement la prostitution au théâtre[77]. Théodose, en 394, leur interdit de posséder des esclaves chrétiens[78]. Le titre De scnicis, au Code Théodosien, rapporte une autre loi relative à cette catégorie de gens de théâtre ; chose étrange et qui montre bien à quelles fluctuations obéissait la législation impériale en ces matières, la loi dont je parle, qui est de 380, et se place, par conséquent, entre celle ayant pour objet les fidicinæ et celle qui vient d'être analysée, semble inspirée par un esprit tout païen : elle défend d'enlever et de conserver dans sa maison des thymelicæ, et le motif qu'elle donne de cette prohibition, morale en apparence[79], est la crainte que ces femmes soient ainsi détournées de servir aux plaisirs publics, voluptatibus publicis non serviat[80]. Le plus curieux et le plus humiliant exemple de ces retours à l'esprit païen est une loi rendue par Honorius en 413, c'est-à-dire trois ans après le sac de Rome par Alaric. Il semble que, les terreurs de ce moment passées, l'empire ait été pris d'une fièvre de plaisirs et de folie. Elle se fit sentir surtout en Afrique. Saint Augustin nous montre les Romains fugitifs se battant pour des histrions dans les théâtres de Carthage[81]. Les spectacles, ajoute-t-il, furent, à partir de cette époque, beaucoup plus insensés qu'auparavant : foulés aux pieds par l'ennemi, vous n'avez rien perdu de votre luxe ; vous n'avez pas su mettre à profit vos infortunes ; vous avez été malheureux, et vous êtes demeurés aussi corrompus qu'auparavant[82]. A cette disposition des esprits se rapporte une loi d'Honorius, relative à la ville de Carthage, et adressée au tribunus voluptatum, c'est-à-dire au magistrat chargé de l'intendance des fêtes publiques[83] : l'empereur déclare que toutes les mim qui, par un bienfait du prince, ont été libérées des liens de leur condition, y doivent être réintégrées, même par force, somma instantia, afin, dit-il, que ni les plaisirs du peuple, ni les jours de fête ne soient privés de leur éclat accoutumé[84]. Il faut, dans ce déclin de la fortune romaine, parcourir un demi-siècle avant de retrouver dans la législation impériale une trace de cette sollicitude pour les murs publiques qui a fait l'honneur du règne de Théodose. En 468, Léon, qui gouvernait l'empire d'Orient, chargea par un édit solennel les magistrats des villes et les évêques de veiller à ce qu'aucune femme, libre ou esclave, ne fût contrainte de faire partie des troupes de mimes ou de chanteuses et rie pût être obligée à monter malgré elle sur le théâtre[85]. C'était l'abolition complète de l'ancienne servitude des gens de théâtre : c'était plus que cela, c'était donner à l'esclave elle-même le droit de résister à un ordre que sa conscience repoussait. En 534, Justinien, par un rescrit adressé aux évêques établis dans le monde entier, renouvela cette loi[86] : une novelle postérieure du même prince annula même les engagements contractés librement par une femme de théâtre : mieux vaut, dit-il, manquer à un engagement impie que mener une vie impure[87]. Je ne sais s'il faut attribuer ces actes de Justinien à l'influence de l'ancienne pantomime Théodora, devenue la femme de l'empereur : même si l'on ajoute foi aux turpitudes racontées d'elle par Procope, il sera beaucoup pardonné à celle qui, après avoir retiré, à prix d'argent, cinq cents femmes des mauvais lieux de Constantinople, et peut-être du théâtre, qui, à cette époque, se confondait presque avec eux, leur ouvrit, dans un palais de la côte du Bosphore, un asile honorable et pur, et donna l'exemple de la charité chrétienne envers les filles repenties[88]. IV Aucune statistique ne permet de se rendre un compte exact de la diminution, certaine cependant, du nombre des esclaves à l'époque qui nous occupe. Elle dut être considérable. L'action de l'Église, constamment dirigée vers ce but, ne demeura pas sans effet : il est certain que, sous l'impulsion de l'esprit chrétien, les affranchissements furent plus fréquents et s'appliquèrent à plus.de personnes, que beaucoup de fidèles, en renonçant à des plaisirs fastueux ou coupables, réduisirent dans une grande proportion le nombre de leurs serviteurs, que les enfants exposés devinrent plus rares, et que, parmi les enfants recueillis, beaucoup, l'ayant été par la charité chrétienne, furent élevés non pour la servitude, mais pour la liberté. Ce sont là des faits d'ordre moral, qu'il est impossible de traduire par des chiffres, mais dont, cependant, l'influence ne put pas ne point se faire sentir au dehors. D'autres causes tout extérieures, et auxquelles le christianisme n'a point de part, contribuèrent à diminuer le nombre des esclaves. Parmi les sources de l'esclavage, une des plus abondantes, la conquête, fournit, un contingent de plus en plus faible à partir du Me siècle. Le temps des grands succès militaires était passé. Sous la république, on avait vu Paul Émile vendre 150 mille prisonniers Épirotes, Marius ramener des plaines d'Aix et de Verceil 90 mille Teutons et 60 mille Cimbres, Lucullus faire dans le Pont un si grand nombre de captifs que, si l'on en croit Appien, la marchandise humaine descendit un instant au prix de 4 drachmes (3 fr. 50) par tête, César tirer des Gaules conquises au moins quatre cent mille esclaves, Caton en ramener de Chypre et Cicéron lui-même mettre en vente ses captifs de Cilicie. Au commencement de l'empire, Auguste avait fait dans les montagnes des Salasses 44 mille prisonniers : 99 mille esclaves juifs avaient été jetés sur les marchés de Rome par Titus[89]. Au IIIe siècle, l'empire était réduit à repousser les barbares, et les captifs provenant de ces guerres défensives furent plutôt répandus à titre de colons dans les campagnes appauvries qu'ils n'entrèrent dans les rangs de l'esclavage proprement dit. Pour que le nombre des esclaves ne diminuât pas, il eût fallu que l'esclavage eût suffi à se recruter lui-même. Tout démontre qu'il n'en put être ainsi. Le nombre des esclaves mâles dépassa toujours celui des femmes esclaves : beaucoup d'esclaves de l'un et de l'autre sexe étaient maintenus par leurs maîtres dans un célibat rigoureux : parmi les femmes, un très-grand nombre, vouées à la débauche dans la maison même où elles servaient, ou contraintes à la prostitution, se trouvaient frappées de stérilité, conséquence naturelle de ce genre de vie. De plus ; par l'effet des supplices, des mauvais traitements, d'un travail meurtrier, de l'intérêt du maître à ne pas nourrir de vieux esclaves qui ne pouvaient plus lui procurer de bénéfices, la quantité des décès dut être très-grande dans la classe servile : il dut y avoir, dans cette classe, un excédant considérable du nombre des décès sur celui des naissances[90]. Appien a remarqué que les esclaves ruraux se multipliaient vite[91] : cela tenait à ce que beaucoup d'entre eux jouissaient d'une liberté plus grande que ceux des villes, à ce que les maîtres favorisaient davantage leurs mariages, et à ce que leurs femmes étaient moins exposées aux débauches vénales : mais la classe des esclaves ruraux, qui était devenue très-nombreuse quand celle des paysans libres avait diminué, avait décru à son tour à mesure que les pâturages, qui exigent peu d'hommes, avaient remplacé en beaucoup de lieux les cultures, qui demandaient un grand nombre de bras : à la fin du IIIe siècle cette transformation était généralement accomplie. La fécondité des esclaves ruraux ne pouvait donc suffire à combler, dans l'ensemble de la population servile, le vide qui s'y creusait chaque jour. Tant qu'il n'y eut point de diminution dans les sources extérieures de l'esclavage, ce vide fut peu sensible : quand Rome eut cessé de faire des conquêtes, on commença à en mesurer la profondeur. Un des indices les plus remarquables de la diminution du nombre des esclaves est celui-ci : dans les deux premiers siècles de l'empire, l'esclave mâle se vendait beaucoup plus cher que la femme esclave : au commencement du IIIe, Septime Sévère fixa à une même somme la valeur moyenne des esclaves, sans distinction de sexe[92] : au commencement du VIe, Justinien établit parité de prix réel entre les esclaves des deux sexes[93]. Les sources extérieures de l'esclavage étant presque taries, la femme esclave acquérait une plus grande valeur, comme moyen de reproduction. A mesure que diminuait le nombre des esclaves, celui des travailleurs libres augmentait. Les uns prenaient peu à peu la place des autres. M. Wallon a analysé dans tous ses détails[94] ce mouvement qui introduit des hommes libres dans des fonctions originairement réservées aux esclaves publics, agrandit les cadres des collèges voués aux services intéressant l'État, la richesse commune, le bien général, et, la contrainte publique aidant, pousse de tous côtés les hommes libres dans ces divers corps de métier, où il les retient par le lien de fer de la corporation. Les conditions du travail ne sont pas absolument changées : si la population industrielle libre augmente, s'organise, se classe, les esclaves continuent cependant à travailler sous les ordres du chef d'atelier : le pistor public, attaché par l'État à sa boulangerie, doit tenir celle-ci garnie de meules, d'animaux et d'esclaves[95]. Il en est de même dans toutes les autres corporations. La proportion seule change : les ateliers renferment moins d'esclaves, plus d'ouvriers. Ainsi, malgré la diminution du nombre des esclaves, les conditions du travail ne se modifient qu'insensiblement. Elles restent les mêmes pour les prolétaires, qui sont, au IVe siècle, à Constantinople comme à Rome, et même à Alexandrie, nourris ou au moins assistés dans une large mesure par l'État[96]. Elles diffèrent en deux points seulement : la concurrence des esclaves, qui les écartait autrefois du travail, est considérablement affaiblie, et le travail, grâce à l'idée chrétienne, à qui seule peut être attribuée cette révolution morale[97], a cessé d'être un objet de mépris. Ils doivent donc, par une ascension lente et graduelle, s'élever au rang honorable de l'ouvrier tel que le moyen âge et l'époque moderne nous le présentent. Le travail, au contraire, pèse beaucoup plus lourdement qu'auparavant sur l'homme libre de condition aisée, le propriétaire, le chef d'industrie. Dans le monde romain, quiconque possède la terre ou les capitaux, quiconque est solvable se trouve par là même astreint, obnoxius, à quelque service public. Une partie de l'impôt est payée en nature, c'est-à-dire en travail. De même que les détenteurs de certains fonds provinciaux sont tenus de contribuer, pour une quote-part, à l'alimentation de l'empire, en fournissant des tributs de blé ou d'autres denrées, de même que la possession d'une certaine fortune territoriale donne place dans la curie, c'est-à-dire dans la corporation municipale qui répond à l'État de la levée des impôts, de même d'autres propriétaires sont rangés d'office dans les corporations qui subviennent à quelque détail de la vie générale. Tels sont les collèges des navicularii, chargés du transport par eau de l'annone, des nautæ Tiberini, qui doivent conduire à Rome, en remontant le Tibre, le canon frumentarius, des pistores ou boulangers publics, des collecteurs des bufs, des porcs, du vin, servant à l'alimentation du peuple ; à des degrés inférieurs, les collèges des portefaix, des peseurs et mesureurs publics, des fabricants de chaux, des administrateurs des thermes, les corporations chargées de lever et de conduire les chevaux destinés à l'armée[98], etc. Toutes les villes importantes renferment des collèges ainsi voués aux services publics[99]. On y entre de plusieurs manières : 1° par le choix de l'État, qui se charge de leur recrutement, y pousse de force les oisifs, c'est-à-dire ceux sur lesquels ne pèse encore aucune charge de cette nature, otiosi, vacantes, vacui publico officio[100], verse quelquefois dans un grand collège, dont les membres diminuent, ceux d'une petite corporation, de minusculis corporibus[101], y enrôle les étrangers, peregrini[102], y introduit même des condamnés[103] ; 2° par la possession de certains fonds soumis aux obligations de tel ou tel collège, fundos functioni adscriptos[104], et qu'on ne peut ni acheter, ni acquérir à titre d'hérédité, de legs, de donation, sans devenir membre de la corporation à laquelle appartenait le précédent propriétaire[105] ; 3° par l'entrée dans la famille d'un corporatus, par exemple quand on épouse la fille d'un pistor[106] ; 4° par suite de certaines circonstances, comme la possession d'un navire propre aux transports, qui classe d'office son propriétaire dans le collège des navicularii[107], ou d'une barque sur le Tibre, qui en fait un nauta Tiberinus[108]. Cet état de choses, qui tient à tout le système d'impôts établi dans le monde romain, n'est pas particulier au IVe siècle. Ainsi, l'on attribue à Trajan l'organisation du collège des pistores[109], à Aurélien celle du collège des suarii[110]. Mais à cette époque appartiennent la plupart des lois qui tendirent outre mesure le lien qui attachait les hommes libres, les classes aisées, à ces divers services publics. Au IVe siècle, le corporatus fut véritablement enchaîné à son collège, comme le curiale à la curie. Après lui, ses obligations passèrent à ses enfants[111]. Il lui fut interdit d'aspirer aux dignités qui auraient pu l'en libérer[112]. La porte des monastères, l'entrée du clergé, lui fut quelquefois fermée, de peur qu'il ne frustrât l'État de son travail[113]. Il n'eut pas même le droit de voyager sans autorisation, comme le curiale, du reste, ne pouvait s'éloigner de la curie sans congé : une loi de 412 ordonne aux gouverneurs de province de renvoyer à Rome tous les corporati absents, afin qu'ils puissent reprendre leur service, ut servire possint functionibus[114]. Cette servitude du travail n'atteignait les classes populaires que dans une faible mesure et dans des circonstances exceptionnelles : elle pesait surtout sur les rangs moyens de la société. Ses désastreux effets ont été souvent décrits : au commencement du Ve siècle, les pouvoirs publics furent quelquefois obligés de ramener de force à leur fonction des corporati qui avaient pris la fuite, s'étaient cachés dans les campagnes, mêlés aux colons et même aux esclaves, et avaient tenté de se confondre avec eux en épousant leurs filles[115] : Honorius se plaint que beaucoup de villes ont perdu leur ancien éclat par suite de cet abandon. Il faut, cependant, se garder ici de trop généraliser. Les hommes dont il s'agit appartenaient pour la plupart à un milieu social relevé. Les lois, en spécifiant avec soin que nulle dignité ne les fera sortir de leur corporation, indiquent quels étaient, en général, leur fortune et leur rang. Les navicularii avaient droit à l'ordre équestre[116] : plusieurs étaient sénateurs[117]. Les pistores, bien qu'inférieurs aux navicularii, pouvaient également faire partie du sénat[118]. Il est question de suarii qui ont essayé d'échapper à leurs obligations en suivant la carrière des honneurs, honoribus evecti[119]. Après cinq ans d'exercice, le patron des caudicarii du Tibre et les principaux des suarii obtenaient de droit le titre de comte du troisième ordre[120]. Dans la plupart des corporations moins élevées affectées comme celles-ci à des services publics, les hommes qui les composaient étaient possesseurs d'une certaine fortune territoriale : en principe, c'était la terre, non l'homme, qui servait, res enim oneri addicta est, non persona[121]. A moins d'admettre une ruine générale, plus complète que ne l'indiquent, en dehors de textes de loi, les autres documents de l'époque, il est impossible de croire à une désertion en masse des membres des collèges : les lois que j'ai indiquées font allusion à des cas isolés. Ils purent être nombreux, mais il durent demeurer toujours à l'état d'exception. De plus, il ne faut pas juger de la situation des classes moyennes uniquement par l'oppression qui pesait sur les collegiati ou, à côté d'eux, sur les curiales. Outre les collèges voués à des services publics, on compte un grand nombre d'autres corporations composées de commerçants, d'industriels, d'artisans, unis librement avec l'autorisation et sous la surveillance de l'État. Les corporations de cette nature existaient depuis plusieurs siècles' : elles avaient une grande importance au IVe, où la tendance universelle et comme un instinct de préservation sociale portait les individus et les intérêts à se grouper. A cette époque, si le travail était, à bien des égards, opprimé, si la main de l'État pesait lourdement sur lui, si de nombreux impôts lui étaient demandés, il était, en revanche, plus honoré qu'il ne fut dans aucun des siècles précédents. On était bien loin de l'époque où les arts mécaniques étaient considérés comme sordides et le commerce lui-même comme peu honorable. Au IVe siècle, l'exercice distingué d'un métier, vulgaris artis cujuslibet obsequium, pouvait conduire à la dignité de comte du premier ordre[122]. Symmaque nomme dans une de ses lettres Cyriades, vir clarissimus, comes et mechanicus[123]. Le travail manuel était devenu une source de noblesse. On le voit, il y avait des compensations à la situation pénible qu'une politique peu éclairée, qui cherchait à réveiller par la contrainte les forces vives du travail, avait faite aux classes moyennes. D'une part, un grand nombre d'industries et de métiers libres leur étaient laissés : la loi ne poussait dans les corporations spécialement affectées à des services publics que ceux désignés d'avance par l'origine ou la situation de leurs propriétés, ou qu'un lien héréditaire y rattachait, ou enfin qu'elle considérait comme employant leur vie d'une manière inutile à la société, otiosi, vacantes : c'était une oppression que l'ignorance économique de cette époque explique seule : mais elle ne pesait pas sur tous. D'autre part, si fausse, à beaucoup d'égards, que fût la politique industrielle du iv' siècle, elle honorait le travail tout en le tyrannisant. Ce sentiment nouveau rejaillit sur les classes populaires, sur les ouvriers proprement dits. Ils échappèrent en grande partie aux fardeaux qu'avaient à supporter les classes plus élevées. L'impôt si maudit du chrysargire[124], assez analogue à notre impôt des patentes, et qu'une société plus forte eût à peine ressenti, ne fut pas demandé aux artisans, c'est-à-dire, selon l'expression de Valentinien, à ceux qui gagnent leur vie par le travail de leurs mains, comme les potiers et les charpentiers[125] : il ne frappa que les producteurs qui joignaient à leur art un commerce, grand ou petit. Grâce à la diminution du nombre des esclaves et à la presque entière disparition des préjugés qui pendant plusieurs siècles avaient tenu l'homme libre écarté du travail, les artisans retrouvèrent peu à peu le rang qui leur appartient dans une société ordonnée selon la vérité et la justice. Sans doute, l'état du peuple ne changea pas brusquement. Il ne s'habitua pas immédiatement à vivre sans dépendre des secours de l'État : le pli était pris depuis trop longtemps. Pendant le IVe et le Ve siècle, les distributions gratuites et les ventes à bas prix de blé, d'huile, de lard, auxquels Constantin, plus hardi qu'Aurélien, avait ajouté des rations de vin, continuèrent d'avoir lieu : un grand nombre de constitutions impériales les règlementent[126], et c'est précisément pour y subvenir que furent si sévèrement organisées les corporations des pistores, des pecuarii, des suarii, etc. Mais, au milieu de ces restes du socialisme ancien, le travail libre se développait : l'influence chrétienne favorisait activement ses progrès. Saint Jean Chrysostome s'élève contre la plèbe oisive et
les coureurs de sportule : il montre combien les hommes qui obéissent au devoir du travail lui sont supérieurs : De quoi faut-il rougir ? du péché seul, de ce qui offense
Dieu, de ce qui est défendu, mais il faut se glorifier du travail et des
métiers. En travaillant, nous chassons de nos curs les mauvaises pensées,
nous pouvons venir en aide aux indigents, nous cessons de frapper avec
importunité aux portes d'autrui, et nous accomplissons cette parole du Christ
: Il vaut mieux donner que recevoir... Ceux
qui sont oisifs non seulement font mal, parce qu'ils négligent le devoir de
subvenir à sa vie par son propre travail et se rendent importuns aux portes
d'autrui, mais encore parce qu'ils se corrompent et deviennent les pires des
hommes[127]. Le même Père revient sans cesse, et avec prédilection, sur ce type de l'ouvrier chrétien qui commençait à passer dans la réalité commune, et dont il voit les premiers exemplaires dans les apôtres, ou dans les deux époux Aquila et Priscille. S'adressant à des hommes du peuple, qui remplissaient le forum de leurs rixes : N'as-tu pas honte, ne rougis-tu pas, de te conduire comme un animal sauvage, de ravaler ainsi ta noblesse ? tu es pauvre, mais tu es libre, tu es ouvrier, mais tu es chrétien[128]. Il peint le bonheur modeste et digne d'envie de l'artisan : Vous voyez souvent l'homme qui possède une épargne de dix mille talents proclamer heureux celui qui travaille dans un atelier et gagne sa nourriture par le labeur de ses mains[129]. Selon l'idéal charmant de saint Jean Chrysostome, l'atelier chrétien est un lieu où l'on travaille et où l'on chante en famille : La femme qui file ou qui tisse peut en même temps élever son âme au ciel et faire monter vers Dieu une prière ardente : celui qui est assis dans un atelier et qui coud des cuirs peut tourner son âme vers Dieu[130].... Apprenez à vos fils et à vos femmes à chanter des psaumes, et quand ils tissent ou travaillent, et même quand ils sont à table. Ouvrier, vous pouvez, assis dans la boutique et travaillant, chanter[131]. Ces paroles rappellent de belles maximes attribuées par des manuscrits orientaux aux Pères du concile de Nicée, et qui, si elles ne sont pas authentiques, expriment cependant l'idée qu'au IVe et au Ve siècle on se faisait de l'ouvrier chrétien : Hâte-toi vers l'église, et ensuite à ton métier, pour que Dieu bénisse l'uvre de tes mains : celui qui va à son métier avant d'entrer à l'église, travaille en vain. Retiens ce que tu as entendu dans la maison de Dieu, et roule-le dans ta pensée, pendant le travail comme en voyage. Celui qui cherche un refuge en Dieu s'amasse un secours intérieur[132]. A toutes ces paroles, à cet accent nouveau, ne sent-on pas qu'une veine de joie pure s'est ouverte, et qu'un rayon d'allégresse, un souffle de paix, traverse cette société laborieuse et croyante ? L'ouvrier chrétien apparaît avec sa dignité simple et modeste, son influence bienfaisante, son humble prospérité, dans cette épitaphe écrite en latin barbare du IVe ou du Ve siècle sur la tombe d'un fabricant de dés d'ivoire, artifex artis tessalariæ lusoriæ : De peu de chose il nous a élevés à une condition médiocre, mais dont personne n'eût pu rougir : il a été le premier de sa corporation : c'est lui qui exhortait ses compagnons : il fut d'une admirable bonté, d'une admirable innocence, de parbula mediocritatem nostram digno fecit omnium hominum, sodalicii magister et hortator, miræ bonitatis et innocentiæ homo[133]. On ne peut lire les écrits des Pères du rve siècle sans y découvrir de nombreux indices de cette renaissance du travail libre : ils parlent sans cesse du peuple et au peuple, et l'on entrevoit dans la société à laquelle ils s'adressent un véritable mouvement industriel, une vie populaire très-intense. Si la pauvreté était supprimée, dit saint Jean Chrysostome, l'économie des choses serait détruite et tout moyen de vivre ôté ; il n'y aurait ni matelot, ni pilote, ni laboureur, ni maçon, ni cordonnier, ni forgeron, ni ouvrier en airain, ni corroyeur, ni boulanger, ni artisan d'aucune nature. La nécessité, comme une prévoyante maîtresse, pousse chacun au travail, même malgré lui[134]. Cela ne semble point une société morte, où l'État, à la façon d'un garde-chiourme, aurait contraint les hommes à travailler. Les villes ont l'aspect animé de ces cités du moyen âge, où l'on voyait, dans les fêtes publiques, les corporations marcher processionnellement, parées de leurs insignes ; quand saint Athanase, revenant d'exil, entre dans Alexandrie (la ville de l'empire où, même à l'époque païenne, le travail était resté le plus en honneur[135]), le peuple le reçoit en triomphe : les habitants, dit saint Grégoire de Nazianze, se portent au-devant de lui, divisés par sexe, par âge et par métiers, car tel est l'usage de cette ville lorsqu'elle veut faire honneur à quelqu'un[136]. Même les ouvriers des manufactures impériales, dont le sort paraît si triste quand on parcourt les lois qui les concernent, sont, en réalité, très-turbulents et très-libres. L'État possédait des mines, des carrières, des salines, des pêcheries de pourpre ; il exploitait des ateliers de monnayeurs, d'orfèvres, des fabriques d'armes ; il dirigeait les tissages et les teintureries qui fournissaient les étoffes destinées à l'armée, au prince et à sa famille. Il y avait en Gaule huit fabriques d'armes, trois ateliers d'orfèvrerie, des teintureries, plusieurs manufactures de tissus. L'Italie, l'Espagne, l'Afrique, les provinces orientales, comptaient un grand nombre d'établissements de même nature. On y employait concurremment des esclaves, des condamnés, des ouvriers libres. La condition légale de ces derniers se rapprochait à certains égards de l'esclavage. Leur travail était soumis aux règlements les plus sévères[137]. On les marquait au bras avec un fer rouge, afin de les retrouver s'ils prenaient la fuite[138]. Le service des manufactures de l'État était héréditaire[139] ; ceux qui y travaillaient n'avaient même pas le droit de se marier hors de leur corporation[140]. Il leur était interdit de travailler pour les particuliers[141]. Ils ne pouvaient se soustraire au joug de l'atelier qu'en présentant un remplaçant[142]. Ce joug était peut-être plus dur en apparence qu'en réalité. Il semble toujours que, au IVe siècle, le travail manuel côtoie de très-près la noblesse : Constantin interdit aux monetarii d'aspirer au titre de perfectissimes, au rang de ducénaires, de centénaires, à l'égrégiat[143], qui les auraient libérés des liens de leur profession. Cela seul montre que la condition de ces hommes n'était pas absolument misérable. Ils formaient une caste, enchaînée à un monopole, mais se sentant nécessaire, et avec laquelle on était obligé de compter. Ils avaient une force redoutable : une révolte de monetarii, dont la cause est inconnue, coûta à Aurélien sept mille hommes de ses meilleures troupes[144]. A la fin du IVe siècle, ils se mêlaient à toutes les émotions populaires, et y tenaient le premier rang. Saint Grégoire de Nazianze raconte une émeute qui éclata à Césarée en faveur de saint Basile, menacé par un juge impie : le peuple est en émoi : tous, comme un essaim d'abeilles que la fumée fait sortir de la ruche, se lèvent et s'agitent ; avant tous les autres sont les fabricants d'armes et les tisserands des manufactures impériales ; car, dans les circonstances semblables, il sont les plus promptement échauffés et les plus audacieux, à cause de la liberté et de la licence dont ils jouissent[145]. Il semble donc que la situation des hommes voués au travail industriel ait été, à tous les degrés de la société, moins dure que ne l'indiquent les lois du IVe et du Ve siècle. Celles-ci cherchèrent dans des moyens empiriques un remède à la détresse de l'empire, qui supportait le poids d'une mauvaise constitution économique, fruit de la prépondérance de l'esclavage pendant plusieurs siècles : elles multiplièrent les règlements restrictifs, les pénalités, les entraves de toute sorte ; mais en même temps se développait, sous l'influence chrétienne, un principe de liberté et de vie dont les classes populaires ressentirent promptement les effets : il fit contrepoids au mouvement qui entraînait la législation dans une fausse voie, et permit au progrès de s'accomplir au milieu même de la décadence intérieure et extérieure de l'empire. V Au IVe siècle, non-seulement la haute bourgeoisie[146], mais aussi la plèbe des villes était en grande partie chrétienne. Regardez-la, dit Prudence : qui parmi elle ne méprise l'autel souillé de Jupiter ? Tous ceux qui habitent le dernier étage des maisons et se nourrissent du panis gradilis, vont en pèlerinage aux souterrains du Vatican, ou courent au baptistère de Latran recevoir l'onction sainte[147]. Il n'en était pas tout à fait ainsi dans les campagnes. Le christianisme y avait moins profondément pénétré : il était déjà maître des villes à une époque où il avait à conquérir, en dehors d'elles, bien des lieux rebelles à son influence, dernier refuge des superstitions païennes. Les Vies des saints nous montrent des missionnaires parcourant encore, du IVe au VIe siècle, en Occident surtout, certains cantons ruraux, et y rencontrant une grande résistance[148]. Ceci s'explique facilement : en général, les campagnes gardent longtemps les vieilles murs et se laissent difficilement entamer par les idées nouvelles. Il en est surtout ainsi dans les contrées où la population est peu dense et où les communications sont rares. Tel était, au IVe siècle, l'état des campagnes dans une grande partie de l'empire. En beaucoup de lieux, à la culture, qui groupe naturellement les hommes, avait succédé l'exploitation de vastes pâturages, qui formait quelquefois de véritables déserts. Bien des centres de population avaient ainsi disparu. De là, pour la prédication chrétienne, un grand obstacle : les points d'appui, c'est-à-dire les villages, les groupes d'habitations, jouissant d'influence et de rayonnement, lui manquaient fréquemment dans les campagnes. Si, quand écrivait Prudence, les paysans du Picenum, du Samnium et de l'Étrurie se rendaient à Rome pour l'anniversaire du martyre de saint Hippolyte[149], si les laboureurs des environs d'Antioche accouraient autour de la chaire de saint Jean Chrysostome le jour de l'Ascension[150], il y avait, à la même époque, des contrées peu fréquentées, éloignées des villes ou des bourgs importants, dans lesquelles le nom du Christ était à peine connu, où les chapelles des dieux rustiques demeuraient debout, où l'on voyait au milieu des champs se dresser des autels de pierre et des idoles, et où l'on entendait au fond des bois retentir les chants de paysans ivres, revêtus de la dignité de prêtres de Diane ou d'aruspices[151]. La population rurale se composait, au IVe siècle, de plusieurs éléments. Un même domaine, villa, c'est-à-dire une exploitation d'une étendue quelquefois immense, comprenait souvent, outre les esclaves ruraux, inscrits sur les registres du cens comme une partie intégrante du fonds, et que, depuis une loi de Valentinien et Gratien, on ne pouvait vendre sans lui[152], des affranchis qui, en vertu de leur contrat d'affranchissement, devaient continuer leurs services au propriétaire du sol, et enfin des hommes libres. Ces derniers n'étaient pas tous de la même condition : il y avait parmi eux des fermiers exploitant, suivant les règles ordinaires, un certain lot de terres pris à bail, et des hommes qui, sans être esclaves, étaient attachés par la loi même à la terre qu'ils cultivaient. Ils consistaient, soit en barbares, que l'État distribuait dans les provinces pour remplacer la population rurale épuisée, soit en citoyens romains chassés de leurs villes par la misère, l'oppression, les troubles de toute nature qui agitaient l'empire à cette époque, et venus demander asile au propriétaire du sol[153], soit enfin en descendants des uns et des autres, car le nexus colonarius une fois établi ou par une attribution de l'État, ou par une convention, ou par la prescription, devenait héréditaire. Quelle que fût leur origine, les coloni se trouvaient incorporés au domaine sur lequel eux ou leurs pères avaient été reçus : ils devenaient, selon l'expression d'une loi, membres de la terre[154]. Ils jouissaient des droits de l'homme libre, autant que ceux-ci pouvaient se concilier avec leur qualité d'immeubles par destination. Ils se mariaient valablement, possédaient tous les droits conjugaux et paternels, conservaient le titre d'ingénus. Ils étaient soumis à l'impôt personnel. Ils étaient tenus d'une redevance annuelle, tributum, envers le propriétaire du sol. Ils ne pouvaient être vendus. Quand le sol auquel ils étaient attachés passait à un autre propriétaire, ils changeaient de maître avec lui. Il leur était interdit de s'enfuir : le colon fugitif pouvait être condamné à l'esclavage[155]. Telle était la condition d'un grand nombre d'habitants des campagnes. On la voit se dessiner nettement dans les lois du IVe siècle. Avant cette époque, cet état intermédiaire entre l'esclavage et la pleine liberté n'existait pas, ou n'existait guère que pour les captifs barbares transplantés dans l'empire. Le sol rural était habité par des hommes libres, propriétaires, fermiers, ouvriers, devenus peu nombreux à cause des progrès de l'esclavage et de l'extension des latifundia, et par. des esclaves, dont le travail, dans les campagnes comme dans les villes, s'était presque entièrement substitué à celui des ouvriers proprement dits. Au IVe siècle, la misère, en poussant vers les campagnes un grande quantité d'hommes libres, n'eut pas, cependant, pour effet de repeupler celles-ci ; mais c'est à elle surtout que doit être attribuée la formation de cette classe particulière de paysans, les coloni. La diminution du nombre des esclaves, qui se faisait sentir à cette époque dans les campagnes comme dans les villes, se trouvait ainsi compensée. Les exploitations rurales n'étaient plus telles que nous les montrent Varron et Columelle : l'homme libre y trouvait une place. Il y avait là, à certains égards, un progrès. Si l'homme libre travaillait à côté de l'esclave, celui-ci, le voyant attaché à la terre, soumis en certaines choses au pouvoir, même coercitif, de leur maître commun[156], sentait que la distance qui les séparait s'était amoindrie : entre l'esclave à qui, par l'influence chrétienne, les droits de famille avaient été restitués, qui était devenu époux et père, qui depuis le milieu du IVe siècle ne pouvait plus être séparé violemment de sa femme et de ses enfants, puisque l'on ne pouvait vendre ni lui ni eux sans le fonds sur lequel ils étaient inscrits ensemble, et l'homme libre attaché au sol comme lui, il n'y avait plus que des différences légères : elles devaient s'effacer peu à peu, non au préjudice, mais au profit de la liberté. A un autre point de vue, l'institution du colonat semble en certains lieux avoir été un bienfait : peut-être favorisa-t-elle dans une certaine mesure l'évangélisation des campagnes. Les coloni ne pouvaient être ordonnés clercs sans le consentement du propriétaire du sol[157] : quand ils étaient entrés dans les rangs du clergé, ils devaient exercer leurs fonctions ecclésiastiques sur le fonds auquel ils étaient attachés, et on n'y pouvait établir de prêtres originaires d'un autre lieu[158] ; ils étaient même obligés de continuer leurs fonctions agricoles après avoir reçu le caractère sacerdotal[159]. Un propriétaire chrétien, préoccupé des besoins religieux de ses paysans, pouvait, à l'aide de clercs enfants du sol, fonder dans ses domaines des centres religieux, des paroisses. Il faut citer, sur ce point, une belle et curieuse exhortation de saint Jean Chrysostome : il montre aux propriétaires ruraux que la vie religieuse, à mesure qu'elle croîtra dans leurs domaines, y fera croître le travail : il leur peint le vieux prêtre donnant l'exemple aux paysans et travaillant de ses mains, il leur rappelle que la propriété a charge d'âmes : Beaucoup construisent des forums
et des bains : peu bâtissent des églises. Je vous en avertis, je vous en
supplie, je vous le demande en grâce, je vous en fais une loi, qu'aucun de
vous ne possède un domaine rural où il n'y ait point une église... Nourrissez-y un catéchiste, un diacre, une communauté de
prêtres[160]. Que cette église soit pour vous comme une épouse ou une
fille : donnez-lui une dot. Et ainsi votre terre sera bénie... Cela est utile à la paix de ceux qui la cultivent. Le
prêtre sera vénéré, la sécurité du domaine en sera plus grande. Bans cette
église on priera sans cesse pour vous : on y fera des réunions pieuses, on y
chantera des hymnes pour votre salut : on y célébrera chaque dimanche le
sacrifice... Vous qui commencez, vous serez
cause que le bien se fera autour de vous à votre exemple. Grâce à vous, il y
aura des catéchumènes dans les domaines voisins. Les bains rendent vos
paysans plus mous, les tavernes les rendent plus délicats : et cependant, par
vaine gloire, vous leur en construisez. Le forum, les grandes assemblées, les
rendent plus difficiles à conduire. Au contraire, les églises. Quelle belle
chose ce sera, de voir le prêtre marcher, à l'exemple d'Abraham, la tète
blanchie, les reins ceints, creusant la terre, travaillant ! Quelle belle
chose ce sera, de pouvoir entrer dans la maison de Dieu, en sortir, se disant
qu'on l'a construite ! de pouvoir, après avoir pris son repos, après avoir
assisté à l'office du soir et à celui du matin, recevoir le prêtre à sa
table, converser avec lui, jouir de sa bénédiction, voir les autres venir à
lui ! Voilà le vrai rempart, la vraie sauvegarde de vos champs. Voilà le
domaine de qui il est dit : Il a l'odeur du champ fertile, que le Seigneur a
béni., Si votre villa vous paraît douce, parce que vous y trouvez le repos et
le loisir, que serait-elle, si vous y ajoutez cela ? Un domaine qui renferme
une église est semblable au paradis de Dieu... Et quelle sera la dépense, dites-moi ? Faites le temple petit : celui
qui viendra après vous y ajoutera un portique : celui qui lui succédera y
ajoutera autre chose : et vous aurez le mérite de tout. Vous aurez donné peu,
vous recevrez la récompense de tout. Commencez donc, posez le fondement,
concertez-vous pour cela les uns avec les autres... Construisez une défense contre le diable : une église est
cela. De l'église sortiront des mains prêtes au travail : on ira d'abord à la
prière, puis à l'ouvrage. On y trouvera la force du corps : la fertilité des
champs y gagnera : tous les maux disparaîtront... Ainsi donc si, dans un même lieu, il y a trois
propriétaires, qu'ils s'entendent ensemble : s'il n'y en a qu'un, qu'il persuade
les propriétaires voisins[161]. L'insistance avec laquelle s'exprime ici saint Jean Chrysostome montre combien, dans les provinces les plus civilisées et les plus chrétiennes, les églises rurales étaient encore rares à la fin du IVe siècle. Il est surtout étrange de voir, à la même époque, la mollesse et l'oisiveté des villes répandues jusque dans les campagnes, avec la connivence des maîtres du sol, et ceux-ci bâtissant à leurs paysans des bains, des lieux d'assemblée et de plaisir, mettant, en un mot, à leur portée ce que le villicus d'Horace regrettait de ne trouver qu'à la ville. C'est un indice de ces murs païennes toujours vivantes qui semblent avoir tenté d'étouffer le travail partout où il paraissait vouloir renaître. Pour en dégager l'idée dans son austère vérité, il fallait que, dans les villes et dans les campagnes, des hommes désintéressés, devenus étrangers aux cupidités et aux vanités du monde, donnassent l'exemple d'une vie où les forcés du travail fussent, en quelque sorte, multipliées par la prière, le jeûne, la pratique d'héroïques vertus. Ce fut le rôle des moines, répandus au IVe siècle non-seulement en Égypte et en Palestine, mais en Italie, en Gaule, et dans toutes les parties du monde civilisé. Partout où ils mirent le pied, le travail fleurit, et en même temps les centres religieux qui manquaient encore dans les cantons ruraux se formèrent d'eux-mêmes autour de chacun de leurs établissements. Les deux célèbres disciples de saint Jérôme, Paula et Eustochium, décrivent ainsi l'état des campagnes voisines du monastère qu'elles habitaient : Ici, dans cette campagne du Christ, tout est simplicité, tout est silence. Où que vous alliez, le laboureur, appuyé sur sa charrue, murmure les louanges de Dieu, le moissonneur se délasse par le chant des psaumes, et le vendangeur taillant sa vigne redit quelque chose des accents de David. Ce sont les chants d'amour de ce pays, les mélodies du berger, l'accompagnement du laboureur[162]. Il se créait ainsi, aux environs des monastères, comme des oasis de travail et de foi : à mesure que la vie monastique poussait au loin ses rejetons, la lumière du Christ pénétrait plus avant dans les campagnes : elle perçait jusqu'aux ténèbres des grands bois et des forêts séculaires où, chassés des villes, les dieux du paganisme semblaient s'être réfugiés. Là où luttaient trop souvent sans succès des prêtres séculiers, peu nombreux, éloignés de leurs chefs, quelquefois attachés au sol par les liens du colonat[163], des légions de moines arrivaient, et ressuscitaient les merveilles de l'antique apostolat. On peut dire que l'évangélisation des campagnes est en grande partie leur uvre. VI Je n'écris point ici l'histoire des moines : je cherche seulement à faire comprendre la part qu'ils eurent dans la réhabilitation du travail au IVe et au Ve siècle. Il semble que l'institution monastique ait été destinée de Dieu à offrir aux hommes de chaque siècle l'image et comme l'idéal de ce qui leur manque le plus. Dans le monde moderne, où les gouvernements et les individus méconnaissent trop souvent la grande fonction sociale de la prière, les moines élèvent vers le ciel, pour tous et au nom de tous, une prière qui ne se tait ni jour ni nuit. Au IVe siècle, le travail se relevait lentement d'une oppression séculaire. : il trouvait, dans le système d'association poussé à l'excès, moins un appui qu'une entrave ; les moines opposèrent à cette nouvelle forme d'oppression l'exemple d'associations de travailleurs qu'une libre vocation avait recrutées, dont une obéissance librement consentie formait le lien, et où le travail libre régnait, véritablement. Il n'est pas surprenant qu'il ait fallu faire des lois pour empêcher les esclaves, les colons, les curiales, les membres des corporations, de chercher dans les monastères cette vie meilleure que, malgré de réels progrès, la société de leur temps ne pouvait leur offrir[164]. Les personnes vouées à la vie monastique se divisaient en deux classes, les anachorètes, qui vivaient seuls, et les cénobites, qui formaient des communautés. Les premiers étaient les moins nombreux, car, dès que leur renom de vertu avait franchi les limites du désert qu'ils habitaient, des milliers de disciples couraient se ranger sous leur règle, et ils devenaient, malgré leur résistance, fondateurs et chefs de monastères. Il en fut ainsi de saint Antoine, de saint Pacôme, de saint Hilarion : ces amants passionnés de la solitude attirèrent autour d'eux d'innombrables compagnons. A tous ils imposèrent une même loi, le travail. Lorsque vous êtes assis dans votre cellule, dit saint Antoine, que trois choses vous occupent continuellement, le travail manuel, la méditation des psaumes et la prière[165]. Dans ces monastères primitifs, qui réunissaient quelquefois jusqu'à dix mille hommes sous la conduite d'un même abbé, tous les métiers étaient exercés. Les moines de la Thébaïde, les cénobites des bords du Nil, étaient laboureurs, moissonneurs, fabricants de nattes, charpentiers, corroyeurs, tailleurs, foulons, cordonniers. Les frères du même métier, dit saint Jérôme, se réunissent dans une même maison sous l'autorité d'un préposé : par exemple, ceux qui tissent le lin sont ensemble, ceux qui font des nattes forment un même groupe, les tailleurs, les charpentiers, les foulons, les cordonniers, forment également des groupes distincts, et chaque semaine on rend compte de leur travail au père du monastère[166]. A Le produit de ces divers travaux était, suivant sa nature, consommé sur place, ou vendu sur les marchés pour subvenir aux besoins de la communauté ; celle-ci, au moyen de ces gains, nourrissait les pauvres, les étrangers, les voyageurs, dans les xenodochia attachés à chaque couvent ; quelquefois, dans les temps de disette, on voyait des navires partir des ports de l'Égypte : ils allaient porter dans des contrées désolées l'aumône de ces héroïques travailleurs qui produisaient tant et consommaient si peu[167]. Lorsque, vers le milieu du IVe siècle, la vie monastique reçut de saint Basile une forme précise et des règles uniformes, le' travail fut mis par le pieux législateur au premier rang des obligations des moines : il le préfère même au jeûne. Lui-même, avec son ami saint Grégoire de Nazianze, avait donné l'exemple de cette vie laborieuse. Qui nous rendra, lui écrivait ce dernier, ces jours où nous travaillions ensemble du matin jusqu'au soir ? où tantôt nous fendions du bois, tantôt nous taillions des pierres ? où nous plantions et arrosions nos arbres ? où nous traînions ensemble ce lourd charriot dont les marques nous sont restées aux mains ?[168] De tels exemples acquirent toute leur signification lors du grand mouvement de ferveur monastique qui éclata en Occident après la venue de saint Athanase à Rome. C'est alors qu'on vit les plus nobles dames romaines transformer leurs palais en couvents, ou se précipiter vers l'Orient sur les pas de saint Jérôme, et peupler de monastères les campagnes de la Palestine ; des sénateurs, d'anciens préfets de Rome, des hommes de la plus haute naissance, revêtir l'habit religieux et se mêler à la foule, s'associer aux pauvres, se joindre aux paysans, de princes se faire peuple[169]. Le spectacle du travail exercé par de telles mains était la plus éloquente des prédications. C'était l'époque où l'on voyait une parente de Théodose, Euphraxie, vivre en religieuse dans la Thébaïde, après avoir distribué ses biens aux pauvres, affranchi ses esclaves, et arraché ce cri à l'impératrice : Vraiment, cette fille est de race royale ! Pendant dix-huit ans elle s'assujettit volontairement aux plus humbles travaux, balayant, portant de l'eau, du bois, des pierres, cuisant le pain[170]. A peu près dans le même temps, Paula et Eustochium, les petites-filles des Scipions, nettoyaient les lampes, allumaient le feu, balayaient le pavé, épluchaient les légumes, mettaient la table dans le monastère qu'elles avaient fondé à Bethléem[171]. Quelques années plus tard, Mélanie la jeune, une petite-fille des Marcellus, copiait obscurément des manuscrits dans le monastère africain de Tagaste, tandis que son mari, ancien préfet de Rome, exerçait dans un monastère voisin le métier de jardinier[172]. L'aristocratie chrétienne se précipitait avec ardeur vers cette nouvelle vie : autrefois, dit saint Jérôme, il y avait parmi les chrétiens peu de savants, de puissants, de nobles ; aujourd'hui, beaucoup de savants, de puissants, de nobles se font moines[173]. Elle y trouvait un regain de popularité. Quand tu étais riche, écrivait le même saint à un ancien consul qui avait pris l'habit monastique, le monde ne te connaissait pas ; tu t'es fait pauvre, et l'univers entier a les yeux sur toi[174]. De tels exemples étaient le meilleur antidote aux deux maux que redoutaient le plus les premiers législateurs de la vie monastique, l'invasion parmi les religieux de l'esprit de mollesse et d'orgueil. A première vue, on s'étonne que des hommes qui avaient tout quitté pour se consacrer à Dieu aient pu en être menacés. Quelles pensées d'orgueil pourraient-ils avoir, s'écrie saint Jean Chrysostome, eux qui passent leur vie à creuser la terre, arroser, planter, tresser des corbeilles, coudre des sacs, souffrir la pauvreté, lutter avec la faim ? Chez eux l'humilité est facile. Pas d'admirateurs, pas d'applaudissements : le moine ne voit devant lui que la solitude, les oiseaux qui volent, les arbres que le vent agite, la brise qui souffle, les torrents qui coulent dans les vallées. D'où viendrait l'orgueil à cet habitant du désert ?[175] Il vint non des riches, des grands, des nobles, mais des esclaves et des petits, confondus avec eux dans l'égalité monastique. Ces derniers se laissèrent quelquefois enivrer par une vie si nouvelle pour eux : quelques-uns devinrent arrogants et superbes, d'autres refusèrent de travailler sous prétexte d'une plus grande perfection spirituelle. Saint Augustin leur fait rudement la leçon dans ce De opere monachorum que M. de Montalembert appelle l'exposé des motifs de cette loi du travail qui a fait la gloire et la force des moines[176]. Ceux, dit saint Augustin, qui ont abandonné ou distribué aux pauvres de grands biens, ou au moins certaines richesses, pour se confondre humblement parmi les pauvres du Christ... travaillent de leurs mains afin d'ôter toute excuse aux paresseux qui, d'une condition plus humble, et, par cela même, plus accoutumée au travail, viennent demander asile aux monastères : en donnant un tel exemple ils accomplissent un plus grand acte de charité que lorsqu'ils ont distribué tous leurs biens aux indigents[177]. Il ne convient pas, ajoute-t-il, que dans les monastères, où l'on voit des sénateurs se faire ouvriers, des ouvriers demeurent oisifs, que là où viennent les propriétaires du sol après avoir abandonné toutes les délices de la vie, des paysans fassent les délicats[178]. C'est ainsi que l'Église veillait à ce que le peuple n'introduisît pas dans les monastères les habitudes à oisiveté qu'il commençait à perdre dans la vie civile. Elle voulait que le moine marchât à la tête de la société laborieuse de son temps comme le premier des ouvriers, l'ouvrier du Christ, selon l'expression de saint Basile. Sa seule vue devait être une leçon. Tous les scandales devaient trouver en elle une réparation et une réponse. Saint Jean Chrysostome montre, dans une de ses homélies, un homme libre, fils d'homme libre, qui gagnait sa vie par un travail honnête, et goûtait à peine les douceurs du sommeil, scandalisé du luxe extravagant que déployaient sur le théâtre les comédiennes et les mimes, fils ou filles de cordonnier ou de boucher, quelquefois d'esclave : il entre dans un monastère : là, il voit des fils de riches, des petits-fils d'hommes d'État, portant des habits dont rougiraient les derniers des pauvres, et les portant avec joie : il admire, et s'en va consolé[179]. C'est une image des sentiments que faisait naître le spectacle de la vie monastique. Bien des préjugés, des irritations, des convoitises, s'évanouissaient à la vue de cette humanité sublime, comme parle saint Jean Chrysostome la société du IVe siècle, chrétienne de nom, sur bien des points encore païenne de fait, apprenait à mettre ses murs d'accord avec ses croyances en contemplant des hommes hier brillants par leurs richesses ou leur naissance, aujourd'hui sans vêtements, sans maisons, sans esclaves, ayant abandonné habits magnifiques, demeures splendides, domestiques innombrables, allumant eux-mêmes le feu, coupant le bois, faisant la cuisine, servant les hôtes, lavant les pieds des étrangers... et parmi lesquels le plus grand est celui qui fait les travaux les plus vils[180]. |